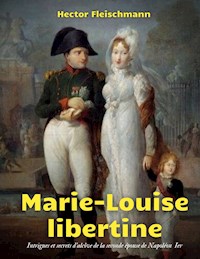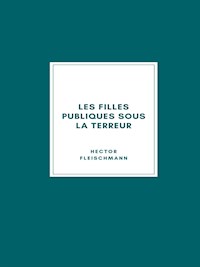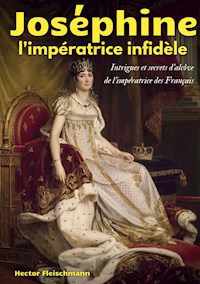
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Joséphine, l'impératrice infidèle" d'Hector Fleischmann nous plonge dans l'univers fascinant et complexe de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte. Ce livre explore les intrigues et les secrets d'alcôve de l'impératrice des Français, révélant une femme à la fois aimante et calculatrice, dont les relations extraconjugales et les manoeuvres politiques ont marqué l'histoire de France. À travers une narration riche et documentée, Fleischmann dépeint Joséphine comme une figure incontournable de son temps, naviguant avec habileté entre les exigences de la cour et ses aspirations personnelles. Le livre s'attarde sur les aspects moins connus de sa vie, offrant une perspective inédite sur ses motivations et ses choix. Ce portrait nuancé met en lumière les tensions entre devoirs conjugaux et ambitions personnelles, tout en soulignant l'influence durable de Joséphine sur l'Empire. À la croisée de l'histoire et de l'intime, cette oeuvre invite le lecteur à redécouvrir une personnalité complexe, dont le charme et l'intelligence ont su conquérir un des plus grands conquérants de l'histoire. L'AUTEUR : Hector Fleischmann, historien et écrivain français, est reconnu pour ses travaux sur l'époque napoléonienne et les figures marquantes de cette période. Bien que peu d'informations personnelles soient disponibles sur Fleischmann, ses oeuvres témoignent d'une rigueur historique et d'une passion pour les détails qui font revivre le passé avec une précision captivante. Il a su se démarquer par sa capacité à rendre accessible des sujets historiques complexes, alliant érudition et narration fluide. Ses recherches approfondies et son style d'écriture engageant lui ont permis de se faire une place parmi les auteurs spécialisés dans l'histoire de France. À travers ses livres, Fleischmann s'attache à dévoiler les facettes cachées des personnages historiques, offrant aux lecteurs une compréhension plus profonde de leur impact sur l'histoire. Son intérêt pour les figures féminines de l'Empire, telles que Joséphine de Beauharnais, illustre sa volonté de mettre en lumière des perspectives souvent négligées dans les récits traditionnels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
PAGE DE TITRE
AVANT-PROPOS
A CRÉOLE MAQUIGNONNÉE
L’AUTRE TANTE, OU LA SENSIBLE FANNY
L’ARISTOCRATE QUI GRAISSE LA GUILLOTINE
JOSÉPHINE SUSPECTE
HOCHE ET SON PALERFRENIER
UN MAUVAIS LIEU, SON TENANCIER ET SES COMMENSALES
« LE SABRE DE MON PERE »
DANS SES MEUBLES
LA « VIEILLE » ET SON JEUNE MARI
NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
LES SOIREES AMOUREUSES DE MALMAISON
LIQUIDATION DES COMPTES
« TOUT CE QUI EST NOBLE ET DÉLICAT NE LUI EST JAMAIS ÉTRANGER »
LE CHANTAGE DU SACRE
LES CHIFFONS ET LEURS NOTES
COLLABORATION DE NAPOLÉON A LA LÉGENDE
POUR RÉPARER DES ANS ET DU PASSÉ
...
JOSÉPHINE DIVORCÉE OU RÉPUDIÉE
POUR CONSOLER LA CRÉOLE
L'EXIL DE MALMAISON
L'ENVERS DE LA LÉGENDE
POLITESSES COSAQUES ET SOURIRES FRANÇAIS
« Cette femme, qu’il a faite la première de France..., cette femme, soudain promue par cette rencontre, des angoisses d’une galanterie besogneuse à la sécurité de la plus glorieuse fortune, dès qu'elle rencontre un soldat vigoureux qui lui fait la cour, ou un calembouriste râblé qui la distrait, se donne et se livre. »
FREDERIC MASSON, Conférence, 1908.
* * *
AVANT-PROPOS
Voici le second livre de l’enquête entreprise par nous sur le rôle de l’amour chez Napoléon et ses deux femmes.
La première partie de cette œuvre a été accueillie par diverses objections, auxquelles nous répondrons quand nous aurons livré au public toutes les pièces du dossier. Nous ne demandons qu’à être jugé sur l’ensemble de nos recherches. Ce deuxième livre complète, en effet, le premier. Il en continue l’exposé et confirme, par des faits, ce que forcément nous avons dû abandonner précédemment au domaine de la théorie.
Ce que fut l’adultère chez Napoléon, quelle fut sa part dans cette vie orageuse et passionnée, nous pensons l’avoir dit assez clairement. Ici on en trouvera la cause première. Logiquement, ce livre aurait dû précéder le premier, l’effet succédant à l’objet, mais dès sa première rencontre avec Joséphine, Bonaparte l’éclipse au point que c’est à lui que va d’abord l’attention. Et puis, c’est le mari, l’homme de cette femme-ci, et de l’autre, l’Autrichienne, dont nous aurons à nous occuper plus tard. Dès lors, exposer le rôle de l’adultère chez Napoléon, c’était commencer par mettre en lumière les pièces du procès, les arguments de l’accusation d’immoralité portée contre lui. Ne fallait-il point, d’abord, écouter le réquisitoire et dire : Voilà ce que cet homme a fait Et, ce réquisitoire entendu, pouvoir répondre : Voici pourquoi il l’a fait. C’est ce que nous avons pensé. De là, Joséphine cédant le pas à Napoléon, et, d’accusatrice, devenant accusée. Accusatrice ? Sans doute, car sans elle, dit M. Frédéric Masson, « on ignorerait la plupart de ces anecdotes : c’est elle qui les découvre, qui les conte, qui les rabâche, au besoin qui les invente, car nulle n’est menteuse comme elle ». Ces anecdotes de Napoléon, on les connaît, elle forme l’objet de notre précédent ouvrage. N’est-il pas juste de conter maintenant les anecdotes de Joséphine ? Si elles sont un peu moins édifiantes que les premières, à qui s’en prendre, sinon à elle-même ? Tout réquisitoire implique, appelle et impose une défense. Joséphine se douta-t-elle jamais que sa vie amoureuse, à elle, plaiderait en faveur de celle de Bonaparte ?
Sans doute, c’est, avant d’être l’Impératrice, la compagne de celui que Hegel salue du titre de « grand ouvrier du Destin », la souveraine sacrée et couronnée, c’est, avant tout cela, une femme. Mais ce n’est pas une excuse suffisante. A ce titre, peut-être, lui doit-on quelque respect, mais si cela devait être un dogme, une règle, une obligation consentie, un article de foi accepté, il deviendrait assurément périlleux d’écrire la vie de Catherine de Médicis, et on se verrait forcé de passer sous silence le règne de Marie Antoinette. Mais on l’a dit fort bien : « Ici, plus de vie privée, plus de pudeur féminine, plus de respect : ce n’est plus une femme, c’est un personnage d’histoire et l’Histoire a pour base nécessaire la vérité intégrale sur les êtres qui relèvent d’elle1. » Ceci est fort bien pensé, mais toujours assez mal exécuté. On a une excuse : le manque de sources probantes. Joséphine bénéficie de ces circonstances atténuantes.
Mais quelles sources ne sont point suspectes à quelque titre ?
Certes, aucune d’elles ne peut être admise sans contrôle rigoureux, mais ce contrôle, même sévère, peut-il faire qu’elles ne soient point viciées ? Sur toutes, la suspicion est naturelle et légitime. D’abord les femmes. De Mme de Rémusat, on sait ce qu’il faut penser. Pour elle, née de Vergennes, aristocrate, Napoléon n’est qu’un parvenu. Si, parmi toutes, elle et son mari, sont comblés et favorisés, c’est que la chose leur est due, naturellement. Dès lors ce qu'elle peut dire des Napoléonides doit être tenu pour l’expression de ses sentiments de rancune et d’aigreur hérissée. Suspecte encore Mme d’Abrantès, non parce qu’elle tire argent de ses souvenirs et bat monnaie du grand nom du Maître, mais bien parce qu'elle est une obligée, et qu’elle ne veut point s’en souvenir. Et puis elle a connu Bonaparte pauvre, elle l’a vu venir, sans le sol, et crotté, dîner chez sa mère. Il suffit. Pour les autres, les motifs, s’ils sont plus variés, n’en sont pas moins significatifs. Mme de Vaudey a été la maîtresse de l’Empereur. Il s’en est séparé assez rudement, – tout en conservant des « formes » à la rupture. Les Souvenirs de la dame tâcheront à faire arriver à la postérité l’écho de son ressentiment. Pour elle, c’est affaire de haine ; pour la nièce de Mme de Genlis, cette Mme de Genlis qui déclarait « que les rois n’ont aucun usage du monde », pour cette Georgette Ducrest, dont le recueil d’anecdotes fait encore des dupes, c’est affaire de besoin. Sous le second Empire, son livre lui sera un titre à réclamer la place de chanteuse de la chambre de l’Impératrice, pour sa fille2. Et ainsi du reste.
Quant aux hommes, même suspicion, et plus motivée encore. Barras calomnie, oui, mais il n’a pas été le premier à le faire. C’est une explication. Marmont n'a besoin que de ses lettres privées pour être jugé. « J’ai servi Bonaparte, écrit-il, tant que ses destinées ont été liées à celles de la France ; depuis plusieurs années, je ne me dissimulais ni l’injustice de ses entreprises, ni l’extravagance de ses projets, ni son ambition, ni ses crimes3. » On sait comment il a parlé de cet ambitieux et de ce criminel qui fit pour lui ce qu’il ne fit pour aucun de ses maréchaux. Mais, dans l’exil gantois de 1815, M. de Raguse ne pensait pas que la mémoire de Napoléon pût relever de la postérité. Suspect encore Bourienne, tripoteur jusque dans le cabinet du Premier Consul - suspect aussi Constant, parce que ce n’est qu’un valet - suspect le baron Thiébault, parce qu’il « n’aime pas l’Empereur4 (il l’a écrit) ; suspect Montgaillard, parce que ce n’est qu’un espion5 ; tous sont suspects parce que ce sont des obligés qui ne se croient point tenus à la gratitude de la vérité.
Ainsi se révèle ce qui vicie les sources auxquelles ont est forcé de recourir. Mais il ne s’ensuit pas que toutes doivent être délibérément écartées. Nous y ferons appel souvent, et le lecteur comprendra-t-il alors pourquoi ce ne sera que sous toutes réserves malgré le bénéfice d’inventaire et le contrôle ? Joséphine, naturellement, suivant la galante expression de M. de Vogüé, sort de là « avariée », mais on peut croire qu'elle y a mis quelque peu du sien, et qu'elle s’est chargée de semer les mauvaises – et vilaines – plantes, qu’on a aujourd’hui à récolter.
Mais mieux encore. Par-là elle-même se charge, par ses paroles, par ses gestes, par ses aventures, de battre en brèche la légende qui en fait la « bonne », la « tendre », la « douce » Joséphine, l’ange gardien de l’Empereur., son porte-bonheur, et incite les âmes sensibles à s’attendrir sur les « petites secousses » de cette femme excitée. Son auréole de sainte laïque et politique, qui d’autre la dédore, sinon elle-même ? Mieux que Marie-Antoinette, contre laquelle les plus sévères et les plus accablantes accusations sont portées par sa mère, par Marie-Thérèse elle-même6, Joséphine n’a besoin que d’elle-même pour s’accuser. Sa race et son caractère déposent contre elle. Infidèle, elle l’est, parce qu'elle est créole, parce que c’est son instinct, son besoin, son appétit sexuel et son tempérament. Infidèle, elle l’est comme elle est menteuse, inconsciemment voudrait-on croire, involontairement pourrait-on dire. Si vous récusez en sa faveur la loi de l’hérédité, le levain atavique, rien ne s’explique. Si vous l’admettez, au contraire, tout devient clair et on conçoit alors comment M. Charles peut devenir l’Hippolyte de cette Phèdre un peu avariée.
C’est là la raison pour laquelle Joséphine doit être prise dès son enfance (car elle est pubère vers dix ou douze ans), dès l’heure de son éveil à l’amour. On comprendra pourquoi, après son mariage avec Beauharnais, elle ne pouvait être autrement qu’elle ne fut, et pourquoi, infidèle au premier mari, elle le fut tout naturellement au second. Peut-on lui en faire un grief sérieux, l’accabler de cette accusation et la vouer à ce titre à une exécration qu’une archiduchesse d’Autriche se chargera, dès 1814, d’assumer devant la postérité ? On ne le pense pas. Joséphine n’est point d’une intelligence hors ligne, quelqu’un même dit le mot crûment : « bette et sotte », elle ne devine point sous Bonaparte le futur Napoléon. Elle a trompé l’Empereur, soit ; mais elle l’a trompé anticipativement et sans le savoir. La première de ces fautes, on la lui peut pardonner. Son mari n’est point encore l’homme d’Arcole. Mais après ? Après Rivoli, après Mantoue, protégée en mémoire de Virgile, après le passage, éclaboussé de sang et de gloire, du Tagliamento, après Gradisca et Tarvis, après ces poudreux lauriers cueillis par une jeune main dans les champs, après tout ce triomphe qui la sacre Notre-Dame des Victoires, comment expliquer, excuser ou pardonner? Pourtant, Bonaparte pardonne, lui. C’est pourquoi on l’appelle un mauvais mari et le tyran jaloux et ombrageux d’une femme, un peu moins à la mode que la Tallien, parce qu’elle commence à se faner.
Joséphine infidèle fait aimer Napoléon. Sa tendresse pour la créole fait comprendre ce qu’il y eut chez lui de fougueusement, de juvénilement amoureux. Par-là l’enquête sur son caractère se complète. Avec l’étude du rôle de Marie-Louise nous pensons l’achever. C’est par l’ensemble de ces trois volumes que nous voudrions pouvoir fixer des avis indécis et des opinions hésitantes. Napoléon, – et nous l’espérons d’eux, – ne sortira pas diminué de ces ouvrages qui se veulent violemment partiaux, parce qu’il s’agit de sa gloire, et que la seule acception de la médiocrité consentie peut se targuer de cette impartialité fictive, sous le prétexte de laquelle on fausse l’histoire des Napoléonides, depuis le jour où ils sont nés à l’immortalité de leur gloire.
H.E
1 FRÉDÉRIC MASSON, Joséphine de Beauhamais., 1763-1796 Paris, in-8, p. 4. Édit. de 1899.
2 Lettre autographe signée ; 23 mai 1856, 2 pages et demie in-folio. Catalogue Noël Charavay, n° 355, mars, 1906. Cette lettre, n° 56404, était offerte au prix de 8 francs.
3 Copie contemporaine d’une lettre du maréchal Marmont à Caulaincourt, duc de Vicence. Gand, 1er avril 1815 ; 3 pages et demie in-4. Catalogue d’autographes Eugène Charavay, mai 1892. Lettre offerte à 10 francs.
4 Lettre autographe signée : Tours, mars 1816 ; 6 pages in-folio. Catalogue d’autographe Eugène Charavay, janvier 1894. Lettre offerte à 20 francs.
5 En doute-t-on Qu’on lise cet ordre envoyé de Fontainebleau, le 5 octobre 1813, par l’Empereur à Savary, ministre de la Police générale : « Faites payer les 13.000 francs pour lesquels le sieur Montgaillard est détenu, afin qu’il puisse être mis en liberté. Vous imputerez cela sur les fonds de la police. » Archives nationales, A F, IV, 886. – Lettres inédites de Napoléon 1er, publiées par LÉONCE DE BROTONNE. Nouvelle Revue, 15 août 1896, t. CVII.
6 C.f. notre ouvrage, les Pamphlets libertins contre Marie-Antoinette ; Paris, 1909 in-18, passim.
L’OISEAU DES ÎLES
LA CRÉOLE MAQUIGNONNÉE
Vers la fin du dix-huitième siècle, la rue Thévenot était, dans le quartier Saint-Denis, ce que sont aujourd’hui encore ces petites rues étroites et noires, où tombe un avare soleil entre de hautes constructions hostiles, massives, lugubres. Alors, cependant, c’était une voie assez fréquentée, où débouchait la rue des Deux-Portes (aujourd’hui rue Dussoubs), au coin de laquelle une illustre maquerelle de l’époque, Mme Gourdan, avait ouvert une hospitalière maison. Par la rue Gratte-Cul, « dénomination due à de vilaines mœurs », les équipages débouchaient, menant gentilhommes et gens de robe sacrée, car Mme Gourdan avait une clientèle variée1. Le spectacle de ces arrivées, des petites scènes quelquefois piquantes auxquelles elles donnaient lieu, c’était là le seul agrément de cette partie du vieux Paris où, aujourd’hui encore, planent les ombres libertines de ce galant passé.
C'est là que, vers la mi-décembre 1779, vint s’installer, mariée du 13, la vicomtesse Alexandre de Beauharnais, née Marie-Joseph-Rose de Tascher de la Pagerie.
Vingt-cinq ans plus tard, cette jeune mariée de seize ans était sacrée Impératrice des Français dans une Notre-Dame sonore d’acclamations, et pleine de l’écho des bourbons et de l’aboi des bronzes guerriers.
* * *
Elle était née, le 23 juin 1763, à la Martinique, de Joseph-Gaspard de Tascher de la Pagerie, chevalier de Saint-Lazare, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, et de Rose-Claire des Vergers de Sannois.
Les Tascher, originaires de Châteauneuf-en-Thymerays, près de Blois, étaient établis à la Martinique depuis 1726. Montgaillard conteste leur noblesse et raille leurs prétentions au blason. « Toutes les familles créoles ont cette prétention, dit-il, qui est, du reste, sans conséquence dans les Antilles2. » Sans conséquence ou non, la prétention des Tascher était fondée. D’Hozier leur concède de fort beaux certificats où on les voit alliés aux Plessis de Savonnières, aux Bodin de Boisrenard, aux d’Arnoul de Malchem, aux Ronsard de Glatigny, aux Racine de Forgirard, et à bien d’autres encore, et de non moins fameux dans la robe ou l’épée.
En 1674, il signale un François de Tascher comme commandant de la noblesse du bailliage de Blois. Plus tard, on voit figurer, en belle place, la famille, titres et blasons en tête, dans l’État de la Fiancé3, et elle porte « d’argent, à trois bandes de gueules, chargées chacune de quatre sautoirs d argent4 ».
A la Martinique Joseph-Gaspard est allé chercher fortune, et il semble bien que la chose ne lui ait guère réussi, quoi qu’on en ait dit. S’il a vingt nègres, il a quelque peu plus de dettes et de passions. Il joue et fait des enfants à des négresses, ce qui vaudra plus tard, à sa fille, devenue impératrice, le désavantage, d’avoir à reconnaître, comme sœur naturelle, une mulâtresse5. Il ne marche, dit-on, que l’épée au côté et la canne à la main6. C’est possible, mais on le voit souventes fois en de moins nobles postures. Au reste, ce n’est qu’un besogneux. Le destin lui jouera le mauvais tour de le faire mourir avant de pouvoir remettre ses affaires à flot par l’avènement de sa fille au trône de France. De fait, il en serait peut-être mort d’étonnement.
Joséphine, qu ’on appelle alors Yeyette, ce qui est une familiarité créole, est un peu élevée à la diable. On dira plus tard qu’elle ne sait que chanter et danser. D’ailleurs elle danse mal. C’est parce qu’elle n’a eu qu’un « mauvais maître »7. On est d’accord pour reconnaître qu’alors elle n’avait rien de ce qui lui captiva un jour les désirs de Barras et les fureurs passionnées de Bonaparte. « Plus séduisante que jolie », dit quelqu’un8. En réalité, ce qu’elle a, et aura toujours, pour elle, c’est la grâce créole, alanguie, molle et abandonnée, la souplesse paresseuse des gestes et de brusques et charmantes vivacités.
Elle s’harmonise à merveille à ces beaux paysages tropicaux, comme une plante rare que complète le vase délicat et fragile où elle se penche, humide et chaude. C’est l’oiseau des Iles, la petite bête frivole, légère, capricieuse et amoureuse faite pour ces lieux de tiède langueur qu’évoquera Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie. Ces paysages brûlés de soleils rouges, pavoisés de bouquets de palmes, zèbrés en vifs éclairs coloriés des mille oiseaux des îles chaudes, ce sont les cadres où Joséphine dessine ses premières grâces, dont elle emportera avec elle la molle ardeur, le parfum et l’éclat. S’ils sont faits pour elle, elle est faite pour eux. En France, elle ne sera qu’une exilée. Comment, dans un pareil terrain, préparé, dirait-on, pour elle, la légende de Joséphine ne fleurirait-elle pas ?
Heureuse, elle l’est incontestablement. La volupté quiète du bonheur lui est une habitude. Elle règne sur les négresses de la plantation, elle a une nourrice qui, comme toutes les nourrices de sa race, lui vaut mieux et plus qu’une mère9. Ces petits bonheurs-là, minimes et éparpillés, l’Empire les fera regretter à Joséphine. C’est qu’ici elle règne dans la terre qui est sienne, qui l'a formée. En France, elle ne sera qu’une Virginie regrettant ses pamplemoussiers en fleurs et les vérandas où des nègres fidèles éventent, en les berçant dans leurs hamacs, les belles créoles indolentes.
Sous ce climat équatorial, dans cette liberté de vie affranchie des règles de l’éducation de vie européenne, l’éveil des sens est naturellement rapide. Á treize ans, à l’époque où la rencontre de Montgaillard, on la déclare « amoureuse comme une colombe », et, de plus, d’une légèreté, « à étonner même dans les colonies 10 ». Montgaillard n’est pas le seul à s’en apercevoir. On donne à cette date comme amants à Joséphine, le capitaine Tercier11, et un Anglais qui semble bien romanesque pour avoir jamais existé. Dans ces confidences, la vantardise, l’orgueil et la vanité ont, sans doute, une large part. Mais cela, ce sont des Européens. Barras lui attribue mieux et plus. « On racontait même, dit-il, que les infidélités de la créole avaient passé la mesure des convenances, et que, supérieure au préjugé de la couleur foncée de la peau, elle aurait eu des rapports avec des nègres 12 ». Écrivant cela, Barras attribuait à Joséphine ce qui avait été le fait de plusieurs femmes blanches, à Saint-Domingue, lors de l’expédition de 1801. Plus tard, Pauline Bonaparte a été à son tour accusée de la chose. Ce qui est certain, c’est que Barras n’inventait rien. Donnant, en 1802, des instructions à ses subordonnés, Leclerc, commandant en chef de l’expédition de Saint-Domingue, écrivait : « Les femmes blanches qui se sont prostituées aux nègres, quel que soit leur rang, seront renvoyées en France. » Ce qui se passait à Haïti pouvait bien, n’est-ce pas, se passer à la Martinique ? D’ailleurs que risquait Barras ? Au moins, ne se montrait-il pas jaloux de ses prédécesseurs.
Que Joséphine, à cette époque, ait été légère et se soit compromise, cela semble peu douteux. Plus tard, Alexandre de Beauharnais recueillera sur elle, à la Martinique, mieux que des bruits, des faits, qui serviront de motif à la rupture avec Joséphine. Ce mariage, qui ne connaîtra même pas de lune de miel, et durera un peu moins de cinq ans, s’est fait dans des conditions singulières.
Le père d’Alexandre, le marquis François de Beauharnais, chef d’escadre des armées navales, descendant de ce marquis de Beauharnais qui, pour le compte du Roi de France, gouvernait le Canada, en 1726, et de cet autre qu’on trouve intendant de la marine à Rochefort, en 1710 13, est arrivé dans la colonie, le 13 mai 1757, comme gouverneur de la Martinique et des Iles du Vent. Avec lui il a amené sa femme, Marie-Anne-Henriette Pivart de Chastelet. Entre Européens, dans l’exil tropical, des relations s’établissent rapidement. M. de Beauharnais les pousse au point de devenir l’amant d’une tante de Joséphine, Marie-Euphémie-Désirée, mariée à un sieur Renaudin. Cela transpire à peine, puisque ce n’est que trois ans plus tard, que la marquise de Beauharnais apprendra la trahison de son mari. Mais la Renaudin a à ce point acquis de l’influence sur le gouverneur que, en 1761, quand il quitte son poste, elle l’accompagne en France. Il est vrai que la marquise est, elle aussi, du voyage. Quand, à Paris, elle connaît les dessous de l’affaire, elle en prend fort dignement son parti et se retire chez sa mère, à Blois. Cela lui permet de mourir en paix, six ans plus tard, le 5 octobre 1767.
Elle laisse deux fils, François et Alexandre. Le premier sera ce royaliste fervent, opposé à toute atteinte à la prérogative royale, qui méritera à l’Assemblée Nationale, d’être appelé le féal Beauharnais sans amendement14, sera mêlé à la fuite de Louis XVI, émigrera, sera, en 1805, ambassadeur en Étrurie, et, sans nul respect pour sa parenté avec l’Empereur, conspirera avec les Bourbons sous l’Empire. L’autre, Alexandre, est né à la Martinique, le 28 mai 1760, pendant le séjour du gouverneur.
Entre les mains de Mme Renaudin, cette tante Cardinal de l’ancien régime, il sera l’instrument dont elle usera pour retenir auprès d’elle le marquis. De là la combinaison du mariage entre deux enfants dont l’un a seize et l’autre dix-neuf ans. D’abord, on avait songé à faire épouser à Alexandre, la sœur cadette de Joséphine, Marie-Françoise, née le 3 septembre 1766 ; puis, Catherine-Marie-Désirée, née le 11 décembre 1764 ; et comme la plus jeune mourut et que la seconde fut retenue par la mère, ce fut Joséphine qui fut choisie. Au surplus, peu importait laquelle dut être mariée. Mme Renaudin n’y regardait pas de si près. Une fille, n’importe laquelle, une Tascher, c’est tout ce qu’elle demandait. Elle l’eut. Le 20 octobre 1779, elle la cueillait au quai de Bordeaux 15. Le 13 décembre, à Noisy-le-Grand, en catimini, avec deux bénédictions et trois oraisons, on dépêchait le mariage. Aussi bien, ne s’agissait-il pas dans tout cela, pour Mme Renaudin, d’assurer sa position auprès de M. de Beauharnais père ? Elle en fut à ce point certaine qu'elle en escompta par avance son crédit. Elle dota sa nièce et lui paya un trousseau de 20.672 livres. La petite créole en avait bien besoin. Entre honnêtes gens, cela s’appelle un maquignonnage. Entre les gens de moins bon ton, on apprécie plus sévèrement ces petits détails.
Ce que pouvait être un mariage fait dans de telles conditions, à peine est-il besoin de le dire.
Alexandre, alors capitaine au régiment de la Sarre, était déjà ce qu'il demeura sa vie entière : léger, frivole, dissipé. Un almanach politique de 1791 qui évaluait les députés et estimait l'abbé Maury, une pipe et trois louis dix sols ; Mirabeau cadet, un tonneau de vin ; évaluait Alexandre de Beauharnais, une femme aimable16. Aimable, il est certain qu’il le fut toujours, même dans les moments les plus périlleux de sa vie. Cela lui valut les plus tendres conquêtes. On n’hésite donc pas à déclarer qu’il « obtint à la cour de Versailles tous les succès que pouvaient y donner les talents les plus aimables17. » La ville, de son côté, ne lui refusa rien sur ce terrain. Mais au début, de son mariage, il s’imagina de faire le sérieux et de fonder une famille. Mme Renaudin ne demandait pas mieux. Le 3 septembre 1780, Joséphine accouchait d’un fils : Eugène. Beauharnais, dans ce temps, courait les garnisons, et aussi les filles. Il rêvait des lauriers guerriers et faute de champ propice pour les cueillir, il s’embarquait, le 26 septembre 1782, comme volontaire, pour aller porter l’épée aux Iles. En novembre suivant il touchait terre à la Martinique. Cinq mois après, le 10 avril 1783, sa femme lui donnait un second enfant, une fille cette fois : Hortense18. Elle habitait alors rue de la Pépinière.
Beauharnais, à la Martinique, fut accueilli avec circonspection par des beaux-parents qui avaient le tort d’attendre moins de frivolité chez ce jeune étourneau.
Il en prit de l’humeur, et une jeune personne se trouva là à point pour le consoler, et l’initier à certaines historiettes où la Renaudin et la Joséphine jouaient des rôles peut-être divers, mais assurément piquants. Dans ces historiettes que pouvait-il y avoir de vrai. On l’ignore exactement, mais, par ce que disent Montgaillard et Tercier, on en peut deviner le fond. Alexandre se choqua vraisemblablement de les apprendre un peu trop tard, et à ses dépens, car il se montra irrité au point d ’en écrire vivement et vertement à Joséphine. C ’est un document curieux que cette lettre, et qui mérite d’être rapporté en contribution à la jeunesse amoureuse de la créole :
Si je vous avais écrit dans le premier moment de ma rage, ma plume aurait brûlé le papier et vous auriez cru, en entendant toutes mes invectives, que c’était un moment d’humeur ou de jalousie que j’avais pris pour vous écrire ; mais il y a trois semaines et plus que je sais, au moins en partie, ce que je vais vous apprendre. Malgré donc le désespoir de mon âme, malgré la fureur qui me suffoque, je saurai me contenir ; je saurai vous dire froidement que vous êtes à mes yeux la plus vile des créatures, que mon séjour, dans ces pays-ci, m’a appris l’abominable conduite que vous y avez tenue, que je sais, dans les plus grands détails, votre intrigue avec M. de Be..., officier du régiment de la Martinique, ensuite celle avec M. d’H..., embarqué à bord du César, que je n’ignore ni les moyens que vous avez pris pour vous satisfaire, ni les gens que vous avez employés pour vous en procurer la facilité ; que Brigitte n’a eu sa liberté que pour l’engager au silence, que Louis, qui est mort depuis, était aussi dans la confidence ; je sais enfin le contenu de vos lettres et je vous apporterai avec moi un des présents que vous avez faits. Il n’est donc plus temps de feindre et, puisque je n’ignore aucun détail, il ne vous reste plus qu’un parti à prendre, c’est celui de la bonne foi. Quant au repentir je ne vous en demande pas, vous en êtes incapable ; un être qui a pu, lors des préparatifs pour son départ, recevoir un amant dans ses bras, alors qu’elle sait qu’elle est destinée à un autre, n’a point d’âme : elle est au-dessous de toutes les coquines de la terre. Ayant pu avoir la hardiesse de compter sur le sommeil de sa mère et de sa grand-mère, il n’est point étonnant que vous ayez su tromper votre père à Saint-Domingue. Je leur rends justice à tous et ne vois que vous seule de coupable. Vous seule avez pu abuser une famille entière et porter l’opprobre et l’ignominie dans une famille étrangère dont vous étiez indigne. Après tant de forfaits et d’atrocités, que penser des nuages, des contestations survenues dans notre ménage Que pensez de ce dernier enfant survenu après huit mois et quelques jours de mon retour d’Italie19. Je suis forcé de le prendre, mais j’en jure par le ciel qui m’éclaire, il est d’un autre, c’est un sang étranger qui coule dans ses veines ! Il ignorera toujours ma honte, et, j’en fois encore le serment, il ne s’apercevra jamais, ni dans les soins de son éducation, ni dans ceux de son établissement, qu’il doit le jour à un adultère ; mais vous sentez combien je dois éviter un pareil malheur pour l’avenir. Prenez donc vos arrangements : jamais, jamais, je ne me mettrai dans le cas d’être encore abusé, et, comme vous seriez une femme à en imposer au public si nous habitions sous le même toit, ayez la bonté de vous rendre au couvent, sitôt ma lettre reçue ; c’est mon dernier mot, et rien dans la nature entière n’est capable de me faire revenir. J’irai vous y voir à mon arrivée à Paris, une fois seulement ; je veux avoir une conversation avec vous et vous remettre quelque chose. Mais, je vous le répète, point de larmes, point de protestations. Je suis déjà armé contre tous vos efforts, et mes soins seront tous employés à m’armer davantage contre de vils serments aussi faux et aussi méprisables que faux. Malgré toutes les invectives que votre fureur va répandre sur mon compte, vous me connaissez, Madame, vous savez que je suis bon, sensible, et je sais que, dans l’intérieur de votre cœur, vous me rendrez justice. Vous persisterez à nier, parce que, dès votre plus bas âge, vous vous êtes fait de la fausseté une habitude, mais vous n’en serez pas moins intérieurement convaincue que vous n’avez que ce vous méritez. Vous ignorez probablement les moyens que j’ai pris pour dévoiler tant d’horreurs, et je ne les dirai qu’à mon père et à votre tante. Il vous suffira de sentir que les hommes sont bien indiscrets, à plus forte raison quand ils ont sujet de se plaindre : d’ailleurs, vous avez écrit ; d’ailleurs, vous avez sacrifié des lettres de M. de Be... à celui qui lui a succédé ; ensuite vous avez employé des gens de couleur, qu’à prix d’argent on rend indiscrets. Regardez donc la honte dont vous et moi, ainsi que vos enfants, allons être couverts, comme un châtiment du ciel que vous avez mérité, et qui me doit obtenir votre pitié et celui de toutes les âmes honnêtes.
Adieu, Madame, je vous écrirai par duplicata et l’une et l’autre seront les dernières lettres que vous recevrez de votre désespéré et infortuné mari.
RS. — Je pars aujourd’hui pour Saint-Dominique et je compte être à Paris en septembre ou octobre, si ma santé ne succombe pas à la fatigue d’un voyage, jointe à un état si affreux. Je pense qu’après cette lettre je ne vous trouverai pas chez moi et je dois vous prévenir que vous me trouveriez un tyran si vous ne suiviez pas ponctuellement ce que je vous ai dit20.
Cette lettre n’est pas que de la littérature. Visiblement, Beauharnais a d’autres motifs de rupture, mais de là il ne s’ensuit pas que ses accusations doivent être écartées délibérément. Quand il présume que Joséphine niera, et quand il la déclare menteuse par nature, exagère-t-il Non, sans doute, car l’avenir lui donnera, sur ce point, raison. Seulement, ce sera Bonaparte qui, à son détriment, en fera la constatation. Cette scène de larmes, que Beauharnais redoute et veut éviter, Joséphine ne la jouera-t-elle pas en l’an VIII, au retour de Bonaparte d’Egypte ? Mais cela, c’est du futur. Pour l’instant, Beauharnais cite des faits et des noms. Il ne dissimule point qu’il tient ses renseignements des amants eux-mêmes et des intermédiaires de la liaison, ces nègres que Barras met au compte de la créole. Mais M. Masson est presque tenté de lui en faire grief. D’où voulez-vous donc qu’il les tirât ? de la famille de Joséphine, elle-même ? On ne saurait raisonnablement le soutenir. Cependant, le fait que Beauharnais se soit trouvé le premier à formuler ces accusations, ne permet-il pas de suspecter, un peu moins qu’on ne le fait, les témoignages de Montgaillard et de Tercier ? S’ils ont menti, ils ont menti en bonne compagnie.
Alexandre, qui annonçait son retour pour septembre ou octobre, ne débarqua qu’en octobre, dans les premiers jours du mois, vraisemblablement, car, à la date du 20, on trouve, datée de Châtellerault, une nouvelle lettre de lui à Joséphine :
J’ai appris avec étonnement en arrivant en France, écrit-il, par les lettres de mon père, que vous n’étiez pas encore dans un couvent, ainsi que je vous en avais témoigné la volonté par ma lettre datée de la Martinique. J’imagine que vous avez voulu attendre mon arrivée pour vous soumettre à cette nécessité, et que ce retard ne doit pas être considéré comme un refus. En vous écrivant au mois de juillet dernier, j’avais déjà fait toutes mes réflexions, et mon parti était décidément pris. Vous sentez que ce n’est pas une fièvre inflammatoire et putride que j’ai eue, occasionnée par l’excès de ma douleur, qui aura pu me faire changer d’avis, non plus que les rechutes continuelles durant quatre mois pendant lesquels j’ai été entre la vie et la mort, non plus que l’entier dérangement de ma santé qui me fait craindre de ne la jamais bien rétablir. Je suis inébranlable dans le parti que j’ai pris, et je vous engage même à dire à mon père et à votre tante que leurs efforts seront inutiles et ne pourront tendre qu’à ajouter à mes maux, tant au moral qu’au physique, en mettant ma sensibilité en jeu et me mettant dans l’obligation de contrarier leurs désirs. Quant à nous, ceci soit dit sans fiel, sans humeur, pouvons-nous habiter ensemble après ce que j’ai appris ? Vous seriez tout aussi malheureuse que moi par l’image perpétuelle de vos torts que vous sauriez être connus de moi. Et, quand même vous seriez incapable d’un remords, l’idée que votre mari aurait acquis des droits à vous mépriser, ne serait-elle pas tout au moins humiliante pour votre amour-propre ? Prenez donc, croyez-moi, le parti le plus doux, celui d’acquiescer à mes désirs, et préférez, dans cette cruelle position, la certitude de ne point éprouver de mauvais procédés de ma part à l’obligation dans laquelle vous me mettriez d’en mal agir et d’user sévèrement avec vous si vous ne vous soumettiez pas à ce que j’exige. Je ne vois cependant aucun inconvénient, si vous désirez retourner en Amérique, à vous laisser prendre ce parti-là, et vous pouvez opter entre le retour dans votre famille et le couvent à Paris. Comme j’espère faire en cinq ou six jours les soixante-dix lieues qui me séparent encore de la capitale et, qu’une fois rendu, j’aurai besoin de me promener en voiture pour me distraire et suppléer à la faiblesse de mes jambes, vous m’obligerez d’envoyer à Paris mes chevaux et ma voiture pour dimanche prochain 26 du courant. Si Euphémie veut profiter de cette occasion pour y amener Eugène, j’en serai très reconnaissant, et je lui devrai un plaisir, et il y a bien longtemps que je n’en ai goûté...
Vous ne trouverez dans ma lettre aucuns reproches et combien cependant ne serais-je pas en droit d’en faire, mais à quoi serviraient-ils. Ils ne détruiraient pas ce qui a existé, ils n’auraient pas même le pouvoir de vous rendre vraie ! Ainsi, je me tais. Adieu, Madame ; si je pouvais déposer ici mon âme, vous la verriez ulcérée au dernier point, mais ferme et décidée de manière à ne jamais changer. Ainsi nulle tentative, nul effort, nulle démarche qui tente à m’émouvoir. Depuis six mois je ne m’occupe qu’à m’endurcir sur ce point. Soumettez-vous donc ainsi que moi à une conduite douloureuse, à une séparation affligeante pour vos enfants, et croyez, Madame, que, de nous deux, vous n’êtes pas la plus à plaindre21.
* * *
Quoi qu’en ait prié Alexandre, des tentatives sont faites auprès de lui, en vue d’un rapprochement, par son père et Renaudin. C’est une peine superflue. En novembre suivant, Joséphine, décidée à lui intenter un procès, se retire avec sa tante, rue de Grenelle, au couvent de Panthémont, une manière d’abbaye de Thélène pour dames du monde en rupture de ban conjugal. C’est de là qu'elle date toutes ses lettres de défense, c’est de là qu'elle écrit ce billet pour répondre à une nouvelle accusation, – entre cent autres ! – d’Alexandre :
M. le vicomte de Beauharnais doit se rappeler, dit-elle, que je ne voulus pas le laisser partir pour la Martinique sans le charger de quelques présents pour ma famille : une pension de trois mille six cents livres, ayant des maîtres à payer, se trouva trop modique dans ce moment pour mon cœur, je fus donc obligée de m’endetter, mes couches arrivèrent, mon papa devait tenir mon enfant (Hortense) avec la comtesse de Beauharnais, il n’était point à portée de faire les frais du baptême, je les fis. Pour les acquitter, vous jugez bien, Monsieur, que je ne trouvai d’autre expédient que de me défaire d’un objet qui m’avait été donné22. Je ne répondrai rien relativement aux meubles. M. de Beauharnais doit savoir que je n’ai rien et que j ’ai besoin de tout ; mais, comme l ’argent n’est pas mon Dieu, cet objet n’est pas celui qui m’occupe le plus... 23.
C’est de Panthémont encore, que la tante Renaudin dirige l’instance en séparation, car il ne peut être question du divorce, donc la loi votée, le 20 septembre 1792, ne sera promulguée que cinq jours plus tard. Mme Renaudin manœuvre bien habilement ou Alexandre a bien des torts, car l’acte sous seing privé qui, le 3 mars 1785, règle la séparation est entièrement pour donner satisfaction à Joséphine. On dit que c’est parce qu’Alexandre n’a pas pu fournir les preuves de ses griefs. C’est donc un étourdi accompli ? Pourquoi, diable, a-t-il laissé à la Martinique les nègres et les amants de sa femme ?
Tout compte fait, il avoue ses torts. Cela ne veut point dire que Joséphine ait raison.
Á cette époque, ce même mois, à l’École militaire royale de Paris, le jeune élève napoléon Buonaparte apprend que son père vient de mourir. L’écolier a alors quinze ans et sept mois.
1 Sur cette maison de prostitution fameuse, on consultera avec intérêt le curieux volume que lui a récemment consacré M. EUGENE DEFRANCE, Vieilles façades parisiennes ; la maison de Mme Gourdan, documents inédits sur l’histoire des mœurs de la fin du dix-huitième siècle Paris, 1908, in-18.
2Souvenirs du comte de Montgaillard, agent de la diplomatie secrète pendant la Révolution, l’Empire et la Restauration, publiés, d’après des documents inédits, par (ELEMENT DE LACROIX ; Paris, 1895, in-8, p.276.
3L’État de la France, à Paris, chez Guillaume Cavelier, rue Saint-Jacques, près la Fontaine Saint-Severin, au Lys d’Or; MDCCXXXVI, avec privilège du Roi; t. II,p. 370.
4 LOUIS-PIERRE D’HOZIER et D’HOZIER DE SERIGNY, Armorial général ou registres de la noblesse de France. Paris, 1866, in-fol. ; p. 534.
5 FRÉDÉRIC MASSON , Joséphine de Beauharnais..., p. 81.
6 IMBERT DE SAINT-AMAND, les Femmes des Tuileries ; la jeunesse de l’impératrice Joséphine. Paris, in-18, p. 13.
Z FRÉDÉRIC MASSON , Joséphine de Beauharnais...., p. 84.
8 CLÉMENT DE LACROIX, préface aux Souvenirs du comte de Montgaillard... déjà cit., p. 11.
9 A cette nourrice, une nommée Marion, l’Empereur fait, le 20 septembre 1807, une pension de 1.200 francs sur les fonds du Trésor. On en trouvera le brevet dans l’ouvrage de M. FRÉDÉRIC MASSON, Joséphine de Beauharnais..., p. 78. Précédemment, Napoléon ordonnait au ministre de la Marine, le vice-amiral Decrès, de communiquer à Villaret-Joyeuse des instructions à l’égard de cette négresse. « Qu’il fasse ce qui est convenable pour la nourrice de l’Impératrice, écrivait-il, qu’il lui donne des secours, et lui accorde la pension nécessaire pour vivre dans l’aisance ; qu’à sa réponse le brevet de pension lui sera adressé ». Archives Nationales, AF, IV, 875 ; LÉON LECESTRE, Lettres inédites de Napoléon 1er. Paris, 1897, in-8, t. 1, (an VIII-1809), p. 116 – Le vice-amiral de Villaret-Joyeuse était, à cette époque, capitane général de la Martinique, - Cf. Almanach impérial an bissextil MDCCCVIII, présenté à S.M. l’Empereur et Roi, par TESTU; A Paris, chez Testu, imprimeur de sa Majesté, rue Hautefeuille, n° 13, p. 293.
10 CLÉMENT DE LACROIX, loc. cit., p. 11.
11 Cf. Mémoires politiques et militaires du général Terder, publiés avec préface, notes et pièces justificatives, par C. DE LA CHANONIE ; Paris, 1891, in-8, passim.
12Mémoires de Barras, membre du Directoire, publiés avec une introduction générale, des préfaces et des appendices, par GEORGES DURUY, Paris, 1895, in-8, t. II, p. 57.
13L’État de la France, déjà cit.. t. III, pp. 539, 563.
14Biographie des hommes vivants, etc. Paris, Michaud, septembre 1816, t. I, p. 242.
15 TH. IUNG, Bonaparte et son temps, 1769-1799, d’après des documents inédits ; Paris 1881, in-18 ; t. III, p. 107.
16 HENRI WELSCHINGER, les Almanachs de la Révolution ; Paris, MDCCCLXXXIV, in-18 p. 19.
17Biographie den tous les ministres depuis la Constitution de 1791 jusqu’à nos jours, 2e édition, à Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 1825, in-8, P 19.
18 Les actes de naissance d’Eugène et d’Hortense de Beauharnais sont donnés par TH. IUNG, ouvr. cit.,t. I, pp. 314, 315, 316.
19 M. FRÉDÉRIC MASSON, Joséphine de Beauharnais... p. 145. a confronté les dates et a établi qu’Hortense était bien la fille d’Alexandre de Beauharnais. Naturellement, de ce fait, la suspicion est jetée sur les autres griefs de la lettre.
20Archives Nationales série Y, dossier 13975. – Cf. Ci. D’ARGUZON, Hortense de Beauharnais : Paris. 1897, in-18 ;
p. 13 et suiv. ; frédéric: massen,