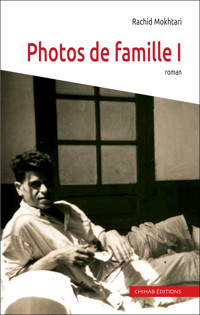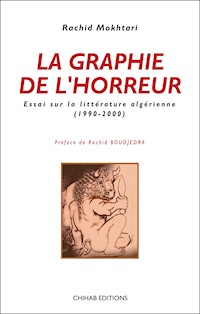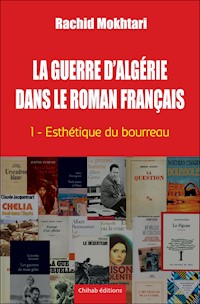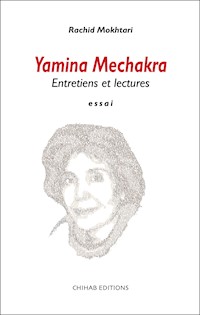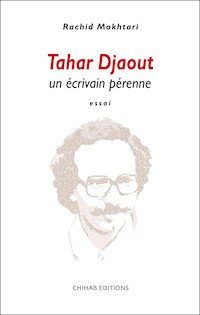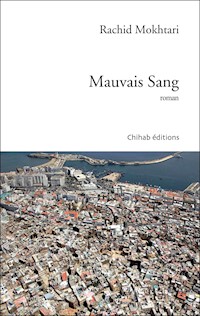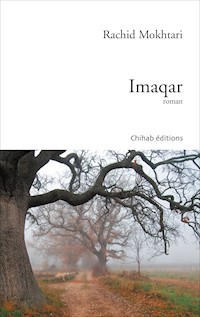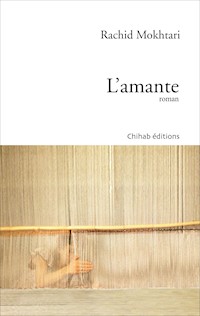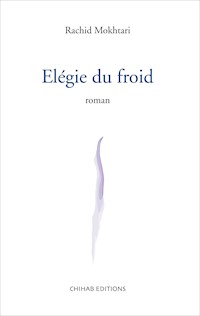13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un scribe, le dernier de la race de lettrés vénérés, retranché dans un réduit qui lui sert de bureau, cherche dans sa mémoire les lettres qu’il écrivait, adolescent, aux épouses d’émigrés, mais il est assailli par celles du Peuple de Disparus. Karim-Ka, un jeune reporter radio l’aide dans sa quête scripturaire macabre et le sollicite pour une relecture de sa pièce de théâtre loufoque qu’il veut voir adaptée sur les ondes. Entre le Scribe déclassé et le dramaturge amateur, une autre voix, celle de Zaïna, convoque ses oiseaux charognards qui dépècent les mots et leur syntaxe…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rachid Mokhtari est universitaire, journaliste et romancier. Il a également publié plusieurs ouvrages consacrés à la littérature et la musique algériennes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MOI, SCRIBE
Rachid Mokhtari
MOI, SCRIBE
roman
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2015.
ISBN : 978-9947-39-149-5
Dépôt légal : 5793/2015
Je suis le Scribe, et je me dois de le dire ainsi de manière abrupte, semblant me vanter. Je me suis terré là, dans ce semblant de local d’une association culturelle, prêté par Karim-Ka son président, dramaturge amateur. Qu’y fais-je ? Quelle est ma valeureuse mission de Scribe dans ce pays sans pays, territoire vacant, retourné au paganisme. Copiste de palimpsestes, correcteur de pamphlets politiques, collecteur d’articles brûlots, cela ne sert qu’à amuser la galerie, à donner du grain à moudre à toute une faune d’affairistes, mâles et femelles. Non plus rien de tout cela, j’avais dit à Karim-Ka, tu te trompes, ce n’est pas une abdication, c’est quoi alors ce silence de mort, m’avait-il houspillé avec ses manières apprêtées de jeune militant. Eh bien, comme tu peux le constater par toi-même, je range, classe, répertorie, plie, numérote des télégrammes, des plaintes, des avis de recherches pour écrire une sorte de Mémoire épistolaire sur l’affaire des Disparus. Karim-Ka m’avait dit, il n’y a que toi qui pourrais leur redonner vie, il serait dommage, vois-tu que ces lettres de la dernière chance, pliées en quatre dans leurs enveloppes scotchées, meurent et moisissent, après tant de drames, d’horreurs, d’attentes angoissantes et d’écritures sans cesse recommencées, disparaissent comme si elles n’avaient jamais été reçues, écrites dans l’urgence d’appels désespérés, de colère volcanique, non pas de plainte, pas de complaintes : qui a tué mon père, a violé ma sœur, qui a égorgé mes frères, où est ma mère, est-elle morte, jetée au fond d’un puits, qui a incendié notre maison si vieille et protectrice avec son beau patio où notre chatte Ginette allaitait une portée de quatre chatons, l’un d’eux n’a pas survécu ; c’est moi, le Scribe de cet enfer, de cette géhenne portée à son paroxysme, citée dans Le Livre pour ses mille et une façons de donner la mort, d’autodafé, de lynchages, de bûchers, de bourreaux aux mains angéliques, qui demandent pardon à leurs victimes, absous de leurs crimes. Que raconter, qu’écrire après tout ça ? Je suis le Scribe des perdants de l’Histoire, des taiseux, des poltrons, des sans-voix ; moi, Scribe, Karim-Ka et Zaïna, je vais lire votre pièce de théâtre. Pas seulement, mon cher Scribe, nous te sollicitons pour, vois-tu, sa réécriture, nous avons la hargne, la rage, mais cela ne suffit pas, nous n’avons pas la plume, et comptons sur la tienne ; nous pensons la soumettre à la commission du département Théâtre de la radio nationale. Voilà le manuscrit mais tu auras la version électronique ce soir.
Quand je dis et redis que c’est moi le Scribe, ce n’est guère par vantardise ou à cause d’un ego exacerbé. C’est, en quelque sorte, pour souligner la rareté de cette race, car qu’est-ce qu’un Scribe ? Ce n’est sans doute pas un écrivain public. Le mot est rare, vieillot et d’un usage suranné. De plus, difficile à prononcer, avec ses trois consonnes qui se suivent, ce qui est rare dans la phonétique de la langue française. Définitions du mot Scribe, trois entrées : Nom masculin singulier.
1. (Administration) : fonctionnaire qui était chargé de tenir les comptes et de rédiger les actes administratifs, dans l’ancienne Égypte.
2. (Religion) : Docteur juif, tel qu’il est décrit dans le Nouveau Testament.
3. (Péjorativement) : employé aux écritures.
Je suis dans la troisième catégorie, et, c’est vrai, cela fait pédant et ronflant ; il y a une autre connotation de ce mot, celle de Taleb, respecté et vénéré. Mais cette race a disparu.
C’est fini, elle est morte et enterrée cette saison de la cueillette des lettres, des olives, des regards, des cœurs, des passions. La fécondité du monde, avaient prédit les anciens, est signe de sa perte. Aux aurores hivernales, le brasero nourri de charbon la veille, de paroles, de confidences, d’amertume, de mots à transcrire, traduire, écrire en majuscule, en gras, et soulignés, s’est éteint. Givre, cendre froide de mes lettres enneigées, entassées dans les replis de l’oubli, poussières de missives disparues, déchirées, perdues. Les saints patrons, Sidi Lhadj Amar et Sidi Mhand Amazit, eux aussi, ont mis en berne leurs vertes coupoles. Les femmes ont eu beau embrasser leurs murs, elles n’eurent pas la mer clémente aux sillages des bateaux de leurs hommes. Ô gens de piété et de dévotion. Je viens à vous, malheureux Scribe muni de mes lettres, mes amulettes, rendez-les moi. J’ai noirci les feuilles d’espoirs, pleines de vies et je me suis noirci de leurs alphabets.
Moi, le Scribe des temps révolus, je n’ai gardé aucune de ces lettres écrites dans l’exil de mes seize ans. En ce temps où je transcrivais avec application la graphie des absences, des distances, les événements douloureux et tragiques des familles des hommes absents, les paroles interdites des femmes. Moi, le Scribe adolescent, devenu intime de ces femmes d’émigrés qui, je ne m’en rendais pas compte, avaient parfois mon âge. Ah, combien j’aimerais, si le temps pouvait se vivre à reculons, supplier toutes ces épouses, mères, grands-mères qui couraient dans les champs, interrompant quelques menus travaux, rentrant les bêtes avant le moment de l’annonce de l’arrivée d’un courrier de ceux de « Fafa », les leurs, de me le confier délicatement, l’enveloppe à peine effleurée pour ne pas la salir de terre, de bouse de vache séchée, sous le regard comme attendri par cette missive qui, comme toutes les missives de ceux qui étaient partis, sans rien, pour rien, avaient traversé les sept mers. Voilà, moi, Scribe chétif et naïf en ce temps là, je n’ai pas gardé celle d’un premier amour intellectuel, qui s’écrivait à partir d’une mezzanine, du coin de cette rue, si joliment bordé d’un petit jardin sombre et humide. 1 bis, rue Lallier, dans le 9e arrondissement, du côté chic de Pigalle des missives paysannes. Par quel mystère tout cela s’est-il éteint, a disparu, s’est évanoui dans les plis et replis des années.
Pauvre scribouillard inconscient ! Comme si aucune lettre ne s’était jamais écrite, dans les masures, au coin du feu, au coin des pensées noires et des attentes rudes de ces hivers d’absences ; je consignais les appels de celles qui survivaient à tout, à la faim, la solitude, aux tourments, à la mort qui rôde comme une chienne maléfique dans les maisons de femmes sans hommes. J’aimais tous ces prénoms de femmes, si jeunes devenues veuves de vivants ; j’avais appris à transcrire la magie de leurs lettres, leur sonorité ancestrale : Sekoura, Titem, Fadhma, Tazazraït, Jedjiga, est-ce J. ? Elles dans la boue, les ravins, la poussière, eux dans le froid mortel d’une « Fafa », ogresse occidentale, mégère, sorcière quand ceux qui sont partis ne reviennent pas, ou fée quand les saints patrons Sidi Lhadj Amar et Sidi Mhand Amazit ouvraient leur fenêtre donnant sur le nord, appelaient au retour les égarés, les poltrons qui, n’ayant pas plutôt reçu les messages magiques, arrivaient, à la nuit, évitant ainsi d’être reconnus par celles et ceux qui ne les attendaient plus. Que le froid morde et givre terre et végétal, que les flocons tapissent les nuits et brouillent les itinéraires, que les pluies torrentielles embourbent les patios, que les bêtes, fatiguées, remuent leurs oreilles et refusent de sortir paître, effrayées, celles qui vivent d’attentes reportées sans cesse dans un futur incertain se secouent, s’éveillent, s’illuminent. Et les foyers des revenants, Ô miracle des saints, retrouvent un semblant de vie, toujours en suspens, provisoire, erratique.
Les absents ayant répondu aux appels au retour des Saints Protecteurs, reprennent leurs amulettes confiées au moment de leur départ, à la séculaire Tazazraït qui s’empresse de les ressortir d’une boite d’aluminium rouillée, ancien emballage « Nestlé » et, dans un rituel incantatoire, les pose dans les paumes écaillées des forçats revenants, aux épaules lasses et affaissées.
Moi, Scribe, j’écoute Karim-Ka me parler avec enthousiasme de la pièce de théâtre qu’il veut adapter sur les ondes de la radio dite nationale et de la chronique de son amie Zaïna, « Nouvelles de mes oiseaux », une émission sur l’ornithologie méditerranéenne. Elle parle d’oiseaux migrateurs, comme si le pays en manquait, me dit, avec une pointe d’ironie, Karim-Ka qui revient à la charge avec sa pièce de théâtre. Je l’ai intitulée « Révolte et Récolte », un titre provisoire, un peu ringard, je l’admets ; il me manque la forme, l’habillage, et toi seul pourrais la muscler, lui donner comme on dit de « la gueule » ; mais, toutes ces lettres de l’effroi, des carnages, des cris d’épouvantes, de mots coagulés, du rouge virant au noir, elles n’ont que moi, leur destinataire et elles ne peuvent souffrir davantage de la moisissure des tiroirs de bureaux officiels.
Des lettres de tout format, en toutes langues, de toutes les horreurs, et de toutes les régions de ce pays sans pays, insulté « vagin de ta mère » fui comme la peste, territoire de « Bled Mickey ». Karim-Ka, je t’avoue cette amère évidence : je n’ai plus l’âge des poings serrés, des pancartes brandies, des slogans scandés, des marches réprimées. Et l’âge est traître, ingrat et, comment dire, prétexte à camoufler l’impuissance. Il me faut beaucoup de gymnastique éreintante pour un projet qui, celui-là me tient à cœur : collectionner les lettres de femmes d’émigrés de l’ancienne génération bien sûr. Je veux retrouver cette mémoire écrite, aller crapahuter dans les villages, discuter avec les familles, les persuader de l’importance historique de ces lettres certainement gardées là où l’aigle élève ses petits. Alors que j’ai encore toute ma tête pour exhumer ces trésors, mon corps, lui, me lâche. Je réécrirai ta pièce de théâtre et en retour, je te confie la recherche des anciennes missives des « Veuves des vivants ».
Le Scribe a-t-il encore la force de Karim-Ka, prêt à prendre la route, à grimper vers ces villages pour rassembler ces trésors manuscrits, devenus archives si rares pour les historiens, anthropologues et sociologues. « Je vous écris ces quelques lignes pour vous dire que je suis en bonne santé. Je travaille. Vous aurez un mandat dans quelques jours. J’embrasse grands et petits. Cet été, si Dieu me prête vie, je serai parmi vous. » Toutes les missives des émigrés de « França » commençaient par cette précaution oratoire qu’il me fallait interpréter selon l’état d’esprit des destinatrices. Scribe, tu t’égares ! Il te faut continuer ton récit. La nostalgie de ton adolescence, de ton premier amour, cette fille bretonne, petite, mince, au visage d’enfant, avec le cœur sur la main et une sensibilité à fleur de peau, bloque ce récit qui est pourtant le tien. Ne succombe surtout pas, comme Saïd, à des amours éteints, à des cueillettes interdites. Alors tais-toi ! Aie l’humilité du Scribe détaché des événements. Donne, offre, à présent que tu as vieilli, que tes mains te lâchent, incontrôlables sur le clavier de l’ordinateur, affolées dès qu’il leur faut remplir un formulaire en public et, parfois même en privé, efface-toi. Il est plus que temps de laisser la place. De l’air ! Du vent ! Tes écrits ont fait leur temps. C’est Zaïna qui parle. Ne m’interromps pas. Mon avis sur la pièce ? Elle fait partie de ma propre histoire, les deux se télescopent même, par pur hasard ; mais je la trouve naïve ; oui, Karim-Ka n’en fait qu’à sa tête, il compte sur toi pour la réécrire, l’« actualiser », c’est son terme, ta propre histoire de « Scribe » d’après ce qu’il m’a dit, je ne fais que te rapporter ses propos, y est tournée en dérision, quoique, la dérision est un genre noble. J’ai feuilleté le manuscrit, j’y découvre un côté moqueur. C’est étrange cette propension à la satire, venant de lui, si timide, en tout cas avec moi ! Karim-Ka ne m’en a pas beaucoup parlé.
***
Acte 1 Scène 1
L’annonce funeste du Patriarche
La scène inaugurale se déroule lors d’une assemblée villageoise où sont réunis les imaqarois sous la tutelle du Patriarche assis sous un grand frêne centenaire. Tout autour, sur des bancs de pierres, les membres de l’assemblée. C’est le mois d’octobre, ordre du jour : la récolte d’huile tant attendue.
Le Patriarche scrute l’assistance d’un regard d’aigle :
— Le ver est dans le fruit. La récolte n’aura pas lieu. Une maladie ronge les troncs, en suce la sève, dessèche les branches de l’intérieur. Il nous faut prendre une décision avant qu’il ne soit trop tard car, bientôt, nous n’aurons que du bois mort, impropre même à alimenter l’âtre de nos foyers. Cette maladie, si rien n’est décidé, dessèchera nos oliviers, nos figuiers, nos arbres fruitiers, nos femmes et nos fontaines. Je dis bien « nos » car que vous apparteniez ou non à ce soi disant parti PPCL, nous sommes tous concernés par ce mal insidieux. Il est plus que temps de mettre fin aux tergiversations prétendument politiques. Ni le pouvoir central ni même ce parti ne mesurent la gravité du danger ni l’urgence de la tâche. C’est pourquoi, je le dis et le répète, n’en déplaise à ceux ici présents ou absents, la Djemâa ne saurait être mise sous la tutelle d’un quelconque parti. Elle demeure souveraine dans ses décisions.
Silence sépulcral, ébahissement, affaissement de poitrines, crissements de cannes sur le sol pierreux. Braiement d’un âne de passage. Regards torves. Personne ne réagit.
Le Sage assène : Nos oliviers souffrent d’une fécondité excessive. Leur sève coule abondamment et perd de sa consistance. Du lait caillé ! Les olives enflent ! Les oiseaux migrateurs ont déserté le ciel d’Imaqar. Les nuages éclatent sans pluie et, comme vous le constatez, même les saisons ont perdu la tête. Nous sommes en octobre et les ruelles du village sont toujours poussiéreuses. Quel mal, quel sacrilège, quelle offense, payons-nous de notre vivant ?
Brouhaha dans l’assistance. Chuchotements.
Nous devons, séance tenante, décider d’un programme d’action pour en finir avec cette calamité. Dans un premier temps, je vous invite, dès la fin de cette réunion, à aller constater par vous-même le mal qui ronge les oliviers. Pour ma part, je propose que l’on fasse venir un spécialiste en la matière, un agronome qui serait capable de nous proposer un remède. Pour cela je délègue Saïd qui se chargera de cette tâche. Vous avez la parole.
Tikouk : Avec tout le respect que je vous dois, en tant que maire et Premier secrétaire du PPCL qui, dois-je vous le rappeler, est le premier parti de la contrée, force est de constater que, primo la djemâa ne nous a pas informés en temps utile ; secundo, elle n’a pas saisi les autorités compétentes sur cette affaire ; tertio, le PPCL n’est pas un parti aux ordres. Ou la djemâa se soumet et remet ses pouvoirs aux représentants du peuple ou le PPCL prendra les décisions qui s’imposent.
Un militant : Vous nous disiez tout à l’heure que nos ancêtres luttaient contre l’invasion des étourneaux en frappant sur les tambours et autres casseroles comme le font les Africains pour sauver leur récolte des criquets. Pourquoi ne pas invoquer, pendant que nous y sommes, les saints du village, Sidi Lhadj Amar, Sidi Mhand Amazit, Sidi Amar Ou Aâr, ou Sidi Machin chouette pour protéger nos oliviers ?
Un sympathisant modéré du PPCL : Il faut, je pense, réunir toutes nos chances pour venir à bout de cette épidémie si elle est avérée : tirer profit de la tradition qui est le fer de lance de notre culture et nous mettre à l’heure de la modernité. Je propose que nous fassions une recherche poussée via internet sur les différentes maladies de l’olivier. Pour ma part, je l’ai déjà faite et j’en ai recensé plusieurs et, pour chaque cas, des conseils et des remèdes sont proposés. Je peux vous préparer un dossier pour le PPCL.
Un autre militant : L’avenir de la région ne s’arrête pas à cette récolte d’huile. Le PPCL pourra s’en passer. Il faut désormais la transformer en projet politique de manière à inscrire notre action hors des saisons et des calendriers agricoles.
Tikouk reprend la parole :
Voilà qui est bien dit. Nous instruirons l’affaire lors d’un congrès extraordinaire du parti puis nous vous ferons part des décisions qui auront été prises. D’ici là, vos oliviers peuvent bien attendre.
De plus, votre assemblée n’est plus souveraine. Notre Parti, le PPCL, et cela ne vous échappe pas, a été élu à une majorité absolue lors des premières élections communales multipartistes ! Les décisions seront désormais prises au sein du Parti et aucune autre pseudo assemblée ne peut s’ériger en République parallèle !
Le Patriarche et ses fidèles quittèrent l’assemblée.
Tikouk acclamé par ses ouailles, se leva, alluma son téléphone portable, réajusta son costume bleu nuit, passa la paume de sa main droite sur ses cheveux gominés avec soin par son épouse, la patronne crainte et vénérée des salons de coiffure pour Dames.
Grommellements. Jets de chique. Exaspération. Assemblée désemparée. Comme effarée. L’agora se vide en silence. Le Patriarche est seul sous le grand frêne. Est-ce la fin d’un règne ?
L’Oracle qui voit et entend tout, surgit sur la scène et, péremptoire, prend à témoin les spectateurs : Les apparences sont trompeuses, n’est-ce pas. Que vaut la parole d’un patriarche de nos jours, dites-moi ! Le Patriarche s’était adressé à l’assistance qui avait fini la litanie des formules rituelles et incantatoires pour entrer dans le vif des débats : aviez-vous médité la Parole des sages : « le ver est dans le fruit ! Le ver est dans le fruit, a-t-il dit. La récolte des olives est compromise cette année ! Un mal insidieux boursouffle les fruits de l’intérieur ! Méfiez-vous de leur apparence si appétissante, si tentante ! Qu’avez-vous à dire ? Ils ne disaient rien. Toute l’assistance, a dit l’Oracle, est restée bouche bée.
Vifs conciliabules avec l’honorable Patriarche craint et vénéré, puis ils s’étaient tenus cois. Le Patriarche avait dit et répété : « le ver est dans le fruit ! ».
Un membre de l’assemblée avait ajouté d’un air dépité : « Nous sommes donc tous pourris de l’intérieur, comme nos oliviers ? »
Le patriarche avait pointé son index vers le ciel, un ciel jaune d’un octobre sec. Un linceul au-dessus des têtes.
Chuchotements, incantations, supplications presque : que Dieu nous préserve des calamités.
Le patriarche : nous devons honorer nos saints. Sidi Lhadj Amar et Sidi Mhand Amazit ne nous abandonneront pas. Ils ont le pouvoir de guérir nos oliviers, de raviver leur sève. Eux seuls détiennent la clé du mystère, les racines profondes de cette calamité !
Un autre jeune membre de la djemâa se leva, déclara, vociférant : quel mal ? quelle calamité ? qu’avons-nous fait ? Cette année, la récolte promet. Les branches ploient sous le poids des olives vertes et noires, il vous suffit d’aller voir. Vous croyez encore aux sornettes ? Je vous prends à témoin, vous, honorables de cette assemblée, nous ne pouvons rester spectateurs de nos malheurs, et puis, de quels malheurs s’agit-il, dites-moi. Je refuse de croire à ces balivernes. Faisons venir un ingénieur agronome pour ausculter les troncs des oliviers et nous verrons bien ! Qu’est-ce que le ciel, les oiseaux migrateurs, les mausolées et je ne sais quoi d’autre ont à voir avec cette épidémie invisible ?
Le patriarche : Vous ne regardez pas les cieux. Les étourneaux ont déserté le nôtre. Libre à vous d’aller cueillir vos maudits fruits. Les âmes sont souillées !
Grognements. Agitations.
Le jeune paysan n’en démord pas : Alors, procédons à un vote et décidons une fois pour toutes. Qui est pour la cueillette des olives ?
Les membres de l’assemblée se regardèrent, hésitants. Le patriarche ne perdit pas contenance : le ver ronge le fruit. De mémoire d’Imaqar, nous n’avons jamais vu pousser des olives aussi grosses que des figues. Elles ont enflé comme un abcès, elles se sont boursouflées. Les oiseaux migrateurs ont flairé de loin, d’instinct, l’odeur pestilentielle, le pus qui coule sous leur brillance. Les rares moineaux qui en ont picoré quelques-unes sont tombés raides morts. Hizoula en a été témoin.
La proposition de vote resta lettre morte.
Un autre membre, cheveux grisonnants : Alors, je porterai l’affaire au maire de la contrée, le premier secrétaire du nouveau parti, le PPCL.
Entracte
– premières élèctions communales multipartistes à imaqar
– large victoire du parti populaire pour le citoyen libre (ppcl)
– tikouka été elu à la majorette absolue
– vive tikouk
– defilé sur la place d’imaqar
–« place à la modernité. à bas la djemaa des vieux chnoques »
–« la cueillette des olives se fera et les saints n’ont qu’à se tenir tranquilles »
L’Oracle seul sur scène haranguant les rares spectateurs :
Pourtant tout le village restait suspendu à la sentence de Khali Amar qui se refusait à tout commentaire et conciliabule inutiles. Ils étaient donc revenus dans cette assemblée qui avait moins à dire qu’à médire. Le mois d’octobre tirait à sa fin et la récolte qui, chaque hiver, rythmait le quotidien, était sérieusement menacée. Vertes en automne, d’un noir brillant et ferme l’hiver venu, les grosses olives demeuraient pourtant orphelines des mains généreuses des belles cueilleuses, fruits tassés, sous les feuilles d’un vert luisant, s’accrochant désespérément aux branches qui, en cette saison, auraient dû être bercées, secouées, allégées de leurs fruits. Nombre de villageois, et il s’en trouvait parmi les fidèles du Patriarche, accusaient secrètement Le Vieux de fomenter un coup d’État. « Le ver est dans le fruit » leur avait-t-il asséné. Quels vers ? Des asticots ? Pourquoi s’en prendraient-ils aux oliviers centenaires ? Est-ce le début de la fin du règne du patriarche ? Quel triste présage !
***
Moi, le Scribe, j’ai survécu à tous les drames de ce monde étrange avec la honte d’être encore vivant. Mon histoire, Karim-Ka la connaît. C’est à se demander s’il ne s’en est pas inspiré pour écrire cette prétendue pièce de théâtre, ce vaudeville. Elle apporte un peu de gaieté dans cet antre de la désolation, croulant presque sous une paperasse remplie de désespoirs, de quêtes et d’enquêtes renouvelées, entêtées. Des milliers de Disparus, des cohortes sans doute enfouies dans des charniers. Mères éplorées de jeunes soldats appelés du contingent, remplissant les enveloppes de photos de fils souriant, au bel uniforme, avec, bien mis en évidence dans le décor, les diplômes, les médailles et… des supplications suivies d’adresses et de numéros de téléphone. Compte sur moi, maître, m’avait dit Karim-Ka et depuis, presque chaque après-midi, il est là, à recopier les infos, noter les détails des disparitions signalées ou prévisibles, tandis que moi, j’écris le désastre, l’innommable, classe les lettres de l’horreur selon les régions d’où elles ont été expédiées. Un travail titanesque ! Heureusement, j’ai la nostalgie, et je ne m’en cache pas, du temps faste et glorieux, où j’étais ce jeune Scribe de missives féminines. La haute saison des lettres des émigrés était celle des labours et de la récolte d’huile. Elles se raréfiaient au printemps et l’été venu, les absents rentraient au village, siégeaient à la djemâa sous les auspices de Khali Amar auprès de qui je m’asseyais depuis qu’il m’avait désigné, à la grande stupéfaction de ma mère, bourgmestre et Scribe attitré des « veuves de vivants ».
L’été venu, Khali Amar mettait à jour les statistiques de la population d’Imaqar et faisait des prévisions sur les naissances à venir, avant le retour des mâles dans les bras de fer de « Fafa ». Il m’avait appris, alors que j’étais Scribe amateur, hésitant et timide, peinant à transcrire, les premières phrases rituelles communes à toutes les missives féminines en formules de bienséance. Je ne devais pas écrire « Ton fils est né », mais « la famille s’est agrandie ». « Attention, me disait-il, fais bien attention, n’écris jamais. ‘Cette année, c’est une fille qui est venue au monde dans ton foyer’ mais, ‘Tes futurs gendres, te dit ta mère, possèdent les plus belles oliveraies et des biens au chef-lieu d’Imaqar à faire pâlir les envieux’ ». Ecrire ce genre de lettres où le non dit était de règle relevait de la prouesse stylistique et m’avait aidé, plus tard, après le tourbillon des saisons et des âges, dans la critique littéraire. Si Khali Amar pouvait m’entendre, là, lire ces lignes, il serait sûrement fier de moi, il me demanderait certainement des nouvelles de ces oliviers qu’il a tant chéris. Avec le temps et l’abondance du courrier de ceux de « là-bas », j’avais acquis une certaine dextérité métaphorique dans cette écriture épistolaire et mes interlocutrices elles aussi dictaient, commentaient leurs messages sans fixer des yeux le mouvement du stylo à bille dessinant pour elles les signes magiques sur la feuille quadrillée posée sur un cahier de 96 pages tout neuf. J’assurais, en vérité, à cette époque bénie, la fonction sacrée de Taleb versé dans le secret des écritures saintes des amulettes. Le titre de Scribe est plus récent auprès des épouses éplorées, esseulées ; une nuit de miel, deux à trois années de fiel. Les adolescentes me dictaient leur lettre à l’insu de leurs belles-mères qui corrigeaient les errements verbaux de leurs brus indécentes et m’obligeaient à changer de feuilles, puisant des pages entières de mon cahier encore vierge de collégien. Elles lâchaient les mots, les formules, les remontrances, s’insurgeaient contre un veuvage forcé, juraient de se remarier au bout de deux années, voire trois, quatre, cinq, dix : « Dis-lui, je ne peux attendre plus longtemps, qu’il rentre définitivement ! Dieu pourvoira à nos besoins ! Dis-lui, encore que je ne suis pas naïve. J’ai autant d’expérience que lui, qu’il le sache ! Sauras-tu écrire cela ? » J’en rendais compte à Khali Amar. « Ecris ce qu’elles ne te disent pas, comprends-tu ? Tout est dans le non-dit » Ah, ces mandats ! C’était la guerre entre belles-mères et brus ! Heureusement, ils étaient tous adressés à la lignée mâle de la famille, grands-pères, pères, oncles et rarement cousins. C’étaient les hommes qui encaissaient l’argent, c’étaient les femmes qui se confiaient à mon stylo Bic noir. J’intimidais les expéditrices lorsque j’allais chez elles, bardé de stylos de rechange, avec des enveloppes déjà timbrées et une pile de papier à lettres. « Que veux-tu lui dire ? » « Ecris et ne pose pas de questions. C’est l’hiver. »
Certaines lettres reçues, je m’en souviens avec délice, celles de Lhabachi, étaient presque indéchiffrables. Casseur de pierres dans une carrière, Lhabachi ne manquait pas de carrure pour ce travail de forçat. Un de ses oncles paternels, établi en France parmi les vétérans de l’usine Renault, lui avait envoyé une belle combinaison bleue marine et une grosse ceinture en cuir tanné avec laquelle il « tenait ses reins » disait-il, pour leur éviter les secousses des coups de burin sur les blocs de pierres qui allaient rouler en contrebas, sur la piste fermée aux rares voitures qui y passaient, arrêtées par de simples cris des concasseurs qui, au besoin, agitaient leurs mains. Lhabachi n’avait d’autre moyen que de rentrer à pied, avec ses outils suspendus à la grosse ceinture qui lui « tenait solidement les reins » sur une bonne dizaine de kilomètres. Mais, après voir découvert des raccourcis qu’il avait lui-même ouverts à travers champs, par escarpements et ravinements, il n’en faisait que cinq même si le raccourci coûtait plus en fatigue et en usure de ses pataugas que l’usage de la piste communale. Après avoir vainement attendu la délivrance de son visa pour la France, une attente partagée par plusieurs jeunes du village, il se mit à se morfondre et, lors des assemblées hebdomadaires, Khali Amar ne manquait pas l’occasion, avant que ne débute la séance, de prendre des nouvelles des « papiers attendus » et Lhabachi répondait « Si Dieu le veut, c’est pour bientôt, avant la cueillette des olives ! » Il prenait son mal en patience comme savaient le faire les paysans aguerris à la longue attente des récoltes. Mais Lhabachi avait tourné le dos aux quelques parcelles de terre familiales perdues sur les flancs des ravins. Qu’ai-je à faire de ces escarpements de chèvres ? répondait-il à ses détracteurs qui le taquinaient, lui rappelant les beaux oliviers que son grand-père paternel avait greffés et que lui, fort comme un bœuf, depuis la mort de l’aïeul, n’avait jugé utile d’en cueillir les fruits, si tant est que la greffe avait pris. J’attends les papiers, en attendant je casse les pierres et mes jours parmi vous, sur ces terres ingrates.
La carrière où les premiers paysans avaient goûté l’odeur âcre de la poussière des pierres effritées par les coups de massue, n’employait quelques bras qu’en cas de force majeure. J’avais donc été désigné par Khali Amar préposé au courrier, et une fois par semaine, le lundi, le casseur de pierres me hélait du haut de la montagne échancrée, lorsque, revenant de la poste du chef lieu, j’arrivais à hauteur de Tala Boulmouten, ma petite sacoche en bandoulière : « hé, Marabout, grand salut à toi. Monte, j’ai quelque chose pour toi. Arrive ! » Il était arc-bouté, le pic fiché dans l’échancrure d’un bloc de pierres, les jambes arquées, la tête légèrement relevée et tournée dans ma direction.
« Alors, de bonnes nouvelles ? ». Il sortait un morceau de galette d’une des nombreuses poches de sa combinaison et me le tendait « C’est Khali Amar qui inspecte d’abord le courrier. Je n’ai pas le droit de le distribuer avant son inspection ! Toutes les lettres, les mandats, les télégrammes, sont ficelés, vois-tu ! A voir la sacoche qui est bien remplie, je crois que c’est mon jour de chance, Marabout ! » Le soir, je remettais le paquet des missives à Khali Amar qui, comme à son habitude, consignait le nom de chaque destinataire sur un registre, afin que, l’été venu, les expéditeurs émigrés paient un forfait sur la distribution, l’écriture des lettres en retour et les mandats encaissés ; moi, Scribe, j’étais chargé, et j’en étais fier, tu m’écoutes Karim-Ka, de convoyer les vieux de « Fafa » aux services postaux du chef-lieu, ils signaient le reçu avec leur doigt, l’index, imbibé d’encre bleue que l’agent appuyait sur le bas du document. L’un des patriarches, ancien mineur en Alsace fit une réflexion à l’agent qui en resta ébahi : « Bientôt cet index servira à la chahada, sans encre, mon fils ! » Ce qui ne fut pas du goût des autres dignitaires assis sur les bancs en lamelles de fer, qui esquissèrent un geste commepour éloigner le mauvais sort, attendant leur tour, tenant fermement, serrés entre le pouce et l’index, leur mandat et leur carte d’identité.