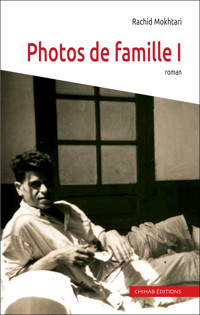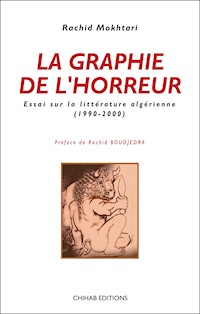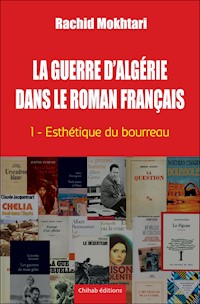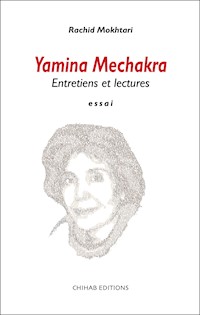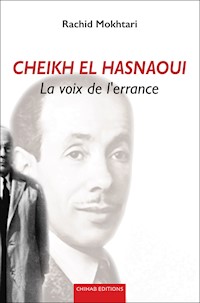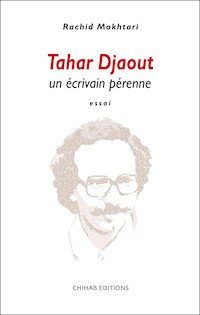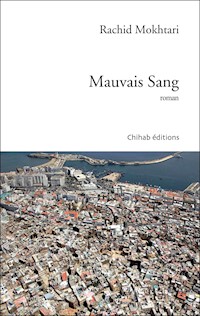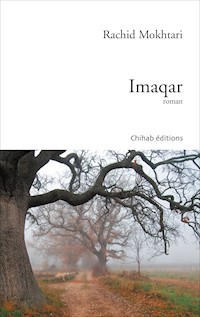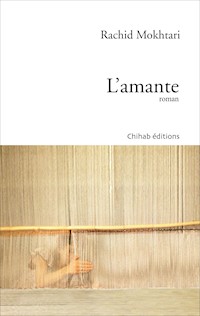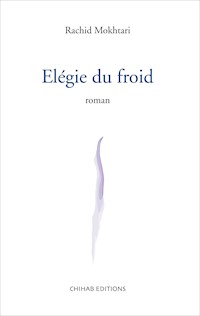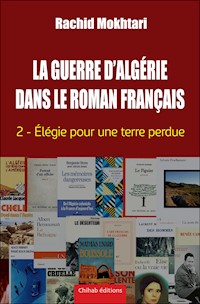
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Cet essai La guerre d’Algérie dans le roman français – s’appuie, dans son contenu et sa démarche, sur une centaine d’ouvrages de genres très variés : fiction, récit, carnets de voyage, témoignage romancé, polar. Il offre ainsi un large éventail de pistes de lectures et de réflexions sur la littérature algérienne des Français qui, depuis ses fondateurs à la nouvelle génération des écrivains nés après 1962, reste essentiellement une littérature ancrée au passé colonial, avec ses faits d’histoire collective et ses pathos.
Divisé en deux tomes distincts mais complémentaires et solidaires du point de vue de la réalité historique et des structures narratives des romans étudiés, l'essai offre aux lecteurs une diversité de regards emphatiques, croisés, divergents, antagoniques parfois, sur le passé colonial de la France en Algérie, la période de la conquête, peu exploitée, et la guerre proprement dite (1954-1962).
Dans ce deuxième tome, Élégie pour une terre perdue, la lecture des romans y afférent montre que la guerre s'efface ou, du moins, devient un écho. La nostalgie en devient l’élément moteur, vive et traumatique aussi, de celles et ceux qui, depuis l'Exode et l'Exil de leur terre natale, les pieds-noirs et leurs descendants écrivains entament des retours réels ou imaginaires au paradis perdu, au puits matriciel, à la ferme ancestrale. Contrairement aux apparences peu d'écrivains Français d’Algérie versent dans l'identité défaitiste des complaintes victimaires. Les tons changent d'un auteur à l'autre, dans la quête mémorielle, d’Alain Ferry, Alain Vircondelet, Hélène Cixous, Marie Cardinal, à Jean-Noël Pancrazi, Sylvain Prudhomme, Annelise Roux et Anne Plantagenet.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rachid Mokhtari est universitaire, journaliste et romancier. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés à la littérature algérienne dont Tahar Djaout, un écrivain pérenne, Le Nouveau souffle du roman algérien et La Graphie de l’Horreur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guerre d’Algérie dans le roman français
2. Élégie pour une terre perdue
RACHID MOKHTARI
La guerre d’Algérie dans le roman français
2. Élégie pour une terre perdue
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2018.
ISBN : 978-9947-39-314-7
Dépôt légal : septembre 2018.
CINQUIÈME PARTIE : Livres d’Exode et d’Exil
La littérature pied-noire, dans son ensemble, sublime la période de la guerre d’Algérie antérieure à 1954. Elle en fait Le Havre des origines, la maison des fondations des premières colonies dites de peuplement de la terre algérienne. La saga Les Chevaux du soleil de Jules Roy et celle de Mathieu Bélezi, analysées dans la précédente partie, peignent un univers homérique dans lequel les aïeux ayant posé le pied en Algérie aux premières années de la conquête, sont décrits comme des défricheurs acharnés, des laboureurs intrépides aux charrues étincelantes, des bâtisseurs infatigables de fermes, villages, routes, et églises, semant le grain et la civilisation sous les yeux ébahis et admiratifs de quelques pauvres hères autochtones vivant dans de méchants gourbis réfugiés dans les montagnes. Le lieu, le puits matriciel, là où tout a commencé, est la ferme au milieu de l’immensité des plaines, si semblables à celles de la série télévisée américaine du temps de la conquête de l’Ouest Lapetitemaisondanslaprairie qui a fait pleurer des générations de téléspectateurs ; un monde idyllique construit pourtant sur le massacre des Indiens autochtones.
Le même procédé romanesque de la littérature pied-noir fait de la ferme le symbole du couple mythique « Terre-Mère » qui transcende les vicissitudes de l’Histoire. La ferme, lieu emblématique de l’identité « pied-noir » d’avant l’exode, est l’ancrage littéraire de plusieurs générations d’écrivains, femmes et hommes, qui la convoquent et l’invoquent dans une rythmique poétique incantatoire. L’image de la ferme, ne s’estompe pas ; quand elle sort du souvenir, elle fait fructifier l’imaginaire. Elle est le lieu autobiographie du récit pied-noir.
Jean Xavier Brager analyse la nature hybride de son écriture : « Le récit autobiographique pied-noir est un tissu hybride qui se crée dans les interstices de la mémoire et de la perception que l’on a de soi et de l’autre. Ces autobiographies, fondées sur un rapport se situant aux confins de la mémoire individuelle et collective, sont sous-tendues par la description polysensorielle et les images mnésiques qui jettent les bases d’une construction résolument hybride de l’identité.
Dans le cas de la littérature pied-noir, cette ambivalence est d’autant plus marquée que les auteurs balancent entre un espace réel, le temps de l’Histoire d’une part, et d’autre part, celui des constructions imaginaires de leurs parcours individuels, voilées par leurs omissions conscientes ou inconscientes. À cette donnée chronologique, il faut ajouter celle du rapport de force à la base de toute littérature coloniale, un rapport qui pervertit tout énoncé narratif en en replaçant les enjeux dans une confrontation, flagrante ou latente, entre les deux sujets : le colon et le colonisé. Enfin, la pluralité des voix entraîne une pluralité de voies, ce qui fait de la littérature pied-noir une littérature en transit qui mute, souvent, en un processus de déni tacite, pour devenir, toujours, le révélateur de la tension sujet/objet ou le lieu de l’amnésie… ».
L’essayiste analyse plus en profondeur les deux concepts qui fondent la littérature des écrivains pieds-noirs : l’hybridité des origines exprimée par l’hybridité même de l’esthétique de leurs textes : romans composés d’oxymorons syntaxiques : vive nostalgie dite sur un ton élégiaque de la ferme des racines, symbole d’un puits matriciel, opposée aux complaintes du déchirement de l’Exode et de l’Exil en Métropole. Le roman pied-noir est composé sur une structure temporelle antithétique : « avant » et « après » de l’Exode qui, à mesure que les vraies images s’estompent dans la mémoire, se ressourcent dans la sphère de l’imaginaire d’un « là-bas » ; cette cassure spatio-temporelle des romanciers pieds-noirs met entre parenthèses la guerre, celle de 1954 à 1962. L’Algérie, telle que décrite dans cette littérature, n’est ni en guerre, ni indépendante, elle est hors du temps de l’Histoire.
Omniprésente dans les albums de famille, la ferme coloniale est le symbole de la nouvelle ère de l’Algérie conquise. Son architecture, ses dépendances, son fronton, ses allées, elle est le lieu central du triomphe du colon. Elle est décrite au moment de sa construction (Jules Roy), de sa puissance agricole sur les immenses plaines au milieu desquelles elle s’étend (Marie Cardinal) ; au cœur de la guerre de 1954, elle devient un bunker, protégée par des militaires des incursions nocturnes de fellaghas avant la fuite de ses propriétaires lors de l’Exode de 1962 (Mathieu Belezi). Un demi-siècle après la fin de la guerre d’Algérie, le pays natal du pied-noir, devenu un « là-bas », la ferme des aïeux, confondue au caveau familial, n’étant plus que décombres et ruines ensevelies sous les herbes sauvages, est le lieu mémoriel qui motive le voyage réel des enfants et petits-enfants de famille pied-noir accompagnant leurs parents pour un ultime adieu au lieu originel dans l’Algérie au seuil du 21e siècle. Aux retours symboliques, littéraires, écrits dans la vive douleur « nostalgérienne » (Marie Cardinal, Alain Vircondelet, Marie Elbe…), succèdent les voyages réels des descendants de famille pied-noir qui découvrent l’Algérie d’aujourd’hui, motivés par la quête de la ferme ancestrale.
Le voyage réel nourrit la fiction des héritiers de l’Histoire pied-noir, d’une nouvelle génération de romanciers qui n’ont pas connu la guerre d’Algérie et qui, par ce retour sur la terre natale de leurs parents exilés, cherchent à se libérer des fantômes identitaires, à mettre un visage sur un pays, une terre, et pouvoir ainsi construire un socle littéraire hors des complaintes victimaires et des béances héréditaires (Anne Plantagenet, Brigitte Benkemoun, Marie-Christine Saragosse, Olivia Burton, Sylvain Prudhomme…).
Hélène Cixous, issue de la communauté juive algérienne, née à l’orée de la Seconde Guerre mondiale à Oran, ayant grandi à Alger jusqu’à son adolescence, ne se reconnaît pas dans le mouvement d’exode massif des pieds-noirs de 1962. Ce qui individualise sa douleur et la rend plus aiguë. Son identité « française » a subi de profondes humiliations : l’octroi de la nationalité française aux Juifs d’Algérie par le décret Crémieux ; le retrait de celle-ci après l’abrogation du décret par le régime de Vichy, puis de nouveau recouvrée pour affronter un autre antisémitisme, celui des populations arabes. Cette identité provisoire, fluctuante et errante est la fissure fondamentale de ce qu’elle nomme « désalgérie » ou « malalgérien ».
Ne cédant ni aux retours symboliques, encore moins au voyage réel, la romancière Annelise Roux, née en France de parents pieds-noirs, ne recherche ni ne revendique cette identité. Elle interroge l’étrangeté de son hybridité (et celle de son écriture) par l’absurdité et la complexité de l’Histoire humaine. Alain Ferry, né à Bône (Annaba) dans la même région qu’Albert Camus, de parents pieds-noirs ayant quitté l’Algérie après l’indépendance, revisite son enfance et son adolescence vécues dans une ferme viticole appelée El-Kous dans un roman-essai, par une érudition littéraire qui le délivre de son passé sans pour autant le faire oublier. Les grands classiques de la littérature universelle lui apprennent à relativiser la tragédie d’El-Kous par rapport à celle vécue par d’autres peuples, sous d’autres cieux, à différentes époques. Il en fait une « éthopée d’un pied-noir ».
Contrairement aux apparences, peu d’écrivains pieds-noirs versent dans la nostalgérie. Il leur a fallu attendre un demi-siècle après la fin de la guerre, pour écrire, exorciser dans la distance le passé algérien au moment où d’autres guerres engendrent les mêmes violences que celles qu’ils ont vécues. (Jean-Noël Pancrazi, Louis Gardel). La « nostalgérie » de Marie Cardinal est soumise à d’épuisantes séances de psychothérapie quelque vingt années après l’Exode, dans la mutité de sa mère qui a enfoui en elle son Algérie ; la « désalgérie » d’Hélène Cixous est la destruction du mythe de la Tour de Babel. Mère d’origine juive allemande, père aux ancêtres andalous ayant fui l’Inquisition,elle-même issue de cette constellation des origines, née à Oran, Algéroise d’adoption, elle en est dessaisie violemment puis insidieusement à un âge où elle ne comprend pas. Son père médecin à Oran est interdit d’exercer son métier ; sa mère, devenue infirmière attentionnée et dévouée, est conspuée par les Arabes, ses voisins qui ont appris que leurs nouveaux-nés sont mis au monde par une Juive ; elle-même, adolescente studieuse est interdite de lycée et sa meilleure amie, « pied-noir française » refuse, sous la menace de ses parents, ses invitations à la maison familiale. Hélène Cixous établit une hiérarchie graduée de cette « désalgérie » ; la « soûlographie » d’Annelise Roux est une interrogation véhémente et audacieuse sur le concept d’« identité », « pied-noir », « gens du voyage », « beurs » « harkis » dont les classifications, dangereuses, couvent encore les pires tragédies de l’Histoire du 20e siècle et au-delà. Le concept d’« hybridité » qu’elle revendique est le socle même de son écriture riche d’un faisceau d’intertextualités dont les grandes œuvres l’aident à mieux comprendre et dépasser sa propre tragédie ; procédé littéraire qui, quarante ans plus tôt a fait l’originalité du roman-essai El-Kous. Ethopée d’un pied-noir d’Alain Ferry.
Chapitre 8 : Chants funèbres du mal d’aurores
1. Marie Cardinal : Thérapie du « malalgérien »
Au pays de mes racines1 de Marie Cardinal est l’archétype littéraire de la « nostalgérie » du pied-noir qui ne s’est jamais remis du profond traumatisme de l’Exode de 1962. Marie Cardinal a fait de cette écriture de la « nostalgérie » une sorte d’autoanalyse thérapeutique.
Au pays de mes racines est un livre de la mémoire ; un livre du retour. Vingt-cinq ans après son départ d’Algérie, Marie Cardinal évoque ses souvenirs du pays natal, de la ferme familiale qu’elle ne veut pas revoir une fois arrivée avec sa fille, à Alger, au cœur du Printemps berbère d’avril 1980 dont ne parlent pas les journaux officiels du FLN ; elle évoque son lycée, sa première communion sans nostalgie. Elle va à la rencontre d’une nouvelle Algérie, son pays et se revendique algérienne auprès des femmes, mères au foyer ou universitaires qui viennent la rencontrer dans son hôtel. C’est une Algérie autre et pourtant la sienne car elle y retrouve « les odeurs, les gestes, les rythmes qui lui étaient familiers, les gens, la mer, sa mer ». Marie Cardinal a ainsi renoué avec l’enfant maintenant apaisée, euphorique qu’elle fut en cette œuvre d’évocation et de réconciliation malgré un regard critique sur les couacs de l’indépendance, la répression du mouvement du Printemps berbère, la léthargie des nouveaux maîtres du pays ; elle se le permet car c’est son pays. Deux époques, deux mondes. Marie Cardinal les évoque dans ce roman du retour par fragments à travers le prisme de ses souvenirs d’enfant pied-noir dans ce récit émouvant de son premier voyage de retour au pays de (ses) racines depuis qu’il a cessé d’être, depuis une vingtaine d’années, département français pour prendre une place souveraine parmi les nations du continent africain. Dans ce voyage qui la guérit des fantômes de son enfance, de la maladie de sa mère, morte d’un cancer du manque d’Algérie, Marie Cardinal s’est fait accompagner par sa fille, Bénédicte Ronfard, qui, à son tour en fin de volume dans Au pays de Moussia, (Moussia étant le prénom algérien, algérois de sa mère) écrit :
« ça cafouille un peu dans ma tête. Liste d’attente… J’ai failli rater cet avion. Me voilà en route pour Alger, coincée entre deux regards braqués sur mon stylo qui ne pourra, par conséquent, qu’écrire des banalités. Je pense à Moussia… Je suis la seule de ses trois enfants à n’avoir jamais mis les pieds là-bas. Me demande qui je vais trouver, qui est Moussia à l’endroit d’où lui vient ce prénom. Qui sera Bénédicte face à elle, face à tout ce passé qui ne lui appartient pas et qui, pourtant l’a nourrie… ». (p. 199)
C’est avec appréhension que Marie Cardinal a préparé ce premier voyage du retour. La femme et mère qu’elle est et l’enfant qu’elle fut, restée là-bas vont-elles se retrouver ou au contraire se livrer une autre guerre, remuer le couteau dans la plaie, dans une altérité entre l’exode et la permanence. C’est dans ce dédoublement (mère de retour et enfant jamais partie d’Alger) que le journal de voyage de Marie Cardinal (mai et juin 1980) est construit :
« Depuis que j’ai décidé de revenir à Alger, beaucoup de personnes m’ont dit : – Tu verras, tu vas être déçue, c’est tout petit –. Or je n’ai pas trouvé Alger petite, je l’ai même trouvée plus grande que dans mes souvenirs. C’est le cimetière que je trouve petit. Dans ma tête il était immense, un dédale d’allées, un interminable éparpillement de caveaux sur un terrain escarpé. Je me laisse guider par la petite fille qui venait ici, le cœur gros. C’est son cœur qui alourdissait sa marche, c’est lui qui rendait cette montée interminable. Aujourd’hui mon cœur n’est pas gros et j’ai pris l’enfant dans mes bras. Elle m’indique le chemin : – tourne là, prends cette allée, monte jusqu’à cette chapelle, il y a un raccourci par là… – C’est vite fait, la tombe est là, je n’en reviens pas. Dans la mousse qui a envahi la dalle, je lis clairement : CARDIN… (…) Quel repos, quelle paix ! Je ferme les yeux. Le silence… ». (p. 126)
Christine Arnothy, femme de lettres et journaliste (1930 – 2015), auteur entre autresde J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir (Ed. Fayard, 1955) qui raconte son histoire, jeune fille durant la Seconde Guerre mondiale, écrit dans sa postface à ce roman de Marie Cardinal : « C’est avec une pierre blanche qu’on devrait marquer cette confession d’amour à la ville blanche. Flou, transparent, scintillant, gris rose, ce livre du mal du pays, de cette douleur que les Allemands définissent avec le célèbre mot Heimweh, ce livre est mon Cardinal préféré. »
Le livre Autrement dit2 n’est pas un roman, mais une retranscription de séances de psychanalyse et d’échanges entre deux intellectuelles, philosophes de formation : Marie Cardinal, née en Algérie qu’elle a quittée en 1962 lors de l’Exode, auteur de Au pays de mes racines roman d’une vive et déchirante nostalgie sur le pays natal perdu et Annie Leclerc, figure majeure du féminisme de l’après 1968. Ce livre se veut une suite à son autre roman autobiographique Les mots pour le dire3dans lequel elle décrit sa psychanalyse, le mal insidieux qui la ronge qu’elle nomme « la chose ».
Nul mieux que Marie Cardinal n’a exprimé avec autant de blessures dans les mots, de saignements du cœur l’Algérie perdue. Avec quels mots dire et redire l’exploration d’une mémoire vive et brûlante de la terre désormais d’autrefois – il était une fois, une Algérie – ? Son roman Des mots pour le dire, est un « livre-cri », violent, parfois impudique de mots vrais, interdits, choquants, comme vomis des entrailles d’une écriture fiévreuse. Physiquement et moralement désemparée, au bord de la folie et presque du suicide, la jeune femme qui s’y livre entière, est une « survivante » d’Algérie dont elle a été déracinée, adolescente, avec sa mère, laissant derrière elles, non pas de simples souvenirs, mais leur âme. Mariée et devenue elle-même mère, la jeune femme, assaillie par des fantômes, erre, sans but, à Paris, incapable de se concentrer dans son travail d’enseignante ; elle entretient des rapports ambigus avec sa mère qui n’a plus rien dit du pays quitté, vivant dans un univers d’aphasie.
Vingt ans sont passés depuis le bateau de l’Exode, pourtant les plaies sont tout aussi sanguinolentes qu’au premier jour de la violente césure. Elle ne veut pas que le mal d’Algérie soit encore une défaite en exil ; elle doit lutter, sortir du gouffre. Elle décide alors de confier son destin à un psychanalyste parisien dont le cabinet se trouve dans une impasse, sombre, dont la fenêtre du bureau donne sur un mur aveugle ; le clinicien froid, silencieux, pointilleux sur les horaires des rendez-vous est antipathique pour sa patiente. Pourtant, chaque jour, à une heure précise, ni avant ni après, et durant quatre années de suite, elle se confie à cet homme qui l’écoute sans prendre des notes, n’intervenant que rarement, dans les flots impétueux de la jeune femme qui, au fil des séances de sa psychanalyse remonte le chemin de sa vie dont les étapes s’éclairent les unes après les autres : le divorce des parents au moment où elle a été conçue après une sœur mort-née, la mort du père à Alger, l’adolescence dans une Algérie en guerre, tout cela arraché aux ténèbres du refoulement maternel. La narratrice sort peu à peu des entraves de son passé, se délivre du mutisme de sa mère, de ses angoisses. Elle peut enfin recommencer à vivre avec son époux et ses enfants. Dans le bureau sombre du psy, des pans d’Algérie sortent des ténèbres des refoulements. Trois images, trois souvenirs intacts, lumineux auxquels l’auteur consacre de belles peintures évocatrices de splendeur, du paradis perdu, refoulé depuis dans les tourbillons de l’exil. Dans ce « refuge » de l’impasse, face au silence des lieux et du psy, la patiente ramone la cheminée de cette Algérie, sa terre natale. C’est d’abord, la maison fondatrice, celle construite par le premier aïeul bordelais, à l’origine une ferme devenue au fil du temps colonial, une vaste propriété, une maison de maître, dont l’auteure évoque, dans une foule de détails, la solide et imposante architecture sans omettre la vie des « domestiques arabes » qui servent les maîtres, pieds nus, pour ne pas faire de bruit, en habits exotiques pour se fondre dans le décorum. Les adjectifs exprimant la solidité des murs, la clarté des chambres, les teintes du salon, les réjouissances de l’heure de l’apéritif et les lignes parfaites des vignes au loin, sont nombreux et contrastent avec le temps de l’imparfait de l’indicatif qui exprime ici un monde disparu :
« La maison était trapue et puissante, bâtie par le premier aïeul bordelais qui l’avait désirée semblable aux maisons de son pays : simple, pratique, solide et grande. Au début, c’était une ferme fortifiée de murailles, hautes de cinq ou six mètres. Quand je l’ai connue il ne restait plus qu’un pan de ces hauts murs, du côté de la cour d’entrée, troué d’un énorme portail fait d’épaisses solives. À l’intérieur de la maison d’habitation les pièces étaient vastes et communiquaient toutes entre elles. Le grand salon qui courait le long de la façade était aménagé pour des adultes qui aimeraient le porto, les havanes et la musique classique. À travers ses baies vitrées on voyait,au-delà de deux poivriers romantiques qui pleuraient leurs feuilles dentelées et leurs grappes de boulettes rouges, de la belle vigne, à perte de vue. Le service lent et attentif était assuré par des domestiques arabes qui, pour servir les repas de galas, se mettaient des gilets brodés, des serouals blancs, des foulards criards et des sequins d’or sur leur front tatoué. Leurs pieds nus ne faisaient pas de bruit sur les dalles noires et blanches du sol. Leurs mains, rouges de henné, manipulaient respectueusement l’argenterie de famille. Sur le fronton triangulaire de l’habitation, entre le ciel et la terre était inscrite la date de construction : 1837… ». (p. 105-106)
Dans toute évocation algérienne du pied-noir, le lieu emblématique, celui par lequel tout a commencé, c’est la ferme qui, dans nombre de romans des Français d’Algérie, est à la fois le symbole des sacrifices consentis par les premiers colons pour la mise en valeur des terres et de leur inscription ineffable dans l’histoire et de l’enracinement définitif par un rapport intime avec la terre et son humus. La ferme n’est pas un lieu, un référent spatial, mais le berceau des fondations. Marie Cardinal l’évoque dans une sorte d’euphorie, par l’abondance inouïe des fleurs, des plantes, des arbres fruitiers, des légumes dont elle énumère les variétés. Jardins exotiques, potagers abondant de légumes, allées bordées d’arbres fruitiers ; senteurs enivrantes dans lesquelles, à l’abri du chaos de l’histoire, l’enfance de l’auteure a germé. La terre algérienne inscrite dans le substrat mental du pied-noir est invariablement fertile. Elle n’est pas celle de l’autochtone, de l’« Arabe » qui n’a pas su la fertiliser, mais celle d’une double conquête, celle du soldat et du laboureur. La nostalgie avec laquelle l’auteure évoque la ferme exclut toutes les pesanteurs de l’histoire de la conquête. Comme si l’existence de cette ferme, ses richesses, ses beautés, ses attraits, ses nourritures du regard et du ventre, son jardinier « Arabe », ses avalanches de floraisons excluaient toute autre réalité, tragique celle-là, n’étaient que poésie, insouciance et nourricières de rêves. L’expression « campagne vide » qui tranche avec le jardin mirifique de la ferme, est le monde inconnu vers lequel s’échappe le jardinier Arabe, Youssef, qui ne fait pas partie de cet éden. L’on pourrait lire dans l’étrange expression « Les légumes comme des objets précieux » une connotation historique se référant à cette « campagne vide » où la famine règne et, cette énumération des légumes du quotidien paraît, sous l’évocation de l’auteure, comme une honte de posséder tant à proximité de là où il n’y a rien. L’auteure use de subtiles connotations dans la mise en opposition de ces deux terres d’un même pays : l’une, celle du colon, nourricière à l’excès ; l’autre, celle de l’Arabe, stérile. Ce monde idyllique dans une Algérie en guerre, doute-t-il de ses fondations au point de faire montre, comme en une dernière partition de ses musiques anciennes, ce qu’il a de plus beau avant de s’éteindre à jamais :
« A la ferme, il y avait de grands jardins. D’abord le jardin pour se promener, avec des parterres, des allées de romarin taillé et des tonnelles dont l’une, en forme de kiosque, était envahie par un jasmin aux grosses fleurs étoilées. C’était de ce jasmin-là que Youssef le jardinier cueillait, les soirs où il allait courir le guilledou, Dieu sait où, dans la campagne vide. Il en mettait quelques brins bien serrés au-dessus de son oreille gauche, contre son tarbouche de soie, et il laissait une trace parfumée partout où il passait. Il en était avare et ne donnait de ces fleurs à personne d’autre qu’à moi, de temps en temps (…) Les légumes comme des objets précieux ! Les aubergines, les melons, les citrouilles, les poivrons, les tomates,les concombres, les fèves, les courgettes, les haricots, tout frais, gonflés, luisants de santé, lançant des reflets enflammés ou sombres au creux de leurs feuillages robustes. Le persil, les carottes, les navets, les radis, les salades, les oignons, les échalotes, la ciboulette, le cerfeuil, bien rangés en masse vertes, lisses ou dentelées, exhalant des odeurs de bonne cuisine, de la table familiale, de paix, de chaleur. Les fleurs d’ail, en haut de leurs longues tiges, exhibant leur rose délicat au-dessus des rouges, des violets et des verts. Après, il y avait les orangers des quatre saisons, les mandariniers, les citronniers, les arbres à pamplemousse, les néfliers, sous lesquels nous nous arrêtions, pour goûter un fruit plein de jus, où la fraîcheur de la nuit était encore prisonnière… ». (pp. 106-108-109)
Ses rendez-vous quotidiens avec le psy ponctuent le retour aux sources que les nombreuses séances dans le cabinet de l’impasse, à Paris, attisent, éveillent la peur obsessionnelle de replonger dans un monde fait de cris, de fuites, de blessures, d’abandons, de déchirements. Celui de deux guerres concomitantes : celle, intime, de ses parents divorcés, ballottée entre une mère surprotectrice et imbue de morale chrétienne et un père mystérieux, libertin, aux petits soins de sa personne auprès duquel, elle se sent mal à l’aise. Conçue au moment de leur divorce, la narratrice est-elle condamnée à cette déchirure. Lorsqu’elle accompagne sa mère au cimetière de Saint Eugène, à Alger, c’est la petite tombe de sa sœur mort-née qui est l’objet de toute l’attention maternelle au point où la narratrice a l’étrange impression qu’elle est née dans la mort.
« Chaque année, à la Toussaint, j’accompagnais ma mère au cimetière. Avant la guerre, nous y venions en voiture et Kader portait les fleurs et les paquets. Plus tard, il nous fallait plus d’une heure et plusieurs changements de trams pour parvenir dans cet endroit escarpé surplombant la Méditerranée qui, là, loin des plages de la baie et à cause de la chute abrupte du sol dans la mer, était déjà profonde, sombre, mystérieuse. On la voyait de partout à travers le tronc et le feuillage noir des cyprès qui bordaient les allées. Odeur poivrée des arbres. Odeur fade des chrysanthèmes. Odeur marine. Odeur des morts. Odeur minérale de toutes ces dalles au ras du sol assaillant la montagne jusqu’à son faîte où était plantée une basilique vouée à Notre Dame d’Afrique ; Vierge au visage fin barbouillé de cirage noir, comme les négresses de carnaval, vêtue d’une chape d’or, raide, hiératique et portant son bébé assis sur son bras replié. Malgré le jaillissement des croix au-dessus des tombes et des clochetons au-dessus des chapelles, tout était écrasé entre le ciel immense et la mer énorme qui se réunissaient au loin… ». (p. 230)
Sur le divan de l’impasse, elle se revoit, enfant, jouant avec son père dans la vaste cour de la ferme avec la crainte diffuse d’être grondée par sa mère qui n’est jamais aux côtés de ce père distant, trop chic dans ses costumes, trop extravagant pour lui confier ses tourments d’enfant. Elle se rappelle aussi la scène du salon, le soir après le dîner, où la mère, dégustant son thé, lui parle, avec une distance froide, de ses règles à venir et que, devenue femme, elle doit éviter la fréquentation des hommes. Avec l’autre guerre, celle de l’Histoire, l’univers de la jeune fille encore quelque peu sécurisant, se fissure progressivement avec la fin du rêve : l’agonie de l’Algérie française et bientôt, pour l’adolescente, qui ne comprend pas, l’arrachement violent à son univers, sa chambre, son lycée, ses amies, l’épicier du coin, ses rêves. Elle ne sait pas ce que c’est « L’Algérie française » ; la guerre, pour elle, est comme celle que se livrent ses parents, chacun continuant de vivre sa vie dans un respect mutuel. Vingt ans après la disparition de cette « Algérie française » devenue « Algérienne », la patiente du psy de l’impasse, a encore ce regard d’enfant sur ceux qui se battent : les uns « les gosses du continent », « les enfants de France », « les meilleurs de nos soldats » – pronom possessif de majesté accolé à soldat – livrent un combat inutile ; les autres « les fellaghas maigres et fanatiques » devenus, l’indépendance venue, des « héros de conte de fées ».
« L’Algérie française vivait son agonie. C’était l’époque où, ainsi que le disent les spécialistes, la guerre d’Algérie était militairement gagnée par les Français. Les meilleurs de nos soldats, ceux qui venaient de recevoir une raclée en Indochine, avaient organisé une grande traque dans les pierrailles des djebels : les gosses du continent, la jeunesse de Saint-Malo, de Douai, de Roanne et d’ailleurs (ils en seront tous marqués au fer rouge comme les bêtes d’un troupeau maudit), avec leurs casques, leurs bottes, leurs armes automatiques et leurs engins blindés, avaient reçu l’ordre de zigouiller à qui mieux les fellaghas maigres et fanatiques. Les enfants de France tombaient dans les corps à corps en vomissant leurs tripes et leur patriotisme mais les autres tombaient encore plus. Finalement le combat cessa faute de combattants. Les fellaghas qui avaient pu en réchapper s’étaient réfugiés dans les villes où ils étaient devenus des héros et où, comme dans les contes de fées, leurs paroles coulaient de leurs lèvres, tels des diamants et des roses dans les Casbahs et les quartiers populaires… ». (p. 111)
Le discours change de ton, passant de la nostalgie des lieux emblématiques du pied-noir d’avant la guerre à celui, pamphlétaire, de la politique du gouvernement français qui, après la fin du « combat tricolore » s’entête à nier la pratique de la torture par son armée en Algérie et à réfuter l’état de « guerre » d’indépendance qui plus est. À l’énumération des plantes, d’arbres fruitiers, de légumes du jardin de la ferme, havre de paix et foisonnant de vie, l’auteur, avec une ironie mordante, énumère toute l’horreur de la guerre et les instruments de la torture sans lesquels l’État français au sortir du conflit semble s’ennuyer, comme ayant laissé son « âme » dans la guerre d’Algérie. Autant elle fustige la politique de l’autruche du « ministre de la guerre » pour lequel la torture n’est qu’une « simple question d’imagination », autant elle condamne les violentes « ripostes des Arabes » coupeurs de sexe, éventreurs de ventres et arracheurs de fœtus. Les deux camps se rejettent les justificatifs de la violence, des exactions, se refusant elle-même aux racines de la guerre qu’elle qualifie de « guerre civile » dans l’agonie honteuse de l’Algérie française et « l’ignoble des ripostes séculaires des Arabes ». La guerre aux yeux de l’adolescente signifie l’écroulement de son monde, la fin d’une existence heureuse y compris avec les indigènes, le fleuriste de la ferme et les domestiques de la « maison de lumière » mais elle était loin de s’imaginer que cette « Algérie française » pour elle terre natale, va sonner l’hallali du rêve de fusion entre les deux communautés et qu’elle sera violemment arrachée de sa terre natale :
« Le combat tricolore avait donc cessé. Pour le ministre de la guerre à Paris il n’y avait plus de guerre en Algérie. Plus de canons, plus de balles, plus de mitrailleuses, plus de grenades, plus de napalm à envoyer là-bas. Pour le grand livre de compte de l’économie française, c’était le calme plat car les baignoires, les électrodes, les paires de claques, les coups de poing dans la gueule, les coups de pied dans le ventre et dans les couilles, les cigarettes à éteindre sur les bouts de seins et les queues, ça se trouvait sur place : broutilles. La torture ça ne se comptait pas, donc ça ne comptait pas, ça n’existait pas. La torture ce n’était qu’une simple question d’imagination, ce n’était pas sérieux. Et pourtant c’était quand même l’agonie honteuse de l’Algérie française, dans la dégradation de tout, dans l’abjection, dans le sang de la guerre civile dont les grosses flaques dégoulinaient des trottoirs sur les chaussées en suivant le chemin géométrique des joints de ciment de la civilisation. C’était la fin dans l’ignoble avec les ripostes séculaires des Arabes, leurs terribles manières de régler les comptes : les corps éventrés, les sexes coupés, les fœtus pendus, les gorges ouvertes… ». (p. 112)
Vingt ans après la perte inconsolable de l’Algérie, l’auteure persiste et signe : la terre, c’est-à-dire les plaines fertiles des vallées et des piémonts enlevées aux autochtones par un arsenal pseudo-juridique de lois d’expropriation, ne sont devenues fertiles qu’à la force des bras des premiers colons installés sous la protection des baïonnettes et à coup d’enfumades. Dans nombre de passages de ce roman-cri, l’Algérie, avant 1830, était une terre à l’abandon, peuplée d’animaux sauvages, dangereuse avec ses « marécages grouillant de vipères », ses maladies mortelles, les fièvres du paludisme et de la dysenterie ; ennemis plus dangereux que les insurrections sporadiques des résistants autochtones. Les premiers colons venus en éclaireurs de la vieille France sont ainsi dépeints comme des « évangélistes », la croix sur le poitrail, pioches et semences dans les mains, asséchant les marécages à moustiques, dessalant les plaines, construisant des maisons, au péril de leur vie, avec un sens du sacrifice hors du commun. L’image surfaite de ces « pionniers de légende » est un invariant obsessionnel du roman pied-noir. Cette ode incantatoire prend encore plus de poids après la perte de l’Algérie4.
Deux images s’entrechoquent dans le plus complet paradoxe. Celle d’avant la conquête d’une Algérie no man’s land, trop vaste pour une peuplade disséminée, à l’abandon, terres de chardons et de maladies et celle des premières années de la conquête et de la fête du Centenaire, d’une terre rouge algérienne où la ligne droite a remplacé l’arabesque, fière de ses rangées de vigne, de ses vergers nourriciers, des plaines moutonnant de hautes tiges de blé, de fermes aux frontons poétiques et d’un peuple de conquérants, de laboureurs à l’araire aussi puissante que les baïonnettes des troupiers de De Bourmont et de Bugeaud :
« Cette terre, les premiers colons s’étaient donné du mal pour la rendre cultivable. Ils avaient asséché les marécages qui grouillaient de vipères et de moustiques à paludisme. Ils avaient drainé l’eau salée qui imbibait les plaines côtières. Ils avaient ensuite dessalé ces plaines pour les rendre fertiles. Ils s’étaient crevés à la peine sous le soleil. Les fièvres et la fatigue les avaient fait mourir comme meurent les pionniers de légende, dans la maison qu’ils avaient construite de leurs mains, dans le précieux lit qui venait du vieux pays, un crucifix sur la poitrine, entourés de leurs enfants et de leurs serviteurs. Ils léguaient à ceux-ci leur terre rouge et le goût de travailler encore pour elle (car elle devenait belle avec ses vignes alignées, ses orangeraies, ses jardins), à ceux-là, la certitude de la sécurité (ils n’auraient jamais faim, ils ne seraient jamais nus, quand ils seraient vieux ils seraient vénérés comme on vénère les ancêtres, quand ils seraient malades on les soignerait) et plus encore, s’ils restaient serviables et fidèles… ». (p. 157)
Remontant le cours de ses souvenirs d’Algérie dans l’atmosphère lugubre du cabinet du psy, l’auteure replonge dans le paradis perdu de son enfance algérienne et évoque, dans un style luxuriant, surchargé d’émotions et d’admiration la ferme ancestrale à la saison des vendanges. De belles pages dans lesquelles l’auteure narratrice décrit l’arrivée triomphale de sa grand-mère, l’aïeule dans une limousine, la patronne vénérée et crainte des Arabes qui, n’ayant pas de parcelles de terre suffisantes, venaient vendre à la ferme des paniers de grappes de raisin à leur « chibania » affublés de gandouras et de chèches immaculés pour faire honneur à la « Ma » qui les recevait, assise dans son fauteuil en rotin, la balance à ses pieds pesant leurs maigres récoltes. Avant son arrivée triomphale à la ferme, la cour de la ferme est lavée, astiquée à grande eau ; sa limousine est escortée par une nuée d’enfants et les petits propriétaires arabes qui s’étaient faits beaux, avec leur séroual blanc, tout de blancheur, agglutinés à ses pieds, savourent le thé à la menthe après les pesées des corbeilles. La ferme, telle que décrite dans ce passage, est le symbole de la puissance coloniale devant laquelle les cultivateurs arabes des environs, se prosternent.
La « chibania » est adoptée par les populations indigènes qui lui doivent leur survie, l’adulent par des révérences dues à cette matriarche régnant, assise dans son fauteuil de rotin, daignant acheter pour ses caves, le maigre produit viticole des Arabes qui ne font pas commerce de vin. La scène, décrite de mémoire, met en évidence deux images antinomiques : celle de la grand-mère toute-puissante dont l’arrivée à la ferme annonce les vendanges et le profit des récoltes, d’une part et, de l’autre, à ses pieds, scrutant la pesée de leurs corbeilles, le petit peuple arabe qui attend d’elle quelque obole, assis, entourant son siège en osier, centre du pouvoir et de la charité, la ferme étant devenue le centre du monde. Hors de son insertion dans la réalité historique de la conquête coloniale sanguinaire, sur le plan purement littéraire et esthétique, les mots, les images évoquant la grand-mère toute-puissante et toute de douceur aussi, sont belles, poignantes et prenantes. Son fauteuil en rotin, son ombrelle, sa grosse balance posée à ses pieds, la blancheur immaculée des habits des Arabes venus lui vendre des paniers de raisins, l’entourant, lui adressant des marques appuyées de respect, voire de dévotion, transforment la ferme, le temps des vendanges, en un microcosme idyllique d’une « Algérie française » qu’incarne la grand-mère trônant sur le petit peuple des indigènes qui, guillerets, après les pesées, concluent la vente autour d’un thé à la menthe offert par l’aïeule :
« Quand ma grand-mère arrivait à la ferme au moment des vendanges, c’était le branle-bas de combat. Kader qui conduisait la limousine, vêtu de sa blouse et de sa casquette de chauffeur, klaxonnait tout au long de l’allée d’oliviers qui menait de la route à la maison et soulevait un maximum de poussière. C’est dans un brouillard rougeâtre qu’il faisait son entrée triomphale dans la cour lavée à grande eau, récurée, balayée, brossée, fleurie. Les ouvriers, leurs femmes et leurs enfants qui attendaient excités, depuis longtemps, escortaient la voiture. Ma grand-mère en descendait et tous se précipitaient pour la toucher, embrasser ses mains et ses vêtements. C’était la chibania, la Ma, même pour ceux qui étaient plus âgés qu’elle. (…) Pendant les vendanges, le charivari régnait dans la cour dès quatre heures du matin (…) Chaque matin, vers dix heures, ma grand-mère s’installait sous un olivier près de la cave. Malgré sa capeline, elle ouvrait une ombrelle au-dessus de sa tête pour se protéger du soleil car elle avait cette carnation de rousse propre à notre famille. (…) Devant son fauteuil de rotin, on dressait une table et une grosse balance. Elle était là pour recevoir avec du thé à la menthe, les petits propriétaires arabes des environs qui avaient trop peu de vigne pour avoir leur propre cave et faire leur propre vin. Alors ils vendaient leur raisin à ma grand-mère (…) Ils s’étaient faits beaux pour venir la voir, ils avaient mis leur séroual blanc, leur tarbouch blanc et leur chemise blanche, leur grande gandoura de laine écrue qui sentait le propre. À leur taille, dans un petit étui de cuir rouge pendait le mouss, petit couteau qui servait aussi bien à trancher le pain qu’à régler les comptes. Ils arrivaient avec quelques paniers de grappes, quelquefois avec une charrette pleine. Ils touchaient du bout de leurs doigts la main tendue de ma grand-mère puis ils embrassaient leur index. Elle en faisait autant. Après ils se tapotaient mutuellement l’épaule et le dos en riant. Ils se connaissaient bien (…) Ils surveillaient attentivement la pesée puis ils s’asseyaient en tailleur auprès d’elle, par terre. Ils roulaient une cigarette. Ils ne parlaient guère. Ils regardaient en connaisseurs les va-et-vient de la cave et la quantité de raisin des autres vendeurs (…) La ferme était le centre du monde… ».(pp. 157-158)
Dans son autre roman Autrement dit, Marie Cardinal, replonge dans cette même Algérie dont elle porte les tatouages dans l’âme. Comment dire et redire le pays, la maison fondatrice, les ancêtres restés « là-bas », un pays-racine devenu, désormais, un « là-bas » comme on dirait d’un pays inconnu, loin, très loin, sans référent géographique, sans toponyme, tel un « au-delà ».
De la même fibre autobiographique que Au pays de mes racines, Autrement ditest un voyage à l’intérieur d’elle-même dans lequel elle se remémore douloureusement les événements traumatisants de son enfance vécue avec sa famille dans une ferme à Alger et la déchirure de l’Exode de 1962 :
« Nous y voilà. L’Algérie, je l’ai quittée il y a exactement vingt ans (à la date de l’écriture de ce livre en 1977), juste après la naissance de mon deuxième enfant, ma fille Alice. Elle avait un mois et mon fils deux ans quand je suis partie. Je ne savais pas, ce jour-là, que je ne reviendrais plus. Si je le savais, j’aurais scruté les détails des détails, j’aurai imprimé en moi l’heure, la chaleur, la lumière, les visages… ». (p. 12)
Le moment de la déchirure, celui du « rapatriement » vers un pays étrange et étranger dont on connaît la langue mais où on n’a pas de racines, ce moment historique de la rupture, massif et violent, les pieds-noirs l’attendaient, le pressentaient. Mais beaucoup étaient loin d’imaginer que ce serait un aller sans retour même si quelques-uns y reviendront quand même dès 1963. Évoquant ce « voyage », Marie Cardinal le réduit à sa plus simple expression, à ses plus simples corvées ; pas de quoi en faire une tragédie. Dans ses souvenirs du voyage, il y a comme un déni de soi, de territoire, d’une perte irrémédiable de ce qu’elle désigne d’abord par « ma terre » pour devenir « l’Algérie des Français » allant d’un lien possessif et intime et affectif à une désignation historique dans laquelle celle qui évoque la traversée s’en détache. Ou plutôt, précise-t-elle, elle ferme les yeux, ne veut pas voir l’inévitable, l’inexorable. Elle fait comme si ce n’était qu’un simple voyage lors duquel il faut penser aux biberons, aux couches, aux valises même si le mot « valise » prend de terribles connotations sémantiques accolées au mot « cercueil ». Mais l’auteur sait que c’est la fin de « L’Algérie française », que cette fin était prévisible mais signifie-t-elle la fin de « Ma terre », d’une appartenance à une Histoire aussi violente fût-elle ? Pour l’auteure, le voyage vers la France n’est pas une tragédie. Elle est même contente d’avoir sauvé ses enfants du drame et de rejoindre son époux en Métropole. L’auteure ne verse pas dans les lamentations de l’Exode, la déchirure profonde du Paradis perdu. Elle garde la tête sur les épaules :
« Je n’ai que les souvenirs d’une jeune femme qui voyage avec des bébés, l’un au bras, l’autre agrippé à sa jupe. Problèmes de valises, de biberons, de couches… C’était l’été, il devait faire très chaud, ça devait sentir la pisse, la poussière et la transpiration, le ciel devait être blanc. Je n’ai même pas regardé ma terre s’éloigner pour la dernière fois. La fin de l’Algérie des Français était proche mais je n’ai pas voulu la voir ; il y avait pourtant des soldats partout, des armes, des contrôles de papier. J’étais contente de sortir mes enfants de là, d’aller en France, rejoindre mon mari qui venait d’être reçu à l’agrégation… ». (pp. 12-13)
La blessure qu’elle ressent n’est pas dans la perte de « l’Algérie française » puisqu’elle ne se considère pas « Française » ni tout à fait Algérienne, elle réside dans la perte du territoire de l’enfance, de son enfance vécue à Alger, qui fut pour elle la première terre où elle a ouvert les yeux sur le monde, où chaque fois, se souvient-elle, qu’elle rentrait de France avec ses parents elle retrouvait la gaieté, la joie de vivre après des séjours sinistres en France où tout s’éteint en elle « Je détestais la France » écrit-elle sur un ton véhément car le pays est guindé, sévère, droit, obtus, mortifère. Deux images, deux mondes s’opposent dans les souvenirs d’enfance de l’auteur : Alger de lumières et de liberté ; La France (sans précision de localités) lourde d’histoire, de vieilleries et de rectitudes de traditions bourgeoises. Ce désir de retour vers sa ville natale n’est pas qu’un souvenir d’enfance qu’elle se remémore ; c’est une obsession qui l’habite et a grandi avec elle. L’interférence entre l’évocation de ses retours dans sa ville natale dans son enfance et le même désir de retour vingt années après l’exil dans l’âge adulte est symptomatique du mal des origines. C’est le même désir de retour, mais celui gardé de l’enfance est magnifié alors que l’âge adulte transforme ce désir de retour en rêve.
« Aujourd’hui je rêve souvent de retourner à Alger et j’imagine que ça se passera comme ça se passait quand j’étais petite (…) quand j’étais petite, à chaque fois que je rentrais à Alger, je pleurais de joie. (Peut-être que je pleurerais aujourd’hui aussi si j’y retournais). Je détestais la France, ma famille bien élevée, les rois, les châteaux, les victoires, les gloires, les monuments, les grands magasins, les boulevards, le climat tempéré, la fine pluie distinguée d’été. Pour moi, c’était l’enfer ; toujours faire attention à se tenir correctement, à manger correctement, à être habillée correctement. Merde ». (p. 15)
La perte du territoire de l’enfance qui se trouve être celui-là qui s’éloignait, s’éteignait à mesure que le bateau de l’exil s’arrachait du port d’Alger, est inguérissable ; elle n’appartient pas au temps historique, à la guerre, au FLN, à l’OAS, mais au temps mythique des origines. Le grand récit mémoriel des pieds-noirs c’est celui de la terre originelle, biblique, celle des racines au-delà de leur contexte d’horreurs coloniales. Cet appel du retour, lancinant, angoissant, se dit sur le ton de l’incantation. Cet appel-désir lancinant d’un autre « abordage », – c’est le mot de l’auteur – celui-là de pèlerinage, bute sur la peur, une peur d’y retrouver les origines, les morts, les tombes, la lignée restée là-bas ; comment alors s’en séparer à nouveau ; peur aussi de voir ressurgir les fantômes sanguinolents de l’Histoire portant des « casques coloniaux » ou des « ombrelles de dentelles », « des sentinelles dérisoires d’une histoire passée, détestable » ; peur également de réveiller les voix depuis trop longtemps éteintes en elle, celles des terres d’enfance, polysémiques : enfance, soleil, cimetière, voix, désir de vie, désir de mort en elles.
Cette terre est fertile en « nostalgérie », c’est un univers fantasmagorique qui relève de la paranoïa des racines défaites. Le télescopage entre l’instant présent de l’auteure qui en vit le manque profond et qui se signale par les verbes commentatifs « je pense », « j’ai un désir », « j’ai peur », « je crois » et le temps du désir fantasmé du retour exprime une forte tension pathologique. L’auteure est comme tiraillée entre l’irrépressible appel de « sa terre » qui l’habite et qu’elle habite et la crainte, si elle y retournait, de faire ressurgir en elle l’Éden perdu. Le ton n’est pas larmoyant quand elle évoque « sa terre » ; il est fait de secousses, de frayeurs, de visions cauchemardesques et féeriques, proche de celui d’un conte fantastique ; la terre devenant une « méduse gluante ».
« … Je pense souvent à cet abordage de ma terre. J’ai un désir profond d’y être de nouveau, de la sentir, de la humer, de la toucher. Mais j’ai peur en même temps, si j’y retournais, d’être assaillie et ligotée par la méduse gluante du sentiment, de l’attendrissement, des souvenirs de famille. Je pense déjà au cimetière de Saint Eugène où sont enterrés mon père et ma sœur, je crains d’y aller, de me réfugier sur la dalle blanche où sont gravés leurs noms, semblables au mien, et de n’en plus bouger considérant que c’est là chez moi – désormais. Alors que je connais peu – ou pas – ces deux morts qui restent là-bas comme les sentinelles dérisoires d’une Histoire passée, détestable. J’ai peur des fantômes affublés de casques coloniaux, d’ombrelles de dentelles. J’ai peur des maisons fraîches dont les portes me seront fermées. J’ai peur des ruines de la guerre. J’ai peur des voix qui m’appelleront de partout, des rues, des jardins, de mon école, des immeubles, du port, de collines, de la campagne. Je crois que je les entendrais, que je susciterais même leurs cris ou leurs gémissements, peut-être que je me laisserais prendre par elle, alors que je n’ai d’attirance que pour la terre elle-même, telle qu’elle est ; dure à cultiver, rouge, sèche, propice au thym, au lentisque, au pin maritime, à la vigne, chaude. Trop chaude… ». (p. 16)
Ode à la terre au sens absolu, métaphysique. Le lien qu’exprime l’auteure est charnel, fusionnel. La réitération poétique de « je sais » au sens intime de l’expression, transforme « cette terre » en appels délirants ; images d’une terre arpentée dans ses manifestations végétatives, lyriques, exotiques, charnelles, fondées par le chantre de la romanité méditerranéenne Jean Grenier et présentes dans Noces et L’Exil et le Royaume de son disciple, Albert Camus. Cet éloge païen à la terre conquise ignore l’Histoire. Elle est ainsi soustraite au temps historique – qui a un début et une fin – pour renaître dans le temps mythique. En disant « cette terre, je la connais par cœur », Marie Cardinal met sur le même plan l’ivresse des sens que lui procurent les plantes, les bêtes, les roches, les chants de la nature sauvage, dans une sorte de paganisme préhistorique ; tout cela peint dans une sensualité animale ; même les « gourbis » sont fondus et confondus dans ce décor languissant du paysage méditerranéen féerique et poétique. Dans le passage qui suit, la réitération de « Je sais » exprime dans ses résonances polysémiques, une absence, une soif de tout ce qu’elles contiennent, énumérées dans un cantique déchirant. «… Cette terre, je la connais par cœur. » L’effet de style introduit par l’expression « par cœur » suggère un apprentissage mnémonique, mais la relation entre « terre » et « cœur » dépasse la mémoire verbale et inscrit cet énoncé dans une sémantique de l’attachement viscéral et instinctif. Quelles images énumèrent-elles de cette terre ? C’est d’abord la mémoire gustative avec l’évocation de la vigne (symbole agraire du colon) et des olives : « Je sais tout d’elle. Je sais où son raisin est le meilleur, le plus sucré, je sais où ses olives sont les plus grosses. ». Ensuite, la mémoire visuelle de paysages sauvages, vierges, saisis sous le regard évocateur, dans ses moindres frémissements de vies animales insaisissables à l’œil nu, cachées dans les abris et les tanières : « Je sais le moindre de ses vallonnements, je sais où l’érosion met ses cailloux à nu comme des os, je sais comment la pluie la fait rougir. Je sais où elle donne des tulipes sauvages, du genêt et des pâquerettes. Je sais où sont les abris de ses hérissons, de ses caméléons et de ses tortues, les tanières de ses chacals… ».
Puis, dans ce chant de la terre pure, magnifiée par le manque obsessionnel, elle convoque l’autre paysage, celui de l’indigène par son « habitat » similaire aux abris et aux tanières des animaux. Les termes de « gourbis » « Raïmas » (Kheimas – tentes) ne prennent sans doute pas dans cette accumulation des pertes magnifiées, un sens péjoratif. Ces habitats qui ne sont pas ceux du colon, appartiennent aussi à la terre perdue, mais seulement comme décor, constitutif du paysage sans présence humaine : « Je sais chacun de ses gourbis, de ses raïmas et de ses douars, je sais les chemins, et même les raccourcis, pour y aller, l’odeur de sarments brûlés qui les annonce… » ; vision enchantée d’un paradis dont les pertes ne sont pas matérielles ou conjoncturelles, mais celles de la vacuité d’une âme asséchée, orpheline de toutes ces profusions nourricières :
« Je sais la mélodie de la flûte, au crépuscule, qui prélude à la douceur de ses nuits. Je sais surtout ce qu’elle m’a appris : non seulement les cheminements de ses fourmis, la folie de son vent, mais aussi le mystère de ses gestations. Je sais la vélocité grouillante de la décomposition dans l’immuabilité pesante de la chaleur, le bonheur de boire quand on a soif, le malheur de ne pas boire quand on a soif. Comment séparer le corps et la terre ; un corps-terre fusionnel. Le pied-noir depuis l’exode vit « le corps ici et le cœur là-bas » : Mon corps a été façonné par elle. Pour toujours, il ne saura aborder le monde que comme elle lui a appris de l’aborder, elle. La plante de mes pieds sait la suavité de sa boue et le coupant de ses roches. Ma gorge a été formée par sa musique et son langage. Je n’ai pas d’autres rythmes que les siens… ». (p. 20)
Ce lien quasi charnel avec la terre des origines cède pourtant à l’explication historique dont le discours est commun à tous les romans autobiographiques ou d’autobiographies romancées écrits par des pieds-noirs : la filiation honorifique à la colonisation ; une double colonisation : celle du soldat et de son étincelante baïonnette et du laboureur avec son étincelante charrue. Marie Cardinal gomme le premier et toutes les horreurs qu’il a commises sur l’autochtone et ne retient que l’image idyllique du second. Ce filtrage de l’histoire de la colonisation est un invariant fictionnel du roman pied-noir. Les massacres de populations indigènes, la violente dépossession des terres, la farouche résistance des paysans dès le débarquement, les horreurs des réalités abjectes de la colonisation, tout cela n’est point dans la généalogie du récit mémoriel du pied-noir. Marie Cardinal dit sa fierté d’appartenir à une lignée de « propriétaires » d’une « une famille de colons ». Ainsi, toute la poésie charnelle et érotique contenue dans la scansion « ma terre » comme une entité absolue, hors du temps, devient un bien matériel, une possession comme héritée par des générations de colons « fiers » de l’avoir fécondée. L’auteure revendique son appartenance à une filiation ancestrale « fière de leur colonisation ». Mais que signifie au juste le mot « colonisation » dans l’acception familiale et romantique que lui confère l’auteure ? :
« Finalement, ce que je crains, c’est d’être confrontée à la vérité de mon amour pour cette terre que j’ai possédée. Je suis née propriétaire, fille de propriétaire, petite-fille de propriétaire, arrière-petite-fille… etc. (…) J’appartenais à une famille de colons fiers de leur colonisation, fiers du mal qu’ils s’étaient donnés pour cultiver le sol. D’ailleurs, il y avait de quoi être fier quand on voyait les champs de vignes strier le paysage jusqu’à l’horizon, quand on se promenait dans les orangeraies, au parfum entêtant, dont les damiers de soleil et d’ombre tapissaient les plaines… ». (p. 20)
C’est là le mythe de l’identité pied-noire des origines. Dans Sur l’Algérie, discours de Tocqueville, l’idéologue de la conquête, il est question dans les premières années de la conquête du problème de la colonisation, autrement dit comment « peupler » le pays conquis et exploiter les terres. Nous rapportons un passage de la présentation du livre par Seloua Luste Boulbina :
« Bien entendu, les expropriations étaient justifiées au début par l’idée selon laquelle la terre, en Algérie, n’appartenait à personne, ce qui accréditait le nomadisme supposé des habitants de ce pays. Les déportations étaient donc monnaie courante. En 1841, Tocqueville souligne que les indigènes craignent en tout premier lieu qu’on les dépossède de leurs terres, et que cette inquiétude est la cause des insurrections. Pour arriver à coloniser avec quelque étendue, il faudrait nécessairement en venir à des mesures non seulement violentes, mais visiblement iniques. Il faudrait déposséder plusieurs tribus et les transporter ailleurs, où vraisemblablement elles seraient moins bien… ».
C’est ainsi que Tocqueville relève le caractère mensonger des documents sur lesquels la Chambre se fonde dans sa politique algérienne. Il le consigne dans ses notes de voyage : « Il nous paraît aussi de notoriété publique ici, tant près des administrations que des administrés, que la plupart des choses distribuées aux chambres sur l’Algérie sont remplies de mensonges et ne méritent aucune foi quelconque. ». À dire vrai, il s’agit moins d’ignorance que de mauvaise foi. Le nomadisme et la loi musulmane avaient alors bon dos ! Ce n’est qu’assez tard, en 1847, que Tocqueville reconnaît :
« Les populations qui repoussaient notre empire n’étaient point nomades, comme on l’avait cru longtemps, mais seulement beaucoup plus mobiles que celles de l’Europe » ; à la différence de nature entre les peuples succède la différence de degré. Mais, comme il le confesse, « on ne peut étudier les peuples barbares que les armes à la main…5 ».
Sur les lois d’expropriations foncières, les regroupements des paysans algériens dépossédés de leur terre autour des villages coloniaux, Tocqueville écrit :
« Il n’y a en général rien de plus dangereux dans un pays nouveau que l’usage fréquent de l’expropriation forcée. (…) Je ne saurais trop me plaindre de l’abus qu’on en fait chaque jour en Algérie. Mais, dans le cas présent et dans ce désordre prodigieux de la propriété, un pareil remède, administré une fois pour toutes en une seule dose, est nécessaire. Il faut de toute nécessité arriver à ceci : fixer à l’aide d’une procédure sommaire et d’un tribunal expéditif, établi pour cette seule occasion, la propriété et ses limites… Voilà enfin un gouvernement maître d’une grande partie du sol soit par droit de conquête, soit par achat volontaire, soit par expropriation forcée. Que va-t-il en faire et comment le peupler ? Il a à ce sujet plusieurs systèmes ; mais tous s’accordent et doivent s’accorder en un point : savoir la nécessité de ne point laisser la population s’éparpiller dans la campagne et de la forcer d’habiter dans des villages que l’État fortifierait à ses frais et dont il confierait la défense à un officier de choix… L’administration doit cadastrer avec soin le pays à coloniser, et autant que faire se pourra, l’acquérir afin de la revendre à bas prix aux colons quitte de toute charge. Elle doit fixer l’emplacement des villages, les fortifier, les armer, les tracer, y faire une fontaine, une église, une école, une maison commune et pourvoir aux besoins du prêtre et du maître… Cela fait, il faut laisser le colon se placer où il le veut, cultiver comme il l’entend… ». Chapitre Travail sur l’Algérie. (pp. 140-141)
La date de 1830 est pour Marie Cardinal celle de la naissance, de la fondation ancestrale, des origines, du peuplement européen des terres « vierges » d’un pays innommé, vaste superficie sans propriétaires si ce n’est une poignée de « burnous » qui ne demandent qu’à être asservis. L’auteure a le mérite d’être claire sur ce sujet ; elle dit tout haut ce que le pied-noir pense tout bas :
« Car, en 1830, dans ce pays qui était cinq fois plus grand que la France il n’y avait, en fait de main-d’œuvre, que quelques tribus nomades éparpillées sur tout le territoire, même pas un million d’habitants. C’est plus tard que les burnous se sont multipliés et qu’on les a fait suer, n’établissant pour ainsi dire pas de différence entre eux et les chèvres qu’ils gardaient… ». (p. 18)
Et, le dur combat contre la terre sauvage l’emporte sur les réalités historiques. Marie Cardinal dresse un plaidoyer dithyrambique de la colonisation dans Autrement dit. Pour l’auteure, il a donc fallu tout un siècle au colon pour domestiquer et féconder cette « glèbe sauvage » qui, sans la témérité et les sacrifices séculaires du conquérant ne serait qu’un « terrain lointain et sauvage », un no man’s land stérile. L’Algérie a été donc faite par le colon. « Les terres étaient grandes là-bas. Les fermes étaient des pays », écrit-elle. Cette vision, idyllique, est un pur fantasme de cette « nostalgérie » qui ne veut voir et retenir du colon que sa lutte épique contre les éléments naturels ; tout cela hors de la réalité historique, celle de la conquête, et de ses désastres :
« Cent ans. Il leur a fallu à peine cent ans pour voir l’Algérie nue de la conquête couverte de vignes, de céréales et d’agrumes. Dans ma famille, on parlait souvent de la terre salée qu’il avait fallu dessaler, des marais infestés de moustiques à malaria qu’il avait fallu assécher ; de ce pays conquis deux fois : par les soldats et les laboureurs. Les colons avaient tant investi dans cette glèbe revêche, où étaient venus les premiers-nés et où étaient enterrés les premiers morts, ils avaient tant donné à ce terrain lointain et sauvage, qu’ils ne considéraient pas leurs fermes comme des conquêtes ou des appropriations mais comme des propriétés privées, fruits de leur sueur, de leur courage et de leur ténacité. D’autant plus qu’au commencement, l’Algérie, ils l’avaient faite seuls… ». (p. 17)
Pourtant, l’auteure se rend à une évidence : l’Algérie des Français est une lubie ; elle devait fatalement disparaître. Mais comment expliquer l’origine de cette agonie ? À qui la faute ? Sur le ton de l’ironie, elle accuse les appelés du contingent qui n’ont pas rallié l’OAS, et dont plusieurs ont dénoncé la torture pratiquée par leur armée. Marie Cardinal les traite de « petits Français du contingent » que haïssaient les riches colons viticulteurs qui vouaient une admiration aveugle aux parachutistes anciens de l’Indochine. Nombre de romans soulignent l’antagonisme sourd entre l’appelé du contingent, novice, idéaliste, pacifiste et antifasciste au para tortionnaire aguerri aux maquis indochinois, aux tortures sous toutes ses formes, subies par eux sous l’occupation allemande et infligées en Indochine et en Algérie. Cette « Algérie des Français » née en 1830 a donc une fin, elle s’est éteinte comme elle a commencé, dans la violence :
« L’Algérie des Français ne pouvait que mourir. Elle est morte dans des douleurs atroces, inoubliables pour ceux qui les ont vécues. La France tout entière a été marquée par l’agonie de l’Algérie française. Car les « petits Français » du contingent ont vu là-bas des horreurs qu’ils n’auraient jamais dû voir et le million de rapatriés a gangrené le continent de ses blessures infectées… ». (p. 20)
La mort fatale de cette « Algérie des Français » a, selon Marie Cardinal, infesté toute la Métropole dont elle est « une honte » et, comme telle, entend bien la cacher, la nier. Ce n’est plus l’indigène qui forme à peine une peuplade nomadisant à travers un territoire qui le dépasse, voire qu’il ne mérite pas, mais, avec la disparition de l’Algérie des Français, entendre celle qui a été créée et fructifiée par les colons français, ce sont les Français d’Algérie qu’elle qualifie de « peuplade bâtarde » errante, condamnée éternellement à l’exil.
« Les Français d’Algérie forment une peuplade bâtarde qui n’est ni française ni algérienne, dont l’histoire n’est pas assez longue pour en faire un peuple, mais suffisamment longue et intense toutefois pour faire de leur dernière génération des irrécupérables. Hors de chez eux, ils sont comme des vers grouillant dans les fruits… ». (pp. 21-22)
Ce n’est pas une déchéance, mais une destruction, la fin d’un monde idyllique, fragile dans ses fondations faites d’usurpations. Bien sûr, il ne s’agit pas là de réfuter la violence du déracinement des pieds-noirs d’Algérie ni même de ne les voir qu’à travers le prisme des complaintes victimaires. Le livre de Pierre Nora LesFrançaisd’Algérie est suffisamment éloquent à ce sujet. Pourtant, cette « Algérie des Français » – l’auteure évite l’expression « Algérie française » – l’auteure en a vécu enfant hors des espaces européens, le « côté confortable ». Elle s’est frottée à celle des indigènes au cœur d’Alger, parqués dans les cités dites du « Plan de Constantine6 ». Elle a dix ans et fête son anniversaire ; sa mère accepte qu’elle l’accompagne dans sa tournée d’étrennes dans les quartiers pauvres, les bidonvilles des indigènes pour une distribution d’effets vestimentaires et d’aliments, de « cadeaux » lors de l’hiver 1939-1940. C’est la première fois que la petite fille sort de son monde calfeutré, où elle mange à satiété, s’habille telle une princesse, a des jouets de rêve. Elle découvre un monde de pauvreté et de misère nues. Elle a honte de sa mère de la voir faire œuvre de charité de manière ostentatoire, presque insultante. Et d’elle-même aussi, prenant conscience, précocement, de l’univers mensonger de la colonisation :