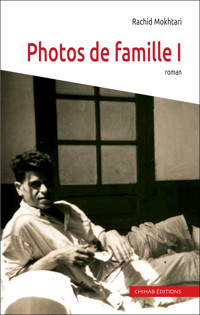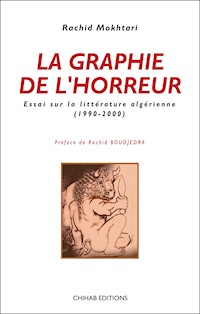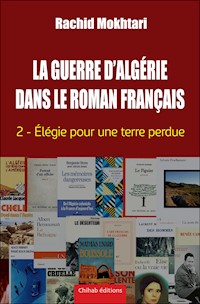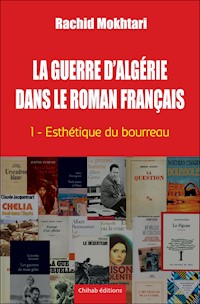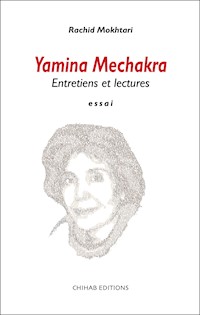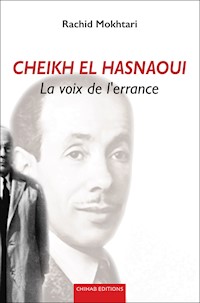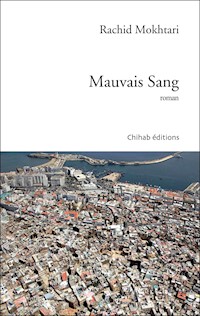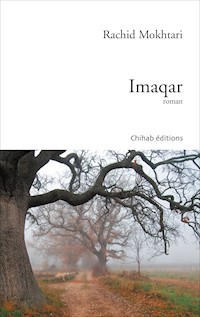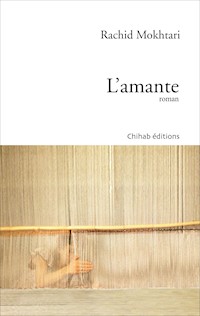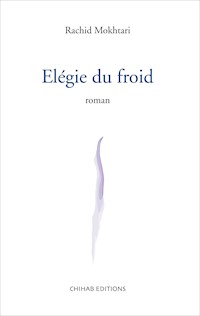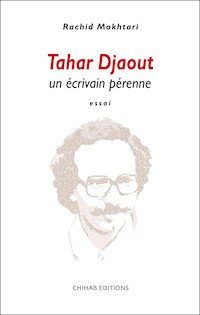
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Cet essai propose une relecture de l’œuvre romanesque de Tahar Djaout composée de L’Exproprié (Sned, 1981), Les Chercheurs d’os (Seuil, 1984), L’Invention du désert (Seuil, 1987), Les rets de l’oiseleur (Enal, 1984), Les Vigiles (Seuil, 1991) et son roman posthume, Le Dernier Été de la raison (Seuil, 1999).
Cette lecture se veut un espace de synthèse de travaux universitaires sur les différents aspects thématiques et esthétiques des romans de Tahar Djaout. Elle répond également au souci pédagogique et didactique d’une approche globale qui s’intéresse à la totalité de l’œuvre romanesque de Tahar Djaout non à l’un ou l’autre de ses romans comme cela a été fait précédemment. Cette démarche synchronique, n’occulte pas en revanche, une analyse interne d’un roman à l’autre. Ces deux mouvements constituent la démarche de cet essai.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rachid Mokhtari est universitaire, journaliste, romancier et essayiste. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés à la littérature algérienne. Après Elégie du froid, Imqar, L’amante. Spécialisé dans la critique littéraire et artistique, il a publié plusieurs essais consacrés à la sensibilité algérienne : Tahar Djaout, un écrivain pérenne est son troisième essai après la Graphie de l’Horreur et Le Nouveau souffle du roman algérien. Rachid Mokhtari anime parallèlement des émissions consacrées à la littérature sur les ondes de la chaine II et III de la radio algérienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TAHARDJAOUT,
UNÉCRIVAINPÉRENNE
RACHIDMOKHTARI
TAHARDJAOUT,
UNÉCRIVAINPÉRENNE
essai
CHIHABEDITIONS
DUMÊMEAUTEUR
MatoubLounes, biographie. EditionsLeMatin, 1999.
Lachansondel’exil, lesvoixnatales1939-1969, essai. EditionsCasbah, 2002.
CheikhelHasnaoui, lavoixdel’exil, essai. EditionsChihab, 2002.
Lagraphiedel’Horreur, essai. EditionsChihab, 2003.
Elégiedufroid, roman. EditionsChihab, 2004.
SlimaneAzem, AllaouaZerroukichantentSiMuhandUM’hand, essai. EditionsApic, 2005.
Lenouveausouffleduromanalgérien, essai. EditionsChihab, 2006.
Imaqar, roman. EditionsChihab, 2007.
L’amante, roman. EditionsChihab, 2009.
© ChihabÉditions, Alger, octobre2010
Isbn : 978-9961-63-831-6
DépôtLégal: 3053-2010
Préface. DONNER A LIRE TAHAR DJAOUT
Je le dis et le redis encore : donner à lire Tahar Djaout, le compagnon, l’ami etle journaliste, l’homme éblouissant et drôle, exigeant, discret, attentif et plein d’esprit.
Donner à lire comme donner à voir « un peu plus » que la simple vision, à entendre, écouter et relire encore une fois l’écrivain et son œuvre, le conteur, l’homme engagé par son désir d’écriture, certes, mais surtout de poésie.
Inscrire la fascination poétique dans une œuvre romanesque, comme l’a fait Tahar Djaout, pour éviter que la seule pensée, ou la pensée solitaire du poème ne demeure au-dessus de nous, manifestement comprise et incomprise, irrecevable.
Et, si le monde allait bien, si la terre et l’éther, l’air, les odeurs que nous respirons, allaient bien, sentaient bon, se trouvaient joliment habillées de nos espoirs et de nos vérités, paroles ouvertes bonnes à entendre, si les rivières et les torrents se portaient bien, allaient à leurs occupations de fraîcheur, de voyages, de rêveries incidentes et de saveurs, de fleurs, de vies alertes, de soleils répartis, brillants comme des étoiles perdues dans la nuit, entourées de légendes, et s’abreuvant aux parfums de vies, aux partages des mondes, des nourritures, du temps, des richesses, des héritages ; si la mer et ses rivages émouvants, ses vagues alléchantes et violentes d’embruns, se portait – oui, la mer, proche et riveraine – elle aussi, au-devant des mirages, des embarcations fragiles où gisent déjà des enfants à peine nés, filles et garçons, femmes et hommes – et bientôt des vieillards, partiront-elles-ils-un jour ? – sur elle ? oui, la mer, pour connaître, conquérir des mondes, ceux qui auraient été faits pour accueillir les générations nouvelles, naissantes, filles et garçons nés, enfin nés dans un pays de vies, de rêves, de découvertes et de destins ; si les routes nous emmenaient sans embûches, ni pièges, sans crimes et sans irruptions, sans méchancetés, ruses ou meurtres d’un bout à l’autre de nos vies – en flânant un peu, par-ci par-là, en se promenant un peu – ; si les paroles blessantes, les injures, la délation, les désespoirs, les mensonges, ne l’emportaient sur les racines, Le Dernier Été de la raison, comme l’écrivit Tahar Djaout, pour demeurer, et vivre, parmi nous, les chemins de terre et, même, ceux goudronnés, les lieux imaginés, les lieux imaginaires, les feuillus, les librairies, les bibliothèques, les oiseaux, les chemins de replis et d’immigration ; et si au juste, tout ce que nous avons évoqué, et plus encore, allait bien, aurions-nous encore quelque nécessité à écrire, traquer ou prendre le poème, poursuivre les terres du roman dans les talwegs, les déserts, les villes et les cités, les ombres, les disparus, les torturés, les prisons, les pensées, l’entêtement, comme l’écrit justement Rachid Mokhtari dans son livre, sur l’œuvre romanesque de l’ami, l’écrivain, le journaliste et poète, Tahar Djaout « la première victime de l’entêtement des intellectuels algériens », même si, pour ma part, je ne parlerai pas d’« entêtement » mais de « la première victime parmi… » ; oui, même si le monde était devenu « bon », ce qui n’est pas, et pour cela même, comme cela se passa dans des temps pas très reculés pour Mouloud Feraoun, lui aussi assassiné, aussi inutilement, absurdement et injustement, sans recours. Donner à lire Tahar Djaout comme le fait dans ce livre Rachid Mokhtari peut apparaître comme une sauvegarde fragile, indispensable contre les nuits de la terreur, de la création, de l’humain, de l’esprit.
Nabile Farès
Paris, mai 2010
AVANT-PROPOS
Cetessaiproposeaulecteurunerelecturedel’œuvreromanesquedeTaharDjaoutcomposéedecinqromansécritscoupsurcoupaprèssesrecueilsdepoésie1 : L’Exproprié(Sned, 1981), réécritetpubliésouslemêmetitredixannéesaprèslapremièreversion (FrançoisMajault, 1991), LesChercheursd’os (Seuil, 1984), L’Inventiondudésert(Seuil, 1987), Lesretsdel’oiseleur (Enal, 1984), Les Vigiles (Seuil, 1991) etsonromanposthumeLeDernierÉtédelaraison (Seuil, 1999) dontlemanuscritdatede1992ainsiquel’indiquelanotedesonéditeur, leSeuil : « TaharDjaoutaétéassassinéle2juin1993. Quelquessemainesauparavant, lorsd’unséjouràParis, ilnousavaitannoncéqu’ilavaitentreprisunnouveauroman, maisqu’iln’enétaitqu’autoutdébut. Lemanuscritquenouspublionsaujourd’huiaétéretrouvédanssespapiers. Ilnousestparvenuaprèsbiendespéripéties. Ilnecorrespondpasausujetqu’ilnousavaitindiqué. OnpeutpenserqueTahar, deretouràAlger, adécidédemettredecôtéleprojettrèslittérairedontilnousavaitparlépourseconsacreràunrécitplusdirectementinspiréparl’actualité… » Lapériodesismiquedel’Algériepost-indépendanceallantde1980à1990aétéprolifiquepourleromancierquiacesséd’écriredelapoésie « parprofondrespect »2pourcegenre.
C’estunedécenniericheetlourdepourl’histoirecollectivedel’Algérie, d’uneAlgérietumultueuse. Elles’ouvresurlePrintempsberbèredéclenchéaprèsl’interdictiond’uneconférencedeMouloudMammerisurlapoésiekabyleanciennequ’ildevaitdonneràl’universitédeTiziOuzou (DjaoutnerevientpassurcesfaitsdansMouloudMammeri, entretienavecTaharDjaout, Laphomic, 1987) ets’achèvesurlesprémissesdeladécennienoireetrougedontilestlevigilanttémoin, etmalheureusementlapremièrevictimedel’entêtementdesintellectuelsalgériens. Entrecesdeuxdates, ilyeutOctobre1988queTaharDjaout, journaliste, accueilledanslescolonnesdel’hebdomadaireAlgérie-Actualitéavecencoreplusdevigilanceetdevisioncritiquesurlesnotionsdedémocratie, delibertéd’expressionengageantencoreplusl’intellectuelàl’effortidéelàcausedurisquedelesvoirsitôtnées, folklorisées, surannéesoudevenirréclamespourdesenjeuxpartisans.
L’implicationdeTaharDjaoutsemanifestedanssesécritsjournalistiquesparunesériedeportraitsd’écrivainsetd’artistesquin’avaientpaslaparoleautempsdupartiuniqueet, danssonœuvreromanesqueparladérisiondel’Histoirefigéeparlapropagandeofficielleetparlalibertédetonetlaprécisiondesmotsparlesquelsilconvoqueles hérosfondateursdel’histoiredelaBerbérieetduMaghreb, danslaveinedeKatebYacineetdeNabileFarès. L’oppositiondeTaharDjaoutaudiscoursofficieldupartiuniquen’estpasfrontale, elleseconstruitparuntravailminutieuxsurlalanguelittéraire.
LesromansdeTaharDjaoutformentununiversromanesquecohérentdanssastructurethématiqueavecsesinvariantsousesrécurrences : l’histoirecollectiveentravéeetl’histoireindividuellelibérée, leterritoiredel’enfanceetl’omniprésencedesoiseauxquisymbolisentlemouvementsicheràl’auteur.
Danssaconstructionformelle, cetuniversromanesquesemblepartird’uneécriturelapluscomplexe(L’Exproprié) àuneécriturelaplusdépouillée (LesVigiles), voireàlaplusimmanenteàl’événement (LeDernierÉtédelaraison). CelasembleêtrecorroboréparlaréécrituredesonpremierromanL’Expropriédontladeuxièmeversionestexpurgéedetouslessignespérigraphiquesaccumulésdanslapremièreversion. Surcepointprécis, TaharDjaoutfaitfiguredepionnierdanslalittératurealgériennequi, ànotreconnaissance, ne comptepasderomansréécritsparleurauteur. CequiattestechezTaharDjaoutunsoucideperfection, unepréoccupationpermanented’esthète, deceluiquiconsidèreuneœuvred’artdanssamouvanceetnondanssafixité.
L’œuvreromanesquedeTaharDjaoutpuisesesracinesdanslarébellionesthétiquedeshéritiersdeNedjma, enl’occurrenceNabileFarèsavecsatrilogiesouslegénériqued’unehistoireprospectiveAladécouverteduNouveauMonde3.
Cespréalablesposés, lalecturequiestfaiteici, desesromansn’éludepaslesoufflepoétiquequiportel’œuvreromanesque ; uneœuvrenovatrice, pérenne, quis’offreàlireetàreliredanssacomplexitéetsasimplicitéàlafois, danssesfaisceauxdesensetdanssesconstellationsdesignes.
Cettelecture, parmid’autrespluspointuesfruitsdelonguesrecherchesuniversitaires, seveutunespacedesynthèsedetravauxuniversitairessurlesdifférentsaspectsthématiquesetesthétiquesdesromansdeTaharDjaoutd’unepart, etdel’autre, lesoucipédagogiqueetdidactiqued’uneapprocheglobalequis’intéresseàlatotalitédel’œuvreromanesquedeTaharDjaoutetnonàl’unoul’autredesesromanscommecelaaétéfaitprécédemment. Cettedémarchesynchronique, n’occultepasenrevanche, uneanalyseinterned’unromanl’autre. Cesdeuxmouvementsconstituentladémarchedecetessai.
L’œuvreromanesquedeTaharDjaoutestmouvantecommelesdunesd’undésertdontilaimel’imprévisible. Cettemouvanceestd’abordattestéeparlamultiplicitédesdiscoursquilacomposentetparuneactivité « sismique » desastructureformelle : lessujetsénonciateurssedédoublent, racontent, seracontentetsontracontésdansunbrouillagesyntaxiquedifficileàdissiper. Elleestparailleursconfortée, ainsiquenousl’avonssoulignéplushaut, parlaréécritureexterneetinternedel’œuvre.
Externe : L’Exproprié, ceromaniconoclasteaétéréécritetrepublié. Interne : despassages, desfragmentsvoyageursseretrouvent, disséminésd’unromanl’autre. Cetteréécritureinterneconfèreàsonœuvreàlafoisunecohérencethématiqueetunecomplexitédiscursive. Lecheminementdel’écritureromanesquedeTaharDjaoutsemblepartirducomplexe, duconnotéetdel’éclatéverslesimple, ledénotéetlechronologique.
DeL’ExpropriéauromanLesVigiles, l’écrituredjaoutienneévolueselonlestermes photographiques, du « négatif » versle « développé » danslachambrenoire.
Desextraitsdesonœuvre, desrelevésdechampslexicauxdonnéssousformedetableauxsynoptiquesainsiquedespointsdesynthèsespartiellespermettentàtoutlecteurd’ensuivrelecheminement. L’objectifrecherchédanscetessaiestd’illustrerleconceptromanesquedeTaharDjaout. Quelssontlesliensinterromans, s’agit-ild’unmêmeRomandonnéàliresousdifférentesversionsfictionnelles ? Uneméta-fictionmouvante ? Ayantpubliédansunlapsdetempsrelativementcourtpouruneœuvreaussidense, TaharDjaoutécrivait-ilsesromansdansunprojetd’architecturelittéraireprospective,àlarechercheduNouveauMondefarésienquiexige, pouryaccéder, ladéconstructiondesmythesfabriquésparl’histoireofficielle, pours’engouffrerdanslesprofondeurslabyrinthiquesdupasséprofonddel’Algérieetdesaproprehistoire.
IlestsansdouteutiledepréciserqueleprésentessaicontinueLaGraphiedel’Horreur4dontledernierchapitreportesuruneanalyseduroman,paruàtitreposthumedeTaharDjaout, LeDernierÉtédelaraison. Danscettecontinuité, l’œuvredeTaharDjaouts’insèredanscelledespèresfondateursduromanmaghrébinmoderne, enmêmetempsqu’ellelaprolongeetlavivifie. IlseveutégalementlabaseréférentielleauNouveausouffleduromanalgérien5.
INTRODUCTION
Tromper la vigilance des gardiens d’un train prison dans lequel le narrateur, se métamorphosant sans cesse, voyage dans une géographie introspective, tourmentée, en proie aux délires et aux réminiscences de fragments de mémoire qui se télescopent ; fouiller aux premiers jours de la Fête, la terre reconquise et rapporter à dos d’âne au cimetière ancestral les ossements incertains d’un maquisard tombé au champ d’honneur ; travailler à améliorer en le modernisant le mécanisme d’un vieux métier à tisser dans une banlieue sous l’œil inquisiteur d’autres gardiens, vigiles qui veillent à réprimer tout dynamisme de la création ; résister au nouvel ordre des vigiles FV (Frères Vigilants) par la nostalgie des livres et de la musique interdits au nom du Livre… ; l’œuvre romanesque dont le générique pourrait être L’Exproprié, titre de son premier roman, est au centre de ces turbulences dédaléennes de la mémoire.
Dans la première version de L’Exproprié, le narrateur est comme déraciné d’un lieu référentiel, Iboudja et il tourne en dérision les dieux et son statut de romancier ; la terre des martyrs sitôt l’indépendance recouvrée devient Le petit arpent du Bon Dieu d’Erskine Caldwell6 de croque- chouhadas.
Avec Les Vigiles, Mahfoudh Lemdjad se voit refuser le brevet pour son invention d’un métier à tisser modernisé. Dans son roman publié à titre posthume, Le Dernier Été de la raison, le nouveau règne des FV déclare l’intellect et les arts impies. Le dernier libraire de la capitale, dépossédé de son royaume de la connaissance, se retranche en vain dans le monde de son enfance.
En profondeur, toutes ces vivisections touchent à la castration du Sens – à la Sensure – et, partant, à l’ablation, au sens chirurgical du terme, préméditée de la mémoire sémantique à l’échelle collective et individuelle. Sur le plan purement esthétique, le télescopage des bribes de genres littéraires dansL’Exproprié, la réduction des phrases à leurs constituants vitaux, sans expansions dans Les Vigiles, la quête macabre desChercheurs d’os dans un paysage féerique, permettent d’illustrer les entreprises de cette ablation de la mémoire qui ne supporte aucune prothèse. Dans l’œuvre romanesque de Tahar Djaout, cette mémoire n’est pas un espace-temps sécurisant, un héritage sédimenté et rassurant. Son écriture en est une complète déroute, une perpétuelle interrogation sur la création d’un nouveau langage littéraire qui brouille les pistes, efface les traces et déboussole les repères d’un ordre familier pour défricher de nouveaux territoires de sens.
Dans L’Exproprié, Tahar Djaout annonce dans un fracas de genres littéraires qui se télescopent et avec une syntaxe chaotique, tous les questionnements majeurs de son univers littéraire composé essentiellement de missions, de quêtes restées inabouties (la défaite d’Ibn Toumert) tant leurs porteurs sont désenchantés, désillusionnés (l’enfant de retour avec les os de son frère martyr qui cliquettent durant le trajet du retour) ou carnavalesques (les honneurs rendus à Mahfoudh Lemdjad sont pure hypocrisie des tenants de l’Autorité), ou folie et déroute (l’iconoclaste se refuse comme le train-prison aux rails de l’Histoire et à ceux, dorure d’aphasie, que veulent lui imposer les zèbres de l’académie).
— La référence à l’histoire : l’insurrection de 1871, la guerre du Rif avec Abdelkrim, la guerre de Libération nationale, la résistance berbère de la Kahéna, la figure d’Ibn Toumert par le truchement de l’intertexte et par le mythe n’est qu’une illusion d’ancrage car l’imaginaire enrobe l’Histoire collective triturée et lui oppose l’histoire personnelle, l’histoire de l’enfance des narrateurs restée quelque peu indemne des vivisections des discours de la propagande officielle.
— Un contexte spatiotemporel en mouvement de rupture, de cassure ; enfantement douloureux d’un monde nouveau soumis à des résistances souvent vaines et pathétiques.
— Des personnages qui aspirent à la liberté, à un monde solaire cependant qu’ils sont confrontés aux ténèbres ; ils s’insurgent avec les outils de l’intellect contre leur milieu socioculturel et économique qui les réprime. Le romancier témoin du dépérissement de son objetlittéraire ; l’enfant qui rapporte les os de son frère sans aucune gloriole, pour flatter l’hypocrisie des anciens ; le jeune chercheur qui donne le change au banquet où il est gratifié ; le libraire qui résiste à l’autodafé de son monde de livres par Le Livre.
— L’intrusion de fragments musicaux et poétiques des enfances alliées des solstices, des fraîcheurs marines et des envols fougueuxd’oiseaux indociles à la prédestination céleste qui déjouent les rets et « font fi de l’archer ». L’enfance, dans l’univers romanesque djaoutien est une perspective du monde7, jamais sa rétrospection béate. La vigueur d’une réappropriation d’espaces vierges, une fragrance poétique qui éjecte l’Histoire de ses espaces de servitudes et de croyances figées.
La référence à l’Histoire est constante dans cet univers romanesque, mais Tahar Djaout ne convoque pas l’Histoire comme donnée extérieure alimentant le genre du roman historique ; il en questionne les fondements et les intègre dans sa subjectivité et sa sensibilité d’écrivain portant un projet d’écriture qui en bouscule les repères, en se plaçant hors du territoire des veilleurs d’icônes. Quelques années avant la parution de L’Exproprié, Nabile Farès avec Yahia, pas de chance8 et Mémoire de l’Absent9a ouvert le champ d’une investigation ardue sur cet inconfort et ce désarroi et ce doute littéraires face à une Histoire du confort et de la certitude. Il s’agit sans doute d’éviter en premier lieu dans le travail de la création littéraire la chronologie qui est par excellence la construction de l’Histoire.
Tahar Djaout déconstruit l’Histoire, met en avant ses scories et tourne en dérision ses vérités fabriquées de toutes pièces par un télescopage spatiotemporel dans lequel s’affrontent Histoire comme donnée objective avec ses icônes réelles, et Mémoire comme donnée fluctuante et subjective, soumise aux aléas du temps et l’incertitude des lendemains. Mais il ne s’agit pas de la Mémoire collective, au sens de témoignage ou d’authentification de faits, d’actes, de traces, d’héritages ; il s’agit d’une mémoire subjective, individuelle et donc inscrite hors des voies ferrées. Il n’y a guère de nostalgie dans les personnages djaoutiens. Ils ne vivent pas dans le passé ; ceux qui en ont la tentation, à l’instar de Menouar Ziada se suicident. Ils sont au contraire au cœur de la mouvance, des changements et des palpitations d’un monde angoissant par le fait que l’auteur « écrivant » est en quête d’une écriture de la désorientation à tous les niveaux du texte. La mémoire dont il est question ici, est au centre de ces turbulences syntaxiques et thématiques. Une mémoire en mouvement.
La symbolique de cette mémoire n’est plus l’histoire souche de la Kahéna, ni même celle des expropriés de 1871 dont l’auteur offre quelques complaintes, de la même manière que le fait le personnage de Tante Allalou dans Yahia, pas de chance.
Pris dans la chronologie de leur parution, les romans de Tahar Djaout sont une lancinante interrogation sur la difficulté de produire du Sens quand la mémoire est triturée, soumise aux vivisections du « Maître de l’heure »10. Le lecteur y observe une gradation dans les rétractions du Sens romanesque. Est-ce pour cela que la densité textuelle de L’Exproprié cède à l’écriture photographique du réel contenue dans Les Vigiles et à celle de l’urgence du témoignage sur l’Algérie au seuil de la décennie noire et rouge.
Les vigiles d’un ordre nouveau, inquisiteurs, sont étroitement liés à l’évolution du contexte sociohistorique et économique de l’Algérie.
Tous les personnages sont des iconoclastes qui se refusent aux jougs, aux héritages séculiers et sécurisants. Comment pourrait-il en être autrement quand on se rend à l’évidence que le méta narrateur de L’Exproprié, de L’Invention du désert, de Les Vigiles est un écrivain chercheur qui est dans l’inconfort d’écriture, cherche de nouveaux signes à ses doutes et à ses questionnements et jette les amarres des mots aux larges océaniques de l’imaginaire au-delà des tempêtes.
1 — C’est un narrateur écrivain qui raconte à sa façon l’épopée douloureuse d’Ibn Toumert, dans L’Invention du désert. L’icône historique, trublion du Maghreb au 12ème siècle prêche le retour à un islam orthodoxe face à la corruption des princes almoravides. Désintéressé face aux biens terrestres, vivant de mendicité, n’ayant que son bâton de pèlerin iconoclaste et s’adressant au peuple dans sa propre langue, le berbère, il est craint des princes almoravides qui le chassent de leur royaume. Certains, charmés par ses harangues, le prennent, tout au plus en sympathie. Bien qu’ayant réussi à réunir autour de lui une armée d’adeptes, il meurt d’épuisement, non sans avoir été l’un des principaux instigateurs des Almohades. L’écrivain narrateur et « son » Ibn Toumert finissent par se confondre.
2 — Mahfoudh Lemdjad, jeune professeur de sciences dans un lycée, et chercheur a modernisé un métier à tisser dans lequel s’est imprimé le souvenir de sa grand-mère. C’est dans un univers de la « bouffe » et de ceux qui travaillent du ventre qu’il impose la curieuse machine pour laquelle il a été primé à l’étranger. Il se refuse à l’héritage passif et se rebelle contre l’appareil administratif et policier.
3 — Boualem Yekker est libraire. Il est par excellence, celui par qui l’écrivain existe et propage son univers littéraire qui est menacé d’extinction par le règne de Prédicateurs qui crient au sacrilège car des livres osent défier Le Livre.
4 — L’adolescent au regard neuf sort pour la première fois de son village et découvre, sur les chemins de sa quête macabre, d’autres paysages, d’autres gens, d’autres mœurs et langues, de nouveaux horizons dans un pays nouvellement entré dans le recouvrement de son indépendance. Mais Les Vigiles « vieillards » du village tiennent à leurs os.
CHAPITRE I. REGARDS SUR LES NOUVEAUX ORDRES
I. DES CHAMPS D’HONNEUR
1 – Une Indépendance ossivore
LeromanLesChercheursd’os11, prixdelaFondationdelDuca, estécritàlapremièrepersonne, le « je » d’unenfantqui, accompagnéd’unadulteduvillage, RabahOuali, unparentéloigné, faitpartieduconvoiquidoitallerchercherlesosdesonfrèreaînétombéauchampd’honneurquelquepartdanslepays. L’histoiredontils’agitestimmanenteauxvillageois - lesvieux - qui, l’indépendancerecouvrée, comptenttirerglorioledeleursfilsmartyrsdontlesossontdisséminésenplusieursendroitsdupays. Maisl’adolescentquifaitpartieavecsononcle, d’unedesnombreusesmissionsde « rapatriement » desossacrésdesonfrère, refuseavecsaconscienceaiguisée, departiciperaufestindescroque-morts. Sonfrèren’estpasunamasd’ossementsdelégende, maislecompagnond’uneenfancechampêtrequiluienafaitdécouvrirlesjoiesintimesetqui, malgrél’autoritarismedupère, luiaouvertlesyeuxsurlemonde, ausensdelaLiberté,qu’ignorelaLibération. Ilnecroitpasàla « mémoire » decesossementscarilsaitqu’elleseracadenasséedanscesvillagesauxhorizonsbouchés.
Lamémoiredel’enfantnarrateurest
« unebouilliedelaveoùs’ébattentdessauterellesetunamasdefeuillesroussieseffritéesparlepasdesmarcheurs. Toutesleschosesautourdenoussesontmisesàvivreavecintensitécommesionensentaitlaprésenceetlepoidspourlapremièrefois. » (p. 33)
Aucoursdelaquêtedesrestesdeshérosdelaguerre, ildécouvrelaplaine, d’autreshorizons, d’autreslangues, làmêmeoùilestcensévolerauventredelaterrelesosdesonfrère :
« Quellemémoirefaut-ilpourserrercôteàcôtetantdecouleursemmêlées, tantd’odeursviergesetpoisseuses, tantdemenuscrissuspendusquitissentl’aircommeunetoiled’araignéetraverséedefaisceauxlumineux ? » (p. 43)
Levillagequiattendsondûd’héroïsmeestpétrifiédanssonpasséstérile. Lesvieuxnesontplusdétenteursdelamémoireetdelasagesse. Pasplusqueleurmortn’estsynonymed’unebibliothèquequibrûle
« Unemortquiferadeleurstristescarcassesautrechosequecesdépouillespatriotessurlesquellesprolifèrentlesoraisons (…) Ladjemaâc’esttoutcequileurreste. Etilsexigentqu’onlesylaissesomnolerenpaixcommecescrapaudsaffalésdontilsontlapeautaveléeetrugueuse. » (p. 18)
Ilsontperduleverbetranscendant, laParole, ilsnesontplusdétenteursd’Awal :
« Cesjours-ci, lorsquelesvieillardsseretrouvententreeuxàladjemaâ, ilssontcomplètementdéroutés, carilsnesaventpasdequoiparler. » (p. 19)
Tandisqu’ilsréchauffentleursosausoleil, ilsattendentles « os » deleursfilsquileurredonneraientlaforcedelatranslationdelamémoire. L’enfantnarrateurnecroitpasàsamissionsalvatrice. Cen’estpaslesquelettedesonfrèrequil’afaitgrandirmaisladécouverted’autrescultures, d’autresmanièresdevivre. Ilremetauxvigilesdel’histoiresonbutincommeil (re) jettelatraditionvillageoisequibafouelereposéterneldesjeuneshéros.
Laquêtedesosnesefaitpaspourelle-même, pourl’histoire. Elleestprojetéehorsdesafinalitécommémorative, celledurecouvrementdelamémoireetdeladignitéqu’impliquelesacrificesuprêmepourlapatrie. Elledevientunecaution, unfaire-valoirutilitairepourlagloiredesvivants, desospiècesàconvictionafindes’octroyerdesprivilèges, desattestations, destitresetunrang. Lacassureentrelatribudel’Histoireetlatribuquienattenddesrichessesinespéréess’opèredèslespremièrespagesduromandanslesquellesl’auteurs’identifieaunarrateurquitardequelquepeuàentrerenscène. Maiscetteappréciation, constatd’unadulteavisépréparel’ambianceetlepoidspsychologiquesdanslesquelsl’adolescent, accompagnéd’unlointainparent, RabahOuali, unpaysanaguerriauxretournementsdelavie, affronteracettemission, maisilnecomprendnilesmotivationsnil’utilitéd’unetellequête. Lecaractère, peurespectueuxdesconvenancesdues, enprincipe, au « rapatriement » parlesvillageoisdesleurstombésauchampd’honneur, s’énonced’abordentermesphilosophiquesparlefaitquecesont
« desgaminsquineconnaissaientriendelavie (qui) allaientfarfouillerdanslesregistresdelamort. » (p. 10)
L’auteurjouesurunedoubleambiguïtépardesavoureusesconstructionssyntaxiquesdanslesquelleslesenscontextueldesmots « os », « squelette » renvoientàl’idéedeprofitspost-mortemquecesbutinspermettentdelégitimer, voiredesanctifier :
« Luidisputerdessquelettesdontlesvivantsavaientbesoinpouratténuerl’éclattropinsolentdesrichessesquelenouveaumondedispensait. » (p. 10)
Lelecteurrelèveradenettesoppositionsentrel’acceptionhistoriqueethéroïqueetcequeleuraccordentcommeintérêtsmoraletmatériellesbénéficiairesdel’Indépendance.
« Cesrestesdehéros » : l’expressionestironiqueàsouhait. Autermede « squelette » attenduaprès « restes » estsubstituéceluide « héros » ; cequineutraliselachargesymboliqueetcérémonialecontenuedanslemot « reste » qui, parcetteadjonctioncorromptlesensdumot « héros » commeonauraitdit « desrestesd’aliments ». Lemot « héros » estunenotionabstraite, honorifique, alorsquel’expression « restes » est, selonsescontextesd’emploi, valorisanteoudépréciative. Dansl’ouvragecollectifLesacréetleprofanedansleslittératuresdelanguefrançaise12, KamelBenOuares13dansuneétudeintituléeLesChercheursd’osdeTaharDjaout (Ed. Cerès, 1994, Tunis) : l’archéologiedusacré, relèveàcepropos :
« TaharDjaoutn’abordepasleréeld’unemanièrefrontale (…) Illefaitparledétourdelafable, dusymboleouencoreceluidelaperversiondessignes : chercheursd’or/ os, pièceàconvictiondevientl’osàconviction. »
C’estparcebiaisqu’ilfustigelediscoursdepropagande.
2 – L’univers œsophagique
Pourconforterlesinsatiablesappétitsetlepouvoirnaissantdurègneœsophagique, quoideplusirréprochable, indemnedetoutsoupçonquecettecautionmoraleetéthique. Desoschargésdesanctifierl’arroganceetlesregistresdecommerce, d’enclencherlaconstitutiondedossiersd’acquisitionsdebiensmeublesetimmeublesetpourfinir, exhibercesosrevientàbrandirdesattestations. Letoutconstitueun « amasdeconviction » :
— « chaquepersonneabesoindesapetitepoignéed’ospourjustifierl’arroganceetlesairsimportantsquivontcaractérisersoncomptoiràvenirsurlaplaceduvillage. »
— « cesos, préludecocasseàladébauchedepapiers. »
— « Malheuràquin’auraniosnipapieràexhiber. »
— « unamasàconviction. »(p. 21)
Mêmelesmaquisardssurvivantsdelaguerre, devenusprédicateursàl’occasion, nesontpasabsousdecettefrénésiedessquelettes. Lesvillageoissontterroriséspar
« Lavigilanced’unchefmilitairedel’arméelibératricequiportaituncasquecolonialetfaisaitàlongueurdejournéedesdiscourssurleprofaneetlesacré, surlecourageetlacouardise, surleliciteetl’interdit. » (p. 11/ 12)
Ainsisetramel’offensefaiteàl’Histoiredanscevillagequalifiédetyranniqueaux « contraintesimbécilesethypocrites ». Lamissionestpourl’adolescentl’occasioninespéréedequitterenfinlevillage :
« Jesuisheureuxdequitterlevillage, décorimplacabledemonenfancedésolée. » (p. 23)
C’estlacaniculeetlespectacleestdésolant :
« Lesvieillardsrespiraientpéniblementcommedespoulesoppresséesparlararéfactiondel’air ; offertsausoufflegrésillantdelacanicule ; desvieillardsquirespiraientaveceffortcommedescrapaudssurlepointdepasserdansl’au-delàdesbêteshideuses. » (p. 14)
Des vieillardssomnolentsquiattendentune « mortformalité » deladécrépitudephysique, del’horlogedutemps, anonyme, opposéeàcelleduhéros, mortcélébrée, iconiqueettranscendantale. Lesvieuxs’excusentpresqueauprèsde « cessquelettesheureux » d’êtreencoreenvie, terrassésparlacanicule, devantlesacrificesuprêmeconsentiparleursenfants. Maisalorsàquoileursert-ilàeux, « détenteurshypocritesdesagesse » deramenerlesosmartyrs, delesraviràleurtombepremièrepourlesréenfouirdansladésolationambiante. Cesosranimeront-ilslaviepétrifiéeetl’ambiancedemortdecevillage ? L’adolescentserefuseàcettetransactionhistorique ; ilserendàl’évidencedel’absurditécocassedelamission :
« Lemieuxquejepuisseespérerpourmonfrèreestquesesosdemeurentintrouvables, enfouisdansquelqueterreplushospitalière. » (p. 26)
Maisquepeutson « je » intimedevantle « nous » tribal :
« Etvoiciqu’aujourd’huinousallonschercherunsquelettehypothétique. » (p. 28)
Lorsdecevoyageinitiatiquehorsdesfrontièresvillageoisesetqu’ilavaittantsouhaité, etn’eûtétécettequêtemacabre, l’adolescentdécouvreunnouveaumonde, d’autresmanièresdevivre, d’autreslangues, d’autresmœursautrementplusavenantesquelestatismedesonvillagenatal. Legoûtduvoyageetdeladécouvertefaitdireàl’adolescent :
« Jem’ingénieàmeconvaincrequenousnousacheminonsversquelquevilleàvisiterouquelqueparentoubliédepuisdesdécennies. » (p. 46)
Maisilatôtfaitdereveniràlaréalitébrutaledel’éprouvanteruéeversl’or/ l’os. Dessacrificestitanesquess’imposentàluisousleregardautoritairedeRabahOualiquisuperviselamission avecunascétismequisiedaucaractèrequasireligieuxdelaquête. Ilsnegoûtentàaucunmetsgastronomiqueoffertàl’occasiond’unewaâdadédiéeausaintdelalocalitéSidiMaâchouBenBouzianesetrouvantsurleurchemin. Lejeunehommeassistestupéfiéàunescènededébauchealimentairelorsd’unritesacrificield’horreurbestiale :
« Aujourd’hui, encorehuitbœufsdépecéssurlaplaceplantéedefrênesetd’eucalyptusespacés, témoignentdelagloireinaltérabledusaint (…) leshachesn’enfinissentpasdes’abattre, lescouteauxdetaillader. Lesgrosos(…)ontétédémantelésàleursjointuresetlesbœufsmassifs, quin’ontpuêtreterrassésquelorsquelesvillageoisontdécidédes’ymettretousensembleontététransformésendestaspresqueégauxoùilestdevenuimpossiblederestitueràchaquebêtesatêteetsesmembresd’origine. » (p.64)
Parcedétailscrupuleuxdudémembrementanatomiquedel’animal, voirelasauvageriecollectiveaveclaquellelespèlerinss’acharnentavechachesetcouteauxsurlesbêtes, l’auteur, toujourssousleregardneufdel’enfant, contrebalancel’actesacrificielàlagloiredusaintquidevient, danssanudité, unactedebarbarieextrêmequ’aucunedévotionnevienthumaniser. Laterminologiedelatueriecollectiveestrendueparuneaccumulationdetermesquiévoquentplutôtunmassacre : « dépecé », « leshachess’abattent », « lescouteauxtailladent », « lesosdémantelés », « bœufsterrassés ». C’estuneorgiedemiseàmortcollectiveetviolenteparlaquelle, paradoxalement, lesfidèleshonorentlesaintpourlagloireduquel
« Lesgensvinrentdetrèsloin, parfoisdesjournéesdemarche, ilvientmêmedespersonnesquineparlentpaslalangued’ici, maisuneautrelangue, plusprestigieuseparcequeplusprochedelalanguesainte. » (p. 57)
Acettedébauched’égorgementetdedémembrementdesbœufs, succède « lafrénésiedelacuiller ». L’enfantresteébahidevantlespectacledecesvieuxdévotsentraindes’empiffrerdecouscousetdeviande, sollicitantlespouvoirsdusaint,quipourbénirsescommerces, quisesvoitures, quémandantdesamulettesauxcharlatansdeslieux « quigriffonnentdemystérieusesordonnances ». Lacritiqueducharlatanismeesticiforteetsansparabole. L’adolescentquiassisteàcesréjouissancesterrestresassocielesogresdescontesdesonenfanceauxpèlerinsgoinfresdumausolée. MausoleestvaincuparGargantuacar :
« Lesujetpréféréetinépuisabledeshabitantsdecepays, c’estlabouffe. » (p. 51)
Labouffe, termetrivial, estlanouvelleidentitédurecouvrementdel’indépendancedupays.
Cettefrénésiedelacuillerrendueavecforcedétailsestassociéeàcelledesfouilleursdetombes :
« Lesosdemonfrèrenousattendentcommeuntrésor, enfouisparmid’autrescadavreshéroïquessurlesquelspullulentlesoraisonsetleslouangescommelesversquelacharogneattire. » (p. 70)
L’associationentrel’imagedesbœufssacrifiésaumausoléedusaintSidiMaâchouBenBouzianeetlesosmartyrsdufrèreestainsisubtilementétablie. L’auteurcomparelesoraisonsetleslouangesfaitesausaintàdesasticotsquis’acharnentsurunecharogne. Lesaintetlemartyrnesont-ilspasassociés ? Quel(s) rapportsétablitTaharDjaoutentrele « martyr » et « le