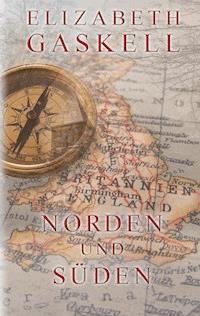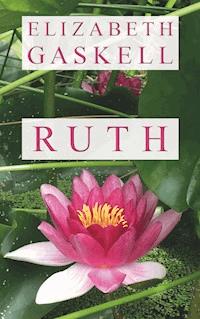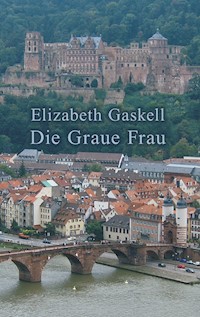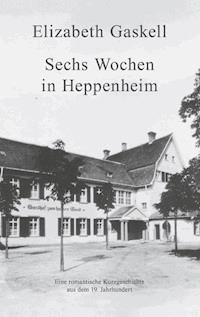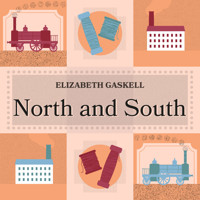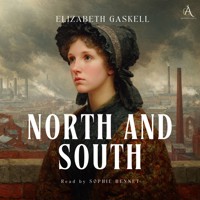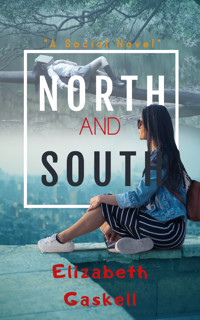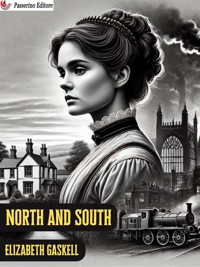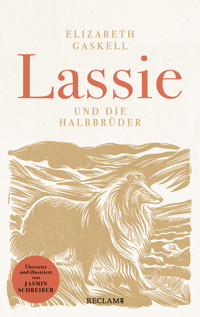1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nord et Sud, roman majeur d'Elizabeth Gaskell, constitue une œuvre profonde et nuancée qui mêle drame social, question de classe, et tension sentimentale dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle. À travers le destin de son héroïne, Margaret Hale, Gaskell explore les contrastes culturels et économiques entre le Sud rural et aristocratique de l'Angleterre et le Nord industriel et ouvrier, en pleine mutation sociale. Margaret Hale, jeune femme issue de la bourgeoisie du Sud, voit sa vie bouleversée lorsque sa famille s'installe dans la ville fictive de Milton, inspirée de Manchester. Là, elle découvre un monde rude, dominé par les usines, les conflits entre ouvriers et patrons, et les tensions sociales croissantes. Elle fait la connaissance de John Thornton, maître d'une manufacture de coton, homme fier, rigide, mais aussi profondément engagé dans les réalités du monde industriel. Entre Margaret et Thornton naît un rapport complexe, nourri de confrontations idéologiques, de respect mutuel et de malentendus persistants. Le roman dresse un tableau saisissant de la condition ouvrière, de la pauvreté urbaine, des grèves, et de l'émergence progressive d'une conscience sociale dans l'Angleterre industrielle. Il illustre également l'évolution des mentalités et des rapports entre les classes sociales, à une époque de profonds bouleversements économiques. À la fois roman d'apprentissage, fresque sociale et histoire d'amour intellectuelle, Nord et Sud se distingue par la richesse psychologique de ses personnages et par la subtilité avec laquelle Elizabeth Gaskell traite les tensions entre devoir, justice sociale, et désir personnel. L'ouvrage reste d'une grande actualité par sa réflexion sur l'empathie entre milieux sociaux opposés et sur les possibilités d'évolution commune dans un monde en transition. Véritable miroir de son époque, ce roman impose Gaskell comme l'une des voix féminines les plus importantes du réalisme victorien. Cette traduction a été assistée par une intelligence artificielle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nord et Sud
Table des matières
Chapitre 1. « En route vers la noce »
« Courtisée, mariée, et tout le reste. »
« Edith ! » dit Margaret doucement, « Edith ! »
Mais, comme Margaret s’en doutait un peu, Edith s’était endormie. Elle était blottie sur le canapé du petit salon à l’arrière, sur Harley Street, et paraissait ravissante dans sa mousseline blanche et ses rubans bleus. Si Titania avait jamais été vêtue de mousseline blanche et de rubans bleus, et s’était endormie sur un canapé cramoisi dans un salon à l’arrière, on aurait pu la prendre pour Edith. Margaret fut à nouveau frappée par la beauté de sa cousine. Elles avaient grandi ensemble depuis l’enfance, et depuis toujours, tout le monde, sauf Margaret, s’émerveillait de la jolie apparence d’Edith. Margaret n’y avait jamais vraiment pensé avant ces derniers jours, quand la perspective de perdre bientôt sa compagne semblait rehausser chaque qualité douce et charmante qu’Edith possédait. Toutes deux avaient discuté de robes de mariée, de cérémonies de mariage, du capitaine Lennox et de ce qu’il avait raconté à Edith sur sa future vie à Corfou, où son régiment était en poste ; elles avaient aussi évoqué la difficulté de garder un piano bien accordé (une difficulté qu’Edith trouvait la plus insurmontable de sa future vie de femme mariée), et les robes dont elle aurait besoin pour ses visites en Écosse immédiatement après le mariage. Mais à mesure que le temps passait, le ton susurré d’Edith était devenu plus somnolent. Après une courte pause, Margaret comprit, du moins le crut-elle, que malgré le léger brouhaha venant de la pièce voisine, Edith s’était roulée en une petite boule de mousseline, de rubans et de boucles soyeuses, puis s’était assoupie dans un paisible somme après le dîner.
Margaret s’apprêtait à faire part à sa cousine de quelques-uns des projets et rêves qu’elle nourrissait pour sa future vie dans ce presbytère de campagne où vivaient son père et sa mère et où elle avait toujours passé ses vacances radieuses, même si, ces dix dernières années, la maison de sa tante Shaw était considérée comme son foyer. Mais, faute d’une oreille attentive, elle garda désormais pour elle ce changement de vie. Ces réflexions étaient néanmoins heureuses, même si liées à un certain regret à l’idée d’être séparée pour une durée indéterminée de sa douce tante et de sa chère cousine. Tandis qu’elle savourait déjà la joie d’occuper ce poste essentiel de fille unique au presbytère de Helstone, elle entendait par à-coups des bribes de la conversation qui se tenait dans la pièce voisine. Sa tante Shaw s’adressait aux cinq ou six dames invitées à dîner, leurs maris restant en bas. C’étaient des connaissances familières, des voisines que Mme Shaw appelait ses amies, parce qu’elles dînaient ensemble plus souvent qu’avec d’autres et parce que, si elle ou Edith avaient besoin de quelque chose d’elles, ou elles d’elle, elles n’hésitaient pas à se faire une petite visite en matinée. Ces dames et leurs maris avaient été conviés, en qualité d’amis, à un dîner d’adieu en l’honneur du prochain mariage d’Edith. Edith avait un peu rechigné à ce projet, car le capitaine Lennox était attendu ce soir-là par un train tardif. Néanmoins, elle était trop gâtée et trop insouciante pour s’opposer fermement et consentit quand elle découvrit que sa mère avait déjà commandé tous les mets délicats de saison, censés détourner l’excès de tristesse aux dîners d’adieu. Elle s’était contentée de s’appuyer sur le dossier de sa chaise, ne jouant qu’avec les aliments dans son assiette, et affichant un air sérieux et distrait, tandis que tout le monde autour d’elle riait aux bons mots de M. Grey, ce monsieur qui s’asseyait toujours à l’autre bout de la table lors des dîners de Mme Shaw, et qui demanda à Edith de leur offrir un peu de musique au salon. M. Grey fut particulièrement agréable durant ce dîner d’adieu, et les messieurs restèrent plus longtemps que d’habitude en bas. Et ils eurent bien raison, à en juger par les bribes de conversation que Margaret entendit.
« J’ai moi-même trop souffert ; non que je n’aie pas été extrêmement heureuse avec le pauvre et cher Général, mais tout de même, l’écart d’âge est un handicap. Je ne voulais pas qu’Edith ait à subir ce problème. Évidemment, sans me vanter, j’avais prédit que la chère enfant se marierait tôt ; j’ai souvent dit que j’étais sûre qu’elle serait mariée avant d’avoir dix-neuf ans. Je l’ai presque ressenti de façon prophétique, quand le capitaine Lennox... », et ici la voix s’abaissa à un murmure, mais Margaret pouvait aisément deviner la suite. Le cours de l’amour n’avait rencontré aucun obstacle pour Edith. Mme Shaw s’était fiée à son pressentiment, comme elle disait, et avait même encouragé ce mariage, bien qu’il fût en deçà des attentes nourries pour Edith par nombre de ses connaissances, étant donné que la jeune femme était à la fois jolie et héritière. Mais Mme Shaw répétait que son unique enfant devait épouser celui qu’elle aimait — et poussait de grands soupirs, comme si l’amour n’avait pas présidé à son propre mariage avec le Général. Mme Shaw trouvait toute cette romance très attachante, davantage encore qu’Edith ne le faisait. Non qu’Edith ne fût complètement et correctement amoureuse, mais elle aurait certainement préféré une belle maison dans Belgravia à l’atmosphère pittoresque que le capitaine Lennox décrivait à Corfou. Les mêmes aspects qui faisaient frémir Margaret de plaisir la faisaient frissonner, voire frémir, en partie pour donner à son amoureux l’occasion de la cajoler et en partie parce qu’une vie bohème la rebutait réellement. Pourtant, si un prétendant riche, doté d’un grand domaine et d’un titre alléchant, était apparu, Edith serait demeurée aux côtés du capitaine Lennox tant que la tentation n’aurait pas faibli ; mais une fois celle-ci dissipée, il est possible qu’elle aurait ressenti quelques petits regrets mal dissimulés de ne pas voir le capitaine Lennox réuni à tous ces avantages. Sur ce point, elle était bien la fille de sa mère, laquelle, après avoir épousé délibérément le général Shaw sans beaucoup plus de sentiment qu’un profond respect pour son caractère et sa situation, se lamentait doucement, mais sans fin, du malheur d’être unie à un mari qu’elle ne parvenait pas à aimer.
« Je n’ai reculé devant aucune dépense pour son trousseau », fut la phrase suivante que Margaret entendit.
« Elle possède tous les magnifiques châles et écharpes indiennes que le Général m’avait offerts, mais que je ne remettrai jamais. »
« C’est une fille chanceuse », répondit une autre voix, que Margaret reconnut comme étant celle de Mme Gibson, laquelle écoutait la conversation avec un intérêt particulier, vu que l’une de ses propres filles s’était mariée ces dernières semaines.
« Helen tenait absolument à avoir un châle indien, mais en découvrant le prix exorbitant, j’ai dû refuser. Elle sera jalouse d’apprendre qu’Edith en possède déjà. De quel type sont-ils ? Des Delhi, avec leurs jolies petites bordures ? »
Margaret entendit à nouveau la voix de sa tante, mais cette fois-ci on eût dit qu’elle s’était redressée sur son siège et qu’elle regardait vers la pièce à l’arrière, moins éclairée. « Edith ! Edith ! » appela-t-elle ; puis elle se laissa retomber, comme épuisée par cet effort. Margaret s’avança.
« Edith dort, tante Shaw. Puis-je faire quelque chose ? »
Toutes les dames s’exclamèrent : « Pauvre enfant ! » en apprenant cette nouvelle contrariante au sujet d’Edith ; et le minuscule chien de compagnie blotti dans les bras de Mme Shaw se mit à aboyer, comme s’il était agité par cette vague de compassion.
« Chut, Tiny ! vilaine petite ! tu vas réveiller ta maîtresse. Je voulais juste demander à Edith si elle voulait dire à Newton de descendre ses châles. Peut-être pourrais-tu t’en charger, ma chérie ? »
Margaret monta jusqu’à l’ancienne nursery, tout en haut de la maison, où Newton s’occupait de repasser quelques dentelles nécessaires au mariage. Pendant que Newton allait (non sans murmurer) défaire les châles, déjà montrés quatre ou cinq fois dans la journée, Margaret jeta un œil à la nursery ; c’était la première pièce qu’elle avait fréquentée dans cette maison, il y a neuf ans, quand on l’avait amenée, toute sauvageonne de la forêt, pour partager le foyer, les jeux et les leçons de sa cousine Edith. Elle se souvenait du côté sombre et austère de cette nursery londonienne, dirigée par une nurse solennelle et cérémonieuse obsédée par la propreté des mains et la surveillance des accrocs aux robes. Elle se remémorait son premier goûter là-haut, séparée de son père et de sa tante, qui devaient être en train de dîner plus bas, indétectables à ses yeux d’enfant. Chez elle — avant de venir vivre à Harley Street —, la chambre de sa mère servait de nursery, et comme l’on dînait de bonne heure au presbytère, Margaret prenait toujours ses repas avec son père et sa mère. Oh, la grande jeune fille de dix-huit ans se souvenait fort bien des larmes abondantes versées par la fillette de neuf ans, cachée sous les draps cette première nuit ; et de la nurse qui lui intimait de ne pas pleurer, car cela risquait de déranger Mlle Edith ; et de comment elle avait continué à sangloter, plus doucement, jusqu’à ce que sa tante Shaw, toute nouvelle pour elle, montât à l’étage avec M. Hale pour montrer à ce dernier sa petite fille endormie. Alors la petite Margaret avait essayé de se faire passer pour endormie de peur de peiner son père avec son chagrin, qu’elle n’osait exprimer devant sa tante, et qu’elle jugeait peut-être déplacé, après toutes les espérances et les projets qu’ils avaient dû mettre en place chez elle avant de pouvoir garnir sa garde-robe pour ce nouveau rang, et avant que son papa puisse quitter sa paroisse et monter à Londres, même pour quelques jours.
À présent, elle était attachée à cette vieille nursery, bien qu’elle fût désormais dépouillée, et elle la contemplait, envahie par une espèce de regret félin, en pensant qu’elle la quitterait définitivement dans trois jours.
« Ah, Newton ! » fit-elle, « je crois que nous serons tous tristes de quitter cette bonne vieille pièce. »
« Oh non, mademoiselle, pas moi. Je n’y vois plus aussi bien qu’avant, et la lumière est si mauvaise ici que je ne peux repriser les dentelles qu’en me tenant à la fenêtre, où il y a un courant d’air épouvantable — de quoi attraper la mort. »
« Eh bien, je parie que vous aurez une meilleure lumière et bien plus chaud à Naples. Vous devriez garder si possible vos reprisages pour là-bas. Merci, Newton, je peux les descendre — vous êtes occupée. »
Alors Margaret redescendit, chargée de châles, aspirant avec plaisir leurs effluves épicés venus d’Orient. Sa tante lui demanda de jouer le rôle d’un mannequin vivant pour les présenter, Edith dormant encore. Personne n’y prêta attention, mais la haute silhouette de Margaret, mise en valeur par sa robe de soie noire qu’elle portait en signe de deuil pour un parent éloigné de son père, soulignait la beauté des longues et splendides draperies, qui auraient presque étouffé Edith. Margaret se tint debout, juste sous le lustre, immobile et silencieuse, pendant que sa tante ajustait les étoffes. Parfois, au détour d’un mouvement, Margaret apercevait son reflet dans le miroir au-dessus de la cheminée, et souriait face à ce curieux spectacle — ses traits familiers affublés comme une princesse. Elle toucha délicatement les châles, savourant leur douceur et leurs couleurs éclatantes, et trouva un certain plaisir enfantin à être ainsi parée. C’est alors que la porte s’ouvrit pour laisser entrer M. Henry Lennox, dont l’arrivée inopinée fit sursauter quelques-unes des dames, embarrassées d’avoir manifesté tant d’intérêt pour de simples vêtements. Mme Shaw lui tendit la main ; Margaret, songeant qu’on pourrait encore avoir besoin d’elle comme portant de châles, resta là, parfaitement calme, le regard brillant et amusé, certaine qu’il comprendrait la drôlerie de la scène.
Sa tante était si absorbée à questionner M. Henry Lennox — qui n’avait pas pu venir dîner — sur son frère, le futur marié, sur sa sœur, la demoiselle d’honneur (attendue d’Écosse avec le capitaine pour l’occasion), et sur divers autres membres de la famille Lennox, que Margaret comprit qu’on n’avait plus besoin d’elle pour exposer les châles. Elle se consacra donc à divertir les autres convives, un bref instant négligés par sa tante. Edith ne tarda pas à entrer depuis le deuxième salon, en plissant les yeux face à la lumière plus vive, faisant voleter ses boucles légèrement dérangées, ressemblant tout à coup à la Belle au bois dormant tout juste tirée de son sommeil. Même endormie, elle avait senti la présence d’un Lennox et s’était ressaisie pour mieux l’accueillir. Elle avait tant de questions à poser sur la chère Janet, cette future belle-sœur qu’elle ne connaissait pas encore mais auquel elle disait déjà tenir énormément. Si Margaret n’avait pas été si fière, elle aurait presque pu éprouver un brin de jalousie pour cette rivale surgie de nulle part. Alors que Margaret s’effaçait un peu plus sur le côté lorsque sa tante reprit la conversation, elle surprit Henry Lennox en train de lorgner un siège vide près d’elle ; et elle savait parfaitement que, dès qu’Edith cesserait de l’assaillir de questions, il s’y installerait. Elle n’était pas tout à fait sûre de sa venue ce soir-là, compte tenu des propos un peu confus de sa tante sur son emploi du temps ; c’était donc presque une surprise de le voir, et l’assurance d’une soirée agréable. Il aimait à peu près les mêmes choses qu’elle. Le visage de Margaret s’irradia d’une franchise et d’une vivacité honnêtes. Et lorsque, après un moment, il s’approcha, elle l’accueillit avec un sourire exempt de toute timidité ou gêne.
« Eh bien, je suppose que vous êtes toutes plongées dans des affaires sérieuses — des affaires de dames, je veux dire. Très différentes de mon travail, le vrai travail juridique. Jouer avec des châles, c’est tout de même autre chose que de rédiger un contrat de mariage. »
« Ah, je savais que vous trouveriez amusant de nous voir toutes occupées à admirer des parures. Mais, en vérité, les châles indiens sont vraiment très réussis en leur genre. »
« Je n’en doute pas. Leurs prix, eux aussi, sont probablement très aboutis. Rien ne leur manque. » Les messieurs commencèrent à entrer un à un, et le brouhaha monta d’un cran.
« C’est votre dernier dîner mondain, n’est-ce pas ? Vous n’en donnez plus avant jeudi ? »
« Non. Je pense qu’après ce soir, nous serons soulagées, du moins de ce sentiment de fébrilité continu, depuis plusieurs semaines déjà ; un repos où il ne reste plus rien à faire et où tout est en place pour un événement qui occupe l’esprit et le cœur. Je serai heureuse d’avoir du temps pour réfléchir, et je suis sûre qu’Edith aussi. »
« Pour elle, je ne suis pas si certain ; mais je vous imagine très bien, vous, en pleine méditation. Chaque fois que je vous ai vue récemment, vous étiez happée par un tourbillon provoqué par quelqu’un d’autre. »
« Oui », répondit Margaret, un peu tristement, en songeant à cette agitation interminable autour de détails futiles depuis plus d’un mois : « Je me demande si un mariage doit toujours être précédé par ce que vous appelez un tourbillon, ou s’il ne peut pas y avoir, dans certains cas, un moment de calme et de douceur juste avant. »
« La marraine de Cendrillon qui s’affaire sur le trousseau, le repas de noces, la rédaction des invitations, par exemple », dit M. Lennox en riant.
« Mais toutes ces extravagances sont-elles vraiment indispensables ? » demanda Margaret, le regard fixé sur lui, à la recherche d’une réponse. Elle était prise d’une lassitude indicible devant cette obsession du beau et du raffiné, dont Edith avait été la grande orchestratrice ces six dernières semaines, et elle espérait vraiment que quelqu’un lui offrirait une vision plus sereine et pleine de douceur de la cérémonie à venir.
« Oh, bien sûr », répondit-il en reprenant son sérieux. « Il faut passer par certaines formes et cérémonies, pas tant pour soi-même que pour satisfaire les apparences, sans quoi la vie deviendrait vite intenable. Mais comment organiseriez-vous un mariage, vous ? »
« Oh, je n’y ai jamais vraiment réfléchi ; mais j’aimerais que ce soit un beau matin d’été, que je puisse aller à l’église à pied, sous l’ombre des arbres, qu’il n’y ait pas trop de demoiselles d’honneur et qu’il n’y ait pas de grand repas de noces. J’imagine que c’est tout l’inverse de ce qui m’a tant préoccupée ces derniers temps. »
« Non, je ne le crois pas. L’idée d’une simplicité majestueuse semble bien correspondre à votre caractère. »
Margaret n’apprécia pas entièrement ce commentaire ; elle s’esquiva légèrement, se remémorant certaines fois où il avait tenté de la faire s’exprimer sur sa façon d’être, en jouant le rôle du flatteur. Elle coupa court :
« Pour moi, c’est naturel de penser à l’église de Helstone et au chemin qui y mène, plutôt qu’à l’idée d’arriver devant une église londonienne au milieu du pavé. »
« Parlez-moi de Helstone. Vous ne m’en avez jamais fait la description. J’aimerais savoir à quoi ressemblera l’endroit où vous vivrez, alors que le 96 Harley Street sera fermé, sombre et poussiéreux. Helstone est un village ou une ville, pour commencer ? »
« Oh, juste un hameau ; je ne crois même pas qu’on puisse parler de village. Il y a l’église et quelques maisons autour du green — plutôt des chaumières — couvertes de rosiers. »
« Et qui fleurissent toute l’année, surtout à Noël… finissez donc votre tableau », plaisanta-t-il.
« Non », répondit Margaret, un peu agacée, « je ne dresse pas un tableau, j’essaie de décrire Helstone tel qu’il est. Vous n’auriez pas dû dire ça. »
« Je me repens », répondit-il. « C’est juste que votre description sonne comme celle d’un village de conte plus que d’un lieu réel. »
« Et c’est le cas ! » rétorqua Margaret avec enthousiasme. « Tous les autres endroits d’Angleterre que j’ai vus me semblent tellement austères et prosaïques, comparés à la New Forest. Helstone ressemble à un village de poème — un poème de Tennyson. Mais je ne veux plus essayer de vous le décrire. Vous ne feriez que vous moquer si je vous disais ce que j’en pense, ce qu’il est vraiment. »
« Je vous assure que non. Mais je vois que vous voulez absolument le garder pour vous. Alors parlez-moi plutôt de ce qui me plairait encore davantage : la cure. »
« Oh, je ne peux pas dépeindre ma maison. C’est chez moi, et je ne peux pas mettre son charme en mots. »
« Je m’incline. Vous êtes plutôt sévère ce soir, Margaret. »
« En quoi ? » demanda-t-elle, en le regardant de ses grands yeux doux. « Je ne savais pas que je l’étais. »
« Eh bien, parce que j’ai fait une remarque malencontreuse, et depuis, vous ne voulez plus me décrire Helstone, ni me parler de votre maison, alors que je vous ai dit combien j’ai envie de tout savoir, surtout sur celle-ci. »
« Mais vraiment, je ne peux pas vous décrire ma propre maison. Je ne pense pas que ce soit un sujet dont on discute si on ne l’a pas vue soi-même. »
« Dans ce cas... dites-moi comment vous y passez vos journées. Ici, vous lisez ou vous suivez des leçons, ou vous occupez votre esprit jusqu’à midi, vous vous promenez avant le déjeuner, vous allez faire un tour en voiture avec votre tante après, et vous avez une sortie chaque soir. Maintenant, décrivez-moi votre journée à Helstone. Allez-vous faire de l’équitation, de la voiture ou de la marche ? »
« Marcher, sans hésiter. Nous n’avons pas de cheval, pas même pour papa. Il se rend à pied jusqu’aux limites de sa paroisse. Les promenades sont tellement belles, ce serait un sacrilège de se déplacer en voiture — et presque trop en selle également. »
« Allez-vous faire un peu de jardinage ? J’ai entendu dire que c’est une occupation recommandée aux jeunes filles de la campagne. »
« Je ne sais pas. J’ai bien peur de ne pas aimer une tâche si exigeante. »
« Des concours de tir à l’arc, des pique-niques, des bals hippiques, des bals de chasse ? »
« Oh non ! » dit-elle en riant. « La paroisse de papa est bien modeste ; et même si nous étions à proximité de ce genre d’événements, je doute que j’y participe. »
« Je vois, vous ne me direz rien. Vous vous contentez de m’indiquer ce que vous ne ferez pas. Avant la fin des vacances, je viendrai vous rendre visite et constater par moi-même à quoi vous vous occupez. »
« J’espère bien que vous le ferez. Vous verrez alors de vos propres yeux comme Helstone est un endroit enchanteur. Maintenant, je dois filer. Edith va se mettre au piano, et je sais tout juste tourner les pages pour elle. En plus, ma tante Shaw n’aime pas quand nous bavardons. » Edith jouait brillamment. Au beau milieu du morceau, la porte s’entrouvrit. Edith aperçut le capitaine Lennox, hésitant à entrer. Elle abandonna aussitôt sa partition et se précipita hors de la pièce, laissant Margaret rougissante et confuse expliquer aux convives stupéfaits la vision qu’Edith venait d’entrevoir, et qui avait causé sa fuite soudaine. Le capitaine Lennox était arrivé plus tôt que prévu ; ou bien était-ce déjà aussi tard ? On vérifia les montres, l’on s’exclama, puis l’on prit congé.
Puis Edith revint, radieuse, un peu timide et pourtant fière, tenant par la main son grand et bel officier. Son frère lui serra la main, et Mme Shaw l’accueillit avec cette touchante gentillesse qui la caractérisait, mâtinée d’un soupçon de plainte, fruit de la longue habitude de se considérer comme une victime d’un mariage mal assorti. Maintenant que le Général avait disparu, elle jouissait pourtant de tous les plaisirs de l’existence, sans presque aucun inconvénient. Cela l’avait un peu désorientée de ne plus trouver de motif d’anxiété ou de chagrin. Elle avait néanmoins fini par se raccrocher à sa santé, source de toutes ses inquiétudes ; elle se mettait à tousser nerveusement dès qu’elle s’en préoccupait. Un docteur bienveillant lui prescrivit ce dont elle avait envie — passer l’hiver en Italie. Mme Shaw avait de fortes envies comme tout un chacun, mais elle n’aimait pas agir par pur désir personnel ; elle préférait s’imaginer contrainte par quelque nécessité extérieure. Elle se persuadait réellement qu’elle ne faisait que se soumettre à quelque injonction, lui permettant ainsi de se plaindre tout à loisir, alors même qu’elle se faisait plaisir.
C’est ainsi qu’elle commença à parler de son futur voyage au capitaine Lennox, qui, par devoir, acquiesçait à tout ce que sa future belle-mère disait, les yeux cependant rivés sur Edith. Celle-ci s’affairait à réorganiser la table à thé et à commander toutes sortes de douceurs, malgré les protestations de son fiancé qui expliquait avoir déjà dîné il y a à peine deux heures.
M. Henry Lennox était debout, adossé à la cheminée, amusé par cette scène de vie familiale. Il se tenait près de son séduisant frère ; c’était lui, dans leur fratrie, l’homme au physique moins remarquable, mais son visage était intelligent, vif et expressif. Par moments, Margaret se demandait à quoi il pensait, lui qui restait silencieux tout en observant la scène avec un intérêt teinté d’une légère ironie, spécialement envers la conversation que Mme Shaw tenait avec son frère; cela n’affectait pas pour autant l’intérêt qu’il portait à ce qu’il voyait. Il trouvait quelque chose de charmant à regarder les deux cousines si affairées près de la table. Edith insistait pour tout faire elle-même, nourrissant l’envie de montrer à son futur mari à quel point elle serait parfaite en épouse de soldat. Elle remarqua que l’eau de la théière était froide et fit monter la grande bouilloire de la cuisine, ce qui ne fit que la laisser pantoise quand elle la croisa à la porte et réalisa qu’elle était trop lourde à porter. Elle revint boudeuse, avec une tache noire sur sa robe de mousseline et la main droite, toute menue et blanche, marquée par la poignée, qu’elle montra au capitaine Lennox, comme un enfant blessé. Et, naturellement, le remède fut le même que pour un enfant. Le réchaud à alcool que Margaret mit en marche sauva la situation, même si cela ne correspondait pas à l’image romantique du « campement de fortune » auquel Edith aimait parfois comparer la vie de caserne. Après cette soirée, tout ne fut plus que tourbillon jusqu’au mariage.
Chapitre 2. Roses et épines
« Par la douce lumière verte dans la clairière boisée, Sur les berges de mousse où ton enfance a gambadé; Près de l’arbre familial, à travers lequel ton regard S’éleva pour la première fois, émerveillé, vers le ciel d’été. »
Mme Hemans.
Margaret était de nouveau en tenue matinale, rentrant tranquillement chez elle avec son père, venu assister au mariage. Sa mère avait été retenue à la maison par une multitude de demi-raisons, qu’aucun ne comprenait vraiment, sauf M. Hale, qui savait parfaitement que tous ses arguments en faveur d’une robe en satin gris—un compromis entre le neuf et le vieux—avaient été vains; et que, n’ayant pas l’argent pour offrir à sa femme une toilette complète, celle-ci ne se montrerait pas au mariage du seul enfant de la seule sœur qu’elle avait. Si Mme Shaw avait deviné la véritable raison pour laquelle Mme Hale n’accompagnait pas son mari, elle aurait fait pleuvoir les robes sur elle; mais cela faisait près de vingt ans que Mme Shaw n’était plus la pauvre et jolie Mlle Beresford, et elle avait réellement oublié tous ses anciens soucis, excepté celui du malheur que causent les différences d’âge dans le mariage, sujet sur lequel elle pouvait discourir pendant une demi-heure. Chère Maria avait épousé l’homme de son cœur, qui n’était son aîné que de huit ans, doté de la plus douce des humeurs, et de ces cheveux noir-bleu qu’on voit si rarement. M. Hale était l’un des prédicateurs les plus remarquables qu’elle eût jamais entendus, et un parfait modèle de curé de paroisse. Peut-être que ce n’était pas tout à fait une déduction logique de tous ces éléments, mais c’était néanmoins la conclusion caractéristique de Mme Shaw, tandis qu’elle songeait à la destinée de sa sœur : « Mariée par amour, qu’est-ce que la chère Maria peut bien désirer de plus en ce monde ? » Mme Hale, si elle avait dit vrai, aurait facilement pu répondre avec une liste toute prête : « une soie glacée gris argent, un chapeau blanc en paille fine, oh ! des douzaines de choses pour la noce, et des centaines de choses pour la maison. » Margaret savait seulement que sa mère n’avait pas jugé opportun de venir, et cela ne la peinait pas de penser que leurs retrouvailles se feraient au presbytère d’Helstone plutôt que durant la confusion des deux ou trois derniers jours, dans la maison de Harley Street, où elle-même avait dû jouer le rôle de Figaro, réclamée partout à la fois. Maintenant, elle avait autant mal au corps qu’à l’esprit en repensant à tout ce qu’elle avait fait et dit durant les quarante-huit heures précédentes. Les adieux pris si hâtivement, au milieu de tous les autres au revoir, parmi ceux avec qui elle avait vécu si longtemps, la remplissaient à présent d’un profond regret pour ces temps à jamais révolus ; peu importait ce qu’ils avaient été, ils étaient partis pour ne jamais revenir. Le cœur de Margaret était plus lourd qu’elle n’aurait pu le croire en revenant dans son cher foyer, cet endroit et cette vie dont elle rêvait depuis des années — surtout à cette heure où le désir se fait le plus vif, juste avant que le sommeil n’endorme les sens trop aiguisés. Elle détourna son esprit des souvenirs du passé, non sans un pincement au cœur, pour contempler l’avenir brillant et serein avec espoir. Ses yeux commencèrent à voir, non plus des visions du passé, mais ce qui se trouvait réellement devant eux : son cher père, assoupi dans le wagon. Ses cheveux noir-bleu étaient maintenant gris et éclaircissaient ses tempes. Les os de son visage saillaient trop pour être beaux, si ses traits n’avaient pas été aussi délicatement dessinés ; pourtant, leur finesse propre leur conférait une certaine élégance si ce n’était de la beauté. Son visage était au repos, mais il s’agissait plutôt du repos après la fatigue que de la sérénité paisible de celui qui mène une vie calme et satisfaite. Margaret remarqua, peinée, l’expression soucieuse et tourmentée ; et elle repassa en revue tous les aspects connus et avoués de la vie de son père, pour y chercher la cause des rides qui témoignaient clairement d’un tourment et d’une tristesse constants.
« Pauvre Frederick ! pensa-t-elle en soupirant. Oh ! si seulement Frederick avait été pasteur au lieu de s’engager dans la Marine, et de nous être tous perdus ! J’aimerais tant tout comprendre. Je n’ai jamais saisi la situation auprès de tante Shaw ; je sais seulement qu’il ne pouvait pas revenir en Angleterre à cause de cette terrible affaire. Pauvre cher papa ! comme il a l'air si triste ! Je suis si heureuse de rentrer à la maison, pour être là et leur apporter du réconfort à lui et à maman.
Elle l’accueillit d’un sourire radieux, sans la moindre trace de fatigue, quand il se réveilla. Il lui rendit son sourire, mais faiblement, comme si cela lui coûtait un effort inhabituel. Son visage retrouva bien vite l’expression d’anxiété habituelle. Il avait cette manie d’entrouvrir la bouche comme pour parler, ce qui crispait la forme de ses lèvres et donnait à son visage un air indécis. Mais il avait les mêmes yeux grands et doux que sa fille — des yeux qui se déplaçaient lentement, presque avec majesté, et qu’ombrageaient de fines paupières transparentes. Margaret lui ressemblait plus qu’à sa mère. Certains s’étonnaient qu’un couple si séduisant puisse avoir une fille loin d’être régulièrement belle ; on disait parfois qu’elle n’était pas belle du tout. Sa bouche était large ; nul bouton de rose qui ne saurait s’entrouvrir que pour laisser échapper « oui » et « non », ou « je vous en prie, monsieur ». Pourtant, cette bouche large dessinait une courbe délicate de lèvres rouges et pulpeuses ; et, si sa peau n’était pas blanche et diaphane, elle avait la douceur et la finesse de l’ivoire. Si la gravité et la retenue qu’on lisait habituellement sur son visage semblaient peu communes pour son jeune âge, en cet instant, en parlant à son père, elle resplendissait tel le matin — pleine de fossettes et de regards pétillants, qui exprimaient la joie enfantine et l’immense espoir de l’avenir.
Nous étions à la fin juillet quand Margaret revint à la maison. Les arbres de la forêt n’étaient plus qu’un grand massif vert sombre, presque obscur ; la fougère en dessous captait tous les rayons obliques du soleil ; le temps était lourd et d’un calme orageux. Margaret arpentait la forêt au côté de son père, écrasant la fougère avec une joie presque cruelle, la sentant céder sous son pied léger et exhaler ce parfum qui lui est propre — elle traversait de vastes landes sous la lumière chaude et parfumée, observant des multitudes de créatures sauvages et libres, s’ébattant sous le soleil, profitant des herbes et des fleurs qu’il faisait éclore. Cette vie — du moins ces promenades — correspondaient parfaitement à tout ce qu’avait imaginé Margaret. Elle était fière de sa forêt. Ses habitants étaient devenus les siens. Elle se lia avec eux d’une solide amitié, apprit et prit plaisir à employer leurs expressions particulières ; elle vivait parmi eux en toute liberté, soignait leurs bébés ; lisait ou discutait lentement et clairement avec leurs anciens ; apportait de petites douceurs aux malades ; et se promit bientôt d’enseigner à l’école où son père se rendait chaque jour comme à un devoir désigné, même si elle se laissait souvent tenter par une visite à tel ou tel ami — homme, femme ou enfant — dans une chaumière nichée dans l’ombre verte de la forêt. Sa vie au grand air était parfaite. Sa vie à l’intérieur présentait toutefois quelques ombres. Avec la lucidité propre à une enfant, elle s’en voulait de remarquer que tout n’y fonctionnait pas comme il se devait. Sa mère — si bonne et si tendre avec elle habituellement — semblait parfois si insatisfaite de leur situation ; elle trouvait que l’évêque négligeait étrangement son office en ne conférant pas à M. Hale une cure plus avantageuse ; et elle reprochait presque à son mari de ne pas être capable de dire qu’il souhaitait quitter la paroisse pour s’occuper d’une plus grande. Il soupirait alors, répondant que s’il parvenait à remplir son devoir dans la petite Helstone, il devrait s’en sentir reconnaissant ; mais chaque jour il se trouvait plus accablé ; le monde devenait de plus en plus déroutant. À chaque nouvel appel de sa femme pour tenter d’obtenir une meilleure situation, Margaret voyait son père se recroqueviller davantage ; et elle s’efforçait, dans ces moments, de réconcilier sa mère avec Helstone. Mme Hale disait que la proximité de tant d’arbres nuisait à sa santé ; Margaret tentait alors de l’entraîner sur les vastes hauteurs baignant dans la lumière du soleil, sous les nuages en mouvement, parce qu’elle était convaincue que sa mère passait trop de temps enfermée, ne sortant guère au-delà de l’église, de l’école et des chaumières voisines. Cela lui faisait du bien, un temps ; mais quand l’automne arriva, avec son climat plus changeant, l’idée que l’endroit n’était pas sain se renforça chez sa mère ; et elle déplora encore plus souvent que son mari, pourtant plus érudit que M. Hume et meilleur pasteur que M. Houldsworth, n’ait pas obtenu l’avancement dont avaient bénéficié ces deux anciens voisins.
Ce qui saccageait ainsi la sérénité du foyer par de longues heures de mécontentement, Margaret ne s’y était pas attendue. Elle savait, et s’en réjouissait même un peu, qu’elle devrait renoncer à bien des commodités, qui n’avaient été pour elle que contraintes et contrariétés dans Harley Street. Son vif plaisir à tout ce qui touchait aux sens se trouvait finement contrebalancé, sinon surpassé, par la fierté de pouvoir se passer de toutes ces choses si nécessaire. Mais le nuage ne vient jamais du coin du ciel où on l’attend. Il y avait eu de légères récriminations et de brefs regrets de la part de sa mère, au sujet de tel ou tel détail tenant à Helstone ou à la situation de son père, quand Margaret rentrait pour les vacances ; mais, dans l’ensemble heureux de ces souvenirs, elle avait oublié les détails moins plaisants. À la fin de septembre, la saison des pluies et des tempêtes d’automne arriva, et Margaret dut rester davantage à l’intérieur qu’auparavant. Helstone était assez éloigné de tout voisin dont la culture d’esprit aurait semblé similaire à la leur.
« C’est sans conteste l’un des endroits les plus reculés d’Angleterre, dit Mme Hale dans un de ses accès de plainte. Je ne peux m’empêcher de regretter en permanence que papa n’ait personne à fréquenter ici ; quel gâchis ! Il ne voit que des fermiers et des ouvriers, semaine après semaine. Si seulement nous habitions l’autre côté de la paroisse, nous serions presque à distance de marche des Stansfield ; et il y aurait assurément les Gorman tout près, à portée d’une promenade. »
« Les Gorman, dit Margaret. Est-ce bien la famille qui a fait fortune dans le commerce à Southampton ? Oh ! je suis ravie que nous ne les fréquentions pas. Je n’aime pas les gens trop commerçants. Je pense que nous sommes bien mieux, à ne connaître que les villageois, les ouvriers, et les gens sans prétention. »
« Ne sois pas si difficile, ma chérie ! répondit sa mère, tout en songeant en secret au jeune et séduisant M. Gorman qu’elle avait déjà rencontré chez M. Hume. »
« Non ! Je considère au contraire que j’ai des goûts très larges ; j’aime toutes les personnes dont la profession est liée à la terre ; j’aime les soldats, les marins, et les trois grandes professions dites libérales. Tu ne souhaites pas vraiment que j’admire aussi les bouchers, les boulangers et les marchands de chandelles, si, maman ? »
« Mais les Gorman n’étaient ni bouchers ni boulangers, ils étaient des carrossiers très respectables. »
« Très bien. Construire des voitures est tout de même un commerce, et à mes yeux bien moins utile que celui de bouchers ou boulangers. Oh ! à quel point j’en avais assez, de ces trajets quotidiens en voiture chez tante Shaw, et comme je rêvais de marcher ! »
Et marcher, Margaret le fit bel et bien, malgré le temps. Elle était si heureuse dehors, au bras de son père, qu’elle en venait presque à sautiller ; et, portée par le doux vent d’ouest dans son dos, lorsqu’elle traversait quelque bruyère, elle se sentait emportée avec autant de légèreté qu’une feuille morte, emportée par la brise automnale. Mais les soirées étaient plus difficiles à occuper agréablement. Juste après le thé, son père se retirait dans son petit bureau, et elle restait seule avec sa mère. Mme Hale n’avait jamais eu grand goût pour les livres, et avait de bonne heure découragé son mari de lui faire la lecture pendant qu’elle travaillait, peu après le début de leur mariage. À un moment, ils avaient essayé le trictrac pour passer le temps ; mais à mesure que M. Hale s’était intéressé davantage à son école et à ses paroissiens, il s’était aperçu que les interruptions causées par ces devoirs étaient vécues par sa femme comme des désagréments — qu’elle ne jugeait pas naturels à la vie de pasteur, mais qu’elle subissait en se plaignant chaque fois. Alors, tandis que leurs enfants étaient encore jeunes, il s’était peu à peu enfermé dans sa bibliothèque, passant ses soirées (lorsqu’il était à la maison) à lire ces livres spéculatifs et métaphysiques qu’il adorait.
Lorsque Margaret était venue précédemment, elle avait apporté avec elle une grande caisse de livres, recommandés par ses professeurs ou ses gouvernantes, et elle trouvait les journées d’été bien trop courtes pour effectuer toutes ses lectures avant de retourner en ville. À présent, il ne restait plus que les classiques anglais bien reliés mais peu feuilletés, que l’on avait prélevés dans la bibliothèque de son père pour garnir les petits rayonnages du salon. Les Saisons de Thomson, le Cowper d’Hayley, le Cicéron de Middleton étaient, de loin, les plus légers, les plus récents, et les plus divertissants. Ces étagères n’offraient donc pas une grande variété. Margaret racontait à sa mère tous les détails de sa vie à Londres, que Mme Hale écoutait avec intérêt, parfois amusée et curieuse, d’autres fois un peu tentée de comparer le confort et les ressources de sa sœur à la modeste situation du presbytère d’Helstone. Durant de telles soirées, il arrivait à Margaret d’interrompre son récit assez brusquement pour écouter le ploc-ploc de la pluie sur le toit du petit bow-window. Il lui était arrivé une ou deux fois de se surprendre à compter mécaniquement la répétition du bruit monotone, tout en se demandant si elle oserait poser la question qui lui brûlait les lèvres : où était Frederick, que faisait-il, depuis quand n’avaient-ils pas reçu de nouvelles de lui. Mais elle savait que la santé fragile de sa mère, de même que son aversion pour Helstone, trouvaient leur source dans cette fameuse mutinerie de Frederick — qu’on ne mentionnait plus qu’avec gêne, et dont Margaret n’avait jamais entendu le récit complet, et qui semblait désormais demeurer dans un silencieux oubli. Alors, chaque fois qu’elle était seule avec sa mère, elle se disait que son père serait le meilleur interlocuteur ; mais quand elle restait avec lui, elle pensait qu’il vaudrait mieux aborder le sujet avec sa mère. Sans doute n’y avait-il pas grand-chose de neuf à apprendre. Dans l’une des lettres reçues avant de quitter Harley Street, son père lui avait écrit qu’ils avaient bien eu des nouvelles de Frederick, toujours à Rio, en bonne santé, et qui lui envoyait ses plus tendres pensées ; autant dire des mots bien fades, et non pas les informations qu’elle attendait ardemment. On ne parlait de Frederick que très rarement, et toujours comme du « pauvre Frederick ». Sa chambre était maintenue telle qu’il l’avait laissée, nettoyée ponctuellement par Dixon, la femme de chambre de Mme Hale, qui ne touchait à rien d’autre dans la maison, mais se rappelait parfaitement le jour où Lady Beresford l’avait engagée comme demoiselle de compagnie pour les pupilles de Sir John, les jolies Mlle Beresford, les coqueluches du comté de Rutland. Dixon avait toujours considéré M. Hale comme le mauvais sort qui s’était abattu sur la destinée de sa jeune maîtresse. Si Mlle Beresford ne s’était pas si vite mariée à ce pauvre pasteur de campagne, nul ne pouvait savoir ce qui aurait pu advenir. Mais Dixon était bien trop loyale pour l’abandonner dans ce qu’elle voyait comme une déchéance (son mariage). Elle était restée, dévouée à ses intérêts, et se considérait comme la bonne fée protectrice, chargée de décontenancer le méchant géant, M. Hale. Le jeune Frederick était son chouchou et sa fierté ; et c’était avec un attendrissement à peine voilé qu’elle venait chaque semaine préparer la chambre, avec le même soin que s’il devait rentrer le soir même. Margaret ne pouvait s’empêcher de croire que son père avait reçu de nouvelles récentes concernant Frederick, à l’insu de sa mère, qui l’inquiétaient. Mme Hale ne paraissait pas remarquer le moindre changement chez son mari. Son caractère était toujours tendre et sensible, touché de la moindre nouvelle affectant le bien-être d’autrui. Il était déprimé pendant plusieurs jours après avoir assisté à un lit de mort ou après avoir entendu parler d’un crime. Mais Margaret discernait maintenant en lui une sorte d’absence, comme si ses pensées étaient occupées par un sujet dont le poids ne pouvait se soulager par quelque action quotidienne, comme réconforter les survivants ou enseigner à l’école dans l’espoir de réduire à l’avenir les maux du monde. M. Hale rencontrait moins qu’auparavant ses paroissiens ; il demeurait davantage dans son bureau ; il attendait avec impatience le facteur du village, dont l’appel à la maison était un coup frappé à la contre-volet de la cuisine — un signal que, à une époque, il fallait souvent répéter, car personne n’était assez éveillé pour deviner l’heure et lui ouvrir. Mais aujourd’hui, M. Hale errait dans le jardin si le temps le permettait, et sinon, il restait là, pensif, près de la fenêtre de son bureau, jusqu’à ce que le facteur passe, lui adressant un hochement de tête mêlé de respect et de confidence ; M. Hale le regardait s’éloigner au-delà de l’églantier et du grand arbousier, avant de regagner la pièce pour commencer ses travaux du jour, tous les signes d’un cœur lourd et d’un esprit préoccupé sur son visage.
Mais Margaret était d’un âge où toute crainte, tant qu’elle ne repose pas sur des faits avérés, peut aisément être dissipée pour un temps par un grand soleil ou par quelque heureux événement extérieur. Et lorsque se levèrent ces quatorze magnifiques journées d’octobre, toutes ses inquiétudes s’envolèrent aussi légèrement que des aigrettes de chardon, et elle ne songea plus qu’aux merveilles de la forêt. La cueillette des fougères était terminée, et maintenant que la pluie avait cessé, elle pouvait s’aventurer dans certains coins profonds de la forêt, là où elle n’avait fait qu’entrevoir durant les mois de juillet et d’août. Elle avait appris le dessin avec Edith ; et la conscience des occasions manquées pendant le temps maussade, où elle avait passivement profité de la beauté des bois sans rien esquisser, la poussait à s’activer pour faire quelques croquis avant que l’hiver ne s’installe vraiment. Ainsi, ce matin-là, elle préparait sa planche quand Sarah, la femme de chambre, ouvrit grand la porte du salon en annonçant : « M. Henry Lennox. »
Chapitre 3. « Plus on se hâte, moins on avance »
« Apprends à gagner la confiance d’une dame Noblement, car c’est une chose élevée; Courageusement, comme si c’était une question de vie ou de mort — Avec une gravité loyale. »
« Conduis-la loin des tables de fête, Montre-lui la voûte étoilée, Protège-la, par la sincérité de tes propos, Pour qu’elle demeure à l’abri des flatteries amoureuses. »
— MADAME BROWNING.
« Monsieur Henry Lennox. » Margaret venait justement de penser à lui un instant auparavant, repensant à ses questions sur ce qu’elle ferait probablement chez elle. C’était « parler du soleil et l’on en voit les rayons » ; et la clarté du soleil illumina le visage de Margaret lorsqu’elle posa sa planche et avança pour lui serrer la main. « Sarah, préviens maman, dit-elle. Maman et moi avons tant de questions à vous poser au sujet d’Edith ; je vous suis si reconnaissante d’être venu. »
« N’avais-je pas dit que je viendrais ? » demanda-t-il, d’un ton plus bas que celui dont elle venait de parler.
« Mais je vous croyais si loin dans les Highlands que je n’imaginais pas que le Hampshire pût être inclus. »
« Oh ! » répondit-il plus légèrement, « nos jeunes mariés s’amusaient à de telles folies, prenant tous les risques, grimpant une montagne, naviguant sur tel lac, que j’ai vraiment pensé qu’il leur fallait un Mentor pour les surveiller. Et effectivement, ils en avaient besoin ; ils étaient complètement hors de la gestion de mon oncle, qui restait paniqué seize heures sur vingt-quatre. En vérité, quand j’ai constaté combien ils étaient peu fiables laissés à eux-mêmes, j’ai jugé de mon devoir de ne pas les quitter avant de les savoir en sécurité, embarqués à Plymouth. »
« Vous êtes donc allé à Plymouth ? Oh ! Edith ne m’en a jamais parlé. Bien sûr, elle écrit toujours à toute vitesse ces derniers temps. Ont-ils réellement embarqué mardi ? »
« Ils ont effectivement pris la mer, me libérant ainsi de bien des responsabilités. Edith m’a chargé de vous transmettre toutes sortes de messages. Je crois que j’ai ici un petit mot minuscule ; oui, le voilà. »
« Oh ! merci », s’exclama Margaret ; puis, à moitié désireuse de le lire seule et sans témoin, elle prétexta devoir aller dire à sa mère (car Sarah avait sûrement fait erreur) que M. Lennox était là.
Lorsqu’elle quitta la pièce, il commença, avec son regard scrutateur, à examiner les alentours. Le petit salon paraissait au mieux sous l’éclat du soleil matinal. La fenêtre centrale de la baie était ouverte, et les rosiers ainsi que le chèvrefeuille écarlate s’enroulaient dans l’angle ; la pelouse, si petite, étincelait de verveines et de géraniums multicolores. Mais cet éclat extérieur rendait les couleurs intérieures ternes et délavées. Le tapis n’était plus neuf ; les cretonnes avaient été maintes fois lavées ; l’ensemble était plus étroit et plus défraîchi qu’il ne l’avait imaginé pour servir de toile de fond à Margaret, si royale en apparence. Il prit l’un des livres posés sur la table ; c’était le Paradiso de Dante, dans l’ancienne reliure italienne de velin blanc et d’or ; à côté se trouvaient un dictionnaire et quelques mots recopiés de la main de Margaret. Ce n’était qu’une liste austère de vocabulaire, mais pour une raison qu’il ignorait, il aimait les regarder. Il les reposa en soupirant.
« La cure est manifestement aussi modeste qu’elle l’avait dit. C’est étrange, sachant que les Beresford appartiennent à une bonne famille. »
Pendant ce temps, Margaret avait retrouvé sa mère. C’était l’un de ces jours où Mme Hale se sentait mal, où chaque chose lui semblait difficile et pénible ; et la venue de M. Lennox prenait cette forme, même si au fond elle se sentait flattée qu’il ait jugé utile de passer.
« C’est vraiment malheureux ! Nous déjeunons tôt aujourd’hui, et nous n’avons que de la viande froide, afin que le personnel puisse avancer son repassage ; et bien sûr, nous devons l’inviter à dîner — c’est tout de même le beau-frère d’Edith. Et ton papa est de si mauvaise humeur ce matin pour je ne sais quelle raison — je viens d’aller dans le bureau, et il avait la tête sur la table, le visage couvert de ses mains. Je lui ai dit que je trouvais aussi que l’air de Helstone ne nous convenait pas, et il a tout à coup levé la tête pour me supplier de ne plus dire un seul mot contre Helstone, il ne pouvait pas le supporter ; s’il y avait un lieu qu’il aimait sur terre, c’était Helstone. Mais je suis convaincue qu’il est pourtant humide et lourd. »
Un léger voile sembla se glisser entre Margaret et le soleil. Elle avait écouté patiemment, espérant que cela soulagerait sa mère de vider son sac ; mais à présent, il était temps de la ramener à M. Lennox.
« Papa apprécie M. Lennox ; ils s’entendaient à merveille au déjeuner de mariage. Je parie que sa venue fera du bien à papa. Et peu importe le dîner, maman : de la viande froide suffira parfaitement pour un repas, que M. Lennox considérera probablement comme un déjeuner vers deux heures. »
« Mais que ferons-nous de lui d’ici là ? Il n’est que dix heures et demie. »
« Je vais lui proposer de sortir dessiner avec moi. Je sais qu’il manie le crayon, et ça le tiendra occupé, loin de toi, maman. Mais viens maintenant, sinon il trouvera étrange que tu ne te montres pas. »
Mme Hale retira son tablier de soie noire et retrouva un visage plus serein. Elle avait l’air d’une très jolie dame, pleine de distinction, lorsqu’elle salua chaleureusement M. Lennox, en vertu du lien apparent avec la famille. De toute évidence, il s’attendait à ce qu’on l’invite à passer la journée, et il accepta cette proposition avec une promptitude réjouie, au point de faire regretter à Mme Hale de ne pouvoir ajouter quelque chose à la viande froide. Tout lui plaisait : il était ravi de l’idée de Margaret d’aller dessiner ensemble ; il ne souhaitait surtout pas déranger M. Hale, d’autant qu’il le verrait bientôt pour le dîner. Margaret sortit ses affaires de dessin pour qu’il fasse son choix ; et, après avoir opté pour le papier et les pinceaux qui lui convenaient, ils partirent, animés de la plus joyeuse humeur qui soit.
« Maintenant, arrêtons-nous ici un instant, s’il te plaît, dit Margaret. Voici les chaumières qui me hantaient pendant toute la quinzaine de pluie, m’accusant de ne pas les avoir encore croquées. »
« Avant qu’elles ne s’effondrent et ne disparaissent. Franchement, si nous devons les dessiner — et elles sont très pittoresques — il vaudrait mieux éviter d’attendre l’an prochain. Mais où allons-nous nous asseoir ? »
« Oh ! Tu aurais pu venir directement de tes bureaux du Temple, au lieu d’avoir passé deux mois dans les Highlands ! Regarde ce magnifique tronc d’arbre que les bûcherons ont abandonné juste là où la lumière est idéale. Je vais y poser mon plaid, et ce sera un véritable trône forestier. »
« Avec tes pieds dans cette flaque comme marchepied royal ! Attends, je vais me déplacer, et tu pourras t’installer plus près d’ici. Qui habite ces chaumières ? »
« Elles ont été construites par des squatteurs il y a cinquante ou soixante ans. L’une est inhabitée ; les forestiers prévoient de la démolir dès que le vieil homme qui vit dans l’autre ne sera plus là, le pauvre ! Regarde, le voilà — je dois lui parler. Il est si dur d’oreille que tu entendras tous nos secrets. »
Le vieillard se tenait, tête nue, au soleil, s’appuyant sur sa canne devant sa chaumière. Son visage figé s’éclaira d’un lent sourire lorsque Margaret s’approcha pour lui adresser la parole. M. Lennox, quant à lui, s’empressa de faire figurer ces deux personnages dans son croquis, complétant le paysage avec eux en point de référence secondaire — c’est du moins ce que Margaret remarqua lorsqu’ils rangèrent l’eau et les chutes de papier et comparèrent leurs dessins. Elle rit et rougit, pendant que M. Lennox l’observait attentivement.
« C’est de la traîtrise, protesta-t-elle. Je ne me doutais pas un instant que, pendant que je questionnais Isaac sur l’histoire de ces chaumières, tu étais en train de nous choisir comme sujets. »
« C’était irrésistible. Tu n’imagines pas à quel point j’ai été tenté. Je n’ose te dire à quel point ce croquis me sera cher. »
Il n’était pas tout à fait sûr qu’elle eût entendu cette dernière phrase avant d’aller à la rivière rincer sa palette. Elle revint un peu rougie, mais l’air parfaitement innocent et sans arrière-pensée. Il en fut heureux, car il avait laissé échapper ces mots sans vraiment y réfléchir — ce qui lui arrivait rarement, lui qui préméditait tant ses actes.
La maison resplendissait sous leur regard lorsqu’ils l’atteignirent. Les soucis qu’affichait le visage de Mme Hale s’étaient dissipés sous l’influence providentielle d’une paire de carpes qu’un voisin avait eu l’excellente idée de lui offrir. M. Hale était revenu de sa tournée matinale et guettait son visiteur devant le petit portillon menant au jardin. Dans son manteau râpé et son chapeau usé, il avait tout l’air du parfait gentleman.
Margaret était fière de son père ; elle ressentait toujours cette fierté douce et profonde en voyant à quel point il faisait bonne impression sur toute personne étrangère ; mais son regard vif distinguait aussi sur ses traits les marques d’une inquiétude nouvelle, mise de côté mais non résolue.
Puis M. Hale demanda à regarder leurs croquis.
« Je trouve que tu as assombri la couleur du chaume, non ? » fit-il, en rendant celui de Margaret et en tendant la main pour celui de M. Lennox, que ce dernier conserva un instant, à peine.
« Non, papa ! Je ne crois pas. La joubarbe et l’orpin ont foncé depuis la pluie. N’est-ce pas ressemblant, papa ? » dit-elle, jetant un œil par-dessus son épaule pendant qu’il admirait les personnages dans le dessin de M. Lennox.
« Oui, très fidèle. Ta silhouette et ta posture sont parfaites. Et c’est bien la raideur d’Isaac, le pauvre, avec son dos courbé par les rhumatismes. Qu’est-ce que c’est, accroché à cette branche d’arbre ? Ce n’est tout de même pas un nid d’oiseau. »
« Oh ! non ! c’est mon chapeau. Je ne peux jamais dessiner en le gardant, j’ai trop chaud à la tête. Je me demande si je saurais également faire des portraits. Il y a tant de gens ici que j’aimerais croquer. »
« Je dirais qu’un visage que tu veux vraiment dessiner, tu réussiras toujours à le rendre, » déclara M. Lennox. « J’ai moi-même une grande foi dans le pouvoir de la volonté. Quant à moi, je trouve t’avoir plutôt bien capturée. » M. Hale les avait laissés pour entrer à la maison, pendant que Margaret s’attardait à cueillir quelques roses pour égailler sa robe de matinée avant le dîner.
« Une jeune femme tout droit sortie de Londres aurait tout de suite compris le sens caché de cette remarque, » pensa M. Lennox. « Elle aurait su déceler l’arrière-pensée flatteuse dans chaque mot prononcé par un jeune homme. Mais je doute que Margaret… Attends ! » s’exclama-t-il. « Laisse-moi t’aider », et il cueillit pour elle quelques roses cramoisies trop hautes pour qu’elle les atteigne. Puis, après avoir partagé son trésor, il en glissa deux à sa boutonnière et la laissa rentrer, ravie, arranger ses fleurs.
Le dîner se déroula dans une ambiance sereine et agréable. Chacun avait mille questions à poser concernant les dernières nouvelles au sujet du séjour de Mme Shaw en Italie, et ils échangèrent leurs informations. L’atmosphère simple et modeste du presbytère, la compagnie de Margaret surtout, firent oublier à M. Lennox la petite déception qu’il avait ressentie en constatant que le revenu de M. Hale était effectivement aussi modeste que la jeune femme l’avait décrit.
« Margaret, ma chérie, tu aurais pu nous apporter des poires pour le dessert, » remarqua M. Hale lorsque la bouteille de vin, nouvellement décantée en gage d’hospitalité, fut posée sur la table.
Mme Hale fut décontenancée. On aurait dit que ces desserts improvisés n’étaient pas coutumiers à la cure ; alors qu’en vérité, si M. Hale avait regardé derrière lui, il aurait vu des biscuits, de la marmelade, et bien d’autres choses sagement disposées sur le buffet. Mais l’idée de poires s’était logée dans l’esprit de M. Hale et il n’était plus question de s’en défaire.
« Il y a quelques beurrés bruns le long du mur au sud, qui valent toutes les confitures et les fruits exotiques. Va nous en chercher, Margaret. »
« Je propose que nous allions dans le jardin et que nous les dégustions là-bas, » dit M. Lennox.
« Rien n’est plus délectable que de croquer dans un fruit croquant et juteux, encore tiède et parfumé par le soleil. Le seul inconvénient, c’est que les guêpes sont assez audacieuses pour le disputer jusque dans l’instant suprême de la dégustation. »
Il se leva comme pour suivre Margaret, qui était déjà sortie par la fenêtre ; il attendit seulement l’approbation de Mme Hale. Celle-ci aurait préféré conclure le dîner comme il se devait, avec toutes les convenances, d’autant plus que Dixon et elle avaient sorti les rince-doigts du débarras, bien décidées à faire honneur à leur rang de belle-sœur d’un général Shaw ; cependant, comme M. Hale s’était empressé de se lever pour accompagner son invité, elle n’eut pas d’autre choix que d’acquiescer.
« Je prendrai un couteau, » déclara M. Hale : « j’ai dépassé le temps où je pouvais manger le fruit si primitivement. Je dois l’éplucher et le couper avant de l’apprécier. »
Margaret utilisa une feuille de betterave comme assiette pour les poires, ce qui rehaussait délicieusement leur couleur brun doré. M. Lennox regardait davantage la jeune femme que les poires, mais son père, déterminé à savourer jusqu’au moindre délice de cette heure volée à ses préoccupations, choisit soigneusement les fruits les plus mûrs et s’installa sur le banc du jardin pour en profiter pleinement. Margaret et M. Lennox firent quelques pas sur la petite allée longeant le mur sud, où les abeilles bourdonnaient toujours avec ardeur autour de leurs ruches.