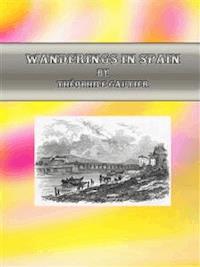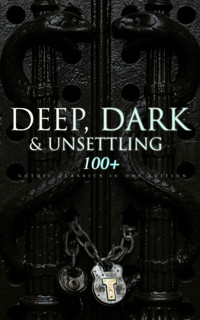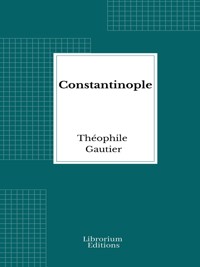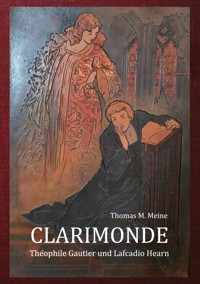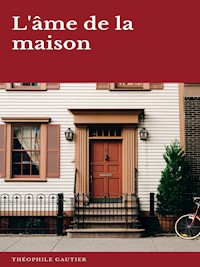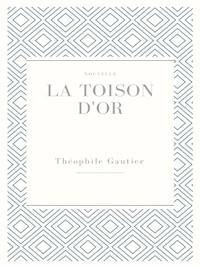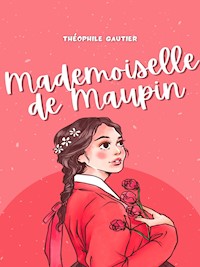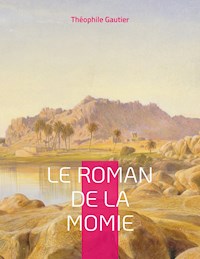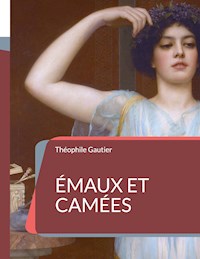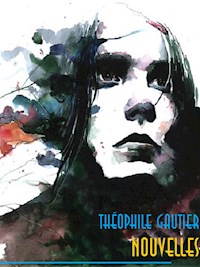
19,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Gautier a écrit une trentaine de contes et nouvelles, pour la plupart de nature fantastique. Extrait : Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion ; mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j'entendais battre mon coeur comme une montre accrochée à mes oreilles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Théophile Gautier
Nouvelles I Antología
table des matières
Première partie La cafetière
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Deuxième partie Omphale ou la Tapisserie amoureuse
Troisième partie La morte amoureuse
Chapitre 5 La chaîne d’or ou l’amant partagé
Quatrième partie L’âme de la maison
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Cinquième partie Une visite nocturne
Sixième partie Le petit chien de la marquise
Chapitre 8 Le lendemain du souper.
Chapitre 9 Le bichon Fanfreluche.
Chapitre 10 Un pastel de Latour.
Chapitre 11 Pompadour.
Chapitre 12 Pourparler.
Chapitre 13 La ruelle d’Éliante.
Chapitre 7
Chapitre 8 Perplexité.
Chapitre 9 Mémoire de Giroflée
Chapitre 10 Le faux Fanfreluche.
Septième partie Annexe
Chapitre 11 De l’obésité en littérature
Première partie La pipe d’opium
Deuxième partie Une nuit de Cléopâtre
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Troisième partie La toison d’or
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Première partie Le pied de momie
Deuxième partie Le club des hachichins
Chapitre 1 L’hôtel Pimodan.
Chapitre 2 Parenthèse.
Chapitre 3 Agape.
Chapitre 4 Un monsieur qui n’était pas invité.
Chapitre 5 Fantasia.
Chapitre 6 Kief.
Chapitre 7 Le kief tourne au cauchemar.
Chapitre 8 Tread-Mill.
Chapitre 9 Ne croyez pas aux chronomètres.
Troisième partie Arria Marcella
Chapitre 10 Souvenir de Pompéi
Quatrième partie Le chevalier double
Cinquième partie Deux acteurs pour un rôle
Chapitre 11 Un rendez-vous au jardin impérial.
Chapitre 12 Le gasthof de l’Aigle à deux têtes.
Chapitre 13 Le Théâtre de la porte de Carinthie.
Première partie La cafetière
Conte fantastique
J’ai vu sous de sombres voiles
Onze étoiles,
La lune, aussi le soleil,
Me faisant la révérence,
En silence,
Tout le long de mon sommeil.
La vision de Joseph.1
Chapitre 1
L’année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d’atelier, Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui, à notre départ, promettait d’être superbe, s’avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie, que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d’un torrent.
Nous enfoncions dans la bourbe jusqu’aux genoux, une couche épaisse de terre grasse s’était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n’arrivâmes au lieu de notre destination qu’une heure après le coucher du soleil.
Nous étions harassés ; aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre.
La mienne était vaste ; je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j’entrais dans un monde nouveau.
En effet, l’on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de porte de Boucher représentant les quatre Saisons, les meubles surchargés d’ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement.
Rien n’était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peignes, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d’argent, jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d’écaille ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais.
Je ne remarquai ces choses qu’après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m’eut souhaité un bon somme, et, je l’avoue, je commençai à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille.
Mais il me fut impossible de rester dans cette position : le lit s’agitait sous moi comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir.
Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l’appartement, de sorte qu’on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille.
C’étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main.
Tout à coup le feu prit un étrange degré d’activité ; une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j’avais pris pour de vaines peintures était la réalité ; car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon singulière ; leurs lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n’entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d’automne.
Une terreur insurmontable s’empara de moi, mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s’entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps.
La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et, lorsqu’il fut éteint tout à fait…
Oh ! non, je n’ose pas dire ce qui arriva, personne ne me croirait, et l’on me prendrait pour un fou.
Les bougies s’allumèrent toutes seules ; le souffler, sans qu’aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres.
Ensuite une cafetière se jeta en bas d’une table où elle était posée, et se dirigea, clopin-clopant, vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons.
Quelques instant après, les fauteuils commencèrent à s’ébranler, et, agitant leurs pieds tortillés d’une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée.
Chapitre 2
Je ne savais que penser de ce que je voyais ; mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d’un gros joufflu à barbe grise, ressemblant, à s’y méprendre, à l’idée que je me suis faite du vieux sir John Falstaff, sortit, en grimaçant, la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta lourdement par terre.
Il n’eut pas plutôt pris haleine, qu’il tira de la poche de son pourpoint une clef d’une petitesse remarquable ; il souffla dedans pour s’assurer si la forure était bien nette, et il l’appliqua à tous les cadres les uns après les autres.
Et tous les cadres s’élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu’ils renfermaient.
Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l’air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits-maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l’épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre, que, malgré ma frayeur, je ne pus m’empêcher de rire.
Ces dignes personnages s’assirent ; la cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d’elles munie d’un morceau de sucre et d’une petite cuiller d’argent.
Quand le café fut pris, tasses, cafetière et cuillers disparurent à la fois, et la conversation commença, certes la plus curieuse que j’aie jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l’autre en parlant : ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule.
Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m’empêcher de suivre l’aiguille, qui marchait vers minuit à pas imperceptibles.
Enfin, minuit sonna ; une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit :
— Voici l’heure, il faut danser.
Toute l’assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement ; alors, chaque cavalier prit la main d’une dame, et la même voix dit :
— Allons, messieurs de l’orchestre, commencez !
J’ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d’un côté, et de l’autre une chasse au cerf où plusieurs valets donnaient du cor. Les piqueurs et les musiciens, qui, jusque-là, n’avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d’adhésion.
Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s’élança des deux bouts de la salle. On dansa d’abord le menuet.
Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s’accordaient mal avec ces graves révérences : aussi chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter, comme une toupie d’Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d’une nature particulière ; on aurait dit le bruit d’ailes d’un vol de pigeons. Le vent qui s’engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu’elles avaient l’air de cloches en branle.
L’archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes, qu’il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s’ils eussent été de vif-argent ; les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressés et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n’auraient pu deux minutes suivre une pareille mesure.
Aussi, c’était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambe, des jetés battus et des entrechats de trois pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le fard. Mais ils avaient beau faire, l’orchestre les devançait toujours de trois ou quatre notes.
La pendule sonna une heure ; ils s’arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m’était échappé : une femme qui ne dansait pas.
Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée, et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d’elle.
Jamais, même en rêve, rien d’aussi parfait ne s’était présenté à mes yeux ; une peau d’une blancheur éblouissante, des cheveux d’un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes, que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu’un caillou au fond d’un ruisseau.
Et je sentis que, si jamais il m’arrivait d’aimer quelqu’un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d’où jusque-là je n’avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pusse m’en rendre compte ; et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l’eusse connue depuis vingt ans.
Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquais d’une oscillation de tête la musique qui n’avait pas cessé de jouer ; et, quoique je fusse au comble du bonheur d’entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle.
Cependant je n’osais lui en faire la proposition. Il paraît qu’elle comprit ce que je voulais, car, levant vers le cadran de l’horloge la main que je ne tenais pas :
— Quand l’aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore.
Je ne sais comment cela se fit, je ne fus nullement surpris de m’entendre ainsi appeler par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l’heure indiquée sonna, la voix au timbre d’argent vibra encore dans la chambre et dit :
— Angéla, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera.
— N’importe, répondit Angéla d’un ton boudeur.
Et elle passa son bras d’ivoire autour de mon cou.
— Prestissimo ! cria la voix.
Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine, sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche.
Jamais de la vie je n’avais éprouvé une pareille émotion ; mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d’acier, mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j’entendais battre mon coeur comme une montre accrochée à mes oreilles.
Pourtant cet état n’avait rien de pénible. J’étais inondé d’une joie ineffable et j’aurais toujours voulu demeurer ainsi, et, chose remarquable, quoique l’orchestre eût triplé de vitesse, nous n’avions besoin de faire aucun effort pour le suivre.
Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo, et frappaient de toutes leurs forces dans leurs mains, qui ne rendaient aucun son.
Angéla, qui jusqu’alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer ; elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué ; ses petits pieds, qui, une minute auparavant, effleuraient le plancher, ne s’en détachaient que lentement, comme s’ils eussent été chargés d’une masse de plomb.
— Angéla, vous êtes lasse, lui dis-je, reposons-nous.
— Je le veux bien, répondit-elle en s’essuyant le front avec son mouchoir. Mais, pendant que nous valsions, ils se sont tous assis ; il n’y a plus qu’un fauteuil, et nous sommes deux.
— Qu’est-ce que cela fait, mon bel ange ? Je vous prendrai sur mes genoux.
Chapitre 3
Sans faire la moindre objection, Angéla s’assit, m’entourant de ses bras comme d’une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre.
Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature.
Je n’avais plus aucune idée de l’heure ni du lieu ; le monde réel n’existait plus pour moi, et tous les liens qui m’y attachent étaient rompus ; mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l’infini ; je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre, les pensées d’Angéla se révélant à moi sans qu’elle eût besoin de parler ; car son âme brillait dans son corps comme une lampe d’albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part.
L’alouette chanta, une lueur pâle se joua sur les rideaux.
Aussitôt qu’Angéla l’aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d’adieu, et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur.
Saisi d’effroi, je m’élançai pour la relever… Mon sang se fige rien que d’y penser : je ne trouvai rien que la cafetière brisée en mille morceaux.
À cette vue, persuadé que j’avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s’empara de moi, que je m’évanouis.
Chapitre 4
Lorsque je repris connaissance, j’étais dans mon lit ; Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j’eus ouvert les yeux, Arrigo s’écria : — Ah ! ce n’est pas dommage ! voilà bientôt une heure que je te frotte les temps d’eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre, et je t’ai trouvé tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisée, comme si c’eût été une jeune et jolie fille.
— Pardieu ! c’est l’habit de noce de mon grand-père, dit l’autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramages verts. Voilà les boutons de strass et de filigrane qu’il nous vantait tant. Théodore l’aura trouvé dans quelque coin et l’aura mis pour s’amuser. Mais à propos de quoi t’es-tu trouvé mal ? ajouta Borgnioli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches ; on la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c’est une belle occasion de faire des minauderies.
— Ce n’est qu’une faiblesse qui m’a pris ; je suis sujet à cela, répondis-je sèchement.
Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement.
Et puis l’on déjeuna.
Mes trois camarade mangèrent beaucoup et burent encore plus ; moi, je ne mangeais presque pas, le souvenir de ce qui s’était passé me causait d’étranges distractions.
Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n’y eut pas moyen de sortir ; chacun s’occupa comme il put. Borgnioli tambourina des marches guerrières sur les vitres ; Arrigo et l’hôte firent une partie de dames ; moi, je tirai de mon album un carré de vélin, et je me mis à dessiner.
Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j’y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représenter avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit.
— C’est étonnant comme cette tête ressemble à ma soeur Angéla, dit l’hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule.
En effet, ce qui m’avait semblé tout à l’heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d’Angéla.
— De par tous les saints du paradis ! est-elle morte ou vivante ? m’écriai-je d’un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse.
— Elle est morte, il y a deux ans, d’une fluxion de poitrine à la suite d’un bal.
— Hélas ! répondis-je douloureusement.
Et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l’album.
Je venais de comprendre qu’il n’y avait plus pour moi de bonheur sur la terre !
Deuxième partie Omphale ou la Tapisserie amoureuse
Deuxième partie Omphale ou la Tapisserie amoureuse
Histoire rococo
Mon oncle, le chevalier de øøø, habitait une petite maison donnant d’un côté sur la triste rue des Tournelles et de l’autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles, dévorées d’insectes et de mousse, étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d’une espèce de cloaque encaissé par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient languissamment la tête comme des jeunes filles poitrinaires, attendant qu’un rayon de soleil vînt sécher leurs feuilles à moitié pourries. Les herbes avaient fait irruption dans les allées, qu’on avait peine à reconnaître, tant qu’il y avait longtemps que le râteau ne s’y était promené. Un ou deux poissons rouges flottaient plutôt qu’ils ne nageaient dans un bassin couvert de lentilles d’eau et de plantes de marais.
Mon oncle appelait cela son jardin.
Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les belles choses que nous venons de décrire, il y avait un pavillon passablement maussade, auquel, sans doute par antiphrase, il avait donné le nom de Délices. Il était dans un état de dégradation complète. Les murs faisaient ventre ; de larges plaques de crépi s’étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine ; une moisissure putride verdissait les assises inférieures ; les bois des volets et des portes avaient joué, et ne fermaient plus ou fort mal. Une espèce de gros pot à feu avec des effluves rayonnantes formait la décoration de l’entrée principale ; car, aux temps de Louis XV, temps de la construction des Délices, il y avait toujours, par précaution, deux entrées. Des oves, des chicorées et des volutes surchargeaient la corniche toute démantelée par l’infiltration des eaux pluviales. Bref, c’était une fabrique assez lamentable à voir que les Délices de mon oncle le chevalier deøøø.
Cette pauvre ruine d’hier, aussi délabrée que si elle eût eu mille ans, ruine de plâtre et non de pierre, toute ridée, toute gercée, couverte de lèpre, rongée de mousse et de salpêtre, avait l’air d’un de ces vieillards précoces, usés par de sales débauches ; elle n’inspirait aucun respect, car il n’y a rien d’aussi laid et d’aussi misérable au monde qu’une vieille robe de gaze et un vieux mur de plâtre, deux choses qui ne doivent pas durer et qui durent.
C’était dans ce pavillon que mon oncle m’avait logé.
L’intérieur n’en était pas moins rococo que l’extérieur quoiqu’un peu mieux conservé. Le lit était de lampas jaune à grandes fleurs blanches. Une pendule de rocaille posait sur un piédouche incrusté de nacre et d’ivoire. Une guirlande de roses pompon circulait coquettement autour d’une glace de Venise ; au-dessus des portes les quatre saisons étaient peintes en camaïeu. Une belle dame, poudrée à frimas, avec un corset bleu de ciel et une échelle de rubans de la même couleur, un arc dans la main droite, une perdrix dans la main gauche, un croissant sur le front, un lévrier à ses pieds, se prélassait et souriait le plus gracieusement du monde dans un large cadre ovale. C’était une des anciennes maîtresses de mon oncle, qu’il avait fait peindre en Diane. L’ameublement, comme on voit, n’était pas des plus modernes. Rien n’empêchait que l’on ne se crût au temps de la Régence, et la tapisserie mythologique qui tendait les murs complétait l’illusion on ne peut mieux.
La tapisserie représentait Hercule filant aux pieds d’Omphale. Le dessin était tourmenté à la façon de Van Loo et dans le style le plus Pompadour qu’il soit possible d’imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d’une faveur couleur de rose ; il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière, comme un marquis qui prend une prise de tabac, en faisant tourner, entrer son pouce et son index, une blanche flammèche de filasse ; son cou nerveux était chargé de noeuds de rubans, de rosettes, de rangs de perles et de mille affiquets féminins ; une large jupe gorge de pigeon, avec deux immenses paniers, achevait de donner un air tout à fait galant au héros vainqueur de monstres.
Omphale avait ses blanches épaules à moitié couvertes par la peau du lion de Némée ; sa main frêle s’appuyait sur la noueuse massue de son amant ; ses beaux cheveux blond cendré avec un oeil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou, souple et onduleux comme un cou de colombe ; ses petits pieds, vrais pieds d’Espagnole ou de Chinoise, et qui eussent été au large dans la pantoufle de verre de Cendrillon, étaient chaussés de cothurnes demi-antiques, lilas tendre, avec un semis de perles. Vraiment elle était charmante ! Sa tête se rejetait en arrière d’un air de crânerie adorable ; sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite moue ; sa narine était légèrement gonflée, ses joues un peu allumées ; un assassin1, savamment placé, en rehaussait l’éclat d’une façon merveilleuse ; il ne lui manquait qu’une petite moustache pour faire un mousquetaire accompli.
Il y avait encore bien d’autres personnages dans la tapisserie, la suivante obligée, le petit Amour de rigueur ; mais ils n’ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette assez distincte pour que je les puisse décrire.
En ce temps-là j’étais fort jeune, ce qui ne veut pas dire que je sois très vieux aujourd’hui ; mais je venais de sortir du collège, et je restais chez mon oncle en attendant que j’eusse fait choix d’une profession. Si le bonhomme avait pu prévoir que j’embrasserais celle de conteur fantastique, nul doute qu’il ne m’eût mis à la porte et déshérité irrévocablement ; car il professait pour la littérature en général, et les auteurs en particulier, le dédain le plus aristocratique. En vrai gentilhomme qu’il était, il voulait faire pendre ou rouer de coups de bâton, par ses gens, tous ces petits grimauds qui se mêlent de noircir du papier et parlent irrévérencieusement des personnes de qualité. Dieu fasse paix à mon pauvre oncle ! mais il n’estimait réellement au monde que l’épître à Zétulbé.
Donc je venais de sortir du collège. J’étais plein de rêves et d’illusions ; j’étais naïf autant et peut-être plus qu’une rosière de Salency. Tout heureux de ne plus avoir de pensumsà faire, je trouvais que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je croyais à une infinité de choses ; je croyais à la bergère de M. de Florian, aux moutons peignés et poudrés à blanc ; je ne doutais pas un instant du troupeau de madame Deshoulières. Je pensais qu’il y avait effectivement neuf muses, comme l’affirmait l’ Appendixde Diis et Héroïbus du père Jouvency. Mes souvenirs de Berquin et de Gessner me créaient un petit monde où tout était rose, bleu de ciel et vert-pomme. Ô sainte innocence ! sanctasimplicitas! comme dit Méphistophélès.
Quand je me trouvai dans cette belle chambre, chambre à moi, à moi tout seul, je ressentis une joie à nulle autre seconde. J’inventoriai soigneusement jusqu’au moindre meuble ; je furetai dans tous les coins, et je l’explorai dans tous les sens… J’étais au quatrième ciel, heureux comme un roi ou deux. Après le souper (car on soupait chez mon oncle), charmante coutume qui s’est perdue avec tant d’autres non moins charmantes que je regrette de tout ce que j’ai de coeur, je pris mon bougeoir et je me retirai, tant j’étais impatient de jouir de ma nouvelle demeure.
En me déshabillant, il me sembla que les yeux d’Omphale avaient remué ; je regardai plus attentivement, non sans un léger sentiment de frayeur, car la chambre était grande, et la faible pénombre lumineuse qui flottait autour de la bougie ne servait qu’à rendre les ténèbres plus visibles. Je crus voir qu’elle avait la tête tournée en sens inverse. La peur commençait à me travailler sérieusement ; je soufflai la lumière. Je me tournai du côté du mur, je mis mon drap par-dessus ma tête, je tirai mon bonnet jusqu’à mon menton, et je finis par m’endormir.
Je fus plusieurs jours sans oser jeter les yeux sur la maudite tapisserie.
Il ne serait peut-être pas inutile, pour rendre plus vraisemblable l’invraisemblable histoire que je vais raconter, d’apprendre à mes belles lectrices qu’à cette époque j’étais en vérité un assez joli garçon. J’avais les yeux les plus beaux du monde : je le dis parce qu’on me l’a dit ; un teint un peu plus frais que celui que j’ai maintenant, un vrai teint d’oeillet ; une chevelure brune et bouclée que j’ai encore, et dix-sept ans que je n’ai plus. Il ne me manquait qu’une jolie marraine pour faire un très passable Chérubin, malheureusement la mienne avait cinquante-sept ans et trois dents, ce qui était trop d’un côté et pas assez de l’autre.
Un soir, pourtant, je m’aguerris au point de jeter un coup d’oeil sur la belle maîtresse d’Hercule ; elle me regardait de l’air le plus triste et le plus langoureux du monde. Cette fois-là j’enfonçai mon bonnet jusque sur mes épaules et je fourrai ma tête sous le traversin.
Je fis cette nuit-là un rêve singulier, si toutefois c’était un rêve.
J’entendis les anneaux des rideaux de mon lit glisser en criant sur leurs tringles, comme si l’on eût tiré précipitamment les courtines. Je m’éveillai ; du moins dans mon rêve il me sembla que je m’éveillais. Je ne vis personne.
La lune donnait sur les carreaux et projetait dans la chambre sa lueur bleue et blafarde. De grandes ombres, des formes bizarres, se dessinaient sur le plancher et sur les murailles. La pendule sonna un quart ; la vibration fut longue à s’éteindre ; on aurait dit un soupir. Les pulsations du balancier, qu’on entendait parfaitement, ressemblaient à s’y méprendre au coeur d’une personne émue.
Je n’étais rien moins qu’à mon aise et je ne savais trop que penser.
Un furieux coup de vent fit battre les volets et ployer le vitrage de la fenêtre. Les boiseries craquèrent, la tapisserie ondula. Je me hasardai à regarder du côté d’Omphale, soupçonnant confusément qu’elle était pour quelque chose dans tout cela. Je ne m’étais pas trompé.
La tapisserie s’agita violemment. Omphale se détacha du mur et sauta légèrement sur le parquet ; elle vint à mon lit en ayant soin de se tourner du côté de l’endroit. Je crois qu’il n’est pas nécessaire de raconter ma stupéfaction. Le vieux militaire le plus intrépide n’aurait pas été trop rassuré dans une pareille circonstance, et je n’étais ni vieux ni militaire. J’attendis en silence la fin de l’aventure.
Une petite voix flûtée et perlée résonna doucement à mon oreille, avec ce grasseyement mignard affecté sous la Régence par les marquises et les gens du bon ton :
« Est-ce que je te fais peur, mon enfant ? Il est vrai que tu n’es qu’un enfant ; mais cela n’est pas joli d’avoir peur des dames, surtout de celles qui sont jeunes et te veulent du bien ; cela n’est ni honnête ni français ; il faut te corriger de ces craintes-là. Allons, petit sauvage, quitte cette mine et ne te cache pas la tête sous les couvertures. Il y aura beaucoup à faire à ton éducation, et tu n’es guère avancé, mon beau page ; de mon temps les Chérubins étaient plus délibérés que tu ne l’es.
— Mais, dame, c’est que…
— C’est que cela te semble étrange de me voir ici et non là, dit-elle en pinçant légèrement sa lèvre rouge avec ses dents blanches, et en étendant vers la muraille son doigt long et effilé. En effet, la chose n’est pas trop naturelle ; mais, quand je te l’expliquerais, tu ne la comprendrais guère mieux : qu’il te suffise donc de savoir que tu ne cours aucun danger.
— Je crains que vous ne soyez le… le…
— Le diable, tranchons le mot, n’est-ce pas ? c’est cela que tu voulais dire ; au moins tu conviendras que je ne suis pas trop noire pour un diable, et que, si l’enfer était peuplé de diables faits comme moi, on y passerait son temps aussi agréablement qu’en paradis. »
Pour montrer qu’elle ne se vantais pas, Omphale rejeta en arrière sa peau de lion et me fit voir des épaules et un sein d’une forme parfaite et d’une blancheur éblouissante.
« Eh bien ! qu’en dis-tu ? fit-elle d’un petit air de coquetterie satisfaite.
— Je dis que, quand vous seriez le diable en personne, je n’aurais plus peur, Madame Omphale.
— Voilà qui est parler ; mais ne m’appelez plus ni madame ni Omphale. Je ne veux pas être madame pour toi, et je ne suis pas plus Omphale que je ne suis le diable.
— Qu’êtes-vous donc, alors ?
— Je suit la marquise de Tøøø. Quelque temps après mon mariage le marquis fit exécuter cette tapisserie pour mon appartement, et m’y fit représenter sous le costume d’Omphale ; lui-même y figure sous les traits d’Hercule. C’est une singulière idée qu’il a eue là ; car, Dieu le sait, personne au monde ne ressemblait moins à Hercule que le pauvre marquis. Il y a bien longtemps que cette chambre n’a été habitée. Moi, qui aime naturellement la compagnie, je m’ennuyais à périr, et j’en avais la migraine. Être avec mon mari, c’est être seule. Tu es venu, cela m’a réjouie, cette chambre morte s’est ranimée, j’ai eu à m’occuper de quelqu’un. Je te regardais aller et venir, je t’écoutais dormir et rêver ; je suivais tes lectures. Je te trouvais bonne grâce, un air avenant, quelque chose qui me plaisait : je t’aimais enfin. Je tâchai de te le faire comprendre ; je poussais des soupirs, tu les prenais pour ceux du vent ; je te faisais des signes, je te lançais des oeillades langoureuses, je ne réussissais qu’à te causer des frayeurs horribles. En désespoir de cause, je me suis décidée à la démarche inconvenante que je fais, et à te dire franchement ce que tu ne pouvais entendre à demi-mot. Maintenant que tu sais que je t’aime, j’espère que… »
La conversation en était là, lorsqu’un bruit de clef se fit entendre dans la serrure.
Omphale tressaillit et rougit jusque dans le blanc des yeux.
« Adieu ! dit-elle, à demain. » Et elle retourna à sa muraille à reculons ; de peur sans doute de me laisser voir son envers.
C’était Baptiste qui venait chercher mes habits pour les brosser.
« Vous avez tort, monsieur, me dit-il, de dormir les rideaux ouverts. Vous pourriez vous enrhumer du cerveau ; cette chambre est si froide ! »
En effet, les rideaux étaient ouverts ; moi qui croyais n’avoir fait qu’un rêve, je fus très étonné, car j’étais sûr qu’on les avait fermés le soir.
Aussitôt que Baptiste fut parti, je courus à la tapisserie. Je la palpai dans tous les sens ; c’était bien une vraie tapisserie de laine, raboteuse au toucher comme toutes les tapisseries possibles. Omphale ressemblait au charmant fantôme de la nuit comme un mort ressemble à un vivant. Je relevai le pan ; le mur était plein ; il n’y avait ni panneau masqué ni porte dérobée. Je fis seulement cette remarque, que plusieurs fils étaient rompus dans le morceau de terrain où portaient les pieds d’Omphale. Cela me donna à penser.
Je fus toute la journée d’une distraction sans pareille ; j’attendais le soir avec inquiétude et impatience tout ensemble. Je me retirai de bonne heure, décidé à voir comment tout cela finirait. Je me couchai ; la marquise ne se fit pas attendre ; elle sauta à bas du trumeau et vint tomber droit à mon lit ; elle s’assit à mon chevet, et la conversation commença.
Comme la veille, je lui fis des questions, je lui demandai des explications. Elle éludait les unes, répondait aux autres d’une manière évasive, mais avec tant d’esprit qu’au bout d’une heure je n’avais pas le moindre scrupule sur ma liaison avec elle.
Tout en parlant, elle passait ses doigts dans mes cheveux, me donnait de petits coups sur les joues et de légers baisers sur le front.
Elle babillait, elle babillait d’une manière moqueuse et mignarde, dans un style à la fois élégant et familier, et tout à fait grande dame, que je n’ai jamais retrouvé depuis dans personne.
Elle était assise d’abord sur la bergère à côté du lit ; bientôt elle passa un de ses bras autour de mon cou, je sentais son coeur battre avec force contre moi. C’était bien une belle et charmante femme réelle, une véritable marquise, qui se trouvait à côté de moi. Pauvre écolier de dix-sept ans ! Il y avait de quoi en perdre la tête ; aussi je la perdis. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer, mais je pressentais vaguement que cela ne pouvait plaire au marquis.
« Et monsieur le marquis, que va-t-il dire là-bas sur son mur ? »
La peau du lion était tombée à terre, et les cothurnes lilas tendre glacé d’argent gisaient à côté de mes pantoufles.
« Il ne dira rien, reprit la marquise en riant de tout son coeur. Est-ce qu’il voit quelque chose ? D’ailleurs, quand il verrait, c’est le mari le plus philosophe et le plus inoffensif du monde ; il est habitué à cela. M’aimes-tu, enfant ?
— Oui, beaucoup, beaucoup… »
Le jour vint ; ma maîtresse s’esquiva.
La journée me parut d’une longueur effroyable. Le soir arriva enfin. Les choses se passèrent comme la veille, et la seconde nuit n’eut rien à envier à la première. La marquise était de plus en plus adorable. Ce manège se répéta pendant assez longtemps encore. Comme je ne dormais pas la nuit, j’avais tout le jour une espèce de somnolence qui ne parut pas de bon augure à mon oncle. Il se douta de quelque chose ; il écouta probablement à la porte, et entendit tout ; car un beau matin il entra dans ma chambre si brusquement, qu’Antoinette eut à peine le temps de remonter à sa place.
Il était suivi d’un ouvrier tapissier avec des tenailles et une échelle.
Il me regarda d’un air rogue et sévère qui me fit voir qu’il savait tout.
« Cette marquise de Tøøø est vraiment folle ; où diable avait-elle la tête de s’éprendre d’un morveux de cette espèce ? fit mon oncle entre ses dents ; elle avait pourtant promis d’être sage !
« Jean, décrochez cette tapisserie, roulez-la et portez-la au grenier. »
Chaque mot de mon oncle était un coup de poignard.
Jean roula mon amante Omphale, ou la marquise Antoinette de Tøøø, avec Hercule, ou le marquis de Tøøø, et porta le tout au grenier. Je ne pus retenir mes larmes.
Le lendemain, mon oncle me renvoya par la diligence de Bøøø chez mes respectables parents, auxquels, comme on pense bien, je ne soufflai pas mot de mon aventure.
Mon oncle mourut ; on vendit sa maison et les meubles ; la tapisserie fut probablement vendue avec le reste. Toujours est-il qu’il y a quelque temps, en furetant chez un marchand de bric-à-brac pour trouver des momeries, je heurtai du pied un gros rouleau tout poudreux et couvert de toiles d’araignée.
« Qu’est cela ? dis-je à l’Auvergnat.
— C’est une tapisserie rococo qui représente les amours de madame Omphale et de monsieur Hercule ; c’est du Beauvais, tout en soie et joliment conservé. Achetez-moi donc cela pour votre cabinet ; je ne vous le vendrai pas cher, parce que c’est vous. »
Au nom d’Omphale, tout mon sang reflua sur mon coeur.
« Déroulez cette tapisserie », fis-je au marchand d’un ton bref et entrecoupé comme si j’avais la fièvre.
C’était bien elle. Il me sembla que sa bouche me fit un gracieux sourire et que son oeil s’alluma en rencontrant le mien.
« Combien en voulez-vous ?
— Mais je ne puis vous céder cela à moins de quatre cent francs, tout au juste.
— Je ne les ai pas sur moi. Je m’en vais les chercher ; avant une heure je suis ici. »
Je revins avec l’argent ; la tapisserie n’y était plus. Un Anglais l’avait marchandée pendant mon absence, en avait donné six cents francs et l’avait emportée.
Au fond, peut-être vaut-il mieux que cela se soit passé ainsi et que j’aie gardé intact ce délicieux souvenir. On dit qu’il ne faut pas revenir sur ses premières amours ni aller voir la rose qu’on a admirée la veille.
Et puis je ne suis plus assez jeune ni assez joli garçon pour que les tapisseries descendent du mur en mon honneur.
Troisième partie La morte amoureuse
Vous me demandez, frère, si j’ai aimé ; oui. C’est une histoire singulière et terrible, et, quoique j’ai soixante-six ans, j’ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferais pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges, que je ne puis croire qu’ils me soient arrivés. J’ai été pendant plus de trois ans le jouet d’une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j’ai mené en rêve toutes les nuits (Dieu veuille que ce soit un rêve !) une vie de damné, une vie de mondain et de Sardanapale. Un seul regard trop plein de complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme ; mais enfin, avec l’aide de Dieu et de mon saint patron, je suis parvenu à chasser l’esprit malin qui s’était emparé de moi. Mon existence s’était compliquée d’une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j’étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes ; la nuit, dès que j’avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant aux dés, buvant et blasphémant ; et lorsqu’au lever de l’aube je me réveillais, il me semblait au contraire que je m’endormais et que je rêvais que j’étais prêtre. De cette vie somnambulique il m’est resté des souvenirs d’objets et de mots dont je ne puis pas me défendre, et, quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt, à m’entendre, un homme ayant usé de tout et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop agités, qu’un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée, au fond d’un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle.
Oui, j’ai aimé comme personne au monde n’a aimé, d’un amour insensé et furieux, si violent que je suis étonné qu’il n’ait pas fait éclater mon coeur. Ah ! quelles nuits ! quelles nuits !
Dès ma plus tendre enfance, je m’étais senti de la vocation pour l’état de prêtre ; aussi toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu’à vingt-quatre ans, ne fut-elle qu’un long noviciat. Ma théologie achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques.
Je n’étais jamais allé dans le monde ; le monde, c’était pour moi l’enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu’il y avait quelque chose que l’on appelait femme, mais je n’y arrêtais pas ma pensée ; j’étais d’une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère vieille et infirme que deux fois l’an. C’étaient là toutes mes relations avec le dehors.
Je ne regrettais rien, je n’éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable ; j’étais plein de joie et d’impatience. Jamais jeune fiancé n’a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse ; je n’en dormais pas, je rêvais que je disais la messe ; être prêtre, je ne voyais rien de plus beau au monde : j’aurais refusé d’être roi ou poète. Mon ambition ne concevait pas au-delà.
Ce que je dis là est pour vous montrer combien ce qui m’est arrivé ne devait pas m’arriver, et de quelle fascination inexplicable j’ai été la victime.
Le grand jour venu, je marchai à l’église d’un pas si léger, qu’il me semblait que je fusse soutenu en l’air ou que j’eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange, et je m’étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons ; car nous étions plusieurs. J’avais passé la nuit en prières, et j’étais dans un état qui touchait presque à l’extase. L’évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple.
Vous savez les détails de cette cérémonie : la bénédiction, la communion sous les deux espèces, l’onction de la paume des mains avec l’huile des catéchumènes, et enfin le saint sacrifice offert de concert avec l’évêque. Je ne m’appesantirai pas sur cela. Oh ! que Job a raison, et que celui-là est imprudent qui ne conclut pas un pacte avec ses yeux ! Je levai par hasard ma tête, que j’avais jusque-là tenue inclinée, et j’aperçus devant moi, si près que j’aurais pu la toucher, quoique en réalité elle fût à une assez grande distance et de l’autre côté de la balustrade, une jeune femme d’une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J’éprouvai la sensation d’un aveugle qui recouvrerait subitement la vue. L’évêque, si rayonnant tout à l’heure, s’éteignit tout à coup, les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d’or comme les étoiles au matin, et il se fit par toute l’église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond d’ombre comme une révélation angélique ; elle semblait éclairée d’elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir.
Je baissai la paupière, bien résolu à ne plus la relever pour me soustraire à l’influence des objets extérieurs ; car la distraction m’envahissait de plus en plus, et je savais à peine ce que je faisais.
Une minute après, je rouvris les yeux, car à travers mes cils je la voyais étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre pourprée comme lorsqu’on regarde le soleil.
Oh ! comme elle était belle ! Les plus grands peintres, lorsque, poursuivant dans le ciel, la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone, n’approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni les vers du poète ni la palette du peintre n’en peuvent donner une idée. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse ; ses cheveux, d’un blond doux, se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d’or ; on aurait dit une reine avec son diadème ; son front, d’une blancheur bleuâtre et transparente, s’étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l’effet de prunelles vert de mer d’une vivacité et d’un éclat insoutenables. Quels yeux ! avec un éclair ils décidaient de la destinée d’un homme ; ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humanité brillante que je n’ai jamais vues à un oeil humain ; il s’en échappait des rayons pareils à des flèches et que je voyais distinctement aboutir à mon coeur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l’enfer, mais à coup sûr elle venait de l’un ou de l’autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux ; elle ne sortait certainement pas du flanc d’Ève, la mère commune. Des dents du plus bel orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d’une finesse et d’une fierté toute royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d’agate jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d’un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de paon qui se rengorge, et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l’entourait comme un treillis d’argent.
Elle portait une robe de velours nacarat, et de ses larges manches doublées d’hermine sortaient des mains patriciennes d’une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d’une si idéale transparence qu’ils laissaient passer le jour comme ceux de l’Aurore.
Tous ces détails me sont encore aussi présents que s’ils dataient d’hier, et, quoique je fusse dans un trouble extrême, rien ne m’échappait : la plus légère nuance, le petit point noir au coin du menton, l’imperceptible duvet aux commissures des lèvres, le velouté du front, l’ombre tremblante des cils sur les joues, je saisissais tout avec une lucidité étonnante.
À mesure que je la regardais, je sentais s’ouvrir dans moi des portes qui jusqu’alors avaient été fermées ; des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues ; la vie m’apparaissait sous un aspect tout autre ; je venais de naître à un nouvel ordre d’idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le coeur ; chaque minute qui s’écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant, et j’étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeaient furieusement l’entrée. Je dis oui cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait et protestait contre la violence que ma langue faisait à mon âme : une force occulte m’arrachait malgré moi les mots du gosier. C’est là peut-être ce qui fait que tant de jeunes filles marchent à l’autel avec la ferme résolution de refuser d’une manière éclatante l’époux qu’on leur impose, et que pas une seule n’exécute son projet. C’est là sans doute ce qui fait que tant de pauvres novices prennent le voile, quoique bien décidées à le déchirer en pièces au moment de prononcer leurs voeux. On n’ose causer un tel scandale devant tout le monde ni tromper l’attente de tant de personnes ; toutes ces volontés, tous ces regards semblent peser sur vous comme une chape de plomb : et puis les mesures sont si bien prises, tout est si bien réglé à l’avance, d’une façon si évidemment irrévocable, que la pensée cède au poids de la chose et s’affaisse complètement.
Le regard de la belle inconnue changeait d’expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu’il était d’abord, il prit un air de dédain et de mécontentement comme de ne pas avoir été compris.
Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m’écrier que je ne voulais pas être prêtre ; mais je ne pus en venir à bout ; ma langue resta clouée à mon palais, et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J’étais, tout éveillé, dans un état pareil à celui du cauchemar, où l’on veut crier un mot dont votre vie dépend, sans en pouvoir venir à bout.
Elle parut sensible au martyre que j’éprouvais, et, comme pour m’encourager, elle me lança une oeillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant.
Elle me disait :
« Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis ; les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t’envelopper ; je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie ; viens à moi, nous serons l’amour. Que pourrait t’offrir Jéhovah pour compensation ? Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu’un baiser éternel.
« Répands le vin de ce calice, et tu es libre. Je t’emmènerai vers les îles inconnues ; tu dormiras sur mon sein, dans un lit d’or massif et sous un pavillon d’argent ; car je t’aime et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles coeurs répandent des flots d’amour qui n’arrivent pas jusqu’à lui. »
Il me semblait entendre ces paroles sur un rythme d’une douceur infinie, car son regard avait presque la sonorité, et les phrases que ses yeux m’envoyaient retentissaient au fond de mon coeur comme si une bouche invisible les eût soufflées dans mon âme. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu, et cependant mon coeur accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie. La belle me jeta un second coup d’oeil si suppliant, si désespéré, que des lames acérées me traversèrent le coeur, que je me sentis plus de glaives dans la poitrine que la mère des douleurs.
C’en était fait, j’étais prêtre.
Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante ; la jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d’elle, la mère auprès du berceau vide de son enfant, Ève assise sur le seuil de la porte du paradis, l’avare qui trouve une pierre à la place de son trésor, le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage, n’ont point un air plus atterré et plus inconsolable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure, et elle devint d’une blancheur de marbre ; ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués, et elle s’appuya contre un pilier, car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Pour moi, livide, le front inondé d’une sueur plus sanglante que celle du Calvaire, je me dirigeai en chancelant vers la porte de l’église ; j’étouffais ; les voûtes s’aplatissaient sur mes épaules, et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole.
Comme j’allais franchir le seuil, une main s’empara brusquement de la mienne ; une main de femme ! Je n’en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d’un serpent, et l’empreinte m’en resta brûlante comme la marque d’un fer rouge. C’était elle. « Malheureux ! malheureux ! qu’as-tu fait ? » me dit-elle à voix basse ; puis elle disparut dans la foule.
Le vieil évêque passa ; il me regarda d’un air sévère. Je faisais la plus étrange contenance du monde ; je pâlissais, je rougissais, j’avais des éblouissements. Un de mes camarades eut pitié de moi, il me prit et m’emmena ; j’aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire. Au détour d’une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d’un autre côté, un page nègre, bizarrement vêtu, s’approcha de moi, et me remit, sans s’arrêter dans sa course, un petit portefeuille à coins d’or ciselés, en me faisant signe de le cacher ; je le fis glisser dans ma manche et l’y tins jusqu’à ce que je fusse seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir, il n’y avait que deux feuilles avec ces mots : « Clarimonde, au palais Concini. » J’étais alors si peu au courant des choses de la vie, que je ne connaissais pas Clarimonde, malgré sa célébrité, et que j’ignorais complètement où était situé le palais Concini. Je fis mille conjectures, plus extravagantes les unes que les autres ; mais à la vérité, pourvu que je pusse la revoir, j’était fort peu inquiet de ce qu’elle pouvait être, grande dame ou courtisane.