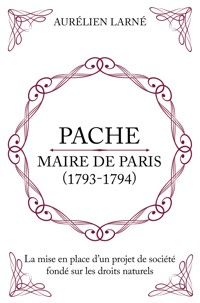
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Du 14 février 1793 au 21 floréal an II – 10 mai 1794, Pache, maire de la Commune de Paris, défendit, de concert avec le peuple parisien et des députés montagnards, un projet de société fondé sur les droits naturels de l’homme et du citoyen à l’existence, à l’instruction et à la liberté individuelle et en société ou souveraineté populaire. Suite à la Révolution des 31 mai-2 juin 1793, la Convention montagnarde adopta ce projet et Pache et la Commune contribuèrent à sa mise en œuvre malgré les oppositions hétéroclites qu’ils rencontrèrent.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Aurélien Larné est titulaire d’un doctorat en Histoire, obtenu à l’université Paris 10 sous la direction de Marc Bélissa. Il exerce actuellement la profession d’archiviste au ministère de la Justice.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1390
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AurélienLarné
Pache, maire de Paris (1793-1794).
La mise en place d’un projet de société fondé sur les droits naturels
Pour contacter l’auteur : [email protected].
Il nous souvient, à ce propos, de ce que nous contait un ami, personne d’âge et d’expérience, et érudit autant qu’homme du monde. Apercevant, il y a deux ans, dans un salon de Paris, un jeune homme de sa connaissance auquel il portait intérêt, il fut le trouver et, après les politesses d’usage, s’entretint familièrement avec lui. On parla un peu de musique, un peu de littérature, voire même un peu de droit, bien que l’un fût avocat et l’autre étudiant :
« — Et en politique, quelles sont vos opinions ? demanda notre ami. — En politique, Monsieur, répondit le jeune homme, je suis pachiste. — Pardon, vous dites? — Pachiste. Vous connaissez bien Pache, Monsieur? — Fort peu, Monsieur ; en vérité, fort peu. — Comment ! le maire de Paris ! (Il commençait à s’échauffer en parlant.) Vous n’avez pas lu... — Ah! parfaitement! le maire de Paris en 1793. Je me retrouve. Excusez-moi… On a parfois de singuliers oublis à mon âge. Je me rappelle très-bien [sic] maintenant votre Pache, bien qu’à parler franc j’ai ignoré jusqu’à cette heure l’existence de son pachisme. Enchanté de faire sa connaissance. Si vous voulez bien sortir, avec moi, monsieur le pachiste, nous fumerons un cigare ensemble et causerons de cela. «
Jules FORNI, Raoul Rigault, procureur de la Commune, 18711.
1 Jules FORNI, Raoul Rigault, procureur de la Commune, Paris, Librairie centrale, 1871, p. 22 et 23.
Remerciements
Je remercie les personnes suivantes qui m’ont aidé à mener à bien ce travail :
Quyen, ma femme, pour son amour inconditionnel,
toute ma famille pour son soutien,
Florence Gauthier, maître de conférences habilité à diriger les recherches à l’Université Paris VII Denis Diderot, pour m’avoir fait découvrir le droit naturel et pour son aide ininterrompue,
Marc Bélissa, maître de conférences HDR à l’Université Paris Ouest Nanterre et Yannick Bosc, maître de conférences à l’Université de Rouen, pour leurs judicieux conseils qui m’ont servi à faire progresser ma réflexion,
les docteurs Alexandre Guermazi, Suzanne Levin, Jean-Claude Gaudebout, Édern De Barros et les étudiants Arthur Dujo, Félix Mangano, Thunc Anh Nguyen pour nos échanges fructueux,
les autres membres du jury de ma soutenance de thèse, Laurence Croq, maître de conférence HDR à l’Université Paris Ouest Nanterre, Dominique Godineau, professeur à l’Université Rennes 2, Martine Sin Blima-Barru, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales, Rémi Dalisson, professeur à l’Université de Rouen, et Hervé Leuwers, professeur à l’Université Lille 3,
le personnel des services d’archives et des bibliothèques où j’ai travaillé pour leur concours dans mes recherches,
Lenaïk Loyant et David Laroche qui m’ont appris l’importance d’agir constamment pour réaliser ses rêves.
NOTA : Les datations utilisées dans cet ouvrage sont celles du calendrier républicain2. La correspondance avec le calendrier grégorien est toujours indiquée. Exemples : 14ème jour du 1er mois an II – 5 octobre 1793 ; 3 brumaire – 24 octobre.
Les sources ont été retranscrites sans changer l’orthographe initiale.
2 Sur le calendrier républicain, voir infra, 2P/C3/III/A et annexe n° 1.
Introduction : Jean-Nicolas Pache, maire de la Commune de Paris (14 février 1793-21 floréal an II – 10 mai1794)
« Dans cet état de révolution, il n’existe de droits politiques que les droits naturels de l’homme appliqués à chaque instant et pour chaque événement, ou chaque série d’événement, à l’ordre politique ; il n’existe que les principes du droit public universel ».
« La Convention avait des droits que lui avait donnés le peuple français, conformément aux principes du droit public universel. Et quels étaient ces droits ? Celui de juger Capet ; celui de préparer une Constitution conforme aux droits de l’homme et de la raison ; celui de présider, jusqu’à l’acceptation et la mise à exécution de cette Constitution future, au mouvement de la machine politique, comme l’avait fait la législature dans l’intervalle de la destitution et de l’emprisonnement de Capet à l’installation de la Convention ».
Jean-Nicolas PACHE,J.-N. Pache sur une affaire pendante à la troisième section du Tribunal civil de la Seine. Premier mémoire, Thin-le-Moustier, 18 germinal an V – 7 avril 1797, Paris, Imprimerie de R. Vatar, 17973.
Jean-Nicolas Pache a été maire de la deuxième plus grande ville d’Europe après Londres (Angleterre), Paris, du 14 février 1793 au 21 floréal an II – 10 mai 17944. Qui était-il et, lors de sa prise de fonction, qu’étaient l’histoire, le contexte administratif et l’organisation de la Commune de Paris ? Quelles sont les principales raisons du choix d’étudier la politique de Pache durant son mandat de maire ? Quels sont les schémas interprétatifs de l’histoire de la Révolution française qu’il est possible de mobiliser pour aborder ce sujet ? Enfin, quelles sont les sources utilisées par ce travail ?
I) Jean-Nicolas Pache et la Commune deParis
A) Biographie de Pache
Jean-Nicolas Pache est né le 5 mai 1746 à Verdun (département actuel de la Meuse). Il était le fils de Nicolas Pache, d’origine suisse, et de Jeanne Lallemand5. À sa naissance, son père était domestique de Charles François d’Hallencourt, évêque de Verdun (1721-1754)6. Il devint ensuite gardien de l’hôtel de la comtesse de La Marck (1719-1793), à Paris. Jean-Nicolas reçut de cette dernière une bonne instruction7. De 1771 au plus tard à 1775 au plus tôt, le marquis de Castries, Charles de La Croix (1727-1801), l’embaucha comme précepteur de son fils Charles (1756-1842)8. À cette époque, Pache lisait plusieurs auteurs des Lumières tels que Diderot, Raynal, Voltaire, ainsi que l’Encyclopédie9.
Il fut ensuite attaché au Trésor royal10. Nommé secrétaire d’État de la Marine en 1780, Castries choisit Pache comme premier secrétaire11. Le marquis agit pour améliorer le sort des « libres de couleur » de la colonie de Saint-Domingue, enfants métissés de colons et de femmes africaines et esclaves affranchies, victimes de la politique qu’il est possible de qualifier de ségrégationniste des « colons blancs ». Il élabora également une réforme visant à améliorer la condition des esclaves12. Pache joua entre autres activités un rôle important dans la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783)13. En juin 1784, il tomba malade et Castries l’envoya se soigner dans son château de Bruyères (département actuel de l’Essonne)14. Le roi lui accorda une pension de 6000 livres « attendu que ses services ayant été hors de règle, la récompense devait être hors d’exemple »15. Peu avant la Révolution française, Pache s’établit dans le canton de Zug, en Suisse16.
Il était donc probablement issu d’un milieu relativement aisé. Son père a servi plusieurs personnes de la haute noblesse. L’évêque Charles François était également comte de Verdun et prince du Saint-Empire17. La comtesse de La Marck était l’épouse de Louis-Engelbert, comte de La Marck et grand d’Espagne18. Pache reçut alors une bonne instruction qui lui permit d’accéder à divers postes et d’acquérir de l’expérience dans la haute administration française d’Ancien Régime.
En 1789 mais avant la naissance de l’Assemblée nationale constituante le 17 juin, Pache proposa que les États généraux et le roi adoptent de concert une constitution19. Lorsque la Révolution française (1789-1794) débuta, il revint à Paris20. La date exacte de son retour ne peut être précisée. Il y était au plus tôt en avril 1791 puisqu’il signa un procès-verbal de l’assemblée générale de la Section du Luxembourg, dans laquelle il résidait21.
Le 13 janvier 1792, Pache et Meusnier, membre de l’Académie royale des Sciences, fondèrent la société patriotique du Luxembourg. Son premier président fut Polverel22. Selon Manon Roland, « Pache était fort assidu dans cette société »23. Nommé ministre de l’Intérieur le 24 mars, Jean-Marie Roland employa Pache comme membre de son cabinet24. D’après sa femme Manon, Pache aurait accepté la proposition d’embauche « sous la condition qu’il conservera [sic] son indépendance, sans prendre aucune espèce de titre ni d’appointemens [sic] »25. Le 9 mai, Servan fut désigné ministre de la Guerre. Pache entra dans son ministère, toujours selon Manon Roland aux mêmes conditions. Il y travailla jusqu’au 13 juin date à laquelle Servan fut renvoyé par le roi26. Pache continuait également de participer aux assemblées générales de la Section du Luxembourg dont il fut secrétaire en avril27. Il fut ensuite élu par sa section à la Commune révolutionnaire qui organisa la Révolution du 10 août, fonction qui prit fin le 17 août28.
Après le 21 août, Pache fut ensuite élu administrateur au Conseil provisoire du Département de Paris29. Le 20 septembre, Monge, ministre de la Marine et des Colonies, le nomma commissaire ordonnateur civil à Toulon. Pache s’y rendit pour quelques jours30. Le 3 octobre, la Convention le choisit comme ministre de la Guerre31. Pache réorganisa les bureaux du ministère, notamment en remplaçant des commis favorables à la monarchie par des citoyens soutenant la Révolution32. Il défendit le Directoire des achats contre le général Dumouriez et des députés brissotins. Cette institution avait été créée le 31 octobre par le Conseil exécutif afin d’acheter des subsistances pour les ministères de l’Intérieur, de la Guerre et de la Marine et de mettre un terme aux pratiques frauduleuses de fournisseurs33. Pache s’opposait généralement aux positions de députés brissotins favorables à la guerre de conquête34. Le 4 février 1793, la Convention brissotine le remplaça par Beurnonville35.
Avec la Révolution, Pache devint membre des institutions démocratiques de sa section et consolida son expérience administrative puis, le 14 février, il fut élu maire de la Commune de Paris par les 48 sections. Il obtint 11 881 voix sur 15 191 votants36.
B) Historique, contexte administratif et organisation de la Commune de Paris
À Paris, l’élection des députés aux États généraux fut régie par un règlement royal particulier, celui du 13 avril 178937. 60 assemblées primaires du Tiers-état, ou « districts », devaient élire les électeurs chargés de nommer 20 députés aux États généraux. Ceux qui pouvaient assister aux assemblées primaires étaient « les habitants […] nés français ou naturalisés, âgés de 25 ans, et domiciliés » disposant d’un « emploi » ou payant une certaine somme de capitation38. Les habitants les plus pauvres étaient donc exclus des assemblées primaires39.
Les États généraux se réunirent le 5 mai puis se transformèrent en Assemblée nationale le 17 juin et en Assemblée nationale constituante le 9 juillet. Le premier acte de la Révolution, transférant la souveraineté du roi au peuple et à ses mandataires, se doubla en juillet d’une révolution populaire contre les institutions de la monarchie40. À Paris, le 10 juillet, les 407 électeurs du Tiers-état se constituèrent provisoirement en Commune et, le 14 juillet, les citoyens renversèrent les institutions municipales d’Ancien Régime. Les 23 et 24 juin 1790, les 60 districts parisiens élurent une Commune provisoire. Conformément à la loi des 21 mai-27 juin, le 8 octobre, elle fut remplacée par une Commune élue par les 48 sections. Le 9 août 1792, pour organiser l’insurrection, les sections élurent une Commune révolutionnaire qui suspendit provisoirement la Commune légale. Suite à la Révolution du 10 août et suivant la loi du 19 octobre, une nouvelle Commune fut élue. Les opérations électorales se déroulèrent de décembre 1792 au 19 août 179341.
En 1793, la Commune était l’une des institutions révolutionnaires alors en place. La Révolution du 10 août 1792 avait renversé la Constitution de 1791 et la monarchie. Une Convention nationale, composée de représentants du peuple, fut alors élue au suffrage élargi par les assemblées électorales des départements, elles-mêmes élues par les assemblées primaires42. Son mandat était de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Elle se réunit pour la première fois le 21 septembre et, le lendemain, elle proclama que ses actes seraient datés de l’an premier de la « république française »43.
La Convention élisait et renouvelait régulièrement dans son sein des comités44. Ils étaient principalement chargés de préparer et de lui présenter des projets de loi. Ils pouvaient aussi donner des avis sur le sens des lois aux citoyens qui le demandaient45. Le Comité de salut public, créé le 6 avril 1793, avait une fonction particulière. Composé de neuf membres, il était chargé de « surveiller » l’action du Conseil exécutif provisoire. Il pouvait suspendre les arrêtés du Conseil contraires « à l’intérêt national » et était autorisé à prendre des arrêtés concernant des mesures de « défense générale » dans des circonstances urgentes. Il devait rendre compte de tous ses actes à la Convention et il était réélu chaque mois46.
Le 26 septembre 1792, la Convention confirma la nomination par l’Assemblée législative (1er octobre 1791-21 septembre 1792) du Conseil exécutif provisoire composé de six ministres47. Le 12 germinal an II – 1er avril 1794, il fut remplacé par 12 commissions exécutives d’un à cinq membres chacune48. La Trésorerie nationale, institution créée par l’Assemblée constituante les 18-30 mars 1791, était composée de six commissaires responsables devant le corps législatif49.
Le 19 octobre 1792, la Convention vota le renouvellement au suffrage élargi de tous les corps administratifs et judiciaires prévus par la Constitution de 179150. Cette dernière avait institué une administration à trois niveaux : départements, districts et communes. Il n’y avait pas d’agents locaux nommés par les ministères, nous dirions aujourd’hui que l’administration locale était complètement décentralisée.
Le Département de Paris avait été créé le 22 décembre 1789 par l’Assemblée constituante. Il comprenait un conseil de 36 membres et un procureur général syndic tous élus par l’assemblée électorale du département. Le Conseil nommait dans son sein un directoire de huit membres et un président du Conseil et du Directoire. Le décret du 10 février 1790 divisa le département de Paris en trois districts51 : celui de Paris, celui de Bourg-La-Reine et celui de Saint-Denis52. La loi du 3 novembre attribua les fonctions du District de Paris à la Commune sous le contrôle du Département53. Le décret du 14 frimaire an II – 4 décembre 1793 sur le Gouvernement révolutionnaire supprima le conseil et les charges de président et de procureur de département. Les fonctions du District de Paris furent confiées au Département54 qui comprit ainsi un agent national de district.
Le décret des 21 mai-27 juin 1790 voté par l’Assemblée constituante avait réglementé l’administration de la commune de Paris55. La ville était divisée en 48 sections qui remplaçaient les 60 districts56. Chacune d’elles comportait une assemblée primaire composée des citoyens habitant son ressort57.
Elles avaient pour rôle d’élire le Corps électoral du département de Paris et la Commune de Paris. L’assemblée électorale était élue de concert avec les assemblées primaires des deux autres districts du département de Paris et comptait 990 membres nommés « électeurs »58. Les assemblées primaires devaient également chacune élire un président, un secrétaire, trois scrutateurs pour organiser les scrutins ainsi qu’un comité civil de 16 membres, un commissaire de police et son secrétaire-greffier59. Le président avait pour rôle de préparer et d’annoncer l’ordre du jour, de lire la correspondance60, d’attribuer la parole, de mettre aux voix les arrêtés, de recevoir les députations et de clôturer la séance61. Le secrétaire avait la fonction de rédiger les procès-verbaux des délibérations62. Le comité civil était chargé d’exécuter les arrêtés de sa section et de la Commune. La fonction du commissaire de police était d’arrêter et d’interroger les délinquants qu’il pouvait envoyer en maison d’arrêt sous le contrôle d’un commissaire civil. Il avait voix délibérative au comité civil63. La Convention chargea les assemblées primaires d’élire de nouveaux commissaires. Le 21 mars 1793, elle institua par exemple un comité de 12 membres dans chaque commune ou section de commune. Ces comités, bientôt appelés comités de surveillance ou révolutionnaires, eurent pour première mission de recenser les étrangers résidant en France64. D’après la loi des 21 mai-27 juin 1790, l’assemblée primaire devenait délibérante lorsque 50 citoyens se réunissaient pour demander sa convocation. Ces assemblées prenaient alors le nom d’assemblées générales65. Pour que les 48 assemblées générales se réunissent, il fallait que cela soit demandé par au moins huit sections.
La Commune de Paris66 était composée des institutions suivantes :
- Le maire était élu par les assemblées primaires tous les deux ans, il pouvait être réélu pour un deuxième mandat, puis il n’était permis de l’élire de nouveau qu’après un intervalle de deux ans. Il était le « chef de la municipalité » et présidait le Conseil général, le Corps municipal et le Bureau municipal où il avait voix délibérative. En son absence, un vice-président était élu par le Corps municipal, parmi les membres du Conseil municipal, pour présider le Conseil général et le Corps municipal. Le Bureau municipal était quant à lui présidé alternativement par les administrateurs. Le maire avait la surveillance de toutes les parties de l’administration communale.
- Le Conseil général était composé de 144 citoyens appelés notables, élus à raison de trois par section. Il était réuni pour les affaires importantes par le maire. Dans les faits, il s’assemblait presque tous les jours. Ses séances étaient publiques.
- Le Corps municipal, composé de 48 officiers municipaux élus par les sections parmi les notables, s’assemblait extraordinairement sur la convocation du maire ou de la moitié des membres du Conseil général. Il était formé du Bureau et du Conseil municipaux.
- Le Bureau municipal était composé de 16 administrateurs nommés par les notables dans le sein du Corps municipal. Il se réunissait trois fois par semaine et était réparti en cinq départements qui fonctionnaient en permanence et qui étaient chacun dirigés par trois administrateurs. Il y avait le département des subsistances et approvisionnements, de police, dirigé par quatre administrateurs, des domaines, finances et contributions67, des établissements publics et des travaux publics.
- Le Conseil municipal, composé de 32 membres, les officiers municipaux exceptés les administrateurs, s’assemblait au moins une fois tous les 15 jours pour vérifier les comptes des administrateurs. Ces comptes, comme ceux du maire, étaient ensuite contrôlés par le Conseil général tous les sixmois.
- Le Parquet était formé d’un procureur général syndic et de deux substituts élus par les sections. Ils avaient voix consultatives dans toutes les affaires du Conseil général, du Bureau et du Corps municipaux, mais ils ne votaient pas. Ils étaient chargés de contrôler le bon fonctionnement de la Commune, de vérifier si les arrêtés qu’elle prenait n’étaient pas en contradiction avec la législation et de requérir l’application des lois68.
- Le Conseil général désignait encore hors de son sein un secrétaire-greffier, deux secrétaires-greffiers adjoints, un trésorier, un garde des archives, un bibliothécaire et six officiers, dont trois parmi les notables, chargés de recevoir les actes d’état civil69. Ces agents ne votaient pas lors des délibérations.
Jusqu’au 9 thermidor an II – 27 juillet 1794, l’administration de la commune de Paris ne fut concernée que par deux autres changements : le 9 septembre 1793, le nombre d’assemblées générales de section fut fixé à deux par semaines70 et, le 14 frimaire an II – 4 décembre 1793, le procureur et ses deux substituts changèrent de nom pour celui d’agents nationaux et restèrent élus comme avant.
Le décret des 19-21 août 1792 réglementa l’organisation de la force armée ou Garde nationale parisienne. Elle était composée de tous les citoyens, armés, qui servaient à tour de rôle. Ces derniers étaient répartis en 48 « sections armées » divisées en compagnies de 126 hommes dont le nombre était proportionnel à la population de la section. La section armée élisait tous les officiers. Le commandant général de la Commune était élu par les 48 sections armées. La Garde nationale était à la disposition des assemblées générales, des autorités sectionnaires et de la Commune71.
La République mobilisait en outre une armée dans le cadre d’une guerre extérieure et intérieure. La guerre contre une coalition de pays européens avait été entreprise par l’Assemblée législative à partir du 20 avril 1792 et poursuivie par la Convention brissotine. En avril 1793, cette guerre de conquête tourna à la débâcle et devint une guerre défensive72. Elle était accompagnée d’une guerre civile. La révolte vendéenne débuta en mars par un soulèvement populaire contre la politique de la Convention brissotine. À partir du mois de juillet, elle fut récupérée par une direction catholique et royale qui constitua sa propre armée73. La révolte dite « fédéraliste »74, également promue par des députés brissotins, commença en avril75.
C) Les principales raisons du choix du sujet : relatif silence historiographique et schémas interprétatifs appliqués
Différentes raisons ont présidé au choix du sujet. Pache reste un personnage méconnu de l’histoire de la Révolution française. Louis Pierquin le constatait déjà en 1898 en évoquant une « conspiration du silence, quand ce n’est pas celle de la calomnie »76. Près d’un siècle plus tard, Raymonde Monnier fit un constat semblable : « Aucune biographie n’a étudié le rôle de Pache à la mairie, rôle important et révélateur de la pratique jacobine77 ».
Pache n’a en effet fait l’objet d’aucune biographie. Seuls quelques travaux apportent des informations éparses sur sa vie. Quelques entrées de plusieurs dictionnaires lui ont été consacrées78. Des auteurs ont résumé sa biographie dans de courts articles, mais sans mentionner toutes les sources sur lesquelles ils se fondaient79. Quelques historiens lui ont également consacré une étude sur un des aspects de sa vie80. En dehors de mes propres travaux, sa politique en tant que maire n’a été étudiée que par deux mémoires universitaires81. Malgré quelques ouvrages anciens ou partiels82, l’histoire de la Commune en 1793 et 1794 reste également à écrire. Enfin, si l’historiographie du mouvement populaire parisien est relativement plus riche, elle ne fait qu’évoquer, sans l’étudier en détail, la politique de Pache et de la Commune.
Ce relatif silence historiographique est la principe raison du choix du sujet. Il peut être expliqué par ce que nous pouvons nommer les schémas interprétatifs de la « révolution bourgeoise » appliqués à l’histoire de la Commune de Paris. La possibilité de remplacer ces schémas par celui de la Révolution française comme révolution des droits naturels de l’homme et du citoyen constitue une autre raison de l’intérêt du sujet.
II) Les schémas interprétatifs de la « révolution bourgeoise » appliqués à l’histoire de la Commune de Paris en 1793 et1794
A) Le « récit standard »
Selon le philosophe Jean-Pierre Faye, des historiens ont élaboré ce qu’il désigne comme le « récit standard » de l’histoire de la Révolution française83. Des travaux sur la politique de Pache et de la Commune contribuèrent à sa structuration.
En 1898, Ernest Mellié étudia les institutions sectionnaires parisiennes pendant la Révolution. Son ouvrage fut publié par la société d’histoire de la Révolution française. Il s’agissait d’un comité d’historiens et d’hommes politiques chargé de la commémoration du centenaire de la Révolution établi dès 1888 et comptant parmi ses membres Alphonse Aulard, historien de la gauche dite radicale et titulaire de la première chaire d’histoire de la Révolution à la Sorbonne en 189184.
Mellié estimait que l’instauration d’un Gouvernement révolutionnaire en l’an II – 1793 se serait accompagnée d’une centralisation administrative. Cette dernière aurait été mise en place par la Commune aux dépens des sections, puis par les comités de la Convention aux dépens tant de la Commune que des sections85. En 1940, un juriste, Alphonse Gardie86, dans une histoire institutionnelle de la Commune, évoqua également la prétendue politique de centralisation administrative de la Convention qui aurait été installée dès le mois de juin 179387.
L’ouvrage de 1946 de Paul Sainte-Claire Deville, sur la Commune de l’an II – 1793-1794, peut être situé dans un ensemble de pamphlets de droite qui s’opposaient à la Révolution et qui furent influents dans les années 194088. Il était ainsi très hostile à Pache et la Commune89. Par ailleurs, Deville pensait que le CSP aurait instauré une « dictature »90 dirigée contre la Commune dès le 14 frimaire an II – 4 décembre1793.
En 1958, Albert Soboul publia sa thèse sur la sans-culotterie parisienne. Militant au Parti communiste français depuis 193991, il développa un schéma interprétatif de la Révolution française comme « révolution bourgeoise »92. Suite à la réunion de la Société des historiens marxistes du 28 décembre 1928 au 4 janvier 1929, à Moscou (Union soviétique), cette notion, jusqu’alors débattue, s’était rigidifiée et inscrite dans un strict déterminisme historique économique qui fait d’une succession mécanique des modes de production le ressort du progrès. La Révolution française, succédant à la société féodale, aurait nécessairement été une « révolution bourgeoise » qui devait engendrer elle-même une « révolution prolétarienne » et le socialisme93.
L’apport principal de la thèse de Soboul a été de mettre en lumière l’existence d’une révolution populaire autonome dans ses expressions, ses modes d’organisation et d’action, c’est-à-dire indépendante d’une direction extérieure. Cette découverte remettait en cause le concept de révolution intégralement dirigée par la « bourgeoisie ». Mais Soboul ne renonça pas à intégrer cette révolution populaire autonome dans un schéma interprétatif de « révolution bourgeoise ».
Les députés montagnards auraient été des « bourgeois » qui s’allièrent au mouvement populaire contraints par les circonstances, c’est-à-dire pour prendre le pouvoir aux Brissotins et mener à bien la guerre. Arrivés au pouvoir, ils auraient progressivement jugulé le mouvement populaire jusqu’à instaurer une « dictature bourgeoise et centralisatrice » avec la mise en place du Gouvernement révolutionnaire. En juin 1793, « les Montagnards s’efforcèrent de rassurer la bourgeoisie en mettant le mouvement populaire dans des bornes étroites »94. La loi du 14 frimaire an II – 4 décembre 1793, « couronna les efforts du CSP en consacrant en principe sa dictature »95.
Le mouvement populaire était défini autant comme un mouvement « progressiste », car il aurait permis la victoire de la « révolution bourgeoise », que « rétrograde » du point de vue du « sens de l’histoire », par ses tendances « anticapitalistes »96. Dans ce schéma interprétatif, Pache et la Commune n’auraient joué qu’un rôle mineur. Représentants de la « moyenne bourgeoisie »97, ils se seraient d’abord opposés sur les plans politique et économique au mouvement populaire98, puis, ils auraient été soumis, avec ce dernier, au Gouvernement révolutionnaire99. Pour Walter Markov, Jacques Roux, membre du Conseil général de la Commune dont il rédigea la biographie en 1967, aurait été membre d’un groupe qu’il appela les « Enragés » et qui se serait opposé à la Convention dite « bourgeoise »100.
Dans ses ouvrages publiés en 1983 et 2005, Haim Burstin a étudié le « comportement des couches populaires » dans un seul quartier de Paris : le faubourg Saint-Marcel101. Sans utiliser les termes de « bourgeoisie » ni de « dictature », il se plaça lui-même dans le « schéma général »102 établi par Soboul. Cette même interprétation se retrouve dans l’ouvrage de 1984 du militant trotskiste Morris Slavin sur la Section des Droits de l’Homme103. C’est également le cas de Maurice Genty, dans son livre sur « l’apprentissage de la citoyenneté » à Paris publié en 1987, à la différence près que, pour l’auteur, la Commune aurait fait partie du mouvement populaire104.
En 1988, Dominique Godineau a mis en lumière l’existence « d’un mouvement féminin, composante du mouvement populaire parisien »105. Néanmoins, elle estima que la Convention et la Commune auraient refusé la citoyenneté aux femmes106 et se seraient opposés sur les plans socio-économiques au mouvement féminin107. Dans son essai sur l’opinion publique à Paris pendant la Révolution, publié en 1994, Raymonde Monnier soutint que le Gouvernement révolutionnaire aurait été opposé à l’idée même de médiation entre le gouvernement et l’opinion publique108. La Commune est absente de son étude de la période. En 1998, Nicole Bossut développa à son tour la thèse de Soboul à propos de la Commune et plus particulièrement de Chaumette, procureur entre 1792 et 1794109.
Les historiens héritiers de ce courant historiographique dit « marxiste » perpétuent ce schéma interprétatif tout en en remettant en cause certaines parties. En 2008, dans l’introduction d’un ouvrage collectif sur ce qui est appelé « les politiques de la Terreur »110, Michel Biard faisait lui aussi des Montagnards des partisans du « libéralisme économique »111. Il considérait par ailleurs que le décret du 14 frimaire an II – 4 décembre 1793 aurait instauré une « confusion des pouvoirs »112. En 2022, Jean-Marc Schiappa affirma que la Convention montagnarde aurait été défavorable au contrôle de l’économie revendiqué par le peuple, au contraire de Babeuf, qui fut notamment secrétaire du Département des subsistances de la Commune113. Dans son livre sur les commissaires de police parisiens, Vincent Denis avança que, dès 1789, la Commune aurait établi sa tutelle sur les sections. Il évoqua en outre la confusion et la concentration des pouvoirs aux mains de comités de la Convention ainsi que la mainmise du Gouvernement révolutionnaire sur la Commune114.
L’historiographie qu’il est possible de qualifier de « néo-libérale » se place également dans un schéma interprétatif de la « révolution bourgeoise » mais fait du capitalisme le dernier stade du développement des sociétés humaines115. Les auteurs du Dictionnaire critique de la Révolution française, dirigé par François Furet et Mona Ozouf et publié en 1988, soutinrent que les Montagnards, qui auraient été des « bourgeois », se seraient alliés au peuple pour gagner la guerre116. La conception économique populaire est qualifiée « (d’)absurde »117 et d’irrationnelle puisqu’elle s’opposait à la liberté économique, le mouvement populaire est ainsi évacué de l’histoire en tant qu’acteur politique conscient. Les Montagnards auraient mis en place une « dictature centralisée »118 pour conserver le pouvoir. Contrairement à la plupart des historiens se situant dans la lignée de Soboul, ces auteurs pensent que cette « dictature » aurait également touché le domaine économique, instituant une « entreprise de direction de l’économie nationale par l’État »119. Pour Patrice Gueniffey, la Commune se serait opposée au peuple avant de succomber aux attaques du Gouvernement révolutionnaire120.
La majorité de l’historiographie a ainsi élaboré un « récit standard » de l’histoire de la Commune de Paris en 1793 et 1794 principalement fondé sur des schémas interprétatifs de la « révolution bourgeoise ». Ces historiens ont soutenu que la Convention montagnarde, et le plus souvent Pache et la Commune, auraient mené une politique « bourgeoise ». Le maire et la Commune se seraient d’abord opposés politiquement au mouvement populaire, avant d’être soumis par le Gouvernement révolutionnaire. Ces historiens ont mis en avant plusieurs arguments.
B) Pache et les membres de la Commune : des « bourgeois » ?
Dans des articles respectifs, George Rudé, Paolo Viola et Michel Pertué pensaient que les troubles des 25 et 26 février 1793 auraient été le fait du mouvement populaire qui aurait tenté d’imposer son programme économique à la Commune et à la Convention121. Pour Soboul, avant le mois de juin, la Commune se serait associée au mouvement populaire par tactique visant à permettre à ses alliés, les Montagnards, de prendre le pouvoir sur les Brissotins.
Après la Révolution des 31 mai-2 juin, la Convention montagnarde et la Commune auraient tenté d’appliquer un programme économique « bourgeois »122, abandonnant la politique du maximum des prix voté le 4 mai123. Les lois contre l’accaparement du 26 juillet et du maximum des 4 et 29 septembre n’auraient été que des « concession[s] »124 de la Convention à l’agitation populaire et auraient été d’ailleurs mal appliquées. Les événements de la journée du 5 septembre seraient quant à eux une manœuvre de la Commune et de la Convention pour détourner ces revendications sociales vers le terrain politique125. À partir du mois de brumaire an II – octobre 1793, la mise en place du programme économique populaire aurait été stoppée par la Convention et la Commune126. Au cours de ce qui est appelé le « drame de germinal »127, qui fait référence aux condamnations d’Hébert et de Chaumette en mars et avril 1794, les lois contre l’accaparement et du maximum auraient été réformées dans un sens défavorable au mouvement populaire128. La Commune n’aurait commencé à appliquer le maximum des salaires qu’à ce moment129 et aurait réprimé les agitations ouvrières au moyen de la loi Le Chapelier130, mesures qui caractériseraient le retour complet à la « normalité »131 « bourgeoise » de la Révolution.
Soboul estimait encore que les décrets de la Convention montagnarde sur les droits au travail et à l’assistance n’auraient jamais été appliqués, tout comme la loi du 29 frimaire an II – 19 décembre 1793 organisant les écoles primaires132. La production de guerre aurait été en priorité « concentr[ée] aux mains de quelques grands entrepreneurs ou hommes d’affaires »133. La législation fiscale conforme aux revendications populaires n’aurait également été acceptée par la Convention que « contrainte et forcée »134. Dans un ouvrage de 2016, Clyde Plumauzille affirma que la Commune aurait contribué à instaurer une « pratique des bonnes mœurs bourgeoises » visant à restreindre les libertés individuelles et notamment le droit des femmes de disposer de leur corps135. Une grande partie des auteurs qui ont étudié le premier projet de code civil a en outre considéré que les mesures élargissant les droits civils et votées par la Convention seraient restées lettre morte. En 1992, le juriste Jean-Louis Halperin écrivit que le décret du 3 brumaire an II – 24 octobre 1793 aurait marqué l’abandon du projet136.
C) Pache et la Commune : contre la démocratie sectionnaire et le Gouvernement révolutionnaire ?
Soboul pensait que le vote de la Constitution par la Convention montagnarde aurait été une manœuvre visant « à faire taire [les] revendications sociales »137 populaires. Avec le décret du 5 septembre 1793, les droits de censure et d’élection des comités révolutionnaires auraient été retirés aux sections au profit de la Commune138. À partir du 13 frimaire an II – 3 décembre 1793, la Commune aurait décidé à son tour de supprimer les droits des assemblées générales de révoquer et d’élire les membres du Conseil général pour les remplacer par la cooptation139. Puis, en pluviôse an II – janvier-février 1794, le Conseil aurait également mis un terme au droit des sections de censurer les comités civils140. Par ailleurs, le CSP et la Commune auraient exclu les femmes des sections puis, le 27 brumaire an II – 17 novembre 1793, la Commune aurait interdit leurs députations141.
Parallèlement à la prétendue prise de contrôle des institutions sectionnaires par la Commune, le CSP aurait également combattu le mouvement populaire, notamment à l’aide du décret du 9 septembre 1793, supprimant la permanence des sections, qui aurait été un « coup très dur à l’autonomie des organisations populaires »142. Avec les décrets des 23 et 28 ventôse an II – 13 et 18 mars 1794, il aurait supprimé les élections des membres de la Commune143 puis, à partir de germinal – mars-avril, les droits des assemblées générales de révoquer et d’élire toutes les autorités constituées144. Dès ce moment, la Commune et les institutions sectionnaires auraient été nommées par le Comité et seraient devenues des rouages administratifs du Gouvernement révolutionnaire. Les lois qualifiées de « terroristes », comme celle créant l’armée révolutionnaire ou celles traduisant Marie-Antoinette et des Brissotins au Tribunal criminel extraordinaire, auraient été des concessions au mouvement populaire145. Après germinal – avril, la « terreur » serait devenue « un instrument de gouvernement » du CSP pour réprimer le mouvement populaire146.
III) Une politique de réalisation des droits naturels de l’homme et du citoyen ?
A) La philosophie du droit naturel
Des historiens, et en premier lieu Florence Gauthier dans ses travaux depuis 1988 puis les membres du séminaire « L’Esprit des Lumières et de la Révolution »147, ont proposé une autre interprétation de l’histoire de la Révolution française (1789-1794) en replaçant la politique des révolutionnaires dans le cadre de la philosophie du droit naturel.
Cette philosophie s’inscrit elle-même dans une culture commune à l’humanité qui définit la liberté de l’être humain par opposition à la domination. Elle a pour origine le projet politique de sociétés préhistoriques, du Paléolithique, du Mésolithique, du Néolithique et du premier monde urbain y compris de la période historique, qui est également celui des sociétés nommées « primitives »148 de l’Amérique149, de l’Océanie150, de l’Afrique151 et de l’Asie152. Ce projet est notamment illustré par des mécanismes, mis en lumière par l’anthropologue Pierre Clastres, qui permettent à la société d’empêcher l’émergence d’un pouvoir coercitif, c’est-à-dire séparé de la société, ou État. Le pouvoir politique est ainsi au service de la société. Cette émergence n’est en outre pas irréversible, comme le montrent les nombreux cas de révolutions sociales qui ont existé depuis la Préhistoire153. Au sein même de nombreux États, ce projet reste en outre celui de communautés villageoises et urbaines à travers le monde154.
La notion de droit naturel a été formulée durant l’Antiquité. Après l’émergence de l’État, des sociétés ont exprimé ce qui a été qualifié de Règle d’or, maxime morale exposant la réciprocité de la liberté : ne fais pas à l’autre ce que tu n’aimerais pas qu’il te fasse155. Des États ont fondé des institutions sur une conception de justice sociale156. Chez les Grecs, des présocratiques, comme Héraclite d’Éphèse (VIème siècle avant notre ère), ont développé l’idée de l’égalité naturelle entre les êtres humains157, idée que les Stoïciens reprirent en se référant à une loi naturelle morale mais non à sa traduction pratique en termes juridiques158. À côté du paradigme grec de la politique comme souveraineté populaire et de la loi égale pour tous, qui a donné corps à l’expérience de démocratie athénienne (VIème et Vème siècles avant notre ère) puis au mouvement plébéien romain (Vème-Ier avant notre ère), les Romains inventèrent celui du droit comme outil au service d’un système politique159. Le Code Justinien (529-534), compilation du droit commandée par l’empereur romain d’Orient, mentionna le droit naturel de naître libre, par exemple chez Ulpien (IIème siècle), mais il restait subordonné au droit positif. Des Pères de l’Église chrétienne (Ier-VIIIème siècles) ont repris cette subordination160.
La philosophie du droit naturel est apparue au Moyen-âge chez des spécialistes du droit canon, et en premier lieu vers 1140, à Bologne (Italie), chez Gratien. Exprimant un grand mouvement social et intellectuel, ces juristes renversèrent le rapport de force entre droit naturel et droit positif161. Ce mouvement fut ouvert par la révolte d’esclaves menée par Spartacus (73 à 71 avant notre ère). Il fut poursuivi, à partir du IVème siècle, à l’occasion des invasions de peuples germaniques qui ont conduit en 476 à la destruction de l’Empire romain d’Occident et à l’apparition d’une nouvelle société. Cette société médiévale était fondée sur le refus de l’esclavage et de la conquête et mit en place des institutions démocratiques162 introduites par les Germains163. Elle exprima un concept de liberté personnelle et politique, illustré par l’adjectif « franc », non exprimé en termes de droit naturel164. Du XI au XIVème siècles, dans le domaine ouest-européen, ce mouvement se prolongea avec la lutte de paysans contre la féodalité asservissante165. Des paysans imposèrent aux seigneurs des chartes reconnaissant l’abolition du servage ainsi que leur statut de sujets libres et dotés de libertés et franchises politiques exercées au sein de la communauté villageoise. Ce mouvement des chartes se généralisa dans toutes les catégories de la société, comme les villes et les corps de métiers urbains d’artisans et de commerçants166.
Au XIVème siècle, les rois de France reconnurent le droit naturel de liberté de leurs sujets contre toute tentative de rétablissement de l’esclavage ou du servage et constituèrent leur pouvoir politique en justice d’appel pour ces diverses communautés167. Ils créèrent également l’institution des États généraux. Elle réunissait les mandataires élus des trois ordres : clergé, noblesse et Tiers-état, composé des communautés villageoises, communes urbaines et corps de métiers. Ils formaient le conseil du roi élargi à tous ses sujets et délibéraient sur le consentement à donner à des décisions politiques importantes. Le gouvernement était ainsi mixte associant souveraineté royale et populaire168. Cette constitution de la monarchie fut notamment exprimée au XVIème siècle par le juriste Bodin169.
La philosophie du droit naturel est développée à plusieurs occasions au cours l’époque moderne dans un effort mondial170. Au XVIème siècle, elle est mise en avant en Espagne, par Las Casas et l’École de Salamanque, dont Vitoria et Suarez, suite à ce qui a été appelé la « découverte » de l’Amérique alors nommée « destruction des Indes »171 ; dans les États allemands, par Thomas Münzer, au cours de la guerre des paysans de 1525172 ; durant la Renaissance française, notamment par La Boëtie173 ; d’environ 1560 à 1600, un peu partout en Europe, par les monarchomaques tel que le français Hotman, dans le contexte des guerres de religion174, suivis par des jésuites de la contre-réforme catholique, dont l’espagnol Juan de Mariana et l’italien Bellarmin175. Entre 1610 et 1768, dans les États actuels d’Argentine, du Paraguay et du Brésil, des jésuites organisèrent des républiques fondées sur ces mêmes principes philosophiques176. Ces principes furent en outre défendus dans le contexte de la Révolution hollandaise, guerre d’indépendance des Provinces-Unies contre l’occupation espagnole (1568-1648), lors et à la suite de laquelle sont notamment intervenus au XVIIème siècle, Grotius, ses continuateurs allemands Pufendorf et Thomasius, puis Spinoza.
Au XVIIème siècle, la philosophie du droit naturel est également reprise dans le cadre de la Première Révolution d’Angleterre (1640-1660), par ceux qui furent alors dénommés Niveleurs, tels que Lilburne, Overton et Walwyn, et Vrais Niveleurs, comme Winstanley, et des théoriciens qualifiés de « néo-romains », comme Milton ou Nedham. Leurs idées ont été synthétisées par Locke. Cette révolution a influencé la révolte populaire et nobiliaire durant la Fronde (1648-1653) et notamment l’Ormée de Bordeaux (1652-1653), groupe d’opposants à la monarchie française qui s’empara de l’Hôtel de ville177. Cette philosophie se trouve en France également chez des jansénistes178.
Au XVIIème siècle, avec Bayle ou le cartésien179 Poullain de La Barre, puis, au XVIIIème siècle, avec Beccaria, Condillac, Jaucourt, Kant, Linguet, Mably ou Montesquieu, la philosophie du droit naturel est encore défendue par les Lumières180. Au cours de ce dernier siècle, elle est en outre mobilisée dans le cadre d’un cycle de révolutions comprenant parmi d’autres les révolutions corses (1729-1769 et 1789-1793), des États-Unis (1776)181, brabançonne et liégeoise (Belgique actuelle, 1786-1791)182.
La philosophie du droit naturel a été formulée par ces théoriciens dans des contextes très divers. Elle découle d’une philosophie183 éthique ou morale184 : la raison sensible à l’humanité permet de connaître le bien, idée élevée par le philosophe grec Platon (Vème siècle avant notre ère) au-dessus de tout être185. Cette éthique est particulièrement fondée sur l’idée de justice : le droit naturel est la pensée critique qui suit le cri de la personne ou du groupe qui subit une injustice et conteste l’autorité186.
La philosophie du droit naturel affirme que tout homme a de naissance des droits naturels et que le premier d’entre eux est de vivre libre. Être libre, c’est n’être soumis au pouvoir d’aucun autre homme. Mais cette liberté étant le propre de tout homme implique sa réciprocité : être libre, c’est également ne soumettre aucun autre homme à son pouvoir. La réciprocité de la liberté est le droit naturel à l’égalité187. Dans la théorie politique du droit naturel, tout homme a également le droit naturel à la liberté en société ou citoyenneté qui est la participation de chaque homme à l’autorité souveraine. La réciprocité de ce droit est le droit du peuple à la souveraineté ou souveraineté populaire, c’est-à-dire de se former en société politique. L’objectif du contrat social doit être alors de réaliser les droits naturels. Les droits naturels sont donc des droits individuels et, impliquant la réciprocité du droit ou droit naturel à l’égalité, des droits universels ou rapports entre les hommes. La réciprocité du droit naturel impose à chacun le devoir de respecter celui d’autrui et se constitue de ce fait en limite188. Le droit à la liberté était lui-même fondé sur un autre droit. Le droit de propriété privée illimité des biens matériels et la liberté illimitée du commerce ont particulièrement été critiqués. Cette liberté a été définie comme celle des propriétaires de biens matériels d’opprimer ou de tuer ceux qui ne possèdent rien d’autre que la vie. Le pouvoir politique, c’est-à-dire par la loi, doit donc subordonner le pouvoir économique au droit à l’existence et aux moyens de la conserver, donc au droit aux subsistances, de tout être humain. Ce dernier est par ailleurs complété par d’autres droits sociaux189.
B) La Révolution française : une révolution des droits naturels de l’homme et du citoyen
En 1828, le révolutionnaire d’origine italienne Philippe Buonarroti analysa la Révolution française comme un conflit opposant les partisans et les adversaires du droit naturel, c’est-à-dire, à l’époque de la Convention, les Montagnards et les Brissotins190. Les mesures économiques et sociales de la Convention montagnarde ont formé un ensemble cohérent et sont replacées dans ce cadre :
« L’établissement des magasins d’abondance, les lois contre les accapareurs, l’émission du principe qui attribue au peuple la propriété des denrées de première nécessité, les lois pour l’extinction de la mendicité […] et la communauté qui régnait alors parmi la généralité des Français, furent quelques-uns des préliminaires d’un ordre nouveau »191.
La Constitution énonçait les droits politiques des citoyens et l’objectif de la législation sur le Gouvernement révolutionnaire était de la mettre définitivement en place192. Albert Mathiez pensa également que certains Montagnards fondèrent leur politique sur les déclarations des droits naturels193. Il jugea qu’ils défendirent une « politique sociale »194 à laquelle les Brissotins s’opposèrent mais que la Commune soutint195. La Convention montagnarde mena également une « politique démocratique »196.
Les historiens qui ont replacé l’histoire de la Révolution française dans le cadre de la philosophie du droit naturel soutiennent, qu’à la Convention, des Montagnards ont défendu une politique fondée sur le droit naturel. Dès 1988, Gauthier et Guy-Robert Ikni l’ont montré pour Robespierre et Coupé197, en 1992, Françoise Brunel pour Billaud-Varenne198, en 2002, Yannick Bosc pour Paine199 et, en 2019, Suzanne Levin pour Prieur député du département de la Marne200. Dans un ouvrage de 2013, Anne Quennedey, chercheuse en littérature, et Pierre-Yves Glasser, philosophe, l’ont établi pour quelques textes de Saint-Just201. Ces auteurs ont mis en évidence que, du 2 juin 1793 au 9 thermidor an II – 27 juillet 1794, la Convention commença à mettre en place cette politique. En 2000, Jean-Pierre Gross, qui étudia les actes de députés envoyés en mission par la Convention montagnarde dans les départements du centre et du sud-ouest, a également démontré que cette politique a bien été mise en pratique. La Déclaration des droits naturels est « traduite en action [...] par les représentants en mission »202. D’autres auteurs ont élaboré la même réflexion à propos d’administrateurs de cette période. En 1976, Daline, s’il se situait dans un schéma interprétatif de la « révolution bourgeoise », mit Babeuf à part et attesta qu’il fut un théoricien du droit naturel203. Dans son ouvrage de 2014, Michèle Grenot constata que Dufourny, président du Département de Paris de juin 1793 au 7 nivôse an II – 27 décembre 1793, a défendu une politique visant à garantir les droits naturels204.
Une partie de ces auteurs a également rapproché la politique de la Convention montagnarde des conceptions populaires du droit qui avaient été précédemment mises en lumière205. En 1924, Georges Lefebvre, qui se plaçait dans un schéma interprétatif de la « révolution bourgeoise », a découvert l’existence d’une révolution paysanne autonome. Il précisa que le mouvement populaire paysan défendit le droit à l’existence et la souveraineté populaire206. Soboul l’a également montré à propos du mouvement populaire urbain parisien207 et Godineau au sujet du mouvement populaire féminin à Paris208. Contrairement à Lefebvre et Soboul, elle ne pensait pas que cette conception du droit ait été rétrograde et la replaça dans la défense du droit naturel209. Une série de mémoires, dirigés par Gauthier à l’Université Paris VII Denis Diderot, l’ont également établi pour l’ensemble du mouvement populaire parisien210.
Quelle politique mena Pache durant son mandat de maire de la Commune de Paris du 14 février 1793 au 21 floréal an II – 10 mai 1794 ? Quels ont été ses aspects économiques et sociaux ? Quelles ont été ses relations politiques avec le peuple parisien d’une part et la Convention d’autre part211 ? La politique de Pache, maire de la Commune, peut être resituée dans le cadre de la philosophie du droit naturel. Le droit aux subsistances, les autres droits sociaux et le droit à la liberté individuelle puis la souveraineté populaire seront successivement abordés. Isabelle Fourneron avait déjà commencé cette étude dans un mémoire de maîtrise de 1991212, réflexion que j’ai poursuivie depuis 2010 dans différents travaux, parmi lesquels une thèse en histoire moderne213, dont ce livre est la synthèse.
C) Définitions et sources
Il peut s’avérer nécessaire de définir les termes de « Montagnards », de « Brissotins » et de « peuple » présents dans les sources et employés dans cet ouvrage. Du 21 septembre 1792 au 2 juin 1793, les propositions de ceux qui furent nommés les Brissotins214 furent généralement soutenues par la majorité de la Convention, puis, du 2 juin au 9 thermidor an II – 27 juillet 1794, ce furent celles de ceux qui furent appelés les Montagnards. Si ces formations étaient mobiles, les députés pouvant rejoindre tel ou tel groupe selon les votes, elles étaient divisées sur les principes politiques. Les Brissotins développèrent une politique opposée à la philosophie du droit naturel et, le 29 mai 1793, allèrent jusqu’à en supprimer la référence en votant une Déclaration des droits de l’homme en société. Les Montagnards défendaient cette référence et la rétablirent dans la Constitution du 24 juin215.
Durant la Révolution, les citoyens formulaient des vœux composites et parfois divergents. En même temps, ils utilisaient des moyens d’expression uniformes, notamment en se réunissant en assemblées générales de communes ou de sections de communes pour délibérer, et formaient des revendications communes. Il est donc pertinent de dire que ce qui était alors nommé, dans son sens politique, le peuple fut un acteur à part entière de la Révolution216.
L’incendie de l’Hôtel de ville de Paris du 24 mai 1871 ayant fait disparaître les archives de la Commune et des sections, une importante partie des sources sur la politique de Pache a aujourd’hui disparu. Néanmoins, il existe encore un nombre important de documents, dont une grande partie n’a encore jamais été étudiée, pouvant combler cette absence.
Ces archives sont dispersées dans un grand nombre de lieux de conservation mais également au sein d’une même institution. Des documents ont été consultés dans 10 centres d’archives, principalement les Archives nationales et les Archives de Paris, et dans 12 bibliothèques, particulièrement la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Ils se composent principalement de lettres de Pache ainsi que d’arrêtés manuscrits ou imprimés et de proclamations imprimées de la Commune signés du maire. La presse publiant les comptes-rendus des séances du Conseil général et donnant accès à des discours de Pache à la Commune, le Journal de la Montagne, la Gazette nationale ou Le Moniteur Universel, les Affiches de la Commune de Paris et Le républicain français ont été consultés intégralement. Pour compléter ces titres, d’autres journaux ont été étudiés plus épisodiquement. Des éditions de textes, comme les Archives parlementaires comportant entre autres les discours du maire à la Convention, ainsi que des catalogues d’autographes ont également été pris en compte.
La nature de ce corpus impose certaines limites à la présente étude. Elle empêche d’avoir une vision exhaustive du sujet. La presse, qui permet d’aborder les actes de la Commune, ne fait que rarement état des assemblées autres que le Conseil général. Les discours de Pache, y étant retranscrits par des journalistes, comportent de fait des différences, qui néanmoins restent superficielles, entre les divers sources217.
Première partie : Le droit aux subsistances
Du 14 février au 2 juin 1793, pour garantir le droit aux subsistances, Pache et la Commune contribuèrent à l’élaboration de ce qui a été appelé par Robespierre une « économie politique populaire »218. Jusqu’au 8 brumaire an II – 29 octobre 1793, ils tentèrent de résoudre le problème de la non-application de la législation sur les subsistances puis continuèrent tout au long de la période étudiée à la mettre en œuvre.
3 Louis PIERQUIN, Mémoires sur Pache, ministre de la Guerre en 1792 et maire de Paris sous la Terreur. Sa retraite à Thin-Le-Moutier..., 1898, rééd. Charleville, E. Jolly, 1900, p. 69 et 71.
4 En 1789, Paris comptait environ 600 000 habitants, Raymonde MONNIER, « Paris et la Révolution », in Michel VOVELLE dir., Recherches sur la Révolution : un bilan des travaux scientifiques du Bicentenaire, Paris, La Découverte-IHRF, 1991, p. 294. Dans une lettre à Descombes du 16ème jour du 1er mois de l’an II – 7 octobre 1793, Pache évaluait la population parisienne à 800 000 personnes, A. N., W/94.
5 Acte de baptême du 6 mai 1746, A. D. de la Meuse, état civil, 5 M. I. 247, consulté sur http://archives.meuse.fr le 01/09/2018, Mémoires de Mme Roland…, Paris, Auguste Durand, 1840, tome 2, p. 133 et M. REYMOND, « L’origine de Jean-Nicolas Pache, maire de Paris », Revue d’histoire vaudoise, 1925, 33ème année, p. 63 et 64. D’après ce dernier, Nicolas Pache serait né à Oron (canton de Vaud, aujourd’hui en Suisse). La lettre de Jean-Nicolas Pache à de Bonnard, officier d’artillerie au régiment de Besançon (département actuel du Doubs), du 26 décembre 1771, A. N., 352/AP/38, indique que son père avait possédé une maisonnette dans un hameau proche de Lausanne (même canton).
6 Acte de mariage de Nicolas Pache et de Jeanne Lallemand du 8 janvier 1746, A. D. de la Meuse, état civil, 5 M. I. 247, consulté sur http://archives.meuse.fr le 01/09/18 et Bulletin du groupe de recherche sur l’histoire de Thin-le-Moutier, 1984, N° 13, numéro spécial « Jean-Nicolas Pache », p. 14.
7 Charles-Pierre COSTE D’ARNOBAT, Anecdotes curieuses et peu connues sur différens [sic] personnages qui ont joué un rôle dans la révolution, Genève, rééd. Paris, Michel, rue des Prouvaires, 1793, p. 63, B. N. F., LB/41/792 et Marc de BOMBELLES, Journal, tome IV : « 1793-1795 », Genève, Droz, 1998, p. 87 et 88. D’après la biographie de Pache rédigée par Georges Avenel, qui ne cite pas toutes ses sources écrites ou orales, Pache étudia au collège jusqu’à 13 ans puis auprès d’un abbé et enfin à l’École royale du Génie de Mézières (département actuel des Ardennes), B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 1-3 et 10. Pour Marc de Bombelles, il s’agit de l’abbé de La Chaux. Selon François PAIRAULT, Gaspard Monge, le fondateur de Polytechnique, Paris, Tallandier, 2000, p. 30, citant Eugène ESCHASSERIAUX, Notes chronologiques pour servir à l’histoire de la vie de Gaspard Monge, s. d., son père aurait également été concierge du marquis de Castries.
8 Lettres de Pache à Bonnard, 1771-1774, A. N., 352/AP/38 et Dominique JULIA, « Bernard de Bonnard, gouverneur des princes d’Orléans et son Journal d’éducation (1778-1782) », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 1997, N° 109-1, p. 383-464. Voir aussi Eugène ESCHASSERIAUX, Notes..., s. d., t. 1er, p. 34, 53-55 et 107-108, B. C. E. P., fonds Gaspard Monge, IX GM 30. Ce manuscrit a été rédigé d’après divers documents de la famille du révolutionnaire Gaspard Monge et pièces officielles dont certains sont cités. Sur le marquis de Castries, voir Duc de CASTRIES, Le maréchal de Castries : 1727-1800, Paris, Flammarion, 1955.
9 Lettres de Pache à Bonnard, 1771-1774, A. N., 352/AP/38. En 1772, Pache fit partie de la société littéraire de Lausanne, voir les archives conservées à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne dont une partie a été publiée sur https://lumieres.unil.ch/fiches/bio/3638, consulté le 05/07/24.
10 D’après la copie d’une lettre du marquis de Castries au roi Louis XVI du 19 juin 1784, Archives de la Marine, citée par la biographie de Pache par Georges Avenel, B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 9, 11 et 12. Avenel indiqua que ce fut Necker qui l’employa. Le 22 octobre 1776, Necker avait été nommé conseiller des Finances et directeur général du Trésor royal.
11Almanach de Versailles, Année 1782…, Versailles, Paris, 1782, p. 235, http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr/pdf/ALV1782.PDF, consulté le 05/12/19 et copie d’une lettre du marquis de Castries à Louis XVI du 19 juin 1784, Archives de la Marine, citée par la biographie de Pache par Georges Avenel, B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 11 et 12.
12 Yves BENOT, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 1988 (rééd. 2004), p. 39, Émilie SAXEMARD, Les citoyens de couleur de Saint-Domingue : la Révolution contre le préjugé de couleur. 1789-1792, mémoire de maîtrise, dirigé par Florence Gauthier, Paris VII Denis Diderot, 1998, p. 54, Fabien MARIUS-HATCHI, « Révoltes, insurrections et révolutions dans les colonies françaises des Antilles, 1773-1803 », in Raymonde MONNIER éd., Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques, 1773-1802, Paris, Ellipses, 2004, p. 90 et 91 et Florence GAUTHIER, L’aristocratie de l’épiderme. Le combat de la Société des Citoyens de Couleur, 1789-1791, Paris, CNRS, 2007, rééd. Aux origines du racisme moderne : 1789-1791, Paris, CNRS, 2024, p. 15 et 16.
13 Copie d’une lettre du marquis de Castries à Louis XVI du 19 juin 1784, Archives de la Marine, citée par la biographie de Pache par Georges Avenel, B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 11 et 12.
14 Biographie de Pache par Georges Avenel, B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 11 et 12 et Eugène ESCHASSERIAUX, Notes…, op. cit., t. 1er, p. 107 et 108.
15 Georges AVENEL, Lundis révolutionnaires 1871-1874. Nouveaux éclaircissements sur la Révolution française à propos des travaux historiques les plus récents et des faits politiques contemporains, Paris, Ernest Leroux, 1875, p. 106 cite une pièce sans cote conservée à l’Hôtel de la Marine. D’après Philippe LE BAS, France. Dictionnaire encyclopédique, Paris, Firmin Didot frères, 1844, t. 11, p. 298, Pache occupa encore les fonctions d’intendant de marine à Toulon (département actuel du Var), de munitionnaire général des vivres de la Marine et de contrôleur de la Maison du roi et des dépenses diverses sous le ministère de Necker. La livre était une unité monétaire.
16 Konrad Engelbert OELSNER, Notice sur la vie de Sieyès. Membre de la première Assemblée nationale et de la Convention, écrite à Paris, en messidor, deuxième année de l’ère républicaine (vieux style, juin 1794), Suisse, 1795, p. 41, Mémoires de Mme Roland…, op. cit., p. 126 et Eugène ESCHASSERIAUX, Notes…, op. cit., t. 1er, p. 107-108.
17 Acte de mariage de Nicolas Pache et de Jeanne Lallemand du 8 janvier 1746, A. D. de la Meuse, état civil, 5 M. I. 247, consulté sur http://archives.meuse.fr le 01/09/18. Sur cet évêque, voir Olivier ANDURAND, « L’exercice du magistère épiscopal à l’heure de l’Unigenitus : questions d’ecclésiologie gallican », Chrétiens et sociétés, 2017, N° 24, p. 47-71.
18 A. GEFFROY, Gustave III et la cour de France…, Paris, Didier et Cie, 1867, t. 1, p. 248 et 249.
19 Note de Pache pour Castries, 1789, A. N., 306AP25. Sur l’institution des États généraux, voir infra, INTRO/III/A.
20Mémoires de Mme Roland…, op. cit., p. 126 et Eugène ESCHASSERIAUX, Notes…, op. cit., t. 1er, p. 136.
21 Jeanne DAMAMME, Pache, ministre de la guerre et maire de Paris : Recherches sur le Jacobinisme, mémoire de maîtrise, dirigé par Albert Soboul, IHRF, 1971, p. 5. Il logea 13 rue de Tournon, lettre de Pache au président de l’Assemblée législative du 30 décembre 1791, A. N., C/141.
22 Eugène ESCHASSERIAUX, Notes…, op. cit., t. 1er, Isabelle BOURDIN, Les Sociétés populaires à Paris pendant la Révolution, Paris, Recueil Sirey, 1937, p. 346-356 et Raymonde MONNIER, L’espace public démocratique. Essai sur l’opinion à Paris de la Révolution au Directoire, Paris, Kimé, 1994, p. 97-119.
23Mémoires de Mme Roland…, op. cit., p. 127. Selon Charles-Olivier BLANC, « Jean-Nicolas Pache », https://gw.geneanet.org/darbroz?lang=fr&n=pache&oc=0&p=jean+nicolas, consulté le 03/02/21, ne citant pas de source, le 21 mars, Pache fut nommé juré du département de Paris.
24 Édith BERNARDIN, Jean-Marie Roland et le ministère de l’Intérieur (1792-1793), Paris, SER, 1964, p. 205.
25Mémoires de Mme Roland…, op. cit., p. 128 et voir p. 126. À cette occasion, Pache aurait également renoncé à ses pensions d’Ancien Régime, ibid., p. 126.
26Ibid., p. 129 et Maurice LEVER, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. T. III, Dans la tourmente : 1785-1799, Paris, Fayard, 2004, p. 247. Sur Servan, voir Jacques-François LANIER, Le général Joseph Servan de Gerbey, Valence, SRIG, 2001.
27 Extrait du registre des délibérations de la Section du Luxembourg du 30 avril 1792, B. N. F., LB/40/1930. Il est signé par Ceyrat, président, et Pache, secrétaire. Pour la biographie de Pache par Georges Avenel, B. C., N.1.M.1, boite 53, p. 20, Pache fut également élu président à cette époque. Dans cet ouvrage, le terme de Section, employé seul, fait référence aux assemblées générales.
28 Voir Fritz BRAESCH, La commune du dix août 1792 : étude sur l’histoire de Paris du 20 juin au 2 décembre 1792, 1911, rééd. Genève, Mégariotis Reprints, 1978, p. 222 et 260.
29 Sigismond LACROIX, Le Département de Paris et de la Seine pendant la Révolution (février 1791-ventôse an VIII), Paris, 3 rue de Furstenberg, 1904, p. 221 et 471 citant l’Almanach national de France de 1793. Le 20 septembre, il fut nommé troisième député suppléant de Paris à la Convention, Étienne CHARAVAY, Assemblée électorale de Paris, Procès-verbaux : volume 3 (2 septembre 1792-17 frimaire an II), Paris, Cerf, Quantin, Charles Noblet, 1905, p. 75.
30 Eugène ESCHASSERIAUX, Notes…, op. cit., t. 1er, p. 204, 205, 209, 211 et 212, Edmond POUPE, Le département du Var, 1790-an VIII, Cannes, Cruvès et Vincent, 1933, p. 218 et François PAIRAULT, Gaspard Monge…, op. cit., p. 83.
31A. P., t. 47, p. 301.
32 Henri LIBERMANN, La défense nationale à la fin de 1792. Servan et Pache (10 août 1792-2 février 1793), Paris, Librairie académique Perrin et Cie, 1927, p. 148.
33 Charles POISSON, Les Fournisseurs aux armées sous la Révolution française. Le Directoire des achats (1792-1793), J. Bidermann, Cousin, Marx-Berr, Paris, A. Margraff, 1932, Isabelle FOURNERON, Pache, ministre de la guerre et maire de Paris (1792-1794)





























