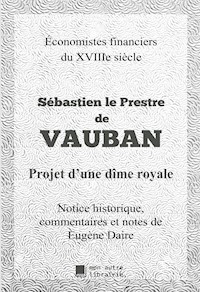
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Par cette étude, fruit d'années d'observations sur le terrain, l'auteur présente au roi le projet d'un impôt simplifié, plus rentable et surtout plus juste. Assez logiquement l'ouvrage déplut, mais malgré l'interdiction du roi, Vauban s'obstina et put le faire imprimer, et en distribuer gracieusement de nombreux exemplaires. Cet ouvrage, technique certes, mais accessible à tous, offre surtout une impressionnante plongée dans la mentalité et la vie quotidienne du XVIIe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Projet d’une Dîme royale
Sébastien Le Prestre de Vauban
Notice historique, commentaires et notes de Eugène Daire
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’ouvrage Économistes financiers du XVIIIe siècle : Vauban, Boisguillebert, Jean Law, Melon, Dutot, édition Guillaumin, Paris, 1843.
Les rectifications de cette présente édition ont été mises entre crochets.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-006-6
Table des matières
Avant-propos
Notice historique sur la vie et lestravaux du maréchal de Vauban
Note relative aux travaux inédits du maréchal de Vauban
Dîme royale
Préface
Qui explique le dessein de l’auteur et donnel’abrégé de l’ouvrage
Maximes fondamentales de ce système
Projet
Premier fonds
Second fonds
Troisième fonds
Quatrième fonds
Seconde partie de ces mémoires
Qui contient diverses preuves de la bonté du système de la Dîme royale, et la manière de le mettre en pratique.
Chapitre I.
Chapitre II.
Chapitre III.
Chapitre IV.
Chapitre V.
Chapitre VI.
Chapitre VII.
Chapitre VIII.
Chapitre IX.
Chapitre X.
Chapitre XI.
Chapitre supplémentaire
Avant-propos
La Collection des Principaux Économistes, destinée tout à la fois à reproduire le mouvement graduel de la science et les œuvres de ses plus grands maîtres, devait s’ouvrir par les écrits de Vauban, de Boisguillebert, de Law, de Melon et de Dutot.
À ces divers penseurs, que, un seul excepté, la France a vu naître, appartient, en effet, la gloire d’avoir marché les premiers à la conquête des vérités économiques. Avec eux finit l’ère de l’empirisme ou de la routine, et commence celle du raisonnement, en ce qui touche les intérêts matériels de la société. Ils sont les véritables précurseurs de l’école physiocratique, dont Quesnay fut le chef, et de l’école industrielle, qui eut Adam Smith pour fondateur. Comme l’impôt fixa principalement leurs regards, nous les avons désignés par le titre d’Économistes financiers du dix-huitième siècle ; mais il ne faudrait pas induire de cette dénomination qu’ils aient concentré leur intelligence à cette seule partie de l’économie publique. Loin de là ; presque toutes les questions qu’agitent encore de nos jours la presse et la tribune des Chambres législatives ont été soulevées ou débattues dans les écrits de Vauban, de Boisguillebert, et de leurs successeurs immédiats.
Voilà les ancêtres de la science et les hommes courageux auxquels échut l’initiative du progrès au commencement du dix-huitième siècle.
À eux revient, autant qu’à Adam Smith lui-même, l’honneur d’avoir réhabilité le travail, et proclamé qu’il était, pour toute société, la condition nécessaire de l’ordre, de la durée, de la richesse et de la force.
À eux revient encore l’honneur d’avoir les premiers flétri la guerre, cet horrible fléau qui a toujours arrêté la civilisation dans sa marche, quand il ne l’a pas détruite.
À eux, enfin, l’honneur de n’avoir pas cherché le bien en dehors des limites du possible, et de ne s’être pas crus brevetés par la Providence pour refondre la nature individuelle et sociale dans un moule nouveau. Et l’on ne doit pas même excepter Jean Law de cet éloge ; car, à part sa grande erreur de la monnaie de papier, nulle intelligence ne fut plus positive que celle du célèbre Écossais, et il y eut loin de son utopie, d’ailleurs, à tous les étranges systèmes qui ont, depuis douze ans, passé sous nos yeux.
Aussi ne craindra-t-on pas de dire qu’une haute raison est, en général, le caractère de tous les écrits contenus dans ce volume ; et ce qui le prouve, c’est que la science, en se livrant depuis à des analyses beaucoup plus rigoureuses de tous les phénomènes de la production et de la distribution de la richesse, n’a infirmé presque aucun des principes importants qui y sont répandus.
En résumé, ce furent ces écrivains qui déterminèrent le grand mouvement économique auquel la France doit sa prospérité actuelle. Il n’y a pas de paradoxe à soutenir qu’à l’apparition de la Dîme royale et du Détail de la France, les rois furent arrachés à leurs préoccupations purement politiques, artistiques ou littéraires, et qu’ils commencèrent dès lors à compter avec les intérêts de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. Et dès que la semence fut jetée, elle fructifia promptement ; car à peine Law, Melon et Dutot eurent-ils quitté la plume que les disciples de Quesnay la reprirent, et qu’un peu plus tard l’illustre Adam Smith, continuant, avec la puissance du génie, la tâche laborieuse de tous ses devanciers, écrivait l’immortel ouvrage de la Richesse des nations. C’est sous cette triple influence que s’accomplit la Révolution française, et que la société, se dépouillant pour toujours de sa vieille enveloppe féodale, s’élança, fière et radieuse, dans la carrière du travail et de la liberté. La part qu’eurent les économistes de la première moitié du dix-huitième siècle à ce grand événement n’est pas douteuse ; mais il faut les lire pour s’en convaincre, et pour apprendre surtout qu’on peut combattre les abus, les misères et les souffrances réelles sans se jeter dans les niaiseries du sentimentalisme, et sans rendre la philanthropie ridicule en la poussant dans des voies où la nature des choses lui commande de ne pas s’engager.
Appelé à l’honorable mission de recueillir les œuvres des premiers maîtres de la science, nous n’avons épargné ni efforts, ni recherches pour l’accomplir dignement. Tous les textes ont été revus avec le plus grand soin, et notamment celui de Boisguillebert, où tous les genres d’incorrections typographiques semblaient en quelque sorte accumulés à plaisir ; un chapitre inédit complète la Dîmeroyale, ce legs si précieux fait à la postérité par la raison et la vertu du maréchal de Vauban ; et les œuvres de Law, enfin, ont reçu dans les quatre Lettres sur le nouveau système des finances, et dans le Mémoire sur les monnaies, que ne contenait pas l’édition de 1790, une augmentation dont l’importance, au point de vue historique et économique, ne sera certainement contestée par personne. Quant aux notices biographiques, notes et commentaires qui grossissent ce volume, il ne nous appartient pas, sans doute, d’en juger la valeur ; mais c’est notre devoir de dire que nous n’y avons professé que des opinions consciencieuses et qui pourraient, la plupart, invoquer à leur appui l’autorité de quelque nom imposant.
Eugène Daire
Paris, 20 mars 1843
Notice historique sur la vie et les
travaux du maréchal de Vauban
Sébastien Le Prestre, chevalier, seigneur de Vauban, Bazoches, Pierre-Perthuis, Pouilly, Cervon, la Chaume, Épiry, le Creuzet, et autres lieux, maréchal de France, chevalier des ordres du roi, commissaire général des fortifications, grand-croix de l’ordre de Saint-Louis, et gouverneur de la citadelle de Lille, naquit, le 1er mai 1633, d’Urbain Le Prestre et d’Aimée de Carmagnol. Sa famille était d’une bonne noblesse du Nivernais ; elle possédait la seigneurie de Vauban depuis plus de deux cent cinquante ans.1
En prononçant le nom du maréchal de Vauban, on éprouve un sentiment d’admiration et de respect qui tient beaucoup moins à la renommée militaire de ce grand homme qu’au souvenir de son éclatante vertu. Dans ce caractère antique, en effet, toute la gloire du soldat s’efface devant celle du citoyen, tant est rare et noble en soi le spectacle d’une longue carrière pure de cupidité, d’intrigue, et d’ambition personnelle. Vauban est une figure à part dans la monarchie de Louis XIV, et une figure auprès de laquelle, on peut l’affirmer, paraissent bien petites et bien vulgaires celles de la plupart des courtisans, des ministres, des généraux, des diplomates et des littérateurs du grand siècle ! De cette foule de célébrités distinctes, cataloguées par Voltaire, si vous retranchez les noms de Catinat et de Fénelon, combien restera-t-il d’hommes dont le cœur ait battu rien que pour l’amour de la vérité, du bien public et de la patrie ? Guerriers, prêtres, magistrats et gens de lettres, semblent-ils même se douter qu’il existe en France autre chose que le prince et la cour ? Si vous ne voulez pas là-dessus interroger Saint-Simon, si vous pensez que le duc et pair a calomnié ses contemporains, écoutez les paroles de cet inexplicable et sublime rhéteur qui flattait les grands de la terre jusque sur leur cercueil, et qui, comparant Louis à Constantin et à Théodose, à Marcien et à Charlemagne, félicitait Michel Le Tellier d’avoir vécu assez longtemps pour signer la révocation de l’édit de Nantes.2 Faut-il ajouter, pour preuve de cet esprit général de servilité, de cet abandon funeste de toute indépendance, que le philosophe Fontenelle voyait le triomphe de la religion dans cet acte impie, et que sa muse glaciale trouvait de mauvais vers pour le célébrer.3
Vauban fur sur ce point bien supérieur à son siècle ; non seulement il gémit en véritable chrétien et en sage politique de ce que la cour et la ville approuvaient sans réserve, mais il n’hésita pas, comme nous le verrons plus tard, à condamner le fanatisme du prince, et à se montrer le généreux défenseur de ses sujets. En outre, c’était bien moins la couronne que l’État qu’il entendait servir, et l’autorité de la première ne paraissait respectable à ses yeux que parce qu’il y voyait une force établie par la Providence pour dominer toutes les volontés contraires à l’intérêt général. Le devoir, comme base du droit, et l’égalité civile, pour arriver au bonheur du peuple, voilà la doctrine politique de cet homme illustre ; doctrine qu’il prêchait de bouche et par écrit, de paroles et d’exemples, dans la guerre comme dans la paix, au milieu des camps comme au milieu de la cour, et cela avec une abnégation si simple et si naturelle, qu’il paraissait ne pas avoir la conscience de sa vertu. « C’était, a dit Fontenelle, un Romain qu’il semblait que notre siècle eût dérobé aux plus heureux temps de la république. » C’était plus encore, selon nous ; car il y a loin du patriotisme antisocial des héros de Rome républicaine au génie de Vauban, déplorant toujours la guerre comme une nécessité malheureuse, et jetant, par ses méditations, les premières bases d’une science qui devait apprendre au monde que l’industrie est le seul fondement durable de la puissance des États, et que les peuples, au lieu de gagner quelque chose à un système de massacres et de pillages perpétuels, ont, au contraire, le plus grand intérêt à leur prospérité respective. On sent que l’âme du guerrier moderne a subi l’influence du christianisme, mais qu’elle a découvert dans cette philosophie sublime ce que n’y avait pas aperçu le clergé de son temps, un grand principe de civilisation, et non une simple doctrine de salut individuel. Mais la meilleure manière de louer les grands hommes étant de raconter leur vie et d’exposer leurs travaux, empressons-nous de jeter un coup d’œil sur la longue et glorieuse carrière du maréchal de Vauban.
La fortune, qui sourit de bonne heure au mérite du jeune Vauban, n’avait pas été favorable à sa famille. Son père, Urbain Le Prestre, s’était, comme presque tous les gentilshommes de province qui n’avaient pas d’appui à la cour, ruiné au service. Il laissa en mourant des affaires très embarrassées, et une veuve qui ne survécut pas longtemps à cette perte douloureuse. La terre de Vauban fut mise sous séquestre, et l’orphelin, encore enfant, paraîtrait n’avoir dû qu’à la bienfaisance de M. de Fontaines, prieur de Saint-Jean, à Semur, l’éducation fort incomplète qu’on lui donna. La lecture, l’écriture, le calcul, et quelques éléments de géométrie, furent en effet le seul enseignement que reçut celui qui ne devait pas tarder à devenir le premier ingénieur de l’Europe, et à opérer une révolution dans tout ce qui concerne l’attaque et la défense des places de guerre. Il ne nous appartient pas de résoudre le problème de savoir si, au point de vue intellectuel, une éducation différente aurait affaibli ou fortifié le génie de Vauban ; mais nous croyons qu’au point de vue moral il n’en pouvait recevoir une meilleure, et que la simplicité d’habitudes dans laquelle se passa son enfance fut cause, en partie, de la noblesse et de l’originalité de son caractère. Élevé dans une petite ville de province, il vécut avec les enfants du peuple, jouit de toute la liberté qu’on leur laisse, connut leurs souffrances ainsi que leurs plaisirs, et puisa certainement dans ce milieu social, sur les hommes et sur les choses, une foule d’idées justes et d’impressions sérieuses qu’il n’aurait pas acquises ou éprouvées dans la vie de collège. On sait, du reste, qu’une éducation analogue et tout aussi négligée n’empêcha pas Henri IV de se montrer un homme supérieur, en même temps que l’histoire témoigne de la sympathie qu’inspirèrent toujours à ce prince les classes laborieuses de la société.
Quelle que soit la valeur des réflexions qui précèdent, en 1651, le jeune Vauban, qui avait atteint sa dix-septième année, petit de taille, mais robuste de corps et d’intelligence, éprouve le besoin d’échapper à l’existence monotone qu’il menait, et part, à l’insu de tout le monde, offrir ses services au grand Condé. On l’enrôla dans la compagnie d’Arcenay, et il eut ainsi le malheur de faire ses premières armes contre la France ; car, à cette époque, le vainqueur de Lens et de Rocroy était ligué contre elle avec les Espagnols, ses ennemis. Cette faute, que les mœurs du temps n’auraient pas fait commettre quelques années plus tard à celui dont le patriotisme ne fut pas moins notoire4 que toutes les autres grandes vertus, est la seule tache qui se rencontre dans la vie de ce grand homme, et il saisit bientôt l’occasion de la réparer. Mais elle décida de sa vocation, et les premières places fortes qu’il aperçut lui révélèrent qu’il était né ingénieur.
En effet, dès 1652, on trouve Vauban employé aux fortifications de Clermont en Lorraine, et se livrant avec une incroyable ardeur à l’étude de la trigonométrie et de toutes les connaissances accessoires nécessaires à l’art qu’il voulait embrasser. En même temps il fait, au siège de Sainte-Menehould, contre les troupes du roi, ses premières preuves de courage militaire, en passant une rivière à la nage sous le feu de l’ennemi.
En 1653, Vauban tomba au pouvoir d’un parti royaliste. C’est alors que Mazarin, qui se connaissait en hommes, le détermina sans peine à quitter la cause du prince de Condé pour le service de la France, et le 3 mai 1655, il était pourvu d’un brevet d’ingénieur.
L’intervalle qui sépare cette époque de la paix des Pyrénées nous le montre prenant part aux attaques de Landrecies, de Condé et de Saint-Guislain, et conduisant en chef, dès 1658, les sièges de Gravelines, d’Ypres et d’Oudenarde. Il reçoit une blessure à Stenay, une autre devant Valenciennes, et trois à Montmédy.5 Le maréchal de La Ferté prédit alors au jeune ingénieur qu’il irait loin, si la guerre l’épargnait ; et, bien qu’il lui eût déjà fait don d’une compagnie dans son propre régiment, il voulut lui en donner une seconde dans un autre, pour lui tenir lieu de pension. Sa bravoure et ses talents ne furent pas récompensés avec moins d’éclat par Mazarin.
Le repos trop court que goûta l’Europe depuis le traité des Pyrénées jusqu’à la guerre de 1667 n’interrompit pas le cours des travaux de Vauban. Ces six années se passèrent pour lui à réparer nos vieilles places fortes, à en construire de nouvelles, et surtout à rendre Dunkerque formidable aux Anglais. Ils virent creuser un magnifique bassin, capable de recevoir trente vaisseaux de guerre, dans cette ville que la politique de Cromwell avait conquise sur les Espagnols à l’aide de nos propres armes, mais que Charles II, plus avide de plaisirs que jaloux de l’honneur de son pays, venait de céder honteusement à la France pour consacrer cinq millions de plus à ses folles prodigalités. De ce moment, Vauban passa pour le premier ingénieur du royaume ; et Louis XIV, qui, selon l’expression de Voltaire, aimait toujours à mettre sa gloire en sûreté, ne confia plus à d’autres qu’à ce grand homme la conduite de tous les sièges, qui se firent sous ses yeux.
L’art de Vauban eut la plus grande part à la rapide conquête de la Flandre et de la Franche-Comté, et l’on y eut recours, après la paix d’Aix-la-Chapelle, pour accomplir dans les villes prises tous les travaux de défense qui pouvaient les empêcher de retomber un jour entre les mains de l’ennemi. La citadelle de Lille et beaucoup d’autres ouvrages s’élevèrent alors d’après une méthode nouvelle, qui consistait bien moins dans l’usage de moyens jusqu’alors ignorés de la science, que dans le secret de tirer, de ces mêmes moyens, des résultats qui n’appartiennent qu’au génie. « La fortification de M. de Vauban, dit un des meilleurs juges en pareille matière,6 n’offre à l’œil qu’une suite d’ouvrages connus avant lui ; mais elle offre, à l’esprit de celui qui sait observer, des résultats sublimes, des combinaisons profondes, des chefs-d’œuvre multipliés d’industrie. C’est dans l’art de disposer respectivement ces ouvrages connus avant lui ; c’est dans l’art de profiter de toutes les circonstances locales ; c’est dans les manœuvres d’eau ingénieusement imaginées ; c’est dans l’art de placer une simple redoute dans un lieu inaccessible, d’où elle prenne de revers sur les tranchées; c’est dans l’art d’enfiler une branche d’ouvrages si habilement qu’on ne puisse la battre ni en brèche, ni par ricochet ; c’est, dis-je, en tout cela, que consiste l’art de Vauban. »
La conquête de la Hollande, la reprise de la Franche-Comté, et toutes les campagnes de la guerre de 1672, fournirent à Vauban l’occasion de déployer une activité infatigable, et de montrer réunies les vertus de l’homme de guerre, du philosophe et du citoyen. Rien n’égalait son intrépidité personnelle, et sa sollicitude pour le bien-être et la conservation du soldat. Au siège de Cambrai, un officier voulant brusquer l’attaque d’un ouvrage avancé, Vauban s’y oppose : « Vous perdrez, dit-il à Louis XIV, qui était de l’avis de l’officier, tel homme qui vaut mieux que le fort. » On n’écoute pas ; le coup de main a lieu, et l’on est repoussé avec perte. – « Une autre fois je vous croirai », dit le monarque ; gracieuses paroles qui ne rappelèrent pas un seul homme à la vie, mais qui sauvèrent peut-être celle des assiégés quand, seul dans le conseil de guerre, Vauban vint s’opposer encore au projet qu’avait conçu le prince de donner l’assaut à la ville et de passer la garnison au fil de l’épée. « J’aimerais mieux, s’écria-t-il alors, avoir conservé cent soldats à Votre Majesté que d’en avoir ôté trois mille à l’ennemi. »
Nommé brigadier d’infanterie en 1664, gouverneur de la citadelle de Lille en 1668, maréchal-de-camp en 1676, il succéda, en 1678, au chevalier de Clerville, comme commissaire général des fortifications. Tous les contemporains de Vauban affirment qu’il ne sollicita jamais aucune faveur, et qu’il éprouva la plus vive répugnance à accepter le dernier de ces titres, à raison des rapports directs qu’il fallait entretenir avec le ministère, c’est-à-dire d’une circonstance à laquelle tout autre aurait attaché le plus grand prix. Plus tard, Louis XIV, qui avait toujours récompensé dignement, on doit le reconnaître, les services de son ingénieur, usa presque de contrainte pour lui faire accepter le bâton de maréchal de France, parce qu’il alléguait que cette dignité l’empêcherait de servir l’État sous un maréchal moins ancien que lui. À cet amour exclusif du bien public, s’alliait encore la plus délicate générosité : en secourant de sa bourse les officiers malheureux, il appela cela leur restituer ce qu’il avait reçu de trop de bienfaits du roi.
La paix de Nimègue n’empêcha pas la prise de Luxembourg, et elle fut due à l’habileté de Vauban, qui s’honora, à ce siège, par un trait de sang-froid et de présence d’esprit admirable. Il s’avançait toutes les nuits jusqu’à la palissade, soutenu par des grenadiers couchés ventre à terre. À l’une de ces reconnaissances, il s’aperçoit qu’il est découvert. Au lieu de se retirer, il avance toujours, en faisant signe de ne pas tirer, et cette audacieuse assurance, qui trompe l’ennemi, permet à l’ingénieur d’achever son opération et d’échapper à une mort certaine. Huningue, Mont-Royal, Landau, Fort-Louis, et les belles fortifications de Strasbourg signalent cette époque, durant laquelle Vauban, sincère admirateur de Riquet, ajoutait quelques perfectionnements à son œuvre, et dirigeait encore les travaux de l’aqueduc de Maintenon, destiné à conduire les eaux de l’Eure dans la ville de Versailles.
Nous n’entreprendrons pas de décrire tout ce que fit Vauban dans les dix années de la guerre de 1688. Nul siège important qu’il ne dirige ; nul point menacé des frontières où il ne se porte. Les généraux se le disputaient ; et Louvois leur écrivait que la conservation de sa personne était considérée par le roi comme une affaired’État. Mais tant de gloire n’altérait en rien sa modestie et ses sentiments d’humanité. Au siège de Charleroi, en 1693, on l’entendit prononcer ces belles paroles : « Il vaut mieux verser moins de sang, dût-on brûler un peu plus de poudre. »
La paix de Ryswick amena enfin trois années de repos pour ce grand homme. Ses services actifs n’avaient été interrompus, depuis 1651, que par une grave maladie de plusieurs mois. Il consacra ce qu’il nomme son oisiveté à jeter par écrit toutes les vues qu’il croyait utiles à la bonne administration de l’État. Ces vues étant l’objet spécial de cette Notice, nous achèverons le récit de la vie militaire de Vauban avant d’en parler.
La guerre de succession le rappela à ses glorieuses fatigues. Après avoir été nommé maréchal de France, en 1703, il fit, sous le duc de Bourgogne, le siège de Vieux-Brisach, place très forte, qu’il réduisit à capituler au bout de treize jours et demi de tranchée ouverte, sans qu’il en eût coûté plus de trois cents hommes. On avait proposé, après la bataille de Ramillies, pour préserver Dunkerque d’une attaque, d’inonder toutes les campagnes environnantes. Vauban se transporta sur les lieux, ranima, par sa présence, le courage des populations, et les sauva de ce malheur. Enfin, cette même période vit se réaliser ses pressentiments que le titre de maréchal devait lui enlever l’occasion de servir utilement l’État. On sait que la perte de la bataille de Turin et la levée honteuse du siège de cette ville ne furent que la conséquence du refus de l’offre faite par Vauban d’accompagner le duc de La Feuillade, chargé de ce siège, pour le diriger sous ses ordres, en la simple qualité d’ingénieur. Ce grand homme avait répondu au roi, qui lui objectait l’impossibilité de subordonner un maréchal de France à un simple lieutenant-général : « Sire, ma dignité est de servir l’État ; je laisserai le bâton de maréchal à la porte, et j’aiderai peut-être M. de La Feuillade à entrer dans la ville. » Mais La Feuillade, aussi vain qu’incapable, avait répliqué à son tour qu’il prendrait Turin à la Cohorn.7 Il ne réussit qu’à faire tomber entre les mains du prince Eugène les bagages, les provisions, les munitions et la caisse de l’armée qui favorisait le siège.8
Vauban pleura ce grand désastre, mais la mort épargna à sa vieillesse la douleur d’être le témoin de tous ceux que la fortune réservait encore à la patrie pour expier les excès de l’ambition, plus vaniteuse qu’habile, de Louis XIV : elle vint frapper ce grand citoyen le 30 mars 1707, dans son château de Bazoches, à l’âge de soixante-quatorze ans moins un mois.9 Le prince l’avait enrichi ; il avait dépensé ses bienfaits au service de l’État, et laissait à sa famille beaucoup plus de gloire que de fortune.
On a calculé que le maréchal avait construit trente-trois places neuves, et fait travailler à trois cents places anciennes ; qu’il avait conduit cinquante-trois sièges, dont trente eurent lieu sous les ordres du roi ou de ses fils, et les vingt-trois autres sous différents généraux, et qu’il s’était trouvé à cent quarante actions de vigueur.
Il nous reste maintenant à le considérer sous un autre aspect, et à montrer qu’il fut l’un des penseurs sociaux les plus remarquables de son époque.
Il ne pouvait échapper à Vauban, que J.-B. Say appelle un esprit judicieux, ce qui n’est pas un médiocre éloge dans la bouche d’un homme qui a été, peut-être, l’esprit le plus judicieux, le plus logique dont la France s’honore, que le gouvernement de Louis XIV s’écartait beaucoup de la fin principale de tout gouvernement, le bonheur du peuple. Les flatteurs intéressés des ministres et du prince ne l’abusaient pas plus à cet égard qu’il ne trompent, de nos jours, les hommes de sens qui, sans nier les améliorations obtenues, savent apercevoir tout ce qu’il reste de vices et de misères dans le régime social actuel. Le grand siècle, en effet, ne brille que parce qu’on le compare aux temps antérieurs, qui furent des temps de profonde barbarie ; mais, considéré dans la valeur absolue de ses institutions, de ses mœurs et de ses lois, le spectacle qu’il offre est certainement des plus tristes à décrire. La France subissait encore à cette époque le joug de la féodalité ; car il ne faut pas prendre à la lettre le langage des historiens, quand ils disent que le génie de Richelieu avait abattu ce système. Il aurait, dans ce cas, tué la féodalité une seconde fois, puisqu’on avait déjà attribué pareil meurtre à Louis XI. C’est que l’on confond, dans cette hypothèse, le régime féodal avec la puissance politique des grands vassaux de la couronne, fait qui naissait bien de la féodalité, mais qui n’était pas, à coup sûr, la féodalité elle-même. Richelieu, par la force, Mazarin, par la ruse, anéantirent ce fait ; mais la féodalité, elle, resta debout, non seulement sous Louis XIV, mais encore sous ses successeurs, et ne fut vaincue définitivement que par la révolution de 1789. La féodalité, c’était l’inégalité civile inscrite dans les lois, et catégorisant le peuple dans les trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état ; c’était un assemblage incohérent de coutumes barbares, qui variaient de province à province et de ville à ville ; c’était la propriété sans garantie, le travail chargé de chaînes, les monopoles commerciaux, les douanes et les franchises provinciales, les corporations industrielles, et les corporations judiciaires, qu’on appelait parlements ; c’était la vénalité des emplois civils et militaires, la torture, les lettres de cachet, les cours seigneuriales et prévôtales, les tribunaux exceptionnels, le vol ininterrompu de l’altération, de la hausse ou de la baisse des monnaies, l’inégalité des charges publiques, et le peuple livré aux exactions des traitants ; c’était la servitude des biens et des personnes,10 le clergé persécuteur des consciences, la liberté d’écrire proscrite, et l’autorité royale aussi forte pour faire le mal qu’elle était faible pour réaliser le bien. Or, ni Richelieu, ni Mazarin, ni Colbert, ni Louvois, n’avaient rien changé de tout cela, et le gouvernement demeurait, comme par le passé, moins la guerre civile, une combinaison monstrueuse de despotisme et d’anarchie. Vauban eut la gloire de comprendre, presque seul, que cet état de choses n’était pas normal, et plus d’une fois il en gémit avec Catinat et Fénelon, auxquels l’unissaient des liens d’une noble amitié. Il fit davantage encore, et n’épargna ni méditations, ni recherches, pour découvrir les causes des malheurs publics, et les remèdes qui pouvaient y apporter quelque adoucissement. Pendant que la noblesse, en dehors du service militaire, ne songeait qu’à la fortune et aux plaisirs ; que le clergé consumait son temps en disputes théologiques, et que les littérateurs ne s’occupaient que de choses frivoles, ce grand citoyen, auquel, jusqu’en 1698, la paix, comme la guerre, n’avait jamais laissé un seul instant de repos, et qui errait depuis quarante années au sein du royaume, ainsi qu’il nous l’apprend lui-même dans la Dîme royale, trouvait le moyen de mener de front, avec ses immenses travaux de défense et de siège, de creusement de ports et de canaux, de construction et de démolition de forteresses, l’étude la plus haute et la plus consciencieuse de tout ce qui a rapport à l’économie publique. Sa vie se passa véritablement à défendre son pays et à recueillir toutes les idées qui lui semblèrent utiles à la gloire et au bonheur de l’État. La guerre, la marine, les finances, la religion, la politique générale, la navigation intérieure, les monnaies, l’agriculture dans toutes ses branches, le commerce et les colonies, paraîtraient avoir été, pour Vauban, les sujets de nombreux Mémoires qui, à en juger par le mérite de la Dîme royale, devaient abonder en vues supérieures, et, dans tous les cas, renfermer pour l’histoire de précieux documents dont, par malheur, il faut aujourd’hui déplorer la perte.11
Ces Mémoires, ou la plus grande partie du moins, furent rédigés après la paix de Ryswick, à l’aide des nombreux matériaux que l’auteur avait employé quarante années à réunir. Ils résumaient la sagesse et l’expérience d’un noble vieillard qui avait dépensé en bienfaits particuliers ou en recherches d’utilité publique presque toute la fortune qu’il tenait de la munificence de Louis XIV. « Il n’épargnait, dit Fontenelle, aucune dépense pour amasser la quantité infinie d’instructions et de mémoires dont il avait besoin, et il occupait sans cesse un grand nombre de secrétaires, de dessinateurs, de calculateurs et de copistes. » Il y a lieu de croire que tous ces Mémoires passèrent successivement, de même que la Dîme, sous les yeux de Louis XIV, de ses ministres, et des principaux personnages de son gouvernement. Le maréchal les réunit en une collection qui, d’après Fontenelle, se composait seulement de douze volumes in-folio, manuscrits, mais qui, d’après M. Noël, ne s’élevait pas à moins de quarante. La Bibliothèque royale possède les tomes II et III de cette collection intitulée modestement : Oisivetés de M. de Vauban, ou Ramas de plusieurs mémoires de sa façon, sur différents sujets.
Vauban doit être considéré comme le créateur de la statistique. Nous avons trouvé le nom, et il a inventé la chose.12 Il conçut, le premier, l’importance des renseignements qu’elle pouvait fournir à l’administration, et suggéra les ordres qui furent donnés par le ministère aux intendants des provinces, en 1698, d’opérer le dénombrement de la population, et de recueillir dans leurs généralités toutes les notions qui pouvaient profiter aux intérêts du commerce et de l’agriculture. Mais ce travail, si simple et si nécessaire, dont le gouvernement n’avait pas même eu l’idée, le maréchal l’avait entrepris bien avant cette époque, et, sans parler de la Dîme royale, tout ce qui reste de ses Mémoires prouve que nul homme, en France, ne connaissait plus à fond que lui l’état financier et économique du royaume. Fontenelle nous le peint interrogeant, sur l’industrie, l’agriculture et le commerce, les hommes de tous les rangs, de toutes les professions, de toutes les classes, avec une curiosité qui, de l’aveu du secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, n’était pas commune, à cette époque, parmi les gens en place. La valeur et le rapport des terres, les divers modes de culture, le nombre et les facultés des paysans, la nature des substances servant à leur alimentation, le taux de leurs salaires, inquiétaient surtout ce grand homme, et seul, pour ainsi dire, dans son siècle, il devinait que ces détails, méprisables et abjects en apparence, ce sont les expressions de Fontenelle, appartiennent cependant au grand art de gouverner. Par malheur, la cour et toutes les hautes classes sociales ne se doutaient guère de la vérité que l’académicien commençait à entrevoir : les temps n’étaient pas encore venus, et c’était plus tard que Vauban devait être compris. Mais ses idées et celles de Boisguillebert, dont l’éloge économique se trouve à jamais inséparable de celui de son illustre contemporain, ne furent pas perdues pour le monde : déjà s’élevait un enfant13 destiné à les recueillir, à réhabiliter l’agriculture et à créer l’école célèbre des physiocrates, de laquelle est sorti Turgot, le plus grand homme d’État, si la grandeur doit se mesurer à la passion du bien public et au dévouement à la cause de l’humanité.
Ce qui caractérise tous les écrits de Vauban, aussi bien que sa vie privée, c’est l’amour de l’ordre, mais de l’ordre fondé sur la justice, joint à la plus haute rectitude de jugement. Voilà sa physionomie morale et intellectuelle, le double élément de sa personnalité, qu’on peut traduire, en quelque sorte, par ces mots : Bon sens et vertu. Les hommes de cette nature, beaucoup plus rares que les imaginations ardentes et les esprits brillants, ne comprennent pas moins bien que ces derniers toutes les misères de leur époque ; mais ils procèdent d’une manière bien plus sage que la guerre qu’ils font aux abus. Au lieu de les attaquer en masse avec une fougue imprudente et presque toujours inutile, ils savent concentrer leurs coups sur ceux qu’il importe le plus de détruire, ou qui leur paraissent le plus vulnérables. Telle fut la marche suivie par Vauban. Il n’attaqua pas toutes les iniquités de la monarchie de Louis XIV, mais il choisit la plus générale et celle qu’il importait presque autant au prince qu’au peuple de voir disparaître. Les privilèges en matière d’impôt, l’inégalité des charges publiques, et un système de finances qui ruinait les citoyens sans enrichir l’État, lui étant apparus, avec raison, comme la calamité qui servait en quelque sorte de fondement à toutes les autres, anéantir cette calamité lui sembla un devoir, et devint, dès lors, une pensée dominante à laquelle se liaient, depuis longtemps, tous les travaux statistiques qu’il avait entrepris. Et la réalisation de cette pensée fut le Projet de la Dîme royale.14
Il n’existe pas, imprimés, d’autres Mémoires, financiers ou économiques, du maréchal, que ce projet. Il coûta la vie à son auteur, s’il faut en croire le duc de Saint-Simon ; et, dans tous les cas, il n’est pas douteux qu’il n’ait été pour lui la cause d’une disgrâce aussi éclatante qu’honorable. Le livre de la Dîme royale parut in-4°, sans noms de lieu ni d’auteur, au commencement de l’année 1707, et le conseil privé de Louis XIV rendait, le 14 février, l’arrêt suivant15 :
« Sur ce qui a été représenté au roi en son Conseil, qu’il se débite à Paris un livre portant Projet d’une Dîmeroyale, qui, supprimant la taille, etc... (suit la mention entière du titre de l’ouvrage) ... imprimé en 1707, sans dire en quel endroit, et distribué sans permission ni privilège, dans lequel il se trouve plusieurs choses contraires à l’ordre et à l’usage du royaume, à quoi étant nécessaire de pourvoir,
« Vu ledit ouvrage,
« Ouï le rapport du sieur Turgot,
« Le roi, en son Conseil, ordonne qu’il sera fait recherche dudit livre, et que tous les exemplaires qui s’en trouveront seront saisis et confisqués, et mis au pilon.
« Fait, Sa Majesté, défense à tous libraires d’en garder ni vendre aucun, à peine d’interdiction et de mille livres d’amende.
« Fait au Conseil privé du roi, le 14 février mil sept cent sept. »
Cet arrêt eut pour conséquence ce que produisent toujours, en pareille matière, les interdictions ab irato du pouvoir, le débit plus grand du livre défendu, et sa réimpression. C’est ce que constate un autre arrêt du même Conseil privé, en date du 19 mars, qui rappelle le précédent, commet M. d’Argenson à la recherche du livre, et déclare qu’il s’imprime à Paris.16
En même temps, Boisguillebert était poursuivi à Rouen pour la publication du Factum de la France, et son livre proscrit par un arrêt, antérieur de quelques jours au second de ceux rendus contre la Dîme royale.
Il faut maintenant laisser le duc de Saint-Simon raconter les causes et les effets de ce grand courroux royal et ministériel.
« Vauban, dit le duc, abolissait toutes sortes d’impôts, auxquels il en substituait un unique, divisé en deux branches, auxquelles il donnait le nom de dîme royale, l’une sur les terres, par un dixième de leur produit, l’autre, légère par estimation, sur le commerce et l’industrie, qu’il estimait devoir être encouragés l’un et l’autre, bien loin d’être accablés. Il prescrivait des règles très simples, très sages et très faciles pour la levée et la perception de ces deux droits, suivant la valeur de chaque terre, et par rapport au nombre d’hommes sur lequel on peut compter avec le plus d’exactitude dans l’étendue du royaume. Il ajouta la comparaison de la répartition en usage avec celle qu’il proposait, les inconvénients de l’une et de l’autre, et réciproquement leurs avantages, et conclut par des preuves, en faveur de la sienne, d’une netteté et d’une évidence à ne s’y pouvoir refuser. Aussi cet ouvrage reçut-il les applaudissements publics et l’approbation des personnes les plus capables de ces calculs et de ces comparaisons, et les plus sensées en toutes ces matières, qui en admirèrent la profondeur, la justesse, l’exactitude et la clarté.
« Mais ce livre avait un grand défaut. Il donnait, à la vérité, au roi plus qu’il ne tirait par les voies jusqu’alors pratiquées ; il sauvait aussi les peuples des ruines et des vexations, et les enrichissaient en leur laissant tout ce qui n’entrait point dans les coffres du roi, à peu de chose près ; mais il ruinait une armée de financiers, de commis, d’employés de toute espèce ; il les réduisait à chercher à vivre à leurs dépens, et non plus à ceux du public, et il sapait par les fondements ces fortunes immenses qu’on voit naître en si peu de temps. C’était déjà de quoi échouer.
« Mais le crime fut qu’avec cette nouvelle pratique tombait l’autorité du contrôleur général, sa faveur, sa fortune, sa toute-puissance, et par proportion celle des intendants des provinces, de leurs secrétaires, de leurs commis, de leurs protégés, qui ne pouvaient plus faire valoir leur capacité et leur industrie, leurs lumières et leur crédit, et qui, de plus, tombaient du même coup dans l’impuissance de faire du bien ou du mal à personne ... La robe entière en rugit pour son intérêt. Elle est la modératrice des impôts par les places qui en regardent toutes les sortes d’administrations, et qui lui sont affectées privativement à tous autres, et elle se le croit en corps avec plus d’éclat par la nécessité de l’enregistrement des édits bursaux.
« ... Ce ne fut donc pas merveille si le roi, prévenu et investi de la sorte, reçut très mal le maréchal de Vauban lorsqu’il lui présenta son livre, qui s’adressait à lui dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres, à qui il le présenta, lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le roi y avait mise, jusqu’à croire se couronner de lauriers en l’élevant, tout disparut à l’instant à ses yeux. Il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du public, et qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne. Il s’en expliqua de la sorte sans ménagement.
« ... Le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tout fait. Il mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consumé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre...
« Boisguillebert, que cet événement aurait dû rendre sage, ne peut se contenir. Une des choses que Chamillart lui avait le plus fortement objectées était la difficulté de faire des changements au milieu d’une forte guerre. Il publia donc un livre fort court,17 par lequel il démontra que M. de Sully, convaincu du désordre des finances que Henri IV lui avait commises, en avait changé tout l’ordre au milieu d’une guerre, autant ou plus fâcheuse que celle dans laquelle on se trouvait engagé, et en était venu à bout avec un grand succès ; puis, s’échappant sur la fausseté de cette excuse par une tirade de : Faut-il attendre la paix pour...,18 il étala avec tant de feu et d’évidence un si grand nombre d’abus, sous lesquels il était impossible de ne succomber pas, qu’il acheva d’outrer les ministres déjà si piqués de la comparaison du duc de Sully, et si impatients d’entendre renouveler le nom d’un grand seigneur, qui en a plus su en finances que toute la robe et la plume. La vengeance ne tarda pas : Boisguillebert fut exilé au fond de l’Auvergne.19 »
On doit convenir qu’en présence, d’abord, du témoignage positif de Saint-Simon, juge souvent passionné, mais d’une probité trop sévère pour charger à plaisir d’imputations fausses la mémoire de Louis XIV ; en présence, surtout, des arrêts du Conseil du 14 février, du 19 mars, et de la mort du maréchal, arrivée le 30 du même mois, il est impossible de ne pas croire à la disgrâce de cet homme de bien, et très rationnel d’admettre qu’elle soit au nombre des causes qui ont abrégé sa vie. Les admirateurs du grand roi ont voulu le justifier sous ce double rapport ; mais de vagues dénégations peuvent-elles prévaloir contre le concours des circonstances qui précèdent, si l’on songe que l’insensibilité personnelle du monarque, même en dehors des affaires d’État, est un fait acquis à l’histoire, et que Vauban était coupable, au premier chef, du crime qui n’avait pas été pardonné à Racine et à Fénelon ?20
L’analyse faite par l’impitoyable duc de l’œuvre de Vauban n’est pas d’une exactitude aussi rigoureuse que le tableau qu’il a tracé de l’effet moral produit par le livre sur les contemporains. Quelque hardi que fût le projet de la Dîme, il n’abolissait pas tous les impôts existants, et ne consistait :
1° qu’à remplacer la multitude des taxes, arbitraires et vexatoires, comprises sous les dénominations de taille, d’aides et de douanes provinciales, par une contribution unique du dixième au maximum du revenu en nature de toutes les terres, et du revenu en argent de tous les autres biens, tels que maisons, usines, rentes sur particuliers ou sur l’État, gages, pensions, traitements, salaires, profits d’offices et profits industriels ;
2° qu’à rendre général dans sa quotité et uniforme dans sa perception, pour toutes les provinces et pour toutes les classes de citoyens, l’impôt sur le sel, dont le prix était abaissé à 18 livres (minimum), et à 30 livres (maximum) le minot.21 Du reste, nulle innovation n’était apportée aux autres taxes indirectes correspondant aujourd’hui à nos droits d’enregistrement et de domaine, de postes et de douanes extérieures, si ce n’est la réforme de certains abus qui ne tenaient pas essentiellement à la nature de ces impositions.
Du temps de Vauban, le projet était bon et très praticable. Ajoutons que le maréchal, qui n’était rien moins qu’un esprit chimérique, accumulait les preuves les plus positives sous ce double rapport.
Il était bon, d’abord, parce qu’il était juste, et que tout revenu existant dans l’État doit contribuer aux charges publiques ; ensuite parce qu’en simplifiant l’impôt, il diminuait les frais de perception, et renvoyait à gagner leur vie par le travail des milliers d’individus qui, non seulement ne subsistaient que du travail du peuple, mais avaient encore mission de gêner, et souvent même d’interdire ce travail.
Il était praticable, car l’impôt foncier, levé en nature sur les terres, ne différait en rien de la dîme ecclésiastique, qui rapportait 133 millions au clergé,22 et se percevait sans embarras et sans réclamation. L’État, dans la pensée de Vauban, devait suivre la méthode que pratiquait le clergé, c’est-à-dire non pas récolter des produits en nature, mais affermer la dîme comme il affermait presque tous les autres impôts. Il ne s’agissait d’ailleurs, selon que la dîme se serait jouée, pour nous servir des expressions de ce grand homme, entre la 20e et la 10e gerbe, que de recouvrer par ce moyen une somme de 60 à 120 millions ; quant au reste de son système, ou il ne changeait rien à l’ordre de choses établi, ou il n’y faisait que des modifications qui ne présentaient dans la pratique aucune difficulté. La plus grande de toutes était celle dont parle Saint-Simon, et que Vauban lui-même avait bien prévue, à savoir les criailleries de l’ignorance et la révolte de l’égoïsme. On voit, en le lisant, qu’il ne comptait guère sur la cour pour appuyer la cause qu’il défendait, et qu’il savait bien que son bâton de maréchal « n’imposerait pas beaucoup à ces armées de traitants et de sous-traitants qui, après mille friponneries punissables, marchaient la tête levée dans Paris, avec autant d’orgueil que si elles eussent sauvé l’État.23 »
Aujourd’hui, le livre de ce grand citoyen présente encore aux méditations des hommes du pouvoir une foule de vérités morales, économiques et financières qui, pour la plupart, demeurent méconnues ou inappliquées. Il est douteux, cependant, qu’elles leur profitent plus qu’aux ministres de Louis XIV ; Dieu mène le monde par d’autres voies.
La Dîme royale enseigne, en effet, d’une manière plus ou moins explicite :
Que le souverain doit protection égale à tous ses sujets ;
Que le travail est le principe de toute richesse, et l’agriculture le travail par excellence
Qu’on doit toujours se tenir plutôt en deçà qu’au delà des limites que la raison commande d’assigner à l’impôt, pensée que Montesquieu a reproduite dans son Esprit des Lois24 ;
Que l’impôt doit frapper, avec une égalité proportionnelle sérieuse, les revenus de toute nature qui existent dans l’État ;
Qu’il faut en simplifier les éléments pour réduire les frais de perception au taux le plus bas possible ;
Que les taxes indirectes nuisent à l’entretien du peuple, au commerce et à la consommation ;
Que les affaires extraordinaires, c’est-à-dire les emprunts, quelles qu’en soient la nature et la forme, ont pour conséquence d’enrichir les traitants et de ruiner les nations, doctrine professée par Colbert,25 et adoptée après lui par les plus grands maîtres de la science économique, tels que J.-B. Say et Ricardo ;
Que le luxe est défavorable à la production ;
Que la liberté de l’industrie et du commerce est un bien, et que toutes les entraves qu’on y apporte sont un grand mal ;
Qu’il est insensé de pousser à l’accroissement des classes improductives de la société ;
Enfin, que le menu peuple, qu’on accable et qu’on méprise, est le véritable soutien de l’État.





























