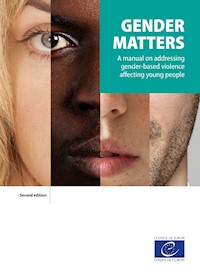Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conseil de l'Europe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La violence fondée sur le genre va à l’encontre des valeurs essentielles des droits humains sur lesquelles est fondé le Conseil de l’Europe et auxquelles adhèrent ses États membres.
La violence fondée sur le genre désigne toute forme d’atteinte portée à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réels ou perçus. La violence fondée sur le genre peut être sexuelle, physique, verbale, psychologique (émotionnelle) ou socio-économique et peut revêtir de multiples formes – de la violence verbale et du discours de haine sur internet au viol ou au meurtre. Les statistiques montrent que la violence fondée sur le genre touche les femmes de manière disproportionnée.
La violence fondée sur le genre va à l’encontre des valeurs essentielles des droits humains sur lesquelles est fondé le Conseil de l’Europe et auxquelles adhèrent ses États membres. Elle pose problème dans tous les États membres et touche des millions de femmes et d’hommes, de jeunes et d’enfants, quels que soient leur statut social, leur milieu culturel, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
La prévention, le traitement et la lutte contre la violence fondée sur le genre font partie intégrante de l’éducation aux droits humains, du travail de jeunesse et des activités d’apprentissage non formel qui aident les jeunes à acquérir leur autonomie en tant que citoyens actifs, conscients des droits fondamentaux de chacun. Les questions abordées dans ce cadre concernent toutes directement les jeunes, leur vie et le monde dans lequel ils vivent.
Questions de genre est un manuel qui explique comment aborder avec les jeunes le problème de la violence fondée sur le genre. Il donne un éclairage sur le genre et la violence fondée sur le genre, fournit des informations de fond sur les principaux aspects sociaux, politiques et juridiques, et propose notamment des activités éducatives et des méthodes permettant d’organiser des activités d’éducation et de formation avec les jeunes.
Questions de genre devrait être utilisé comme un outil pratique pour aider les jeunes à prendre davantage conscience de leurs propres actions et de celles des autres. Le manuel permet de mieux comprendre comment se protéger et comment soutenir ceux qui ont été victimes de violences dans leur vie. Éradiquer la violence fondée sur le genre ne représente qu’une étape vers la dignité pour tous, mais il est urgent de la franchir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
QUESTIONS DE GENRE
Manuel pour aborder la violence
fondée sur le genre affectant les jeunes
Deuxième édition – entièrement révisée et mise à jour
Auteurs
ANCA-RUXANDRA PANDEA, DARIUSZ GRZEMNY, ELLIE KEEN
Direction éditoriale
RUI GOMES
Contributeurs et auteurs de la première édition
ANNETTE SCHNEIDER, DENNIS VAN DERVEUR,
GORAN BULDIOSKI, KAROLINA VRETHEM,
GAVAN TITLEY, GYÖRGYI TÓTH, YAEL OHANA
Conseil de l’Europe, 2019
Remerciements
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué à cette édition du manuel, et en particulier :
• CÉCILE GREBOVAL et ses collègues de la Division pour l’Égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe
• ALICE BARBIERI, rapporteure sur l’Egalité de genre du Conseil mixte pour la jeunesse
• EMIE VALIQUETTE, ENRICO ELEFANTE, FABRIZIO PROVENZANO, KAAN SEN, VINCENT SCANLAN, stagiaires au Centre européen de la jeunesse, NATHALIE GUITER and JOANNE HUNTING pour leurs conseils et attention.
Nous nous sommes efforcés autant que possible de citer les sources des textes et les auteurs des activités que nous vous présentons dans ce manuel. Nous vous prions de bien vouloir excuser toute omission éventuelle, à laquelle nous nous efforcerons de remédier.
Sommaire
Cliquez ici pour consulter la table des matières complète, ou allez directement sur l’option « Table des matières » de votre lecteur numérique.
Poster créé par les « No Hate Ninjas » (Portugal), pour la campagne jeunesse « Mouvement contre le discours de Haine »
PRÉFACE L’égalité de genre est importante
Snežana Samardžić-Marković
Directrice Générale de la Démocratie,
Conseil de l’Europe
La violence fondée sur le genre est l’une des formes d’atteinte aux droits humains les plus répandues ; elle est universellement considérée comme attentatoire à la dignité humaine. Cette violence pose problème dans l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe et touche des millions de femmes, d’hommes et d’enfants, quels que soient leur statut social, leur milieu culturel, leur religion, leur état civil, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
La violence fondée sur le genre va à l’encontre des valeurs essentielles des droits humains sur lesquelles est fondé le Conseil de l’Europe et auxquelles adhèrent ses États membres. Ainsi que l’affirme la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, il ne peut pas y avoir de véritable égalité entre les femmes et les hommes si les femmes subissent massivement des violences fondées sur le genre et que les organismes et institutions d’État ferment les yeux. Il incombe aux autorités nationales de prendre des mesures pour prévenir cette violence, protéger ses victimes et punir ses auteurs.
Il est certes indispensable d’opposer des moyens judiciaires à ces formes de violence, mais ils ne sauraient suffire à éradiquer le phénomène ni même à réduire le nombre de cas. De même, on ne peut ni imposer ni se contenter de promouvoir les valeurs liées aux droits humains, à la non-violence et à l’égalité entre les femmes et les hommes : elles doivent être concrètement admises et respectées, ce qui passe par l’éducation, l’information et la sensibilisation. Seule la combinaison de plusieurs initiatives permettra d’éviter la reproduction, de génération en génération, des modèles porteurs d’oppression et d’humiliation.
Le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe prend ce problème au sérieux car les jeunes sont particulièrement vulnérables aux formes de violence fondée sur le genre. Ils doivent aussi être les acteurs des changements requis pour éradiquer ce fléau. Le programme Jeunesse pour la démocratie lutte systématiquement contre toutes les formes de discrimination et promeut l’égalité de genre selon une approche multidimensionnelle. Une étude de l’impact selon le genre a conclu qu’il existe une adéquation entre les objectifs du programme et la promotion de l’égalité de genre. Le programme vise à promouvoir la diversité et à favoriser l’inclusion des minorités et des personnes vulnérables ; l’égalité de genre figure parmi ses priorités et ses activités contrastent avec les modèles d’inégalité de genre observés actuellement dans les États membres du Conseil de l’Europe. En poursuivant ces objectifs, le programme apporte aussi des réponses aux discours discriminatoires, transphobes et homophobes qui ont cours.
Les travaux du secteur jeunesse du Conseil de l’Europe s’appuient sur l’action de ses multiplicateurs. Les jeunes et les activités de jeunesse jouent donc un rôle primordial dans la sensibilisation du reste de la société à la nécessité de prévenir et de combattre la violence fondée sur le genre. Questions de genre a été publié initialement pour soutenir ces travaux. Ce manuel s’inspire des approches pédagogiques de Repères, le manuel pour la pratique de l’éducation aux droits humains avec les jeunes, qui permet à des millions de jeunes de toute l’Europe de bénéficier d’une éducation aux droits humains et par les droits humains.
Questions de genre est un manuel qui explique comment aborder avec les jeunes le problème de la violence fondée sur le genre. Il s’agit d’une introduction aux questions concernant le genre et la violence fondée sur le genre, destinée aux personnes travaillant avec des jeunes, qui propose une réflexion sur ces questions, donne des informations de fond sur les principaux problèmes actuels et présente notamment des méthodes et des ressources pour les activités d’éducation et de formation avec les jeunes.
Nous espérons que les travailleurs de jeunesse et les militants trouveront dans ce manuel l’inspiration et les ressources nécessaires pour s’opposer aux coups portés à l’égalité et à la dignité pour tous et pour contrer les discours suprémacistes ou sexistes, ou faisant l’apologie de la haine et de la violence.
L’égalité de genre est importante. La violence fondée sur le genre n’a pas d’avenir.
Introduction
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans cette deuxième édition de Questions de genre !
La première édition de Questions de genre a été publiée en 2007, dans le cadre du programme Jeunesse d’éducation aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Elle se situait dans le prolongement de deux publications phares, et notamment Repères - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits humains avec les jeunes (révisé en 2015) et Repères Juniors - Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les enfants, qui toutes deux font référence aux questions de genre, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la violence fondée sur le genre.
Depuis sa première parution, Questions de genre a été utilisé en guise de ressource pédagogique dans le cadre de nombreuses activités éducatives menées par le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe – par exemple, dans des stages de formation, des séminaires et des sessions d’étude organisés en coopération avec des organisations internationales de jeunesse aux Centres européens de la Jeunesse à Strasbourg et Budapest. Questions de genre a également été exploité par des groupes de jeunes et des organisations de jeunesse dans toute l’Europe pour accompagner le travail qu’ils conduisent contre la violence fondée sur le genre dont sont victimes les jeunes aujourd’hui.
La violence fondée sur le genre sape les valeurs fondamentales sur lesquelles repose le Conseil de l’Europe, notamment la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. Dans les années qui ont suivi la première édition de Questions de genre, le Conseil de l’Europe a introduit un certain nombre d’instruments juridiques et de politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de protection contre la violence fondée sur le genre, en particulier :
la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le traité international le plus ambitieux visant à éradiquer la violence faite aux femmes. Cette Convention est novatrice, en ce qu’elle demande aux États d’ériger en infraction pénale les diverses formes de violence à l’égard des femmes.
la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, également connue sous le nom de Convention de Lanzarote. Ce traité exige que tous les types d’infractions à caractère sexuel commises contre les enfants soient criminalisés.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2008, qui renforce les protections garanties aux victimes de la traite.
la Recommandation CM/Rec (2010) 5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Cet instrument est le premier au monde à traiter spécifiquement de l’une des formes de discrimination les plus tenaces et complexes.
Ces nouveaux traités et politiques, ainsi que d’autres développements, ont rendu particulièrement impérieuse la nécessité de réviser et de mettre à jour Questions de genre.
À propos de ce manuel
Questions de genre a pour sujet la violence fondée sur le genre affectant les jeunes. Cette deuxième édition partage les mêmes objectifs qui sous-tendaient la première. Pour les personnes qui travaillent avec les jeunes, elle constitue une précieuse entrée en matière sur le genre et la violence fondée sur le genre, en proposant des réflexions sur ces questions. Elle contient par ailleurs une genèse des principales problématiques sociales, politiques et juridiques, ainsi qu’un ensemble de méthodes et de ressources exploitables pour les activités d’éducation et de formation à mener avec les jeunes.
Ce manuel ne prétend pas à l’exhaustivité ; il ne rassemble donc pas toutes les théories et idées en matière de genre ou d’égalité entre les femmes et les hommes. Il ne traite pas non plus de tous les aspects de la violence fondée sur le genre ; il se concentre sur les questions et préoccupations relatives à cette forme de violence qui sont susceptibles de présenter une pertinence pour la vie des jeunes. Mais ces questions et préoccupations peuvent varier selon le contexte social et politique. Aussi, afin de répondre aux besoins concrets des jeunes dans une communauté, une région ou un pays donné, certains matériels et activités devront peut-être être adaptés.
Bien que les auteur.e.s aient été soucieux.ses d’éviter toute approche exclusive et de traiter d’une grande variété de sujets, il leur a fallu faire des choix quant aux sujets à privilégier. De tels choix sont inévitables dans le processus de production d’une publication internationale dont l’objectif premier est d’ordre pratique.
Qu’est-ce qui a changé ?
Le manuel a été substantiellement réécrit compte tenu des retours des utilisateur. rice.s et des changements législatifs et politiques intervenus, en particulier au niveau du Conseil de l’Europe.
Sa structure a été modifiée :
Le manuel comprend toujours quatre chapitres, mais ceux-ci ont été réorganisés. Les utilisateur.rice.s y retrouveront un chapitre théorique traitant des questions de genre, de la violence fondée sur le genre et des instruments relatifs aux droits humains (chapitre 1), ainsi qu’une série d’activités (chapitre 2). Cependant, la lutte contre la violence fondée sur le genre, qui faisait auparavant partie d’un chapitre plus vaste, est désormais un chapitre à part entière. Le manuel propose par ailleurs un nouveau chapitre, « Thèmes en relation avec le genre et la violence fondée sur le genre », où les lecteur.rice.s pourront trouver des informations sur différents sujets qui peuvent être utiles pour explorer des questions comme le féminisme, l’intersectionnalité ou la sexualité. Nous y avons aussi ajouté un glossaire des termes liés au genre et à la violence fondée sur le genre, qui faisait défaut dans la première édition. La structure du manuel est dorénavant conforme à celle des autres ressources pédagogiques publiées par le Service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe.
Le langage a été simplifié :
Parler du genre peut être très délicat et, souvent, impliquer l’emploi de termes ou l’évocation de théories complexes qui peuvent être difficiles à comprendre pour les jeunes – alors que les détails ne sont pas toujours d’une grande utilité. Afin de conférer au manuel plus de clarté et une meilleure lisibilité, dans l’intérêt de ce public, nous avons essayé d’utiliser un langage plus convivial, sans toutefois tomber dans une simplification excessive du fond.
Le langage est globalement plus inclusif :
Dans l’ensemble du manuel, nous avons essayé d’utiliser un langage qui tienne compte de la dimension de genre et d’éviter le piège du système binaire. Toutefois, cela n’a pas toujours été possible, par exemple dans les parties du manuel consacrées aux instruments juridiques qui, parfois, utilisent un langage moins sensible à la dimension de genre. Par ailleurs, pour ce qui est des activités (section 5, chapitre 2), nous avons décidé de privilégier leur objectif pratique et donc ne pas recourir à l’écriture inclusive afin d’éviter des présentations trop longues et d’optimiser ainsi leur lisibilité et leur bonne compréhension.
Certaines activités ont été ajoutées tandis que d’autres ont été retirées
Après avoir passé en revue toutes les activités, il est apparu que certaines étaient répétitives ; elles ont alors été supprimées ou fusionnées en une seule activité. Le chapitre 2 comporte de nouvelles activités qui tiennent compte des nouveaux instruments juridiques et traitent de sujets absents de la première version. Certaines des activités ont été adaptées de Repères ou de Connexions. Les descriptions des activités ont également été modifiées pour mieux refléter le style utilisé dans d’autres ressources éducatives du Service de la Jeunesse, telles que Repères.
Questions de genre fournit des informations, des idées et des ressources pour enrichir les activités éducatives et de jeunesse qui traitent du genre et de la violence fondée sur le genre, et replace ces questions dans le cadre de l’éducation aux droits humains.
Ce manuel ne présente pas spécifiquement de début ni de fin. Pour vous permettre de choisir les sections qui vous intéressent, nous vous recommandons donc vivement de le feuilleter intégralement pour en avoir une vision globale. Ensuite, lisez les parties théoriques en rapport avec les questions que vous voulez traiter avec les jeunes. Travailler sur le thème de la violence fondée sur le genre peut s’avérer difficile. Du tact et des compétences spécifiques vont être nécessaires pour être en mesure de traiter les questions éthiques qui risquent de se poser.
Questions de genre s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent explorer les sujets liés au genre et à la violence fondée sur le genre par le biais de l’éducation aux droits humains. Ce manuel ne fournit pas toutes les réponses ; il pourrait même nourrir de nouvelles interrogations ! L’idée est de l’utiliser à la manière d’une ressource pour guider les jeunes dans le monde des droits humains, les aider à prendre davantage conscience de leurs propres actions et de celles des autres et à mieux comprendre comment se préserver et soutenir celles et ceux qui ont connu la violence dans leur vie.
A propos de langage inclusif
Dans l’ensemble du manuel, nous avons essayé d’utiliser un langage qui tienne compte de la dimension de genre et d’éviter le piège du système binaire. Toutefois, cela n’a pas toujours été possible, par exemple dans les parties du manuel consacrées aux instruments juridiques qui, parfois, utilisent un langage moins sensible à la dimension de genre. Par ailleurs, pour ce qui est des activités (section 5, chapitre 2), nous avons décidé de privilégier leur objectif pratique et donc ne pas recourir à l’écriture inclusive afin d’éviter des présentations trop longues et d’optimiser ainsi leur lisibilité et leur bonne compréhension.
CHAPITRE 1 Identité de genre, violence fondée sur le genre et droits humains
Identité de genre, violence fondée sur le genre et droits humains
L’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif fondamental pour toute société fondée sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Cette égalité intervient dans presque tous les aspects des interactions sociales et de la politique publique, y compris la politique de jeunesse et le travail de jeunesse. Les problématiques liées à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la violence fondée sur le genre affectent chacun.e d’entre nous, directement et de façon intime.
Cependant, discuter du genre et de la violence fondée sur le genre peut être délicat, car vont alors être évoqués des concepts et des termes qui ne sont pas toujours clairs, qui peuvent évoluer au fil du temps et qui recoupent différentes disciplines comme la psychologie, la sociologie, la culture, la médecine, le droit, l’éducation, l’activisme ou la politique.
L’idée de départ est que la violence fondée sur le genre est une violation des droits humains et qu’elle affecte non seulement les personnes qui en sont directement victimes, mais aussi l’ensemble de la société.
Selon les données fournies par l’Initiative Spotlight des Nations Unies et de l’Union européenne1 :
De plus :
1612 personnes transgenres ont été tuées dans 62 pays entre 2008 et 20142 ;
près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête de l’UE sur les personnes LGBT ont déclaré avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement en raison de leur orientation sexuellen3.
Ces statistiques révèlent en partie l’ampleur de ce phénomène. Mais il est important de noter que la plupart des cas de violence fondée sur le genre continuent de ne pas faire l’objet de signalement. La lutte contre cette forme de violence requiert l’active participation des autorités de l’État, des institutions, des ONG et de l’ensemble des membres de la société. S’attaquer au problème est donc une tâche clé pour le travail de jeunesse.
1. Qu’est-ce que la violence fondée sur le genre et pourquoi est-elle un problème ?
Les termes « violence fondée sur le genre » et « violence à l’égard des femmes » sont souvent utilisés de manière interchangeable, car la plupart des violences faites aux femmes (par des hommes) ont des motivations sexistes, et parce que la violence fondée sur le genre touche les femmes de manière disproportionnée. La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes définit la violence à l’égard des femmes en ces termes :
tous actes de violence dirigés contre des femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée4.
Dans des documents juridiques plus récents, on trouve des exemples de fusion de ces deux termes, et le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » est utilisé. Par exemple, dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), l’article 3 propose la définition ci-après :
Le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée5.
De telles définitions s’appliquent dans les cas où le genre est le fondement de la violence exercée à l’encontre d’une personne. Cependant, le genre ne se limite pas au fait d’être un homme ou une femme : une personne peut naître avec des caractéristiques sexuelles féminines, mais s’identifier comme étant un homme, ou un homme et une femme en même temps, ou parfois ni un homme ni une femme. Les personnes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et autres personnes qui ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle ou aux traditionnelles catégories de genre, dites binaires) souffrent également de violence fondée sur leur orientation sexuelle réelle ou perçue et/ou leur identité de genre. C’est pourquoi la violence à l’égard de ces personnes relève de la violence fondée sur le genre. En outre, les hommes peuvent également être victimes de violence fondée sur le genre : statistiquement, le nombre de ces cas est beaucoup plus faible, mais il ne faut pas le négliger pour autant.
En nous basant sur la définition de « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » tirée du rapport explicatif de la Convention d’Istanbul6, nous pouvons dire que :
la violence fondée sur le genre désigne tout type d’acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre, réels ou perçus.
La violence fondée sur le genre est basée sur un déséquilibre des pouvoirs et exercée dans l’intention d’humilier et de faire naître chez une personne ou un groupe de personnes un sentiment d’infériorité et/ou de subordination. Cette forme de violence est profondément enracinée dans les structures, normes et valeurs sociales et culturelles qui régissent la société, et est souvent entretenue par une culture de déni et de silence. Elle peut se produire dans les sphères privée comme publique et touche les femmes de manière disproportionnée.
La violence fondée sur le genre peut être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique (émotionnelle) ou socioéconomique, et prendre de nombreuses formes, depuis la violence verbale et le discours de haine sur internet jusqu’au viol ou au meurtre. Elle peut être perpétrée par n’importe qui : un conjoint / un.e partenaire actuel.le ou ancien.ne, un membre de la famille, un.e collègue de travail, des camarades de classe, des ami.e.s, une personne inconnue ou encore des personnes qui agissent au nom d’institutions culturelles, religieuses, étatiques ou intraétatiques. La violence fondée sur le genre, comme tout type de violence, est une question de rapports de force. Elle repose sur un sentiment de supériorité et la volonté d’affirmer cette supériorité dans la famille, à l’école, au travail, dans la communauté ou dans la société dans son ensemble.
Pourquoi la violence fondée sur le genre est-elle un problème ?
La violence fondée sur le genre est une violation des droits humains
Il s’agit d’une atteinte acharnée à la dignité humaine, qui prive les victimes de leurs droits humains. Le droit de ne pas être soumis à la violence est un droit fondamental de la personne ; la violence fondée sur le genre nuit à l’estime de soi et au sentiment d’avoir une quelconque valeur. Elle affecte non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale, et peut entraîner des comportements d’automutilation, l’isolement, la dépression, voire des tentatives de suicide.
La violence fondée sur genre menace l’intégrité physique et psychologique de la personne
Toute personne a le droit de se sentir protégée et en sécurité et, en l’absence d’un tel sentiment, sa capacité de fonctionner au sein de la famille, de la communauté et de la société risque d’être compromise, car la réalisation de soi et le développement personnel en sont affectés. La violence fondée sur le genre est un obstacle à la réalisation du bien-être de chaque personne et à son droit à l’épanouissement et au développement personnel.
La violence fondée sur genre est une forme de discrimination
La violence fondée sur le genre est profondément enracinée dans des stéréotypes et des préjugés dommageables à l’égard des femmes ou d’autres personnes qui ne s’intègrent pas dans des sociétés traditionnelles, binaires du point de vue genre ou hétéronormatives. C’est pourquoi cette violence peut avoir pour effet de mettre les femmes et d’autres personnes au ban de la société et de les faire se sentir inférieures ou impuissantes. Dans le cas d’hommes qui ne se conforment pas aux rôles de genre masculins dominants, la violence fondée sur le genre a une fonction de correction. Ainsi, la sévérité de la « punition » infligée à ces hommes qui ne répondent pas aux attentes traditionnelles (qu’ils soient gays, bisexuels ou hétérosexuels) est fonction du danger qu’est censée présenter leur différence pour les hypothèses de genre normalisées et dominantes. Leurs vies risqueraient de contredire l’idée qu’il existe des types de comportement et des rôles sociaux « naturels », tant pour les hommes que pour les femmes.
La violence fondée sur le genre est un obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes
L’égalité entre les femmes et les hommes est essentielle à la protection des droits humains, à la défense de la démocratie et à la préservation de l’État de droit. La violence fondée sur le genre contribue à cultiver une société hétéronormative et perpétue le pouvoir des hommes. L’égalité de genre, d’autre part, implique l’égalité des droits des personnes de tous les genres, ainsi qu’une visibilité et des chances égales pour l’autonomisation, la prise de responsabilités et la participation dans toutes les sphères de la vie publique et privée. Cette égalité implique également l’égalité des femmes et des hommes dans l’accès aux ressources et dans la distribution de ces ressources.
La violence fondée sur le genre n’est pas suffisamment signalée et ses auteur.e.s jouissent souvent de l’impunité
Certaines croyances répandues, du type « ce qui se passe à la maison devrait rester à la maison » ou « ce qui se passe dans la famille ne regarde personne », sont très puissantes. Cela rend difficile la dénonciation de la violence au sein de la famille et risque d’avoir une incidence sur la prestation de services d’aide et de soutien, exposant ainsi la victime de violence à des préjudices plus graves, voire mortels. De plus, la violence réduit très souvent au silence celles et ceux qui en sont victimes. En ne nous élevant pas contre la violence domestique, nous reproduisons les techniques utilisées par les auteur.e.s de violence. Dans un certain nombre de pays, la plupart des types et des formes de violence fondée sur le genre sont illégaux et punissables par la loi, mais il y a des pays qui accusent du retard à cet égard. La Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe demande d’ériger en infraction les différentes formes de violence fondée sur le genre.
La violence fondée sur le genre affecte chacun.e. d’entre nous
Les enfants élevés dans des familles où une femme est maltraitée sont également victimes de violences (parfois pas physiquement, mais toujours psychologiquement). Les enfants témoins de violences peuvent avoir l’impression qu’un tel comportement est justifié ou « normal » ; en d’autres termes, ils assimilent des normes violentes. Par ailleurs, le fait d’être élevés dans une culture de violence peut nuire à leur développement personnel et à leur capacité de fonctionner dans la société. La violence fondée sur le genre touche les membres de la famille, les ami.e.s et les collègues. Tout le monde peut être la cible de la violence fondée sur le genre.
La violence fondée sur le genre a un coût économique très lourd
La violence fondée sur le genre nécessite la mise à contribution de différents services – médicaux, psychologiques, policiers ou judiciaires – et entraîne la perte de ressources ou d’emploi pour les victimes. Elle met les individus en situation de sous-performance au travail et dans l’éducation, et a un effet négatif sur leur productivité. De nombreuses victimes de violence fondée sur le genre doivent quitter leur domicile et ont besoin d’un lieu où être accueillies, ce qui entraîne parfois leur itinérance. Des services d’hébergement doivent être mis à la disposition de ces personnes et, s’il existe des structures d’accueil pour les femmes maltraitées et leurs enfants dans de nombreux pays d’Europe (mais pas en nombre suffisant), le manque de foyers pour les personnes LGBT+ reste critique.
2. Quelles sont les causes de la violence fondée sur le genre ?
La violence fondée sur le genre, et en particulier la violence à l’égard des femmes, demeure l’une des manifestations les plus fortes des rapports de pouvoir inégaux entre les femmes et les hommes. L’auteur.e des violences en est la cause première ; en effet, il est très important de garder à l’esprit que la victime n’est jamais responsable des actes commis par son agresseur.euse.
Dans nos sociétés, la violence fondée sur le genre ne s’explique pas par un unique facteur. Une myriade de facteurs y contribue, et c’est l’interaction de tous ces facteurs qui en est à l’origine. On peut ainsi identifier quatre types de facteurs, et notamment d’ordre culturel, juridique, économique et politique.
Les facteurs culturels
Les conceptions patriarcales et sexistes confèrent une légitimation à la violence afin d’assurer la domination et la supériorité des hommes. Parmi les autres facteurs d’ordre culturel figurent : les stéréotypes et les préjugés fondés sur le genre, les attentes normatives à l’égard de la féminité et de la masculinité, la socialisation du genre, la perception de la famille comme une sphère privée placée sous l’autorité masculine, et une acceptation générale de la violence dans la sphère publique (par exemple, le harcèlement sexuel des femmes dans la rue), et/ou sa reconnaissance comme un moyen acceptable pour résoudre un conflit et s’affirmer.
Dans la tradition religieuse et historique, les châtiments corporels infligés aux femmes ont été approuvés en vertu du principe selon lequel l’homme avait droit d’autorité et de propriété sur la femme. Le concept de propriété, à son tour, légitime le contrôle de la sexualité des femmes qui, en vertu de nombreux codes juridiques, a été jugé essentiel pour assurer un héritage patrilinéaire.
Le concept de « l’honneur familial », en vigueur dans de nombreuses sociétés, intervient dans la sexualité des femmes. Dans ces sociétés, les normes traditionnelles autorisent de tuer des femmes soupçonnées de porter atteinte à l’honneur familial en se livrant à des rapports sexuels interdits ou en se mariant et en divorçant sans le consentement de la famille. Les normes relatives à la sexualité contribuent également à expliquer le nombre élevé de jeunes personnes LGBT+ sans abri, ainsi que la prévalence des crimes motivés par la haine à leur encontre, au motif qu’elles constituent une « menace » pour les normes sociales. Les mêmes normes régissant la sexualité peuvent contribuer à expliquer le viol collectif dont certaines femmes sont victimes.
Les facteurs juridiques
Dans de nombreuses sociétés, le fait d’être victime d’actes de violence fondée sur le genre est perçu comme une honte et un signe de faiblesse, et beaucoup femmes sont encore jugées coupables d’attirer la violence à leur égard par leur comportement. Cela explique en partie pourquoi le nombre de signalements et d’enquêtes tend à rester limité.
Jusqu’à récemment, dans certains pays, la loi établissait encore une distinction entre les espaces public et privé, ce qui rendait les femmes particulièrement vulnérables à la violence domestique. La Convention d’Istanbul garantit le droit de chacun de vivre à l’abri de la violence, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
Alors que la plupart des formes de violence fondée sur le genre sont criminalisées par la loi dans la plupart des pays européens, les pratiques des forces de l’ordre favorisent bien souvent les auteur.e.s. Cette situation contribue à expliquer le faible niveau de confiance dans les autorités publiques et le fait qu’une majorité de ces actes ne sont pas signalés.
La dépénalisation de l’homosexualité est encore très récente dans de nombreuses sociétés. Dans de nombreux États, des progrès ont été réalisés grâce à l’adoption du mariage pour tous. Mais de telles avancées ont parfois eu des répercussions négatives, par exemple en renforçant l’opinion de certain.e.s selon laquelle la famille traditionnelle repose sur l’union entre un homme et une femme, ou en amenant quelques pays à adopter des lois qui interdisent la « propagande homosexuelle ».
Les facteurs économiques
Le manque de ressources économiques place généralement les femmes et les personnes LGBT+ en situation de grande vulnérabilité à la violence. Dans cette situation s’installent des schémas de violence et de pauvreté, qui se perpétuent et réduisent fortement pour les victimes la possibilité de s’en sortir. Lorsque le chômage et la pauvreté touchent les hommes, certains peuvent être tentés d’affirmer leur masculinité par des actes de violence.
Les facteurs politiques
Compte tenu de leur sous-représentation au pouvoir et en politique, les femmes et les personnes LGBT+ ont moins de possibilités d’orienter le débat et d’influer sur les changements politiques, ou de favoriser des mesures pour combattre la violence fondée sur le genre et soutenir l’égalité. Dans certains contextes, l’importance de la violence fondée sur le genre est sous-estimée et la violence familiale ne bénéficie pas non plus de suffisamment de ressources et d’attention. Les mouvements des femmes et des personnes LGBT+ ont soulevé des questions et sensibilisé le public aux normes traditionnelles en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, dénonçant certains aspects de l’inégalité. Pour certain.e.s, cette menace au statu quo a été utilisée pour justifier des violences.
3. Les types de violence fondée sur le genre
La violence n’est souvent associée qu’à la violence physique, sans prise en compte des autres formes de violence, non physiques. C’est une question délicate ; dans ces conditions, toute classification selon des « types » est forcément inexacte. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique prévoit les types de violence ci-après :
la violence psychologique (art. 33) ;
le harcèlement (art. 34) ;
la violence physique (art. 35) ;
la violence sexuelle, y compris le viol (art. 36) ;
les mariages forcés (art. 37) ;
les mutilations génitales féminines (art. 38) ;
l’avortement et la stérilisation forcés (art. 39) ;
le harcèlement sexuel (art. 40) ;
l’aide ou la complicité et la tentative (dans la commission des infractions établies) (art. 41) ;
la justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur » (art. 42).
Prenant cette liste pour base dans cette publication, nous allons distinguer cinq types de violence corrélés :
la violence physique
la violence verbale (y compris le discours de haine)
la violence sexuelle
la violence psychologique
la violence socioéconomique.
Il existe deux autres catégories de violence que l’on peut trouver dans ce chapitre, la violence domestique et le harcèlement (sexuel), toutes deux pouvant être une combinaison des cinq types de violence susmentionnés. Dans la réalité, certaines de ces formes de violence, voire plusieurs, peuvent coexister, notamment dans les relations violentes. Toutes peuvent se manifester dans la sphère privée (famille et relations intimes) et dans la sphère publique (étranger.ère.s, ou encore organisations, institutions et États).
La violence physique
La violence physique inclut les actes suivants : battre, brûler, porter des coups de pied, donner des coups de poing, mordre, mutiler ou tuer, utiliser des objets ou des armes. Certaines classifications incluent dans la catégorie de la violence physique la traite des êtres humains et l’esclavage, étant donné qu’il y a une coercition initiale et que les personnes impliquées finissent souvent par devenir victimes de nouvelles violences du fait de leur situation. La violence physique est un acte avec pour intention ou conséquence la douleur et/ou une blessure physique. Comme dans toutes les formes de violence, l’objectif de l’auteur.e n’est pas – ou peut ne pas être – seulement de causer une souffrance physique, mais aussi de réduire la maîtrise de soi de l’autre. Avec la violence physique, la personne qui agresse envoie un message clair à la victime : « Je peux te faire subir des choses que tu ne veux pas endurer. » Cette violence est l’expression d’inégalités de pouvoir social, ou de la volonté de faire valoir des revendications particulières, parfois de façon répétée, par la coercition. La violence physique dans les relations intimes, souvent appelée « violence domestique », reste un phénomène largement répandu qui n’épargne aucun pays.
La violence physique dans la sphère privée touche largement les jeunes. Comme mentionné précédemment, pour un enfant, être témoin de la maltraitance d’un de ses parents par l’autre va avoir de graves conséquences psychologiques. Souvent, les enfants et les jeunes présents lors de tels actes sont aussi blessés, parfois par accident, parfois pour avoir tenté d’intervenir. Les jeunes hommes commettent parfois des infractions criminelles contre le parent violent (principalement le père), afin de protéger leur mère et leurs frères et sœurs, et les enfants se retrouvent souvent victimes d’un acte de vengeance de l’agresseur. En fait, de nombreuses mères ne quittent pas leurs partenaires violents pour une raison essentielle : parce qu’ils les menacent de blesser ou de tuer les enfants si elles le faisaient.
La violence physique n’épargne pas les relations intimes des jeunes. Le fait qu’il. elle.s ne vivent peut-être pas ensemble ajoute souvent à la difficulté d’en parler.
Les actes de violence fondée sur le genre commis dans la sphère publique sont souvent en lien avec les hypothèses et attentes concernant les rôles des hommes et des femmes. Il peut s’agir d’insultes, d’injures, de menaces ou d’attaques, et il est courant que des personnes LGBT+ ou perçues comme gays, lesbiennes ou « différentes » soient victimes de violences publiques. La violence dirigée contre les personnes LGBT+ peut être organisée (des groupes se rendant dans des lieux connus pour être fréquentés par les gays afin de les « tabasser ») ou spontanée (par exemple, à l’encontre d’une lesbienne qui se promène dans la rue, main dans la main avec son amie). Dans ce cas, les gestes de tendresse en public constituent un risque pour la sécurité, et les études prouvent que la majorité des personnes LGBT s’en abstiennent par crainte de violence. Généralement, cette forme de violence de rue fait assez peu l’objet de signalement.
La violence verbale et le discours motivé par la haine
Dans de nombreuses cultures, il existe des proverbes ou des expressions pour signifier que les mots sont inoffensifs, et une longue tradition nous enseigne à ignorer les attaques verbales. Mais, lorsque ces attaques deviennent régulières, systématiques et portées sur nos points sensibles7, il est juste de les considérer comme des violences verbales.
La violence verbale est une atteinte personnelle, comme les critiques (en privé ou en public), la moquerie, les insultes particulièrement blessantes, les reproches au sujet de personnes aimées, la menace d’autres formes de violence contre la victime ou une personne qui lui est chère. Parfois aussi, les violences verbales peuvent viser les antécédents de la victime, et notamment sa religion, sa culture, sa langue, l’orientation sexuelle (qu’on lui attribue), ou encore ses traditions. Conscient.e.s des points les plus sensibles de leur victime sur le plan émotionnel, les agresseur.euse.s s’en servent souvent de cible pour lui faire mal, l’humilier et la menacer.
Pour l’essentiel, la violence verbale subie par les femmes parce qu’elles sont des femmes est dite « sexiste » et fait partie des violences sexuelles. La violence verbale fondée sur le genre dans la sphère publique est largement liée aux rôles de genre : elle inclut les commentaires et les plaisanteries sur les femmes, ou présentant les femmes comme des objets sexuels (plaisanteries sur la disponibilité sexuelle, la prostitution, le viol, etc.). Beaucoup de brimades sont aussi basées sur la sexualité (perçue) des jeunes, et notamment des garçons. L’utilisation régulière et négative de mots tels « queer » et « pédé » est souvent traumatisante pour les personnes perçues comme gays et lesbiennes. C’est très probablement l’une des raisons pour lesquels beaucoup attendent la fin de leurs études secondaires pour révéler leur orientation sexuelle (faire leur « coming out »).
La violence verbale peut être classée dans la catégorie du discours de haine. Elle peut prendre diverses formes, mots, vidéos, mèmes ou images affichés sur les réseaux sociaux, ou véhiculer un message violent menaçant une personne ou un groupe de personnes à cause de certaines caractéristiques. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance définit le discours de haine comme suit :
(…) le fait de prôner, de promouvoir ou d’encourager, sous quelque forme que ce soit, le dénigrement, la haine ou la diffamation d’une personne ou d’un groupe de personnes, ainsi que le harcèlement, l’injure, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation et la menace envers une personne ou un groupe de personnes et la justification de tous les types précédents d’expression au motif de la « race »8, de la couleur, de l’origine familiale, nationale ou ethnique, de l’âge, du handicap, de la langue, de la religion ou des convictions, du sexe, du genre, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle et d’autres caractéristiques personnelles ou de statut.9
Le discours de haine fondée sur le genre – et notamment le sexe, le genre, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre – vise principalement les femmes (dans ce cas, on parle souvent de « discours de haine sexiste »10) et les personnes LGBT+, et sévit dans la sphère tant privée que publique. Cela inclut l’internet, qui relève de la sphère publique. Cependant, ce type de violence peut aussi être véhiculé par les courriels privés ou les messages envoyés à l’aide d’un logiciel de messagerie en ligne.
Le discours de haine fondée sur le genre peut prendre de nombreuses formes : blagues, propagation de rumeurs, menaces, calomnies, incitation à la violence ou à la haine. Il vise à humilier, déshumaniser et effrayer une personne ou un groupe de personnes. Comme n’importe quel autre type de violence, le discours de haine fondée sur le genre est généralement très destructeur : les personnes qui en sont victimes se sentent souvent impuissantes et démunies. Elles se sentent mal à l’aise, effrayées, perdent confiance en elles et, parfois, elles tentent même de se suicider. Il arrive que le discours de haine amène à des crimes de haine, autrement dit des crimes motivés par des préjugés visant une personne dont l’identité est différente de celle de l’auteur.e des violences. Les crimes motivés par la haine peuvent être de diverses natures : violence physique, destruction de biens, incendie criminel ou meurtre. Les victimes sont délibérément choisies en raison de certaines caractéristiques que, du point de vue de l’auteur.e des violences, elles sont censées posséder.
La violence psychologique
Toutes les formes de violence englobent un aspect psychologique, dans la mesure où leur principal objectif est de blesser l’intégrité ou la dignité de l’autre. Par ailleurs, il existe certaines formes de violence qui recourent à des méthodes inclassables dans d’autres catégories, qui sont ce que l’on appelle des violences psychologiques « pures », comme l’isolement ou l’internement, la rétention d’informations, la désinformation ou encore les menaces.
Dans la sphère privée, la violence psychologique englobe les comportements menaçants sans éléments de violence physique ou verbale, par exemple, les actes se référant à des actes de violence antérieurs, ou l’ignorance et la négligence intentionnelles d’une autre personne.
Dans la sphère publique, la mise à l’écart des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui n’agissent pas selon les rôles traditionnels de genre est un exemple courant de cette violence. Cette mise à l’écart est généralement pratiquée par les groupes de pairs, mais des adultes responsables, comme les enseignant.e.s et les coach sportifs, peuvent parfois s’en rendre coupables. En gros, cela consiste à exclure la victime de certaines activités de groupe. L’intimidation, comme dans la sphère privée, peut également être utilisée.
La violence sexuelle
Alors que de plus en plus d’informations étaient disponibles sur les véritables circonstances entourant la violence sexuelle, il est devenu évident que la violence sexuelle, comme d’autres formes de violence, constitue un abus de pouvoir. La violence sexuelle englobe : la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ; les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ; et le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers. Le viol conjugal et la tentative de viol constituent des violences sexuelles. Parmi les autres activités sexuelles contraintes, citons : le fait d’être contraint de regarder quelqu’un se masturber, de contraindre quelqu’un à se masturber devant autrui, de contraindre à des relations sexuelles non protégées et harceler sexuellement, les violences liées à la reproduction (comme la grossesse contrainte, l’avortement contraint et la stérilisation forcée) et les mutilations génitales féminines.
Certaines formes de violence sexuelle sont liées aux limites personnelles de la victime et sont plus typiques de la sphère privée. L’auteur.e franchit alors ces limites intentionnellement, par exemple, le viol par un compagnon de sortie, le fait de contraindre à certains types d’activités sexuelles, le retrait de l’attention sexuelle comme forme de punition, ou le fait de contraindre une autre / d’autre(s) personne(s) à regarder (et parfois à imiter) de la pornographie.
Toutes les formes de violence sexuelle se manifestent dans les sphères tant privée que publique. Mais il est à noter trois formes de violence sexuelle intervenant dans la sphère publique : le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et forme de torture, et la violence sexuelle infligée aux personnes (perçues) LGBT+ pour les « punir » de ne pas se conformer aux rôles de genre assignés.
La violence socioéconomique
Le dénuement socioéconomique peut rendre une victime plus vulnérable à d’autres formes de violence et peut même être la raison pour laquelle d’autres formes de violence sont infligées. Les données économiques mondiales montrent clairement que l’une des conséquences de la mondialisation est la féminisation de la pauvreté11 (rendant les femmes généralement plus vulnérables économiquement que les hommes), mais la vulnérabilité économique est un phénomène qui existe aussi au niveau personnel. Elle a été identifiée dans un grand nombre de relations violentes en tant que phénomène distinct, c’est pourquoi une catégorie spécifique lui a été réservée. Cependant, même lorsque la situation est inversée et qu’une femme a un statut économique plus élevé que l’homme, cela n’élimine pas nécessairement la menace de violence : des conflits sur le statut et l’émasculation peuvent survenir, particulièrement dans des relations déjà violentes.
Les formes les plus classiques de la violence socioéconomique englobent : priver la victime de ses revenus, lui interdire d’avoir un revenu propre (statut de « femme au foyer », travail non rémunéré dans l’entreprise familiale) ou l’empêcher de travailler au moyen de violences physiques ciblées.
La violence socioéconomique dans la sphère publique est à la fois la cause et l’effet d’une relation de pouvoir déséquilibrée entre les femmes et les hommes. Elle peut inclure le refus de l’accès à l’éducation ou à un emploi (également) rémunéré (surtout à des femmes), aux services, à certaines fonctions, au plaisir et à la jouissance des droits civiques, sociaux, économiques, culturels et politiques ; et, parfois pour les personnes LGBT+, l’imposition de sanctions pénales.
Certaines formes de violence socioéconomique fondée sur le genre contribuent à placer les femmes dans une situation de dépendance économique à l’égard de leur partenaire (bas salaires, allocations familiales très faibles, voire inexistantes, ou encore liées à l’impôt sur le revenu du partenaire masculin rémunéré). Cette dépendance offre alors à une personne qui a tendance à être violente dans ses relations la possibilité d’agir sans craindre de perdre son partenaire.
La violence domestique et la violence dans les relations intimes
La violence domestique, ou violence dans les relations intimes, est la violence fondée sur le genre la plus répandue. Elle nécessite également une attention particulière, car il s’agit d’un type de violence relationnelle, dont la dynamique est par conséquent très différente de celle des incidents violents qui se produisent entre des personnes qui ne se connaissent pas.
Le fait que la violence domestique ait longtemps été considérée comme une question privée et domestique a considérablement entravé la reconnaissance du phénomène comme une violation des droits humains. L’invisibilité du phénomène a été exacerbée par la croyance traditionnelle que le droit international des droits humains s’appliquait seulement aux relations entre l’individu et l’État (ou les États). Or, il est dorénavant reconnu que la responsabilité de l’État en vertu du droit international peut être engagée non seulement du fait de l’action de l’État, mais aussi de son inaction, lorsqu’un État ne protège pas ses citoyens contre la violence ou les abus (principe de la « diligence raisonnable »).
Selon la Convention d’Istanbul, « le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ». Même si la violence domestique concerne aussi souvent des relations homosexuelles qu’hétérosexuelles et que, dans certains cas, ce sont les femmes qui maltraitent leur partenaire masculin, la grande majorité de la violence domestique est perpétrée par des hommes à l’encontre des femmes. La violence domestique (viol, coups et blessures, maltraitance psychologique et physique) provoque au plan physique et mental de graves souffrances, des blessures et souvent le décès. Elle est infligée contre la volonté de la victime dans l’objectif de l’humilier, de l’intimider et de la contrôler. Très souvent, celle-ci est privée de tout recours : la police et les mécanismes d’application de la loi sont souvent insensibles voire hostiles aux questions de genre, et généralement absents dans ces situations12.
Une question revient souvent à propos de la violence domestique : « Pourquoi la victime ne part-elle pas ? » Il n’y a pas de réponse simple à cette question, car la violence domestique est un phénomène complexe qui implique souvent des formes physiques, psychologiques, émotionnelles et économiques de violence. Elle peut souvent induire le « syndrome de la femme battue » où, dans une relation violente, la femme commence à se sentir incapable de réagir, bonne à rien et impuissante, au point d’accepter la situation. Cependant, ce syndrome, outre le fait qu’il n’explique pas pourquoi certaines femmes tuent leur partenaire violent, détourne l’attention d’autres raisons pour lesquelles elles finissent par rester dans la relation violente. Ces raisons peuvent comprendre la dépendance financière à l’égard de l’agresseur, les contraintes sociales et l’absence de solutions de rechange, comme des foyers pour accueillir les victimes. La violence domestique implique souvent une victime isolée de sa famille et de ses ami.e.s et privée de ses biens personnels, des enfants manipulés, des menaces de représailles contre la victime, les enfants ou d’autres membres de la famille. Enfin, pour la victime, il est très difficile voire dangereux de quitter un partenaire violent quand pèsent les classiques pressions sociales du type « un père vaut mieux que pas de père du tout pour tes enfants ».
Une autre raison pour laquelle les personnes restent dans des relations de violence est le phénomène du « cycle de la violence »13.
Le comportement violent décrit par ce cycle, parfois instinctif parfois délibéré, vise à maintenir la victime dans la relation au moyen de promesses et de démentis. Le fonctionnement de base est le suivant : une explosion de violence, suivie de ce que l’on appelle une « lune de miel », pendant laquelle le comportement du.de la partenaire violent.e change soudain positivement. On parle de lune de miel, car la victime décrit souvent cette période comme très similaire au début de la relation. L’auteur.e des violences s’excuse généralement de son comportement, promet de changer et peut même faire des cadeaux. Mais cette période ne dure pas longtemps, son unique fonction étant de mettre un terme aux inquiétudes de la victime quant à l’avenir de la relation. La victime est elle-même habituellement partie prenante de ce processus, car personne n’aime se souvenir des mauvaises expériences ; elle se réjouit donc du changement de son partenaire et des promesses faites.
Avec l’apaisement des inquiétudes de la victime vient la restauration de l’ancienne structure de pouvoir. Les moteurs caractéristiques du phénomène vont alors de nouveau nourrir la tension, qui va exploser, libérant la violence du.de la partenaire. Au début de la relation, les incidents violents peuvent être espacés d’au moins six mois, voire un an, d’où la difficulté d’en identifier la nature cyclique. Les premiers incidents vont être de nature verbale, suivis d’actes de violence mineurs qui empêchent souvent la victime de prendre conscience que les réprimandes, la vaisselle cassée, les bousculades, les gifles et finalement les coups témoignent d’une escalade de la violence.
L’escalade ne se produit pas seulement en termes de gravité des incidents, mais aussi de leur fréquence. Finalement, la phase de la lune de miel peut disparaître totalement. Dans certaines relations violentes, elle est même complètement absente et peut être remplacée par la minimisation ou le déni de violence, notamment dans les groupes sociaux où la violence domestique et des rôles de genre rigides sont moins bien acceptés.
Dans les contextes où les rôles de genre sont plus rigides, l’auteur.e des violences a davantage la possibilité de nier sa responsabilité. La panoplie de rôles de genre que l’on nous apprend à endosser en tant que femme et homme comporte quantité de contradictions et d’exigences impossibles à satisfaire. Au même moment, une part du rôle de genre masculin, hégémonique, est de surveiller que femmes et enfants se conforment à leurs rôles et, si nécessaire, de les discipliner. Ces deux conditions se combinent pour offrir une justification banale au partenaire violent : il peut aisément trouver quelque chose à reprocher à sa femme pour justifier la violence commise et, ainsi, revendiquer le droit de lui infliger cette violence.
Le viol conjugal est une infraction pénale. Le viol commis par des personnes connues de la victime, en qui elle avait confiance, peut avoir des conséquences encore plus graves et durables que lorsque l’auteur.e est un.e étranger.ère. Néanmoins, le viol dans les relations intimes reste très difficile à établir.
Dans beaucoup de pays, les actes de maltraitance physique et affective, souvent accompagnés des violences sexuelles, sont perçus comme relevant du registre des actes ou crimes « passionnels », motivés par la jalousie ou un.e partenaire qui ne répond pas aux attentes. Une telle représentation est particulièrement courante dans les médias. Cependant, ce type de terminologie doit être évité lorsqu’on parle de formes de violence fondée sur le genre, car il perpétue l’idée d’impunité qui lui est associée et implique une responsabilité de la part de la victime. L’influence de l’alcool est souvent invoquée comme circonstance atténuante des actes de violence ou d’exploitation sexuelles, ignorant que ces mauvais traitements se répètent de façon systématique. Comme le fait observer Ronda Copelon, l’alcool rend certes violent, mais « beaucoup d’hommes s’alcoolisent sans pour autant battre leurs femmes… tandis que d’autres battent leurs femmes sans être ivres ». Dans la mesure où l’alcool favorise la violence masculine, il est un aspect important des efforts entrepris pour réduire la violence, mais il n’en est pas la cause14.
Harcèlement et harcèlement sexuel
« Puis-je embrasser mon.ma collègue au travail sans le lui demander, ou s’agit-il de harcèlement sexuel ? »
« Est-il acceptable de faire des commentaires au sujet du corps d’une femme ? »
En fait, quand le harcèlement commence-t-il ? Il est utile de noter, dès le départ, que toute forme de harcèlement est généralement humiliante et dégradante et qu’elle menace l’intégrité physique et mentale de la personne visée. La Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe définit le harcèlement sexuel comme suit :
(...) toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.15
La Directive 2002/73/EC de l’UE16 définit aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel. Le harcèlement, c’est « la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Quant au harcèlement sexuel, il s’agit de « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cette directive stipule que le harcèlement est une forme de discrimination et qu’il est illégal.
Les exemples de harcèlement sexuel verbal peuvent inclure : faire des commentaires sexuels sur le corps d’une personne, faire des remarques ou des insinuations de nature sexuelle, poser des questions sur les fantasmes, les préférences ou les antécédents sexuels, poser des questions personnelles sur la vie sociale ou sexuelle d’une personne, faire des commentaires sexuels sur ses vêtements, son anatomie ou son apparence, essayer à répétition de sortir avec une personne qui n’est pas intéressée, proférer des mensonges ou faire courir des rumeurs sur sa vie sexuelle ou ses préférences sexuelles.
Des exemples de harcèlement non verbal sont notamment : regarder une personne de haut en bas (« déshabiller du regard »), suivre ou traquer quelqu’un, faire des allusions sexuelles ou des gestes à connotation sexuelle avec les mains ou par des mouvements du corps, utiliser des expressions faciales comme cligner de l’œil, envoyer des baisers ou se lécher des lèvres.
Les cas de harcèlement physique comprennent : faire un massage dans la région du cou ou des épaules, toucher les vêtements, les cheveux ou le corps d’une autre personne, l’étreindre, l’embrasser, la caresser, la frictionner, la toucher ou se frotter sexuellement contre elle.
Le concept clé pour comprendre le harcèlement est que toute avance est importune. Il peut arriver qu’une personne accueille et accepte une remarque sexiste ou un commentaire sur son corps, mais cela dépend probablement de la situation et des circonstances particulières. Cependant, il est important de se rappeler que même si quelqu’un accepte - ou accueille - le comportement en question, celui-ci peut quand même être dégradant et humiliant. En outre, cette acceptation peut ne pas être entièrement volontaire : elle peut être le résultat de pressions souvent invisibles de la part du monde extérieur.
4. Explorer le genre et l’identité de genre
Le genre est présent dans toutes nos relations sociales. Lorsque nous interagissons, notre propre perception de nous-mêmes, de nos identités et libertés, droits et possibilités se heurte à la façon dont les autres nous voient et se comportent par rapport à nous. Mais on pourrait tout aussi bien affirmer que, dans le vrai sens du terme, la question du genre n’intervient pas dans nos relations sociales, parce que notre perception du genre est à ce point internalisée qu’elle nous paraît « normale » et « naturelle ».
S’intéresser aux questions de genre est important car, pour comprendre comment nous vivons ensemble, nous devons précisément nous interroger sur ce que nous ne remettons pas en question dans nos vies quotidiennes. Et cela inclut une part de notre identité : notre genre.