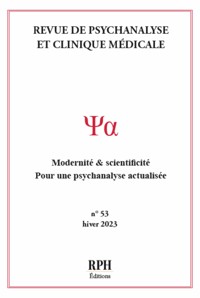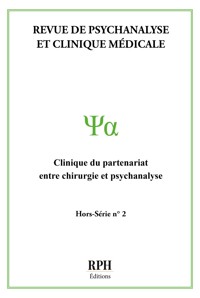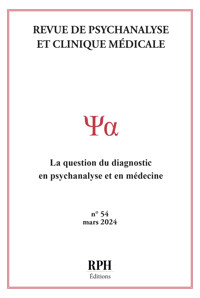
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
"La Revue de Psychanalyse et Clinique Médicale" est une publication semestrielle assurée par le RPH-École de psychanalyse. Elle rassemble les actes des colloques et journées d’étude organisés par le RPH, ainsi que des articles aux contenus variés : articles théoriques, articulations théorico-cliniques, études de cas clinique, articles de recherche.
Le 54e numéro de la revue aborde les questions soulevées au colloque du printemps 2024, La question du diagnostic en psychanalyse et en médecine. En médecine, le diagnostic est un prérequis pour définir le traitement du malade. En psychanalyse, la cure s’engage et avance grâce à la naissance, l’installation et le nourrissage du transfert. C’est au fil des associations libres que le clinicien pourra repérer ce qui signe le diagnostic, ce dernier est alors un indicateur de comment conduire la cure. Ici, le diagnostic s’entend comme diagnostic structurel à partir des structures freudiennes ; soit la névrose, la psychose et la perversion.
À l’heure où de plus en plus de patients consultent avec une demande de diagnostic à accrocher à leurs symptômes, la tentation est grande pour le praticien de vouloir y répondre. Pourtant, quelle fonction occupe le diagnostic en psychanalyse et en médecine ? Quel usage en est-il fait de nos jours ?
Ce numéro se propose d’explorer cet usage du diagnostic dans la pratique médicale et dans les pratiques médicale et psychanalytique pour en dégager les apports et les écueils. Les interventions et articles aborderont tant un point spécifique de la nosographie qu’une réflexion sur la mise en place possible d’une clinique du partenariat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
RPH - Éditions
ISBN : 978-2-38625-408-6
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Actes du XLVIe colloque duRPH
La question du diagnostic en psychanalyse et en médecine
Salle Vinci – Paris IIeSamedi 23 mars 2024
Table des matières
Ouverture
Jean-Baptiste Legouis, membre du RPH-École de psychanalyse, 8 rue de Belzunce, Paris Xe, 06.11.89.51.81, [email protected]
Je suis très heureux d’ouvrir ce XLVIe colloque du RPH dont le thème est le diagnostic, pris sur un versant interrogatif, puisqu’il est indiqué dans le titre de cette journée : « La question du diagnostic en psychanalyse et en médecine ». Avant d’aborder les différents aspects de notre problématique du jour, revenons à l’étymologie et l’histoire du mot diagnostic.
« DIAGNOSTIQUE adj. Est emprunté (1584) au grec tardif diagnôstikôs, « capable de discerner », spécialisé comme terme de médecine, et dérivé du verbe diagignôskein « discerner, reconnaître », composé de dia- (→ dia-) et de gignôskein « apprendre à connaître » et, à l’aoriste, « connaître, comprendre » (→ gnose), mot ayant des correspondants dans d’autres langues du groupe indoeuropéen, tels le latin noscere (→ connaître) et le vieux slave znajǫ, znati « reconnaître ».
♦ Introduit dans sa spécialisation médicale comme adjectif (signes diagnostiques) et comme nom (1669), le mot a partiellement subi la concurrence de son dérivé diagnostic (→ ci-dessous), plus usuel pour l’art d’identifier une maladie d’après ses symptômes. »1
Notez bien que dans cette définition le diagnostic est considéré comme un art, ce qui sera sans doute discuté dans la journée en ce qui concerne sa scientificité.
« ►diagnostic n. m. (1732) l’a emporté sur l’emploi substantivé du féminin la diagnostique en médecine. Par extension, il indique une conclusion prospective résultant de l’examen approfondi d’une situation critique (1899) ; ce sens s’est bien implanté en économie, psychologie, informatique. Le sens particulier de « symptôme », avec lequel il avait évincé le diagnostique, a vieilli. Le xixe s. a vu la formation de diagnostiquer v. tr. (1832) « prévoir par diagnostic », avec ses dérivés diagnostiqueur, euse. n. (1870), diagnostiquable ou diagnosticable adj. (1880-1884) et de diagnosticien n. m. (1886), dont le féminin en -ienne semble récent. Le xxe s. voit l’apparition de composés en -diagnostic précisant la technique de l’établissement du diagnostic : électrodiagnostic, cytodiagnostic, sérodiagnostic, radiodiagnostic. »2
Maintenant que nous avons regardé de plus près le sens du mot, voyons qui est concerné par le thème de notre journée. Dès que nous grattons un peu, nous voyons que les implications de notre question sont vastes. Il sera sans doute question des patients et de leur environnement, qu’il soit familial, amical ou professionnel. Nous parlerons sans doute des médecins généralistes et des médecins spécialistes, parmi lesquels les psychiatres ont une place particulière. Et, bien sûr, nous discuterons largement du rapport du psychanalyste au diagnostic.
Une façon de poser la question pourrait être celle-là : à qui le diagnostic est-il utile ? Pourquoi et pour en faire quoi ?
La première réponse qui vient à l’esprit et qui paraît la plus évidente est du côté de la médecine et du médecin. Comme il est écrit dans la plaquette de présentation du colloque, l’examen clinique et le diagnostic qui en découle sont indissociables d’une médecine qui, depuis Hippocrate, sort du giron religieux pour entrer dans la ronde des causalités biologiques. Ainsi le diagnostic associé à des symptômes renvoie à une causalité identifiable et, par voie de conséquence, à une voie thérapeutique possible.
Depuis Claude Bernard et la mise en place de la médecine expérimentale au milieu du XIXe siècle, la recherche de marqueurs biologiques est au cœur de l’établissement du diagnostic et du traitement qui en découlera. Les recherches biologiques ont amené à une connaissance de plus en plus approfondie des mécanismes à l’œuvre dans le fonctionnement des cellules, des tissus, des organes, des systèmes (nerveux ou digestif par exemple) et de l’organisme dans son ensemble. Les médecins spécialistes sont devenus de plus en plus pointus dans leur champ spécifique. Les différents types d’imagerie ont permis des observations remarquables de l’intérieur de l’organisme permettant l’affinage des diagnostics et des thérapeutiques.
Mais, comme le dit en substance Stefan Zweig, dans l’introduction de son ouvrage de 1931 La guérison par l’esprit3, une connaissance de plus en plus poussée des organes et de leur fonctionnement a amené les médecins à se focaliser sur les maladies en perdant de vue les malades.
Pour le médecin de santé publique ou l’épidémiologue, le diagnostic est un élément crucial pour l’établissement de données statistiques.
La psychiatrie moderne apparaît en France et en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, parallèlement au développement de la médecine expérimentale. Les aliénistes s’attellent à la tâche immense de description des patients et des symptômes qu’ils observent dans les asiles d’aliénés.
À l’heure actuelle, le modèle de médecine basée sur les preuves (Evidence-Based Medecine en anglais) est très problématique concernant la psychiatrie pour deux raisons principales : d’une part, à ce jour, il n’y a pas de marqueur biologique pour les pathologies psychiatriques et, d’autre part, il n’est pas possible de mettre en place des études en double aveugle concernant les traitements psychothérapeutiques dispensés dans le champ de la psychiatrie. C’est parce qu’il n’y a pas de marqueurs biologiques ni de dysfonctionnement organique repérable que la neurologie et la psychiatrie ont pris des voies différentes dans l’histoire de la médecine. Notons que ces deux spécialités tendent à se rapprocher de nouveau et que les neuropsychiatres réapparaissent dans le paysage médical, suivis maintenant de neuropsychologues dont les plaques fleurissent sur les murs de nos villes.
Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux dans sa 5e version (DSM-5)4 nous montre la croissance exponentielle des pathologies à laquelle nous aboutissons si nous nous appuyons uniquement sur les troubles pour établir une classification. Notons que, depuis les années 80, le DSM se veut athéorique, ce qui, en soi, est une notion discutable.
Quel usage les psychanalystes font-ils du diagnostic et quels diagnostics font-ils ? Pour quelles raisons faire usage ou non des classifications américaines ou internationales comme le DSM déjà évoqué ou la Classification Internationale des Maladies (CIM) établie par l’Organisation Mondiale de la Santé ?
Quelle est la pertinence de nous référer, aujourd’hui encore, aux grandes structures psychiques dégagées par Sigmund Freud que sont la névrose, la psychose et la perversion ? Comment faire entendre que ces termes, encore en usage dans le milieu psychanalytique, au grand dam de certains discours sociétaux, ne sont pas des gros mots ? Dans le cabinet du psychanalyste, les mots pervers et perversions ne sont jamais des insultes, mais désignent un rapport au monde spécifique dont les enjeux dans la cure se distinguent de ceux relatifs à la névrose ou à la psychose.
Du côté des patients, il est intéressant de nous demander ce qui est au cœur de leur demande en ce qui concerne le diagnostic. Que demandent-ils ? À qui le demandent-ils ? Pourquoi le demandent-ils ou pour qui le demandent-ils ? Que veulent-ils savoir vraiment ? Quels sont les enjeux du diagnostic dans le rapport à leurs proches, parents, conjoint, enfants ? Pour quelles raisons tenir tellement, ou non, à être reconnu comme malade ?
Au Service d’Écoute Téléphonique d’Urgence (SÉTU ?) mis en place par notre école, il n’est pas rare d’entendre des personnes demander si nous sommes spécialisés dans la prise en charge de tel ou tel symptôme spécifique. Ne pouvons-nous y voir, déjà, l’appel à un sujet supposé savoir ?
Quel savoir et quel usage du diagnostic pour le malade, le patient, le psychanalysant et le sujet ? Pour ouvrir les perspectives de notre journée, je cite cette parole d’un patient : « Je ne suis pas fou en permanence même si je suis schizophrène tout le temps. »
À vous, tous les courageux du samedi, présents dans cette salle ou via Zoom, je souhaite une très bonne journée, qui, comme à l’accoutumée je pense, sera pleine d’enseignements cliniques et théoriques.
1 Rey, A. (Dir). Dictionnaire historique de la langue française (trois tomes), Paris, Éditions Le Robert, 1998, p. 1071.
2Ibid.
3 Ouvrage regroupant les biographies de Franz-Anton Mesmer, Mary Baker Eddy et Sigmund Freud.
4 American Psychiatric Association. DSM-5-TR, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, texte révisé, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2023.
Références bibliographiques
Dictionnaires, encyclopédies
Rey, A. (Dir). Dictionnaire historique de la langue française (trois tomes), Paris, Éditions Le Robert, 1998.
Ouvrages
American Psychiatric Association. DSM-5-TR, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, texte révisé, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2023.
DiagnosticismeSansrien
Nazyk Faugeras, psychothérapeute, membre du RPH-École de psychanalyse, 8 rue de l’Isly, Paris VIIIe, 06.15.30.40.40, [email protected]
Résumé : À partir de la proposition théorique du docteur Fernando de Amorim et en s’appuyant sur le diagnostic idiopathique en médecine, ce texte travaille la question de l’absence d’une construction autour du rien pour éclairer la souffrance de l’être. La circonscription du rien à l’aide du Symbolique dans la cure psychanalytique aboutirait à la naissance du sujet.
Mots-clés : rien – idiopathie – épilepsie – clinique du partenariat – jouissance
Je te parle et tu estoute
A des songes de là-bas
Tu me fuis prenant des routes
Que mon pas ne connaîtpas
Je te suis et je redoute
Au loin ce que tu écoutes5
J’ai donné sa chance à son acoustique pour me risquer au néologisme : diagnostic, agnostique, agnosticisme, Diagnosticisme.
C’est ainsi qu’aux patients et psychanalysants est faite l’invitation d’associer librement leurs pensées à partir des signifiants choisis par médecins, psychiatres, thérapeutes, psychologues ou encore par eux-mêmes pour désigner un diagnostic, lui-même représentant un symptôme, une maladie, un trait de personnalité, une aversion, une passion, une difficulté, un questionnement, une situation, une enfance, un traumatisme, la relation aux parents, etc. Les patients l’amènent avec eux comme un compagnon de voyage dont ils doivent porter le poids. Ils arrivent le jour de la première consultation, croulant ou non, sous le poids de leur souffrance, ou d’autre chose.
Dans ma consultation, je reçois un certain nombre de patients qui disent se reconnaître dans les signifiants « borderline » ou « misophone ». Ce sont ces arrivées munies de bannières dont la visée consciente est celle de « savoir si j’ai ça » ou encore de « savoir si c’est ça » qui m’ont fait penser à la fonction de ces signifiants, élevés et réduits au rang de pare-savoir.
Ces personnes arrivent avec des paroles en souffrance, souvent depuis des années. Avant d’entrer en psychothérapie, avant d’entrer en psychanalyse, puis durant toute la psychanalyse, elles font sans rien. Selon la théorisation de Fernando de Amorim, la construction de l’objet rien est le point de mire du voyage psychanalytique. À mesure que la cure avance, la distance avec le rien originaire s’amenuise, inversant peu à peu la vapeur entre la libido qui nourrit une triste jouissance et celle qui construit le désir. Repus de signifiants venant les assujettir à une place de semblant de vivant ou de semblant de mort – assujettissement de l’être par le Moi, avec la connivence de l’être – ces êtres arrivent sans rien savoir ; c’est par l’élusion de ce moment du rien que peut s’éclairer la cause de leur souffrance. Les signifiants choisis pour nommer le diagnostic produisent malgré tout une étincelle qui guide les êtres jusqu’à la rencontre avec la psychanalyse.
J’ai choisi de vous présenter sous différents angles les diagnostics de Laura et Émile : le diagnostic du médecin, le diagnostic structurel, le diagnostic spécifique6 et les signifiants que le psychanalysant choisit pour lui-même, qui sont de l’ordre de l’interprétation symbolique.
« Sauras-tu jamais ce qui me traverse
Qui me bouleverse et qui m’envahit
Sauras-tu jamais ce qui me transperce
Ce que j’ai trahi quand j’ai tressailli7 »
Laura manifeste une première « crise d’épilepsie »8 généralisée lorsqu’elle a un peu plus de 20 ans. Un malaise sur la voie publique, à l’orée du quartier dans lequel elle a grandi. Elle dit en séance qu’une dispute familiale avait éclaté la veille, menaçant « le secret de [s]a vie sexuelle dévoilée au grand jour », l’exposant dès lors en tant que « femme », notamment « aux yeux de [s]on père ».
Ce malaise en a mobilisé plus d’un. Acheminée vers l’hôpital le plus proche, après une batterie d’examens sanguins et d’explorations cérébrales, il lui est administré un traitement médicamenteux de clonazépam. La visée de cette molécule est « myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, anticonvulsivante et amnésiante »9. Il s’agit notamment de faire chuter le risque de récidive précoce10 post-ictal. À l’issue d’une surveillance neurologique de 24 heures, le rendez-vous avec le neurologue de garde a lieu. Après un recueil anamnestique sur les conditions de survenue de la « crise d’épilepsie » et après l’analyse des résultats de l’IRM, sa conclusion se fonde sur son interprétation de l’imagerie qui ne montre aucune lésion cérébrale. C’est cela qu’il recherchait en première intention, et c’est cela qui s’est montré absent. En l’absence d’une lésion pouvant expliquer la comitialité, la recherche diagnostique est orientée vers d’autres causes. Mais toutes les hypothèses organiques et héréditaires sont écartées.
Le diagnostic se fait à partir de rien. Rien qui explique que cette patiente ait présenté une crise convulsive ; pour le médecin, la violence de la crise est sans précédent et sans antécédent. Ainsi, ne trouvant ni lésion ni dysfonctionnement ni rien, il faut – pour la médecine – nommer cette absence. C’est la cause idiopathique.
Le dictionnaire de l’Académie de Médecine définit l’idiopathie comme suit : « Maladie qui existe par elle-même sans dépendre d’une autre maladie. »11 La racine grecque d’idiopathie nous renvoie à ἴδιος et à πάθεια. ἴδιος signifie « qui appartient en propre à quelqu’un ou quelque chose »12, il renvoie au caractère particulier, privé. πάθεια nous renvoie à πάθος, lui-même signifiant « ce qu’on éprouve, par opposition à ce que l’on fait ».
Enfin, la définition d’ἰδιοπάθεια est « une affection, un sentiment que l’on éprouve pour soi-même », c’est également la « qualité d’un verbe réfléchi »13. Je vous livre ces outils étymologiques qui, je trouve, éclairent la suite des associations libres de la psychanalysante et ses interprétations sur le symptôme qui la malmène. Enfin, ἰδιοπάθεια est antonyme à συμπάθεια où il s’agit de la compassion, de la sympathie14.
L’idiopathie est donc la cause qui ne dit pas son nom en médecine, mais en psychanalyse oui. C’est l’autre nom du symptôme corporel, l’autre nom de la jouissance, l’autre nom de la croisée des chemins entre être joui par son ignorance et désirer savoir.
Une autre cause est dite « cryptogénique »15. C’est une dénomination que j’ai trouvée dans la Revue publiée par le RPH suite à son colloque sur les enjeux de l’épilepsie dans la clinique en 2001. Selon un article de l’INSERM, « on parle d’épilepsie cryptogénique lorsque aucune cause évidente n’a pu être identifiée ». Toutefois, « L’existence d’une composante génétique dans deux tiers des épilepsies est désormais reconnue, bien qu’elle reste incomplètement élucidée. »16
Crypto vient aussi du grec, κρυπτο ́ς. Cela signifie « caché », « le caractère caché ou imperceptible ». « Caché, secret, recouvert, dissimulé, trompeur. »17 Tous ces adjectifs ne sont pas sans évoquer le symptôme, le sens caché qu’il recouvre et la visée qu’il abrite : faire signe à l’être. Jacques Lacan invite à « prendre le mot de symptôme à l’équivalent (...) de celui d’énigme »18. « La dimension du symptôme c’est que ça parle »19, mais dans une langue refoulée, inaccessible pour l’être souffrant s’il ne choisit pas de s’éveiller à sa rencontre avec lui-même.
Le diagnostic clinique du neurologue, comme une sentence, tombe dans les oreilles de la belle indifférence de Laura : « épilepsie myoclonique juvénile ». C’est une nomination, le nom de la manifestation corporelle. Et cette nomination ne donne pas un coup de projecteur sur le message que véhicule le symptôme. Au contraire, elle tend à maintenir l’obscurantisme induit par cette formation de l’inconscient qui pourtant se donne à voir et à entendre. La nomination médicale du symptôme corporel, appelée diagnostic, entretient l’ignorance. La tentation est alors grande pour le Moi de faire du signifiant du médecin un phallus imaginaire. En ce sens, le risque de la sentence diagnostique serait :
•de déjouer la tentative de l’être signalant au Moi une souffrance,
•d’abonder en libido les sillages d’une jouissance mortifère empêchant tout désir,
•de se dérober à toute perspective de manque, de désir, de savoir, du rien.
Le diagnostic lorsqu’il revêt le pouvoir du phallus imaginaire pour le malade, le patient ou le psychanalysant sert à oblitérer le manque, un manque rendu possible grâce au dévoilement d’un savoir sur soi, lui-même occasionnant la résolution des symptômes.
La libido investie dans le signifiant servant à nommer le diagnostic peut devenir symptôme. Il y a identification au signifiant, brandi tel un bouclier pour surtout ne rien savoir, jusqu’à que ce compromis lâche d’une manière ou d’une autre : soit en faveur d’une création, d’une construction, la voie du Symbolique, soit au profit d’un autre compromis, la voie de l’Imaginaire.
Le signifiant d’un autre, qu’il soit praticien hospitalier, médecin de ville, psychiatre, kinésithérapeute, instituteur ou encore un ami, peut venir cristalliser et figer le message qui cherche à se faire entendre par l’entremise du symptôme. La cure psychanalytique offre de faire chuter l’institution de ce signifiant-diagnostic-phallus-imaginaire de sa position de cache-misère, de découvrir ce qu’il recouvre pour l’être.
Laura demande : « Ça veut dire quoi idiopathique ? » Le médecin a répondu : « D’après l’IRM on n’a rien trouvé qui puisse expliquer la crise que vous avez eue. Il n’y a pas de lésion, vous n’avez pas d’antécédents. Une fois qu’on a cherché d’où ça pouvait venir, mais que ça ne nous a pas permis de trouver une explication, on appelle ça idiopathique, ça veut dire qu’on ne connaît pas la cause. Ça peut arriver à tout le monde de faire une crise d’épilepsie une fois dans sa vie. Au bout de deux crises, on considère que vous êtes épileptique. »
Le médecin a fait son travail : il a cherché la source, il a cherché la lésion, il a trouvé : rien.
Ce rien – médical – est un excellent résultat. D’une part, car il écarte toute maladie et toute atteinte organique et, d’autre part, car il assoit davantage l’autorité du médecin, appelant les patients chez qui l’on ne trouve rien, à aller à la rencontre d’un psychanalyste pour prendre l’attache du grand Autre barré. Rien appuie une parole invitant à la castration, l’invitation au rendez-vous psychanalytique.
Ce maillage thérapeutique autour du patient de médecinea été rendu possible dès 1999 grâce à la proposition d’Amorim et du professeur Casassus intitulée la « clinique du partenariat »20. Cela consiste pour les médecins et chirurgiens à orienter l’être souffrant de symptômes corporels et organiques vers un psychanalyste. C’est d’ailleurs ainsi que nous travaillons dans la clinique : dès qu’un patient ou un psychanalysant évoque des rendez-vous manqués avec des spécialistes, des symptômes corporels, des douleurs, des maladies organiques ou encore le souhait de consulter un psychiatre, tout de suite, il s’agit de travailler avec la médecine, sans mettre en suspens l’emprunt de la voie du Symbolique dans la cure. Les paroles des médecins peuvent être de fécondes sources d’associations libres suscitant colères, agitations et bouleversements lorsqu’elles sont reprises dans la cure par le patient ou le psychanalysant.
Amorim affirme que « l’inconscient du médecin interprète, mais ce dernier ne sait pas quoi faire de l’interprétation, c’est pour cette raison que des vérités tombent de sa bouche, comme de celles des enfants »21. Contrairement aux médecins dont le métier n’est pas de travailler avec le transfert – bien que certains y soient sensibles – le psychanalyste s’en saisit et opère pour endiguer l’hémorragie libidinale vers le corps ou l’organisme22. Le patient ou psychanalysant s’appuie pour cela sur le grand Autre barré, trésor des signifiants. À ce sujet, Amorim écrit : « (...) il est important de border la jouissance, mais il est encore plus important de construire un canal pour que la libido puisse nourrir la pulsion et que cette dernière puisse alimenter le désir de devenir sujet »23.
La clinique du partenariat est nécessaire dans la logique du soin, car elle constitue en elle-même une prophylaxie, évitant alors les symptômes paroxystiques et les maladies. Lorsqu’une personne rencontre un médecin généraliste ou un spécialiste et que celui-ci l’adresse à un psychanalyste, il introduit d’emblée l’existence d’une voie Ⱥutre ; murmure à l’oreille de l’être et du Moi, la voie de l’espérance.
Pour Laura, face à l’idiopathie, c’est une ordonnance médicamenteuse qui lui est rédigée, accompagnée de l’indication de consulter un neurologue en ville pour contrôler le traitement.
Durant cette hospitalisation, Laura n’a rien perdu de la superbe de son symptôme. Elle est repartie avec, et donc, sans savoir. Avec son symptôme, avec une prescription médicamenteuse, avec un signifiant, avec son ignorance et plus de jouissance encore, celle des bénéfices secondaires du malade qui, en se faisant objet de la médecine, quête la reconnaissance et la considération du corps médical hospitalier.
Elle ressort de son hospitalisation avec un « plus-encore », offrant un boulevard à une jouissance qui courra alors le risque de s’accrocher à cette sentence signifiante : « Au bout de deux crises, on considère que vous êtes épileptique. » Ça n’a pas raté. Trois ans après la première, une deuxième crise convulsive généralisée a lieu.
Lorsqu’elle vient au cabinet pour la première fois, qu’il lui est demandé ce qui la fait souffrir, elle dit : « J’ai fait une crise d’épilepsie. » Elle témoignera plus tard de sa surprise : « J’ai dit ça, mais ce n’était pas pour ça que j’avais pris rendez-vous, enfin c’est ce que je croyais. »
Dans sa cure, grâce à la technique du précédent, la psychanalysante associe la deuxième « crise d’épilepsie » à un message reçu quelques jours plus tôt : « Ta mère est malade, elle a peut-être un cancer. » Quelques heures plus tard, la crise se produit. Mais cette fois, sa survenue se compose de circonstances diverses que Laura décline : le souvenir de ce message, la dette de sommeil, l’excès d’alcool la veille. Laura a pris ses dispositions, alertée par des « myoclonies », ce sont des « contractions rapides et brutales d’un muscle ou d’un groupe de muscles »24. Elle s’est allongée en lieu sûr.
Les médecins et articles à propos de l’épilepsie évoquent un phénomène d’aura précédant une crise, comme si le Moi avertissait d’un déferlement imminent. Pour Laura, déjà en psychanalyse, il ne s’agissait pas d’une aura, mais d’un savoir sur elle-même, pioché « du côté de l’Autre barré »25. « Trop d’alcool, trop de fête, trop d’excès, pas assez de sommeil », dit-elle. Il y avait aussi l’arrêt du traitement antiépileptique sans avis médical et « ce message qui [lui]est revenu à l’esprit ».
« La maison n’était qu’un nœud de ténèbres »26 : trop de culpabilité. Trop de haine. Trop de jouissance. Débordée par cette libido qui n’a plus où aller, le Moi corporel l’absorbe. Et la manifestation corporelle se produit. L’être de Laura n’est plus, seule reste sa jouissance, aux bons soins de ses organisations intramoïques.
Ce qui m’autorise aujourd’hui à évoquer les crises convulsives de Laura comme étant les exactions de ses organisations intramoïques, ce sont les interprétations de Laura. Elles font office de boussole dans le traitement psychanalytique du symptôme et de sa résolution en présence du rien médical. Des mois de psychanalyse après les deux crises passées ont permis un retour du refoulé et ainsi une parole vraie27 : « J’ai réussi à attraper la pensée qui a précédé les myoclonies. Ce sont des pensées dépréciatives. » Ses myoclonies sont interprétées comme des « interférences » du fait de sa « rage ».
Dans le cas de Laura, à partir du diagnostic médical, la voie de l’interprétation de son symptôme s’ouvre : myoclonies, maladresses, crises partielles, crises généralisées sont l’œuvre de la haine qu’elle supporte. La cause médicale idiopathique et le diagnostic d’épilepsie trouvent une résonance dans l’économie de l’appareil psychique. Rappelez-vous, ἰδιοπάθεια signifie « une affection, un sentiment que l’on éprouve pour soi-même ». (Et « épilepsie » signifie « saisir, s’emparer de, avec une idée d’hostilité » et même au figuré « attaquer en paroles »28). La cure de Laura lui en apprend davantage sur la nature de cette affection pour elle-même, la haine.
Laura et son époux désirant un enfant, Laura a choisi, avec l’accompagnement de son médecin, d’arrêter progressivement son traitement antiépileptique pour ne pas exposer son enfant à la molécule (Lévétiracétam). La conduite psychanalytique des cures ne cautionne pas et n’approuve pas la prise ou l’arrêt de traitement sans avis médical ; le clinicien oriente le psychanalysant vers le médecin pour cela.
Laura poursuit sa cure psychanalytique. À ce titre, contrairement au symptôme corporel qui résulte de la libido ayant emprunté la bucca, contrairement au traitement médicamenteux où il s’agit de prendre une molécule en passant par le canal oral – l’autre bucca,os – le traitement psychanalytique est d’un autre registre, il consiste à « s’engager avec son désir, le parler »29 pour éviter qu’il ne se transforme en libido et qu’elle-même ne se transforme en expression corporelle30.
Rien est un argument médical, parmi d’autres, en faveur de la psychanalyse. Si l’être accepte le rendez-vous, la conclusion médicale « rien » et les diagnostics idiopathiques et cryptogéniques peuvent servir de tremplins pour aller voir ailleurs, l’ailleurs de la psychanalyse.
Sans la perspective d’une construction symbolique pour s’appuyer sur rien, et ainsi en faisant sans rien, plutôt qu’à partir de là, la voie de l’apaisement, de la castration symbolique et de la construction de sa subjectivité – grâce à la construction de l’objet rien – n’est pas encore dégagée de ce qui l’obstrue.
Faire comme si rien n’avait pas été fait barrage à la possibilité pour l’être et au Moi d’accéder à un équilibre instable, mais solide. À son grand dam, le Moi se débat à coups d’interprétations imaginaires pour meubler la vacuité originaire du rien. Faire de la place pour accueillir le rien, le circonscrire à l’aide du Symbolique puis construire à partir de là est la voie que l’être devenant sujet choisit d’emprunter pour « construire sa responsabilité de conduire aussi sa destinée »31.
« C’est comme si j’avais besoin de combler un manque,
un manque que je n’ai jamais reçu,
un sentiment que je n’ai jamais reçu. »32
Émile est un homme d’une quarantaine d’années. Il vient me rencontrer pour la première fois, car il est en grande souffrance du fait d’une lésion rectale. Émile entre en psychanalyse en posant la question « Comment je peux m’en sortir ? ». Aussitôt installé sur le divan, il interprète l’atteinte organique dont il se fait l’objet : « Je l’ai créée moi-même, à cause du stress, je me suis fait mal ».
Pendant le temps de la cure, le symptôme organique et la douleur continuent d’être pris en charge et traités par les consultations des médecins et par voie médicamenteuse. Émile a pris rendez-vous sur le bon conseil de sa sœur. Il arrive avec un signifiant porte-voix : « Je suis quelqu’un d’hypersensible. » Invité à en dire davantage sur ce signifiant, il l’associe à « [s]es traumatismes » et à « l’environnement dans lequel [il a] grandi », une enfance durant laquelle il a été témoin de violences conjugales jusqu’au point paroxystique où il trouve sa mère dans la rue, gisant, battue presque à mort. Il s’agira alors pour la mère, dès ce moment, de se cacher avec la complicité de certains acteurs sociaux ; la mère et les enfants sont hébergés par de bons samaritains pour empêcher leur placement par les services sociaux. En plus des châtiments corporels dont il est témoin, Émile a grandi noyé dans un discours n’encourageant que la retenue et l’Imaginaire, « le regard des autres, ce que les gens vont penser de moi », noyé par des paroles sans fond comme « fais attention » qui ont nourri une peur de tout et de rien à la fois, une peur sans objet, avant sa psychanalyse. Aujourd’hui, il dit qu’il n’a non plus peur de ne pas réussir, mais qu’il a « peur de réussir », « peur que [s]a vie change vraiment », « peur des décisions qu’[il] [s]ait dorénavant prendre », « peur de prendre [s]on indépendance et [s]on autonomie » et « peur de laisser [s]a mère » avec laquelle il vit encore, « comme [s’il] étai[t] son partenaire, son mari ».
Une parole d’Émile a un jour matérialisé une levée de séance. Il dit : « En fait, je ne suis pas hypersensible, c’est l’environnement dans lequel j’ai vécu qui me fait pleurer aujourd’hui. »
Cette parole le déloge d’une identification imaginaire et d’un assujettissement au signifiant « hypersensible », qui ne laissait aucune place au désir. Par cette parole, un jour se créé, jour qu’il s’agit non plus de combler avec l’objet imaginaire « hypersensible », mais à partir duquel il s’agit de construire. Faire avec ? Faire sans ? Faire à partir de rien, tel est l’horizon de la cure. Émile n’a pas choisi cet environnement dans lequel il lui a été donné de grandir, c’est son Réel, mais ce n’est pas une croix qu’il doit porter. Émile interprète sa culpabilité d’avoir consenti aux discours des grands Autres non barrés des majeurs qui l’ont à peu près accueilli.
À partir de là, de sa position de psychanalysant, il s’offre un choix33. Une première bifurcation point : construire sa propre voie ou continuer à s’acharner, au risque de s’écharper lui-même, comme il l’a déjà fait. Pendant des mois, la cure est conduite avec la direction Nord34, celle de la conduite de la cure avec un névrosé, il est invité à interpréter ses paroles, ses rêves, ses sensations corporelles, les séances sont parfois levées avec scansion. Puis, il a fallu mettre le cap vers le Sud (sud-est). La carte des trois structures et la métaphore maritime sont des outils tout à fait concrets pour le clinicien lorsque la certitude jaillit du discours, la navigation clinique est immédiatement et calmement ajustée.
Le diagnostic de psychose est tombé « comme un fruit mûr » et le clinicien conduit la cure comme il se doit. Émile « [s]’autosabote » et en est passé par une « livre de chair »35. La psychanalyse d’Émile se poursuit désormais avec des indications de conduite de cure plus prudentes. Il s’agit d’éviter l’alignement pour le Moi36 entre :
1. L’événement actuel, la mauvaise rencontre,
2. L’Œdipe,
3. La forclusion,
4. L’objet a,
5. Le rien.
Pour Laura et pour Émile, la naissance de symptômes corporels et organiques résulte respectivement du processus de refoulement et de l’existence de la forclusion du Nom-du-Père, l’ignorance empêchant l’accès au rien. Pour autant, leurs voix ne sont pas sans issue. La poursuite de leur cure psychanalytique est le témoin du choix de l’être de construire sa subjectivité, plutôt que d’agir son propre abandon.
Sans rien37, le Moi amer assigne l’être à une pusillanimité, lui-même se stigmatisant à ce rôle le vouant à aucune existence possible. En attendant, ils bricolent ensemble une temporisation, celle du moment où l’être témoignera pour lui-même du choix qu’il fera, rompant alors avec ses décisions abondant dans la trajectoire de la toute-puissance du Moi, ou non, si telle est sa décision.
5 Aragon, L. (1963). « Le futur vu », in Le Fou d’Elsa. Paris, Gallimard, 2022, p. 107.
6 Amorim (de), F. (2024). « La stigmatisation du mot et celle de l’être », in Brèves 2024, Paris, RPH Éditions, à paraître.
7 Aragon, L. (1963). « Les mains d’Elsa », in op. cit., p. 82.
8 Propos de la psychanalysante. Concernant la terminologie distinguant troubles convulsifs et épilepsie, se référer à : Le Manuel MSD. Troubles convulsifs, 2022, consulté le 5 février 2024, https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-épinière-et-des-nerfs/troubles-convulsifs/troubles-convulsifs
9 Vidal. Substance active Clonazépam, 2013, consulté le 5 février 2024, https://www.vidal.fr/medicaments/substances/clonazepam-4157.html
10 HAL. Justine Valieres, Identification des facteurs de risque de récidive dans les 24 heures du passage aux urgences des patients admis pour crise comitiale, consulté le 12 février 2024, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02550968/document, p. 26.
11 Académie de Médecine. Entrée « Idiopathie », consulté le 3 janvier 2024, https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=idiopathie
12 Dictionnaire Bailly grec-français. Entrée « ἴδιος », consulté le 15 janvier 2024, https://bailly.app/idios
13 Dictionnaire Bailly grec-français. Entrée « ἰδιοπάθεια », consulté le 15 janvier 2024, https://bailly.app/idiopatheia
14 Dictionnaire Bailly grec-français. Entrée « συμπάθεια », consulté le 15 janvier 2024, https://bailly.app/sumpatheia
15 Cremniter, D. « Épilepsie : entre psychose et hystérie ». Revue de Psychanalyse et Clinique Médicale, 2001, n° 8, p. 80.
16 INSERM. Épilepsie. Un ensemble de maladies complexe, encore mal compris, 2018, consulté le 28 janvier 2024, https://www.inserm.fr/dossier/epilepsie/#:~:text=On%20parle%20d%27épilepsie%20cryptogénique,qu%27elle%20reste%20incomplètement%20élucidée
17 Dictionnaire grec-français Bailly. « Entrée κρυπτο ́ς », consulté le 15 janvier 2024, https://bailly.app/kruptos
18 Lacan, J. (1956-57). Le Séminaire, Livre IV, La relation d’objet, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 109.
19 Citation complète : « La dimension du symptôme c’est que ça parle, ça parle même à ceux qui ne savent pas entendre, ça ne dit pas tout, même à ceux qui le savent. » Lacan, J. (1971). Le Séminaire, Livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Paris, Éditions du Seuil, 2007, p. 24.
20 « Régime de partenariat » aujourd’hui appelé « clinique du partenariat ». Amorim (de), F. & Casassus, P. « Éditorial ». Revue de Psychanalyse et de Clinique Médicale, 1999, n° 3, p. 1.
21 Amorim (de), F. (1997). « L’inconscient (du médecin) interprète ». Revue de Psychanalyse et Clinique Médicale, 1997, n° 1, p. 102.
Cité par : Amorim (de), F. (2011). La relation entre le désir inconscient en psychanalyse et l’acte médical en médecine, 2011, consulté le 15 février 2024, https://www.rphweb.fr/details-relation+entre+desir+inconscient+en+psychanalyse+et+l+acte+medical+en+medecine-80.html
22Cf. « Le schéma freudo-lacanien de l’appareil psychique », p. 313.
23 Amorim (de), F. « Le maniement du transfert avec l’être psychotique », in Brèves 2023, Paris, RPH Éditions, à paraître.
24 Le Manuel MSD. Myoclonie, 2022, consulté le 24 février 2024, https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/troubles-du-mouvement/myoclonie
25 Citation complète : « Le savoir n’est pas du côté du sujet, le savoir est du côté de l’Autre barré. » Amorim (de), F. « La rectification subjective », in Brèves 2022, Paris, RPH Éditions, à paraître.
26 Aragon, L. (1963). « Les mains d’Elsa », in op. cit., p. 80.
27Cf. Annexe 1 : « Le schéma de la parole vraie », p. 32.
28 Dictionnaire Bailly grec-français. Entrée« ἐπιλαμϐάνω », consulté le 5 mars 2024, https://bailly.app/epilamban%C3%B4
29 Propos de Fernando de Amorim recueillis à l’occasion d’une supervision individuelle qui s’est tenue le 8 janvier 2024 à Paris IXe.
30Ibid.
31 Amorim (de), F. « Aux responsables des institutions psychanalytiques », in Brèves 2024, Paris, RPH Éditions, à paraître.
32 Théo, psychanalysant.
33Cf. Annexe 2 : « Différence entre choix et décision de l’être », p. 33.
34Cf. « Carte des trois structures », p. 309.
35 Shakespeare, W. (1598). Le Marchand de Venise, Paris, Gallimard, 2010, p. 81.
36Cf. « Schéma César », p. 311.
37Cf. Annexe 3 : « Accolades illustrant le rien », p. 34.
Références bibliographiques
Dictionnaires, encyclopédies
Académie de Médecine. https://www.academie-medecine.fr
Dictionnaire Bailly grec-français. https://bailly.app
Ouvrages
Amorim (de), F. « La rectification subjective », in Brèves 2022, Paris, RPH Éditions, à paraître.
Amorim (de), F. « Le maniement du transfert avec l’être psychotique », in Brèves 2023, Paris, RPH Éditions, à paraître.
Amorim (de), F. « Aux responsables des institutions psychanalytiques », in Brèves 2024, Paris, RPH Éditions, à paraître.
Amorim (de), F. (2024). « La stigmatisation du mot et celle de l’être », in Brèves 2024, Paris, RPH Éditions, à paraître.
Aragon, L. (1963). Le Fou d’Elsa, Paris, Gallimard, 2022.
Lacan, J. (1956-57). Le Séminaire, Livre IV, La relation d’objet, Paris, Éditions du Seuil, 1994.
Lacan, J. (1971). Le Séminaire, Livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Paris, Éditions du Seuil, 2007.
Shakespeare, W. (1598). Le Marchand de Venise, Paris, Gallimard, 2010.
Articles de périodiques
Amorim (de), F. & Casassus, P. « Éditorial ». Revue de Psychanalyse et de Clinique Médicale, 1999, n° 3, pp. 1-2.
Cremniter, D. « Épilepsie : entre psychose et hystérie ». Revue de Psychanalyse et Clinique Médicale, 2001, n° 8, pp. 79-90.
Liens internet
Amorim (de), F. (2011). La relation entre le désir inconscient en psychanalyse et l’acte médical en médecine, 2011, consulté le 15 février 2024, https://www.rphweb.fr/details-relation+entre+desir+inconscient+en+psychanalyse+et+l+acte+medical+en+medecine-80.html
INSERM. Épilepsie. Un ensemble de maladies complexe, encore mal compris, 2018, consulté le 28 janvier 2024, https://www.inserm.fr/dossier/epilepsie/#:~:text=On%20parle%20d%27épilepsie%20cryptogénique,qu%27elle%20reste%20incomplètement%20élucidée
HAL. Justine Valieres, Identification des facteurs de risque de récidive dans les 24 heures du passage aux urgences des patients admis pour crise comitiale, consulté le 12 février 2024, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02550968/document
Le Manuel MSD. Troubles convulsifs, 2022, consulté le 5 février 2024, https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-épinière-et-des-nerfs/troubles-convulsifs/troubles-convulsifs
Le Manuel MSD. Myoclonie, 2022, consulté le 24 février 2024,https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/troubles-du-mouvement/myoclonie
Vidal. Substance active Clonazépam, 2013, consulté le 5 février 2024, https://www.vidal.fr/medicaments/substances/clonazepam-4157.html
ANNEXE1
ANNEXE2
ANNEXE3
Psychanalyse et psychiatrie, un dialogue de sourds ?Diagnostic médicalet psychanalytique de l’anorexie
Ranida Bonamy, psychothérapeute, membre du RPH-École de psychanalyse, 125 avenue Pierre Sémard, 94210 Saint-Maur-des-Fossés, 06.17.87.49.71, [email protected]
Résumé : Le diagnostic est un point de départ de la thérapeutique médicale, mais il n’est pas une finalité en psychanalyse. C’est une indication qui sert le clinicien à conduire la cure à bon port, mais il n’est pas nécessairement connu du patient ou psychanalysant. Cela n’en fait pas une accroche identitaire imaginaire. Les différences de lectures du diagnostic, et au final de la pathologie mentale, sont nombreuses entre psychiatrie et psychanalyse, c’est ce que nous abordons dans ce texte.
Mots-clés : diagnostic – anorexie – médicaments – psychose – autodestruction.
Étymologiquement, « diagnostic » associe la notion de connaissance « gnose », au préfixe dia, qui renvoie à l’idée d’une distinction. Autrement dit, le diagnostic est une catégorisation du savoir médical, psychologique ou psychanalytique en pathologies. Avant Hippocrate (460-377 avant J.-C.) et pendant des siècles après, prédominait une lecture religieuse de la maladie. Certaines étaient l’œuvre du Malin, telles que les folies, d’autres bénéficiaient d’une considération plus favorable. Par exemple, l’anorexie revêtait des allures de sainteté, où renoncer à la nourriture terrestre était assimilé à une élévation et une dévotion. La maladie est une altération de la santé humaine. En grec, maladie se dit nosos, d’où les termes médicaux « nosologie » ou « nosographie ». La nosologie est la discipline qui étudie les maladies pour faire des nosographies ou des classifications.
Avant la médecine d’Avicenne (980-1037), s’il n’était pas possible de guérir, nommer la maladie était une façon de ne pas mourir de rien, de l’insignifiance ; comme si le diagnostic permettait de mourir (plus) paisiblement de quelque chose. Sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, avec la multiplication de diagnostics et autodiagnostics en tout genre (HPI, HPE, TCA, TDE, TDA ou TDAH, etc.), il n’est pas rare d’entendre des phrases telles que : « J’ai enfin pu mettre un mot sur ce que j’ai. » Un mot, ce n’est pas suffisant ! En effet, en médecine, ce mot, le diagnostic, est le commencement thérapeutique. C’est ce qui permet au médecin de prescrire le traitement. En psychanalyse, un mot, ce n’est pas assez pour dire sa souffrance, sa haine, sa colère et d’en sortir. S’il est si important en médecine pour établir d’emblée un choix dans le soin, en psychanalyse, le diagnostic peut mettre des années à se révéler dans le transfert. Le psychothérapeute ou le psychanalyste travaille avec le manque, avec ce qui n’est pas, avec ce qui n’adviendra peut-être jamais, et non avec des certitudes inébranlables.
La part de subjectivité de celui qui établit le diagnostic a souvent fait débat. Cette question se pose notamment en psychiatrie, psychanalyse et psychologie. Ce qui n’aide pas à parler la même langue, donc poser le même diagnostic, c’est le fait que ces trois disciplines ont des niveaux de lecture de la souffrance qui sont différents. La psychiatrie a une lecture, au niveau conscient et biologique de la maladie mentale. La psychologie interprète les troubles et comportements au niveau conscient. La psychanalyse, elle, fait l’hypothèse de l’inconscient.
Pendant presque un siècle, entre la naissance de la psychanalyse et les années cinquante, la psychiatrie a pu adopter le paradigme structurel psychanalytique (à savoir : névrose, psychose et perversion) pour poser le diagnostic d’une affection mentale. L’arrivée du Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM)38, dès la seconde moitié du siècle dernier, a marqué un tournant au niveau des classifications psychiatriques. La première version du DSM39 contenait 60 diagnostics, la seconde 145, la troisième 292, la quatrième et la cinquième 410. La suppression du référentiel théorique, de la névrose, de la psychose, de l’hystérie et plus globalement de la psychanalyse, à partir de la troisième version, a donné lieu à une envolée du nombre de maladies et de troubles. Est-ce justifié cliniquement ? L’équipe à l’origine du DSM III40 présente cet ouvrage comme étant purement empirique, c’est-à-dire fondé sur l’observation et l’expérience et non sur la théorie ou le raisonnement.
Cette expérience ne pouvait être celle de la clinique. Robert Spitzer, le psychiatre à la tête de ce projet, avouait dans une interview se sentir trop mal à l’aise face aux patients41. Son travail reposait alors sur l’identification des comportements dits anormaux, ainsi que des symptômes. Le diagnostic devient une description, dans l’optique d’une prescription. De cette façon, il s’intéresse à la maladie et non au malade, ses ressentis, ses pensées, son individualité et son être. La timidité, comme tant d’autres, connaît désormais plusieurs déclinaisons : anxiété sociale, phobie sociale ou trouble de la personnalité évitante. Pour reprendre les propos du docteur Fernando de Amorim, « Le systématique, le standard ne font pas méthode ni thérapeutique »42. Quelle est la solution à cette souffrance croissante ? Les médicaments ?
Récemment, j’ai regardé une vidéo d’une jeune femme qui témoignait de sa bataille avec l’anorexie43. Son extrême maigreur, 33kg pour 168cm, a laissé peu de doute quant au diagnostic. Elle dit : « Cette maladie n’a rien à voir avec la nourriture, j’ai l’impression qu’on [personnel médical] m’a juste fait remanger, fait regrossir, mais effectivement, pas du tout soigné la tête. À ce moment-là, j’ai rechuté encore une fois. En l’espace de deux ou trois mois, j’ai tout perdu ce que j’avais pris en hospitalisation [15kg]. » Elle indique qu’un traitement purement médical n’a pas suffi. Est-ce lié au fait que le niveau de lecture de la pathologie n’est peut-être pas le bon ? Avant de porter atteinte à son organisme, l’anorexique cible son corps par l’image qu’elle en a. Par ailleurs, cette vidéo met en valeur l’importance d’une alliance thérapeutique entre médecins et psychistes. C’est ce que le docteur de Amorim a nommé la clinique du partenariat où : « médecin et psychanalyste s’habituent à opérer cliniquement ensemble. La conséquence de cette politique est qu’il sera plus facile pour le médecin, détenteur du premier transfert, d’introduire le psychanalyste dans la relation qu’il, le médecin, a réussi à établir avec le patient »44.
Le sujet de l’anorexie m’évoque la situation d’une patiente de 12 ans, que je reçois depuis plusieurs mois. Lorsque j’ai reçu B. pour la première fois, elle refusait de bien s’alimenter depuis déjà de très nombreux mois et avait perdu 10kg par rapport à son poids initial, 20 % de ce dernier. Cette attente pour consulter est surprenante, car les signes d’amaigrissement étaient bien visibles. Les joues étaient creuses, le visage émacié, le teint terne, le corps amaigri, avec une perte d’énergie globale. En effet, elle dormait en cours depuis quelque temps, avait réduit ses activités et sorties au minimum et n’avait plus la force d’aller à ses entraînements sportifs, ce sont là des signes manifestes de sa fatigue et d’une perte d’élan vital. Et le fait d’avoir autant attendu pour consulter indique une complicité taiseuse de la part des parents et qu’ils sont de la partie.
La première consultation a été chez le médecin traitant, deux mois après le constat de l’aménorrhée. Ce dernier avait posé le diagnostic d’anorexie, proposé une psychothérapie pour la jeune fille et parlé d’hospitalisation si elle venait à perdre encore 2 kg. À sa première séance de psychothérapie, je lui ai tendu le dictionnaire, dans lequel elle a lu la définition de l’anorexie et dans laquelle elle s’est reconnue. Cette première étape validée, cela n’indiquait pas pour autant dans quelles eaux on naviguait, cela ne disait pas le diagnostic structurel. Les structures sont la névrose, la psychose et la perversion. Elles déterminent le filtre à travers lequel on regarde la réalité et les mécanismes, plus ou moins coûteux psychiquement, pour interagir avec le monde et l’autre. À la différence de la médecine, la psychanalyse ne fait pas reposer le diagnostic sur les symptômes, car ces derniers peuvent disparaître. La structure, elle, est durable. Elle peut s’assouplir, mais reste constante.
Le diagnostic spécifique45