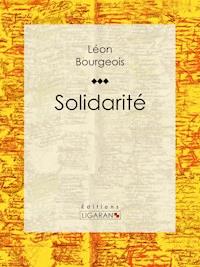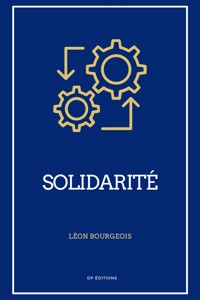
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Léon Bourgeois, lauréat du Prix Nobel de la paix en 1920, est reconnu comme le concepteur de la théorie du "solidarisme". Dans cette théorie, il introduit le concept de dette sociale et avance une idée novatrice pour l'époque, à savoir que chaque citoyen a un devoir et des obligations envers la collectivité. Selon lui, c'est cette "dette" qui constitue la base de la solidarité et permet à chacun de recevoir plus en retour que ce qu'il donne à la société. Ainsi, la doctrine de la solidarité est considérée comme une évolution de la philosophie du XVIIIe siècle et comme l'aboutissement de la théorie politique et sociale dont la Révolution française, à travers les concepts abstraits de liberté, d'égalité et de fraternité, a posé les premières fondations.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOLIDARITÉ
LÉON BOURGEOIS
DP ÉDITIONS
TABLE DES MATIÈRES
Présentation du livre
1. Evolution des idées politiques et sociales.
2. Doctrine scientifique de la solidarité naturelle.
3. Doctrine pratique de la solidarité sociale.
4. Dette de l'homme envers la société ; le quasi-contrat social.
PRÉSENTATION DU LIVRE
Le mot de solidarité n'est entré que depuis peu d'années dans le vocabulaire politique. Au milieu du siècle, Bastiat et Proudhon ont bien aperçu et signalé les phénomènes de solidarité « qui se croisent » dans toutes les associations humaines. Mais aucune théorie d'ensemble ne s'est dégagée de ces observations1 ; le mot, en tout cas, ne fit pas fortune, et Littré, en 1877, ne donne encore de ce terme, en dehors des acceptions juridique et physiologique, qu'une définition « de langage courant », c'est-à-dire sans précision et sans portée : « c'est, dit-il seulement, la responsabilité mutuelle qui s'établit entre deux ou plusieurs personnes ».
Aujourd'hui, le mot de solidarité parait, à chaque instant, dans les discours et dans les écrits politiques. On a semblé d'abord le prendre comme une simple variante du troisième terme de la devise républicaine : fraternité. Il s'y substitue de plus en plus ; et le sens que les écrivains, les orateurs, l'opinion publique à son tour, y attachent, semble, de jour en jour, plus plein, plus profond et plus étendu.
N'y a-t-il qu'un mot nouveau et comme un caprice du langage ? Ou ce mot n'exprime-t-il pas vraiment une idée nouvelle, et n’est-il pas l'indice d'une évolution de la pensée générale ?
1Il faut citer toutefois le livre de P. LEROUX, de l'Humanité, 1839. Mais ce livre, célèbre en son temps, ne semble pas avoir eu d'action sur les générations suivantes. Le Comité organisé par le parti démocratique pour les élections de 1849 s'appelait la Solidarité républicaine, et avait Jean Macé pour secrétaire.
EVOLUTION DES IDÉES POLITIQUES ET SOCIALES.
I
La notion des rapports de l'individu et de la société s'est profondément modifiée depuis un quart de siècle.
En apparence, rien n'est changé. Le débat continue dans les mêmes termes entre la science économique et les écoles socialistes ; l'individualisme et le collectivisme s'opposent toujours l'un à l'autre, dans une antithèse que les événements politiques rendent plus évidente, plus saisissante que jamais.
En France et hors de France, les questions de politique pure cèdent le pas aux discussions sociales, et les succès électoraux des divers groupes socialistes, en Allemagne, en Belgique, en France, ailleurs encore, permettent d'annoncer l'heure prochaine où, dans les assemblées, les majorités et les minorités se grouperont exclusivement sur le terrain de la lutte économique, et prendront pour unique mot d'ordre la solution « libérale » ou « socialiste » du problème de la distribution de richesses.
Mais, comme il est habituel, l'état des partis ne traduit qu'imparfaitement l'état des esprits. Les partis sont toujours en retard sur les idées ; avant qu'une idée se soit assez répandue pour devenir la formule d'une action collective, l'article fondamental d'un programme électoral, il faut une longue propagande ; quand les partis se sont enfin organisés autour d’elle, bien des esprits ont déjà aperçu ce qu'elle contenait d'incomplet, d'inexact, en tous cas de relatif, et une vue nouvelle s'ouvre déjà, plus compréhensive et plus haute, d'où naîtra l'idée de demain, qui sera à son tour la cause et l'enjeu de nouvelles batailles.
C'est ainsi qu'entre l'économie politique classique et les systèmes socialistes une opinion s’est formée lentement, non pas intermédiaire, mais supérieure ; une opinion conçue d'un point de vue plus élevé, d'où la lumière se distribue plus également et plus loin. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une tentative de transaction entre les groupes et les partis, d'une opération de tactique politique. Ce n'est pas entre les hommes mais entre les idées, qu'un accord tend à s'établir ; ce n'est pas un contrat qui se prépare, c'est une synthèse.
Cette synthèse n'est pas achevée. Il y a une doctrine déjà en possession de ses procédés de recherche et de raisonnement, maîtresse de son but et de ses moyens ; il n'y a pas un système arrêté, donnant sur tout des conclusions.
Comment en serait-il autrement ? Ce n'est l'œuvre de personne en particulier, et c'est l'œuvre de tout le monde. Il y a là une manière de penser générale, dont on trouve la trace un peu partout, chez les lettrés comme chez les politiques, dans les œuvres écrites des philosophes comme dans les œuvres vécues des hommes d'Etat ; dans les institutions privées et dans les lois, aussi bien chez les peuples latins que chez les Anglo-Saxons ou les Germains, aussi bien dans les Etats monarchiques que dans les démocraties républicaines.
Cette doctrine n'a pas reçu d'emblée un de ces noms éclatants qui s'imposent d'abord, comme si leurs syllabes mêmes contenaient la solution des problèmes.
Elle est, pour avoir un nom accepté de tous, revendiquée à la fois par des partisans trop divers, venus de points trop éloignés de l'horizon philosophique et politique ; chacun pour son compte cherche à la rattacher à l'ensemble de ses doctrines antérieures. On la trouve professée par des socialistes chrétiens et pour eux c'est l'application des préceptes évangéliques ; par certains économistes, et pour eux c'est la réalisation de l'harmonie économique. Pour quelques philosophes, c'est la loi « bio-sociologique » du monde ; pour d’autres c'est la loi « d'entente » ou « d'union pour la vie1 » ; pour les positivistes, c'est, d'un seul mot, « l'altruisme ».
Mais pour tous, au fond, et sous des noms divers, la doctrine est la même, elle se ramène clairement à cette pensée fondamentale : il y a entre chacun des individus et tous les autres un lien nécessaire de solidarité ; c'est l'étude exacte des causes, des conditions et des limites de cette solidarité qui seule pourra donner la mesure des droits et des devoirs de chacun envers tous et de tous envers chacun, et qui assurera les conclusions scientifiques et morales du problème social.
D'où peut venir, vers une même pensée, le consentement d'esprits si divers ? On dirait, contre les barrières des systèmes trop étroits, la conspiration d'une poussée universelle.
C'est que cette notion de la solidarité sociale est la résultante de deux forces longtemps étrangères l'une à l’autre, aujourd'hui rapprochées et combinées chez toutes les nations parvenues à un degré d'évolution supérieur : la méthode scientifique et l’idée morale.
Elle est le fruit du double mouvement des esprits et des consciences qui forme la trame profonde des événements de notre siècle ; qui, d'une part, tend à libérer les esprits des systèmes a priori, des croyances acceptées sans examen, et à substituer aux combinaisons mentales imposées par la tradition et l'autorité, des combinaisons dues à la libre recherche et soumises à une critique incessante ; et qui, d’autre part, contraint les consciences à chercher, d'autant plus rigoureusement, en dehors des concepts sans réalité et des sanctions invérifiables, des règles de conduite dont le caractère obligatoire résultera simplement de l'accord du sentiment - mesure du bien - et de la raison - critérium du vrai.
C’est donc à des causes très générales et très profondes que ce qu'on commence déjà à appeler le mouvement solidariste doit son origine et sa force croissante. Le moment paraît venu de l'étudier avec suite et de montrer comment il tend déjà à renouveler l'aspect des études économiques et sociales.
II
Les économistes condamnent toute intervention de l'Etat dans le jeu des phénomènes de production, de distribution et de consommation de la richesse ; les lois qui règlent ces phénomènes sont, disent-ils, des lois naturelles, auxquelles le législateur humain ne doit et d'ailleurs ne peut rien changer.
Philosophiquement, l'homme est libre ; l'Etat doit se borner à lui garantir l'exercice de cette liberté dans la lutte pour l'existence, qui d'ailleurs est la source et la condition de tout progrès.
La propriété individuelle est, comme la liberté elle-même, un droit inhérent à la personne humaine ; la propriété individuelle n'est pas seulement une conséquence de la liberté, elle en est aussi la garantie ; ce caractère du droit de propriété est donc absolu : c'est le jus utendi et abutendi. Le droit de propriété de l'un ne peut être limité que par le droit de propriété de l'autre. Sauf, le prélèvement de l'impôt, il n'y a point de part sociale dans la propriété individuelle ; si la charité est un devoir et un devoir impérieux, c'est un devoir purement moral.
Quand l'Etat a pris les mesures nécessaires pour défendre la liberté et la propriété de chacun contre les entreprises et les empiétements, il a accompli tout son devoir et épuisé tout son droit. Toute intervention qui dépasserait cette limite serait à son tour, de la part de l'Etat, une entreprise et un empiétement sur la personne humaine.
Les socialistes exigent, au contraire, l'intervention de l'Etat dans les phénomènes de la vie économique ; c'est faute d'une législation sur la production et la distribution de la richesse que, malgré les conquêtes merveilleuses de la science, le bien-être de l'immense majorité des hommes n'a pas sensiblement augmenté ; bien plus, la transformation du monde par la science a rendu la misère des uns d'autant plus cruelle qu'elle se compare et se mesure à l'extraordinaire accroissement de la fortune des autres.