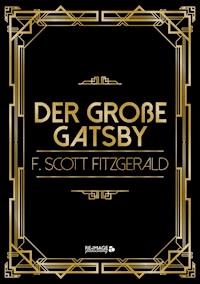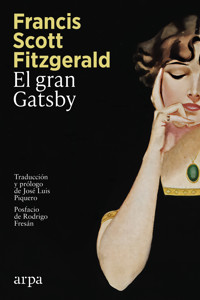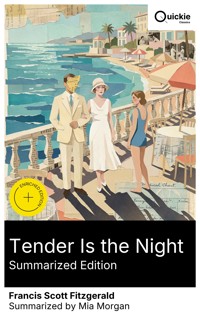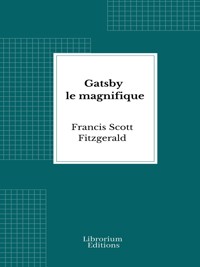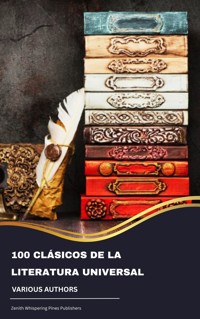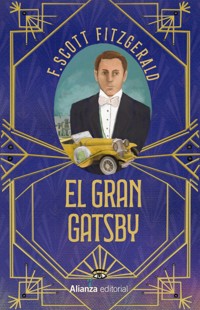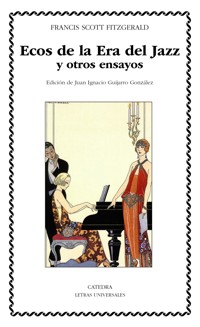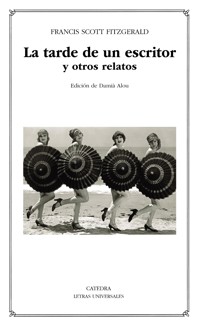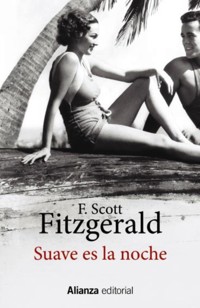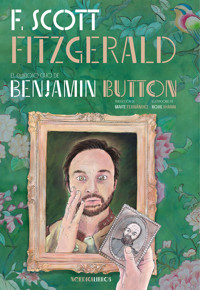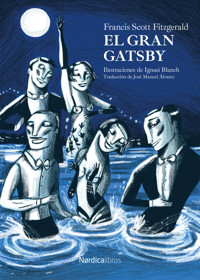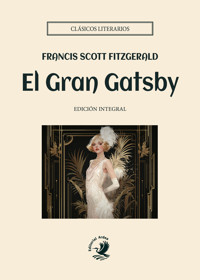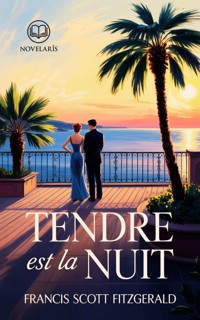
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
|
Côte d’Azur, années
1920. Dick et Nicole Diver sont le couple parfait. |
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francis Scott Fitzgerald
Tendre est la nuit
Copyright © 2025 Novelaris
Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion de ce livre est interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
ISBN: 9783689313067
Table des matières
LIVRE UN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
LIVRE DEUX
1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
LIVRE TROIS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Cover
Table of Contents
Text
LIVRE UN
I
Sur la côte agréable de la Côte d’Azur, à mi-chemin entre Marseille et la frontière italienne, se dresse un grand hôtel majestueux, de couleur rose. Des palmiers déférents rafraîchissent sa façade rougeoyante, et devant lui s’étend une petite plage éblouissante. Depuis peu, il est devenu un lieu de villégiature estivale pour les personnalités en vue et les gens à la mode ; il y a dix ans, il était presque désert après le départ de sa clientèle anglaise vers le nord au mois d’avril. Aujourd’hui, de nombreux bungalows s’y sont regroupés, mais au début de cette histoire, seules les coupoles d’une douzaine de vieilles villas pourrissaient comme des nénuphars parmi les pins massifs entre l’Hôtel des Étrangers de Gausse et Cannes, à huit kilomètres de là.
L’hôtel et sa plage, tel un tapis de prière brun clair, ne faisaient qu’un. Au petit matin, l’image lointaine de Cannes, le rose et le crème des anciennes fortifications, les Alpes violettes qui bordaient l’Italie, se reflétaient sur l’eau et tremblaient dans les ondulations et les cercles créés par les plantes marines à travers les eaux claires et peu profondes. Avant huit heures, un homme descendit à la plage en peignoir bleu et, après s’être longuement aspergé d’eau froide, grognant et respirant bruyamment, il pataugea une minute dans la mer. Une fois parti, la plage et la baie restèrent calmes pendant une heure. Des navires marchands rampaient vers l’ouest à l’horizon ; les garçons de salle criaient dans la cour de l’hôtel ; la rosée séchait sur les pins. Une heure plus tard, les klaxons des voitures ont commencé à retentir depuis la route sinueuse qui longe la basse chaîne des Maures, qui sépare le littoral de la véritable Provence.
À un kilomètre de la mer, là où les pins cèdent la place à des peupliers poussiéreux, se trouve un arrêt de chemin de fer isolé, d’où, un matin de juin 1925, une victoria amena une femme et sa fille à l’hôtel Gausse. Le visage de la mère avait une beauté fanée qui serait bientôt marquée par des veines éclatées ; son expression était à la fois tranquille et consciente, d’une manière agréable. Cependant, le regard se portait rapidement sur sa fille, qui avait de la magie dans ses paumes roses et ses joues illuminées d’une belle flamme, comme le rougeoiement excitant des enfants après leur bain froid du soir. Son front fin s’élevait doucement jusqu’à ses cheveux, qui l’entouraient comme un bouclier héraldique et se déployaient en boucles, ondulations et volutes blond cendré et doré. Ses yeux étaient brillants, grands, clairs, humides et étincelants, la couleur de ses joues était réelle, jaillissant près de la surface grâce à la forte pompe de son jeune cœur. Son corps flottait délicatement à la limite de l’enfance : elle avait presque dix-huit ans, elle était presque adulte, mais la rosée était encore sur elle.
Alors que la mer et le ciel apparaissaient sous eux en une fine ligne brûlante, la mère dit :
« Quelque chose me dit que nous n’allons pas aimer cet endroit. »
« Je veux rentrer à la maison de toute façon », répondit la jeune fille.
Elles parlaient toutes deux gaiement, mais elles étaient manifestement désorientées et ennuyées par cette situation. De plus, n’importe quelle direction ne leur convenait pas. Elles voulaient vivre des sensations fortes, non pas parce qu’elles avaient besoin de stimuler leurs nerfs blasés, mais avec l’avidité d’écolières méritant leurs vacances.
« Nous resterons trois jours, puis nous rentrerons à la maison. Je vais immédiatement envoyer un télégramme pour réserver des billets de bateau. »
À l’hôtel, la jeune fille fit la réservation dans un français idiomatique mais plutôt plat, comme s’il s’agissait d’un souvenir. Une fois installés au rez-de-chaussée, elle s’avança dans la lumière éblouissante des portes-fenêtres et sortit quelques pas sur la véranda en pierre qui longeait l’hôtel. Elle marchait comme une danseuse de ballet, sans s’affaler sur ses hanches, mais en se tenant droite au niveau du bas du dos. Dehors, la lumière chaude coupait son ombre et elle recula, car il faisait trop clair pour voir. À cinquante mètres de là, la Méditerranée livrait ses couleurs, instant après instant, au soleil brutal ; sous la balustrade, une Buick délavée cuisait sur l’allée de l’hôtel.
En effet, dans toute la région, seule la plage était animée. Trois nounous britanniques tricotaient au rythme lent de l’Angleterre victorienne, celui des années 40, 60 et 80, des pulls et des chaussettes, au son de commérages aussi formels que des incantations ; plus près de la mer, une douzaine de personnes se reposaient sous des parasols rayés, tandis que leur douzaine d’enfants poursuivaient sans crainte des poissons dans les eaux peu profondes ou s’allongeaient nus et luisants d’huile de coco au soleil.
Alors que Rosemary arrivait sur la plage, un garçon de douze ans passa en courant devant elle et se précipita dans la mer en poussant des cris de joie. Sentant le regard insistant de visages inconnus, elle ôta son peignoir et le suivit. Elle flottait à plat ventre sur quelques mètres et, constatant que l’eau était peu profonde, elle se mit debout et avança péniblement, traînant ses jambes minces comme des poids contre la résistance de l’eau. Lorsque l’eau lui arriva à hauteur de poitrine, elle jeta un coup d’œil vers le rivage : un homme chauve, portant un monocle et un collant, la poitrine velue bombée et le nombril effronté rentré, la regardait attentivement. Lorsque Rosemary lui rendit son regard, l’homme retira son monocle, qui se cacha parmi les moustaches facétieuses de sa poitrine, et se versa un verre de quelque chose à partir d’une bouteille qu’il tenait à la main.
Rosemary posa son visage sur l’eau et nagea à petits coups saccadés jusqu’au radeau. L’eau l’enveloppa, la tira tendrement hors de la chaleur, s’infiltra dans ses cheveux et coula dans les recoins de son corps. Elle tourna et tourna dans l’eau, l’embrassant, s’y vautrant. Arrivée au radeau, elle était à bout de souffle, mais une femme bronzée aux dents très blanches la regardait, et Rosemary, soudain consciente de la blancheur crue de son propre corps, se retourna sur le dos et dériva vers le rivage. L’homme velu qui tenait la bouteille lui parla alors qu’elle sortait de l’eau.
« Écoutez, il y a des requins derrière le radeau. » Il était d’une nationalité indéterminée, mais parlait anglais avec un lent accent d’Oxford. « Hier, ils ont dévoré deux marins britanniques de la flotte de Golfe Juan. »
« Mon Dieu ! s’exclama Rosemary.
« Ils viennent chercher les déchets de la flotte. »
Avec un regard vitreux pour indiquer qu’il avait seulement parlé pour l’avertir, il fit deux petits pas et se servit un autre verre.
Sans être désagréablement gênée, car l’attention s’était légèrement portée sur elle pendant cette conversation, Rosemary chercha un endroit où s’asseoir. De toute évidence, chaque famille possédait la bande de sable située juste devant son parasol ; en outre, il y avait beaucoup de visites et de discussions, créant une atmosphère communautaire dans laquelle il aurait été présomptueux de s’immiscer. Plus loin, là où la plage était jonchée de galets et d’algues mortes, était assis un groupe de personnes à la peau aussi blanche que la sienne. Ils étaient allongés sous de petits parasols à main plutôt que sous des parasols de plage et étaient manifestement moins indigènes que les autres. Entre les personnes à la peau foncée et celles à la peau claire, Rosemary trouva une place et étendit son peignoir sur le sable.
Allongée ainsi, elle entendit pour la première fois leurs voix et sentit leurs pieds effleurer son corps et leurs silhouettes passer entre le soleil et elle. Le souffle d’un chien curieux soufflait chaud et nerveux sur sa nuque ; elle sentait sa peau griller un peu sous la chaleur et entendait le petit wa-waa épuisé des vagues qui s’éteignaient. Bientôt, son oreille distingua des voix individuelles et elle comprit que quelqu’un, appelé avec mépris « ce type du Nord », avait kidnappé un serveur d’un café de Cannes la nuit dernière afin de le scier en deux. La source de cette histoire était une femme aux cheveux blancs vêtue d’une robe de soirée, vestige évident de la veille, car elle portait encore une tiare sur la tête et une orchidée fanée sur l’épaule. Rosemary, éprouvant une vague antipathie pour elle et ses compagnons, se détourna.
Tout près d’elle, de l’autre côté, une jeune femme était allongée sous un toit de parasols et dressait une liste à partir d’un livre ouvert sur le sable. Son maillot de bain était retiré de ses épaules et son dos, d’un brun orangé, rehaussé d’un collier de perles crème, brillait au soleil. Son visage était dur, beau et pitoyable. Ses yeux croisèrent ceux de Rosemary, mais ne la virent pas. Derrière elle se trouvait un bel homme coiffé d’une casquette de jockey et vêtu d’un collant rayé de rouge ; puis la femme que Rosemary avait vue sur le radeau et qui la regardait en retour, la voyant ; puis un homme au visage allongé et à la chevelure dorée et léonine, vêtu d’un collant bleu et sans chapeau, qui parlait très sérieusement à un jeune homme incontestablement latin vêtu d’un collant noir, tous deux ramassant de petits morceaux d’algues dans le sable. Elle pensait qu’ils étaient pour la plupart américains, mais quelque chose les rendait différents des Américains qu’elle avait connus récemment.
Au bout d’un moment, elle comprit que l’homme à la casquette de jockey faisait un petit numéro discret pour ce groupe ; il se déplaçait gravement avec un râteau, prélevant ostensiblement du gravier et développant entre-temps une sorte de burlesque ésotérique suspendu par son visage grave. La moindre de ses ramifications était devenue hilarante, jusqu’à ce que ses paroles déclenchent un éclat de rire. Même ceux qui, comme elle, étaient trop loin pour entendre, tendirent l’oreille jusqu’à ce que la seule personne sur la plage à ne pas être prise dans cette vague d’hilarité soit la jeune femme au collier de perles. Peut-être par modestie, elle répondait à chaque salve d’amusement en se penchant davantage sur sa liste.
L’homme au monocle et à la bouteille s’exclama soudainement depuis le ciel au-dessus de Rosemary.
« Vous êtes une nageuse hors pair. »
Elle hésita.
« Très bien. Je m’appelle Campion. Il y a ici une dame qui dit vous avoir vue à Sorrente la semaine dernière, qui sait qui vous êtes et qui aimerait beaucoup vous rencontrer. »
Jetant un regard autour d’elle avec une irritation dissimulée, Rosemary vit que les personnes au teint pâle attendaient. À contrecœur, elle se leva et alla vers eux.
« Mme Abrams, Mme McKisco, M. McKisco, M. Dumphry…
Nous savons qui vous êtes », dit la femme en robe de soirée. « Vous êtes Rosemary Hoyt, je vous ai reconnue à Sorrento, j’ai demandé au réceptionniste de l’hôtel et nous pensons tous que vous êtes absolument merveilleuse. Nous aimerions savoir pourquoi vous n’êtes pas de retour aux États-Unis pour tourner un autre film merveilleux. »
Ils firent un geste superflu pour lui faire de la place. La femme qui l’avait reconnue n’était pas juive, malgré son nom. Elle faisait partie de ces personnes âgées « bonnes vivantes » préservées par une imperméabilité à l’expérience et une bonne digestion dans une autre génération.
« Nous voulions vous avertir de ne pas vous brûler le premier jour, a-t-elle poursuivi joyeusement, car votre peau est importante, mais il semble y avoir tellement de formalités sur cette plage que nous ne savions pas si cela vous dérangerait. »
II
« Nous avons pensé que vous faisiez peut-être partie du complot », dit Mme McKisco. C’était une jolie jeune femme aux yeux ternes, d’une intensité décourageante. « Nous ne savons pas qui fait partie du complot et qui n’en fait pas partie. Un homme avec lequel mon mari avait été particulièrement gentil s’est avéré être un personnage principal, pratiquement le héros secondaire.
« Le complot ? » demanda Rosemary, qui comprenait à moitié. « Il y a un complot ? »
— Ma chère, nous ne le savons pas, répondit Mme Abrams avec un petit rire convulsif de femme corpulente. Nous n’en faisons pas partie. Nous sommes dans la galerie.
M. Dumphry, un jeune homme efféminé aux cheveux blonds, fit remarquer : « Maman Abrams est un personnage à elle seule. » Campion agita son monocle dans sa direction en disant : « Allons, Royal, ne soyez pas trop effrayant. » Rosemary les regarda tous avec malaise, regrettant que sa mère ne soit pas venue avec elle. Elle n’aimait pas ces gens, surtout lorsqu’elle les comparait à ceux qui l’avaient intéressée à l’autre bout de la plage. Le don social modeste mais efficace de sa mère leur permettait de se sortir rapidement et fermement des situations délicates. Mais Rosemary n’était une célébrité que depuis six mois, et parfois, les manières françaises de son adolescence et les manières démocratiques de l’Amérique, ces dernières se superposant, créaient une certaine confusion et la mettaient dans ce genre de situations.
M. McKisco, un homme maigre, roux et couvert de taches de rousseur, âgé d’une trentaine d’années, ne trouvait pas le sujet du « complot » amusant. Il regardait la mer fixement, puis, après avoir jeté un rapide coup d’œil à sa femme, il se tourna vers Rosemary et lui demanda d’un ton agressif :
« Vous êtes ici depuis longtemps ?
— Seulement un jour.
« Oh.
Sentant manifestement que le sujet avait complètement changé, il regarda tour à tour les autres.
« Vous allez rester tout l’été ? demanda innocemment Mme McKisco. Si c’est le cas, vous pourrez voir le complot se dérouler.
« Pour l’amour de Dieu, Violet, change de sujet ! » s’écria son mari. « Trouve une nouvelle blague, pour l’amour de Dieu ! »
Mme McKisco se pencha vers Mme Abrams et murmura d’une voix audible :
« Il est nerveux. »
« Je ne suis pas nerveux », contredit McKisco. « Il se trouve simplement que je ne suis pas nerveux du tout. »
Il était visiblement en train de brûler — une rougeur grisâtre s’était répandue sur son visage, dissolvant toutes ses expressions dans une vaste inefficacité. Soudain conscient de son état, il se leva pour aller dans l’eau, suivi de sa femme, et saisissant l’occasion, Rosemary le suivit.
M. McKisco prit une longue inspiration, se jeta dans les eaux peu profondes et commença à battre l’eau de la Méditerranée avec ses bras raides, dans une tentative évidente de nager la brasse. À bout de souffle, il se redressa et regarda autour de lui avec une expression de surprise, surpris de voir qu’il était toujours en vue du rivage.
« Je n’ai pas encore appris à respirer. Je n’ai jamais vraiment compris comment ils respiraient. » Il regarda Rosemary d’un air interrogateur.
« Je pense qu’il faut expirer sous l’eau, expliqua-t-elle. Et tous les quatre mouvements, il faut tourner la tête pour respirer.
— C’est la respiration qui me pose le plus de problèmes. On va sur le radeau ?
L’homme à la tête de lion était allongé sur le radeau, qui tanguait au gré des mouvements de l’eau. Alors que Mme McKisco tendait la main pour l’atteindre, une inclinaison soudaine lui fit lever le bras brusquement, sur quoi l’homme se redressa et la tira à bord.
« J’avais peur que cela vous heurte. Sa voix était lente et timide ; il avait l’un des visages les plus tristes que Rosemary ait jamais vus, les pommettes saillantes d’un Indien, une longue lèvre supérieure et d’énormes yeux dorés enfoncés dans leurs orbites. Il avait parlé du coin de la bouche, comme s’il espérait que ses mots parviendraient à Mme McKisco par un chemin détourné et discret ; en une minute, il s’était éloigné dans l’eau et son long corps gisait immobile vers le rivage.
Rosemary et Mme McKisco le regardèrent. Lorsqu’il eut épuisé son élan, il se plia brusquement en deux, ses cuisses minces émergèrent de la surface, puis il disparut complètement, ne laissant derrière lui qu’une petite trace d’écume.
« C’est un bon nageur », dit Rosemary.
La réponse de Mme McKisco fut d’une violence surprenante.
« Eh bien, c’est un musicien épouvantable. » Elle se tourna vers son mari qui, après deux tentatives infructueuses, avait réussi à monter sur le radeau et, ayant retrouvé son équilibre, essayait de faire une sorte de geste compensatoire, ne réussissant qu’à vaciller davantage. « Je disais juste qu’Abe North est peut-être un bon nageur, mais c’est un musicien épouvantable.
« Oui », acquiesça McKisco à contrecœur. De toute évidence, il avait créé l’univers de sa femme et ne lui accordait que peu de libertés dans celui-ci.
« Antheil est mon homme. » Mme McKisco se tourna vers Rosemary d’un air provocateur : « Antheil et Joyce. Je suppose que vous n’entendez pas beaucoup parler de ce genre de personnes à Hollywood, mais mon mari a écrit la première critique d’Ulysse jamais publiée en Amérique. »
« J’aimerais avoir une cigarette, dit calmement McKisco. C’est plus important pour moi en ce moment.
« Il a du cœur, tu ne trouves pas, Albert ? »
Sa voix s’éteignit soudainement. La femme aux perles avait rejoint ses deux enfants dans l’eau, et Abe North surgit alors sous l’un d’eux comme une île volcanique, le soulevant sur ses épaules. L’enfant hurla de peur et de joie, et la femme regardait la scène avec une paix adorable, sans sourire.
« C’est sa femme ? demanda Rosemary.
« Non, c’est Mme Diver. Ils ne sont pas à l’hôtel. » Ses yeux, photographiques, ne quittaient pas le visage de la femme. Au bout d’un moment, elle se tourna avec véhémence vers Rosemary.
« Êtes-vous déjà allée à l’étranger ?
— Oui, j’ai fait mes études à Paris.
« Oh ! Alors vous savez sans doute que pour profiter pleinement de votre séjour ici, il faut apprendre à connaître de vraies familles françaises. Qu’est-ce que ces gens ont à y gagner ? » Elle désigna le rivage du bout de son épaule gauche. « Ils restent entre eux, en petites cliques. Bien sûr, nous avions des lettres d’introduction et avons rencontré tous les meilleurs artistes et écrivains français à Paris. C’était très agréable.
« Je m’en doute.
« Mon mari est en train de terminer son premier roman, vous voyez.
Rosemary répondit : « Ah bon ? » Elle ne pensait à rien de particulier, si ce n’est se demander si sa mère avait réussi à dormir malgré la chaleur.
« Il s’inspire d’Ulysse, poursuivit Mme McKisco. Mais au lieu de vingt-quatre heures, mon mari prend cent ans. Il prend un vieil aristocrate français décadent et le met en contraste avec l’ère mécanique… »
« Oh, pour l’amour de Dieu, Violet, ne racontez pas l’idée à tout le monde, protesta McKisco. Je ne veux pas que cela se sache avant la publication du livre. »
Rosemary nagea jusqu’au rivage, où elle jeta son peignoir sur ses épaules déjà endolories et se allongea à nouveau au soleil. L’homme à la casquette de jockey passait maintenant de parasol en parasol, une bouteille et des petits verres à la main ; bientôt, lui et ses amis devinrent plus animés et se rapprochèrent, et ils se retrouvèrent tous sous un seul ensemble de parasols — elle comprit que quelqu’un partait et qu’il s’agissait d’un dernier verre sur la plage. Même les enfants sentaient l’excitation monter sous ce parasol et se tournaient vers lui. Rosemary avait l’impression que tout venait de l’homme à la casquette de jockey.
Midi dominait la mer et le ciel. Même la ligne blanche de Cannes, à huit kilomètres de là, s’était estompée en un mirage de fraîcheur et de douceur. Un voilier à la coque rouge vif tirait derrière lui un filet de la mer extérieure, plus sombre. Il semblait n’y avoir aucune vie dans toute cette étendue côtière, sauf sous la lumière tamisée de ces parasols, où quelque chose se passait au milieu des couleurs et des murmures.
Campion s’approcha d’elle, s’arrêta à quelques mètres et Rosemary ferma les yeux, faisant semblant de dormir ; puis elle les entrouvrit et regarda deux piliers flous et indistincts qui étaient des jambes. L’homme tenta de se faufiler dans un nuage couleur sable, mais celui-ci s’éloigna dans le vaste ciel brûlant. Rosemary s’endormit pour de bon.
Elle se réveilla trempée de sueur et trouva la plage déserte, à l’exception de l’homme à la casquette de jockey, qui pliait un dernier parasol. Alors que Rosemary clignait des yeux, il s’approcha et dit :
« J’allais vous réveiller avant de partir. Il n’est pas bon de prendre trop de coups de soleil dès le début. »
« Merci. » Rosemary baissa les yeux vers ses jambes cramoisies.
« Mon Dieu !
Elle rit joyeusement, l’invitant à discuter, mais Dick Diver était déjà en train de porter une tente et un parasol jusqu’à une voiture qui l’attendait, alors elle alla dans l’eau pour se laver la sueur. Il revint et rassembla un râteau, une pelle et un tamis, qu’il rangea dans une crevasse d’un rocher. Il regarda de haut en bas de la plage pour voir s’il n’avait rien oublié.
« Savez-vous quelle heure il est ? demanda Rosemary.
« Il est environ une heure et demie. »
Ils contemplèrent ensemble le paysage marin pendant un moment.
« Ce n’est pas un mauvais moment », dit Dick Diver. « Ce n’est pas l’un des pires moments de la journée. »
Il la regarda et, l’espace d’un instant, elle vécut dans le monde bleu vif de ses yeux, avec enthousiasme et confiance. Puis il chargea son dernier morceau de ferraille sur son épaule et monta à sa voiture, tandis que Rosemary sortait de l’eau, secouait son peignoir et se dirigeait vers l’hôtel.
III
Il était presque deux heures lorsqu’ils entrèrent dans la salle à manger. Au-dessus des tables désertes, un motif dense de rayons et d’ombres oscillait au rythme du mouvement des pins à l’extérieur. Deux serveurs, qui empilaient des assiettes et parlaient fort en italien, se turent lorsqu’ils entrèrent et leur apportèrent une version fatiguée du déjeuner de la table d’hôte.
« Je suis tombée amoureuse sur la plage », dit Rosemary.
« Avec qui ?
D’abord de plein de gens qui avaient l’air sympa. Puis d’un homme.
— Tu lui as parlé ?
— Juste un peu. Il était très beau. Avec des cheveux roux. » Elle mangeait avec appétit. « Mais il est marié, c’est souvent comme ça.
Sa mère était sa meilleure amie et avait mis toutes ses forces à la guider, ce qui n’est pas si rare dans le milieu du théâtre, mais plutôt spécial dans la mesure où Mme Elsie Speers ne cherchait pas à se rattraper d’un échec personnel. Elle n’avait aucune amertume ni aucun ressentiment envers la vie : deux fois mariée et deux fois veuve, son stoïcisme joyeux s’était chaque fois renforcé. L’un de ses maris avait été officier de cavalerie et l’autre médecin militaire, et tous deux lui avaient laissé quelque chose qu’elle essayait de transmettre intact à Rosemary. En ne ménageant pas Rosemary, elle l’avait endurcie ; en ne ménageant pas ses propres efforts et son dévouement, elle avait cultivé chez Rosemary un idéalisme qui, à l’heure actuelle, était dirigé vers elle-même et lui permettait de voir le monde à travers ses yeux. Ainsi, bien que Rosemary fût une enfant « simple », elle était protégée par une double armure, celle de sa mère et la sienne : elle avait une méfiance mûre envers le trivial, le facile et le vulgaire. Cependant, avec le succès soudain de Rosemary au cinéma, Mme Speers sentit qu’il était temps de la sevrer spirituellement ; cela lui ferait plus plaisir que de la peiner si cet idéalisme quelque peu exubérant, haletant et exigeant se concentrait sur autre chose qu’elle-même.
« Alors, tu aimes cet endroit ? » demanda-t-elle.
« Ce serait peut-être amusant si nous connaissions ces gens. Il y avait d’autres personnes, mais elles n’étaient pas gentilles. Elles m’ont reconnue — peu importe où nous allons, tout le monde a vu « Daddy’s Girl ».
Mme Speers attendit que la lueur d’égocentrisme s’estompe, puis elle dit d’un ton neutre : « Cela me rappelle, quand vas-tu voir Earl Brady ?
— Je pensais que nous pourrions y aller cet après-midi, si tu es reposée.
— Vas-y, moi je n’y vais pas.
— Alors nous attendrons demain.
— Je veux que tu y ailles seul. Ce n’est pas loin, ce n’est pas comme si tu ne parlais pas français.
— Maman, n’y a-t-il pas certaines choses que je ne suis pas obligé de faire ?
— Oh, alors vas-y plus tard, mais avant notre départ.
— D’accord, maman.
Après le déjeuner, elles furent toutes deux submergées par le sentiment d’apathie qui envahit souvent les voyageurs américains dans les endroits étrangers tranquilles. Aucun stimulus ne les stimulait, aucune voix ne les appelait de l’extérieur, aucun fragment de leurs propres pensées ne leur venait soudainement de l’esprit des autres, et, privées du tumulte de l’Empire, elles avaient l’impression que la vie ne continuait pas ici.
« Restons seulement trois jours, maman », dit Rosemary lorsqu’elles furent de retour dans leur chambre. Dehors, un vent léger soufflait la chaleur, la filtrant à travers les arbres et envoyant de petites rafales chaudes à travers les volets.
« Et l’homme dont tu es tombée amoureuse sur la plage ?
« Je n’aime personne d’autre que toi, maman, ma chérie. »
Rosemary s’arrêta dans le hall et parla des trains avec Gausse père. Le concierge, affalé dans son uniforme kaki clair près du bureau, la fixa d’un regard rigide, puis se souvint soudain des règles de son métier. Elle prit le bus et se rendit à la gare en compagnie de deux serveurs obséquieux, gênée par leur silence respectueux, et eut envie de les encourager : « Allez-y, parlez, amusez-vous. Cela ne me dérange pas. »
Le compartiment de première classe était étouffant ; les cartes publicitaires colorées des compagnies ferroviaires – le Pont du Gard à Arles, l’amphithéâtre d’Orange, les sports d’hiver à Chamonix – étaient plus vivantes que la mer immobile à l’extérieur. Contrairement aux trains américains, absorbés dans leur propre destin intense et méprisants envers les gens d’un autre monde moins rapide et moins haletant, ce train faisait partie du pays qu’il traversait. Son souffle soulevait la poussière des feuilles de palmier, les cendres se mêlaient au fumier sec des jardins. Rosemary était sûre qu’elle pouvait se pencher par la fenêtre et cueillir des fleurs à la main.
Une douzaine de chauffeurs de taxi dormaient dans leurs cabriolets devant la gare de Cannes. Sur la promenade, le casino, les boutiques chics et les grands hôtels tournaient leurs masques de fer vides vers la mer estivale. Il était incroyable qu’il ait jamais pu y avoir une « saison », et Rosemary, à moitié sous l’emprise de la mode, devint un peu gênée, comme si elle affichait un goût malsain pour le moribond, comme si les gens se demandaient pourquoi elle était là, dans l’accalmie entre la gaieté de l’hiver dernier et celle de l’hiver prochain, alors que dans le nord, le monde réel grondait.
Alors qu’elle sortait d’une pharmacie avec une bouteille d’huile de coco, une femme, qu’elle reconnut comme étant Mme Diver, croisa son chemin, les bras chargés de coussins de canapé, et se dirigea vers une voiture garée dans la rue. Un long chien noir à poil court aboya dans sa direction, réveillant en sursaut le chauffeur qui somnolait. Elle s’assit dans la voiture, le visage charmant, impassible, les yeux courageux et vigilants, regardant droit devant elle sans rien fixer. Elle portait une robe rouge vif et ses jambes brunes étaient nues. Elle avait des cheveux épais, foncés et dorés, comme ceux d’un chow-chow.
Ayant une demi-heure à attendre avant son train, Rosemary s’assit au Café des Alliés sur la Croisette, où les arbres créaient une pénombre verte au-dessus des tables et où un orchestre séduisait un public imaginaire de cosmopolites avec la chanson du carnaval de Nice et un air américain de l’année dernière. Elle avait acheté Le Temps et The Saturday Evening Post pour sa mère, et tout en buvant sa citronnade, elle ouvrit ce dernier au récit des mémoires d’une princesse russe, trouvant les conventions floues des années 90 plus réelles et plus proches que les gros titres du journal français. C’était le même sentiment qui l’avait oppressée à l’hôtel : habituée à voir les grotesqueries les plus criantes d’un continent fortement soulignées comme une comédie ou une tragédie, peu entraînée à la tâche de séparer l’essentiel pour elle-même, elle commençait maintenant à trouver la vie française vide et fade. Ce sentiment était exacerbé par les mélodies tristes de l’orchestre, qui rappelaient la musique mélancolique jouée pour les acrobates dans les vaudevilles. Elle était contente de retourner à l’hôtel Gausse.
Ses épaules étaient trop brûlées pour qu’elle puisse se baigner le lendemain, alors elle et sa mère louèrent une voiture — après avoir longuement marchandé, car Rosemary s’était fait sa propre idée de la valeur de l’argent en France — et roulèrent le long de la Riviera, le delta de nombreux fleuves. Le chauffeur, un tsar russe de l’époque d’Ivan le Terrible, s’était autoproclamé guide, et les noms resplendissants – Cannes, Nice, Monte-Carlo – commencèrent à briller à travers leur camouflage torpide, murmurant l’histoire des anciens rois venus ici pour dîner ou mourir, des rajahs jetant des yeux de Bouddha aux ballerines anglaises, des princes russes transformant les semaines en crépuscules baltiques à l’époque perdue du caviar. Mais surtout, il y avait l’odeur des Russes le long de la côte, leurs librairies et leurs épiceries fermées. Il y a dix ans, lorsque la saison s’est terminée en avril, les portes de l’église orthodoxe ont été verrouillées et les champagnes doux qu’ils appréciaient ont été rangés jusqu’à leur retour. « Nous reviendrons la saison prochaine », ont-ils dit, mais c’était prématuré, car ils ne reviendraient plus jamais.
C’était agréable de rentrer à l’hôtel en fin d’après-midi, au-dessus d’une mer aux couleurs mystérieuses comme les agates et les cornalines de l’enfance, verte comme du lait vert, bleue comme l’eau de lessive, sombre comme du vin. C’était agréable de croiser des gens qui mangeaient devant leur porte et d’entendre les pianos mécaniques endiablés derrière les vignes des estaminets de campagne. Lorsqu’ils quittèrent la Corniche d’Or et descendirent vers l’hôtel Gausse à travers les rangées d’arbres qui s’assombrissaient, alignés les uns derrière les autres dans une multitude de verts, la lune planait déjà au-dessus des ruines des aqueducs…
Quelque part dans les collines derrière l’hôtel, il y avait un bal, et Rosemary écoutait la musique à travers la lueur fantomatique de sa moustiquaire, réalisant qu’il y avait aussi de la gaieté quelque part, et elle pensait aux gens sympathiques sur la plage. Elle pensait les rencontrer le lendemain matin, mais ils formaient manifestement un petit groupe autosuffisant, et une fois leurs parasols, leurs nattes de bambou, leurs chiens et leurs enfants installés, la partie de la plage était littéralement clôturée. Elle décida en tout cas de ne pas passer ses deux dernières matinées avec les autres.
IV
La question était réglée pour elle. Les McKisco n’étaient pas encore là et elle avait à peine étendu son peignoir que deux hommes – celui qui portait une casquette de jockey et le grand blond, qui avait tendance à scier les serveurs en deux – quittèrent le groupe et descendirent vers elle.
« Bonjour », dit Dick Diver. Il craqua. « Écoutez, coup de soleil ou pas, pourquoi êtes-vous restée à l’écart hier ? Nous nous sommes inquiétés pour vous. »
Elle se redressa et accueillit leur intrusion d’un petit rire joyeux.
« Nous nous demandions, dit Dick Diver, si vous ne viendriez pas ce matin. Nous entrons, nous prenons à manger et à boire, c’est donc une invitation substantielle. »
Il semblait gentil et charmant – sa voix promettait qu’il prendrait soin d’elle et que, un peu plus tard, il lui ouvrirait de nouveaux horizons, lui dévoilerait une succession infinie de possibilités magnifiques. Il réussit à faire les présentations sans mentionner son nom, puis lui fit comprendre avec aisance que tout le monde savait qui elle était, mais respectait l’intimité de sa vie privée – une courtoisie que Rosemary n’avait rencontrée que chez des professionnels depuis son succès.
Nicole Diver, le dos brun pendu à ses perles, parcourait un livre de recettes à la recherche d’un poulet Maryland. Elle avait environ vingt-quatre ans, estima Rosemary. Son visage pouvait être qualifié de joli au sens conventionnel du terme, mais il donnait l’impression d’avoir d’abord été sculpté à l’échelle héroïque, avec une structure et des traits marqués, comme si les traits et la vivacité du front et de la couleur, tout ce que nous associons au tempérament et au caractère, avaient été modelés avec une intention rodinienne, puis ciselés dans le sens de la beauté jusqu’à un point où un seul faux pas aurait irrémédiablement diminué sa force et sa qualité. Avec la bouche, le sculpteur avait pris des risques désespérés : elle ressemblait à l’arc de Cupidon d’une couverture de magazine, mais elle partageait la distinction du reste.
« Tu restes longtemps ? » demanda Nicole. Sa voix était basse, presque dure.
Soudain, Rosemary envisagea la possibilité qu’ils restent une semaine de plus.
« Pas très longtemps », répondit-elle vaguement. « Nous sommes à l’étranger depuis longtemps. Nous avons atterri en Sicile en mars et nous avons lentement remonté vers le nord. J’ai attrapé une pneumonie en tournant un film en janvier dernier et je me remets encore. »
« Mon Dieu ! Comment cela s’est-il produit ? »
« Eh bien, c’était en nageant », répondit Rosemary, plutôt réticente à se livrer à des confidences personnelles. « Un jour, j’avais la grippe sans le savoir, et ils tournaient une scène où je plongeais dans un canal à Venise. C’était un décor très coûteux, alors j’ai dû plonger, plonger et plonger toute la matinée. Ma mère avait un médecin sur place, mais cela n’a servi à rien, j’ai attrapé une pneumonie. » Elle changea résolument de sujet avant qu’ils n’aient le temps de réagir. « Vous aimez cet endroit ?
« Ils sont obligés de l’aimer, répondit lentement Abe North. C’est eux qui l’ont inventé. » Il tourna lentement sa tête noble afin que son regard repose avec tendresse et affection sur les deux plongeurs.
« Oh, vraiment ?
« Ce n’est que la deuxième saison que l’hôtel est ouvert en été », expliqua Nicole. « Nous avons persuadé Gausse de garder un cuisinier, un garçon et un chasseur. Cela a porté ses fruits et cette année, ça marche encore mieux.
— Mais vous n’êtes pas à l’hôtel.
— Nous avons construit une maison, à Tarmes.
— En théorie, dit Dick en ajustant un parasol pour protéger l’épaule de Rosemary d’un rayon de soleil, tous les endroits du nord, comme Deauville, ont été choisis par les Russes et les Anglais qui ne craignent pas le froid, tandis que la moitié d’entre nous, Américains, venons de climats tropicaux — c’est pourquoi nous commençons à venir ici.
Le jeune homme d’apparence latine tournait les pages du New York Herald.
« Eh bien, de quelle nationalité sont ces personnes ? demanda-t-il soudainement, et il lut avec un léger accent français : « Sont enregistrés à l’hôtel Palace de Vevey M. Pandely Vlasco, Mme Bonneasse — je n’exagère pas — Corinna Medonca, Mme Pasche, Seraphim Tullio, Maria Amalia Roto Mais, Moises Teubel, Mme Paragoris, Apostle Alexandre, Yolanda Yosfuglu et Geneveva de Momus ! C’est elle qui m’attire le plus, Geneveva de Momus. Ça vaut presque la peine de courir à Vevey pour voir Geneveva de Momus. »
Il se leva avec une agitation soudaine, s’étirant d’un mouvement brusque. Il était plus jeune que Diver ou North de quelques années. Il était grand et son corps était musclé, mais trop maigre, à l’exception de la force concentrée dans ses épaules et ses bras. À première vue, il semblait d’une beauté conventionnelle, mais son visage affichait toujours un léger dégoût qui gâchait l’éclat intense de ses yeux bruns. Pourtant, on s’en souvenait après coup, lorsqu’on avait oublié l’incapacité de sa bouche à supporter l’ennui et son jeune front sillonné de rides d’inquiétude et de douleur inutile.
« Nous en avons trouvé de très bons dans les nouvelles américaines de la semaine dernière, dit Nicole. Mme Evelyn Oyster et… qui d’autre déjà ?
— Il y avait M. S. Flesh », dit Diver en se levant également. Il prit son râteau et se mit sérieusement à retirer les petits cailloux du sable.
« Oh, oui… S. Flesh… Il ne te donne pas la chair de poule ?
C’était calme, seule avec Nicole — Rosemary trouvait cela encore plus calme qu’avec sa mère. Abe North et Barban, le Français, parlaient du Maroc, et Nicole, après avoir copié sa recette, se mit à coudre. Rosemary examina leurs accessoires : quatre grands parasols qui formaient un auvent ombragé, une cabine de bain portable pour s’habiller, un cheval pneumatique en caoutchouc, des objets nouveaux que Rosemary n’avait jamais vus, issus de la première vague de fabrication de produits de luxe après la guerre, et probablement entre les mains des premiers acheteurs. Elle avait compris qu’il s’agissait de personnes à la mode, mais bien que sa mère l’ait élevée pour se méfier de ce genre de personnes qu’elle considérait comme des parasites, elle ne ressentait pas cela ici. Même dans leur immobilité absolue, aussi complète que celle du matin, elle sentait un but, un travail sur quelque chose, une direction, un acte de création différent de tout ce qu’elle avait connu. Son esprit immature ne spéculait pas sur la nature de leurs relations les uns avec les autres, elle ne se préoccupait que de leur attitude envers elle-même, mais elle percevait le réseau d’une agréable interrelation, qu’elle exprimait par la pensée qu’ils semblaient passer un très bon moment.
Elle regarda tour à tour les trois hommes, les s’appropriant temporairement. Tous trois étaient séduisants à leur manière ; tous avaient une douceur particulière qui, selon elle, faisait partie de leur vie, passée et future, et qui n’était pas liée aux circonstances, contrairement aux manières en société des acteurs. Elle détecta également une délicatesse profonde, différente de la camaraderie rude et spontanée des réalisateurs, qui représentaient les intellectuels dans sa vie. Les acteurs et les réalisateurs : c’étaient les seuls hommes qu’elle ait jamais connus, ceux-là et la masse hétérogène et indistincte d’étudiants, intéressés uniquement par le coup de foudre, qu’elle avait rencontrés au bal de fin d’année de Yale l’automne dernier.
Ces trois-là étaient différents. Barban était moins civilisé, plus sceptique et moqueur, ses manières étaient formelles, voire superficielles. Abe North avait, sous sa timidité, un humour désespéré qui l’amusait mais la déconcertait. Sa nature sérieuse se méfiait de sa capacité à faire une impression suprême sur lui.
Mais Dick Diver… il était tout à fait complet. Elle l’admirait en silence. Son teint était rougeâtre et brûlé par le soleil, tout comme ses cheveux courts, dont une légère pousse descendait le long de ses bras et de ses mains. Ses yeux étaient d’un bleu vif et dur. Son nez était quelque peu pointu et il n’y avait jamais aucun doute sur la personne qu’il regardait ou à qui il parlait - et c’est une attention flatteuse, car qui nous regarde ? Les regards se posent sur nous, curieux ou désintéressés, rien de plus. Sa voix, avec une légère mélodie irlandaise, séduisait le monde, mais elle sentait en lui une certaine dureté, une maîtrise de soi et une autodiscipline, ses propres vertus. Oh, elle le choisit, et Nicole, levant la tête, la vit le choisir, entendit le petit soupir qu’elle poussa en réalisant qu’il était déjà pris.
Vers midi, les McKisco, Mme Abrams, M. Dumphry et Signor Campion arrivèrent sur la plage. Ils avaient apporté un nouveau parasol qu’ils installèrent en jetant des regards en coin aux Divers, et se glissèrent dessous avec des expressions satisfaites — tous sauf M. McKisco, qui resta dehors avec dédain. En ratissant la plage, Dick était passé près d’eux et revenait maintenant vers les parasols.
« Les deux jeunes hommes lisent ensemble le Livre des bonnes manières », dit-il à voix basse.
« Ils prévoient de se mêler à la haute société », dit Abe.
Mary North, la jeune femme très bronzée que Rosemary avait rencontrée le premier jour sur le radeau, revint de sa baignade et dit avec un sourire malicieux :
« M. et Mme Neverquiver sont donc arrivés.
« Ce sont les amis de cet homme », lui rappela Nicole en désignant Abe. « Pourquoi ne va-t-il pas leur parler ? Tu ne les trouves pas séduisants ? »
« Je les trouve très séduisants », acquiesça Abe. « Mais je ne les trouve pas séduisants, c’est tout. »
— Eh bien, j’ai trouvé qu’il y avait trop de monde sur la plage cet été », admit Nicole. « Notre plage que Dick a créée à partir d’un tas de galets. Elle réfléchit, puis baissa la voix pour ne pas être entendue par le trio de nounous assises sous un autre parasol. « Mais elles sont tout de même préférables à ces Britanniques de l’été dernier qui n’arrêtaient pas de s’exclamer : « La mer n’est-elle pas bleue ? Le ciel n’est-il pas blanc ? Le nez de la petite Nellie n’est-il pas rouge ? »
Rosemary se dit qu’elle n’aimerait pas avoir Nicole comme ennemie.
« Mais tu n’as pas vu la dispute », continua Nicole. « La veille de ton arrivée, l’homme marié, celui dont le nom ressemble à un substitut pour l’essence ou le beurre… »
« McKisco ?
— Oui… Eh bien, ils se disputaient et elle lui a jeté du sable au visage. Alors, naturellement, il s’est assis sur elle et lui a frotté le visage dans le sable. Nous étions… électrisés. Je voulais que Dick intervienne.
— Je pense, dit Dick Diver en fixant distraitement la natte de paille, que je vais aller les inviter à dîner.
— Non, tu ne le feras pas, lui dit rapidement Nicole.
— Je pense que ce serait une très bonne chose. Ils sont là, adaptons-nous.
— Nous sommes très bien adaptés, insista-t-elle en riant. Je ne vais pas me faire frotter le nez dans le sable. Je suis une femme méchante et dure, expliqua-t-elle à Rosemary, puis, élevant la voix, elle ajouta : « Les enfants, mettez vos maillots de bain ! »
Rosemary sentit que cette baignade allait devenir emblématique de sa vie, celle qui lui reviendrait toujours à l’esprit dès qu’on évoquerait la natation. Tout le monde se dirigea vers l’eau, prêt à se jeter à l’eau après cette longue période d’inaction forcée, passant de la chaleur à la fraîcheur avec la gourmandise d’un curry épicé accompagné de vin blanc bien frais. La journée des plongeurs était rythmée comme celle des civilisations anciennes afin de tirer le meilleur parti des matériaux disponibles et de donner toute leur valeur à toutes les transitions. Elle ne savait pas qu’il y aurait bientôt une autre transition, passant de l’absorption totale de la baignade à la loquacité de l’heure du déjeuner provençal. Mais une fois de plus, elle eut le sentiment que Dick prenait soin d’elle, et elle se réjouit de répondre à ce mouvement inévitable comme s’il s’agissait d’un ordre.
Nicole tendit à son mari le curieux vêtement sur lequel elle avait travaillé. Il entra dans la tente où l’on s’habillait et provoqua une agitation en réapparaissant quelques instants plus tard vêtu d’un caleçon transparent en dentelle noire. En y regardant de plus près, on voyait qu’il était doublé d’un tissu couleur chair.
« Eh bien, si ce n’est pas une astuce de pédé ! s’exclama M. McKisco avec mépris, puis, se tournant rapidement vers M. Dumphry et M. Campion, il ajouta : « Oh, je vous demande pardon. »
Rosemary était ravie de ces caleçons. Sa naïveté répondait sans réserve à la simplicité coûteuse des Divers, inconsciente de sa complexité et de son manque d’innocence, inconsciente que tout cela relevait davantage d’une sélection de qualité que de quantité parmi les produits du bazar mondial ; et que la simplicité du comportement également, la paix et la bonne volonté dignes d’une nurserie, l’accent mis sur les vertus les plus simples, faisaient partie d’un pacte désespéré avec les dieux et avaient été obtenus au prix de luttes qu’elle ne pouvait imaginer. À ce moment-là, les Diver représentaient extérieurement l’évolution la plus avancée d’une classe sociale, de sorte que la plupart des gens semblaient maladroits à leurs côtés — en réalité, un changement qualitatif s’était déjà opéré, ce qui n’était pas du tout apparent pour Rosemary.
Elle se tenait avec eux tandis qu’ils buvaient du sherry et mangeaient des crackers. Dick Diver la regardait de ses yeux bleus froids ; sa bouche aimable et forte dit d’un ton pensif et délibéré :
« Tu es la seule fille que j’ai vue depuis longtemps qui ressemble vraiment à quelque chose qui s’épanouit. »
Dans les bras de sa mère, Rosemary pleura longuement.
« Je l’aime, maman. Je suis follement amoureuse de lui, je ne savais pas que je pouvais ressentir ça pour quelqu’un. Mais il est marié et je l’aime bien aussi, c’est sans espoir. Oh, je l’aime tellement ! »
« Je suis curieuse de le rencontrer.
— Elle nous a invités à dîner vendredi.
— Si tu es amoureuse, cela devrait te rendre heureuse. Tu devrais rire.
Rosemary leva les yeux, eut un petit frisson qui embellit son visage et rit. Sa mère avait toujours eu une grande influence sur elle.
V
Rosemary se rendit à Monte-Carlo avec autant de mauvaise humeur qu’il lui était possible. Elle gravit la colline escarpée jusqu’à La Turbie, jusqu’à un ancien terrain Gaumont en cours de reconstruction, et tandis qu’elle attendait près de l’entrée grillagée une réponse au message inscrit sur sa carte, elle aurait pu se croire à Hollywood. Les débris bizarres d’un film récent, une scène de rue délabrée en Inde, une grande baleine en carton, un arbre monstrueux portant des cerises grosses comme des ballons de basket, fleurissaient là par dispense exotique, aussi autochtones que l’amarante pâle, le mimosa, le chêne-liège ou le pin nain. Il y avait une cabane servant des repas rapides et deux scènes ressemblant à des granges, et partout sur le terrain, des groupes de visages peints, pleins d’espoir, attendaient.
Au bout de dix minutes, un jeune homme aux cheveux couleur de plumes de canari se précipita vers la porte.
« Entrez, Mlle Hoyt. M. Brady est sur le plateau, mais il est très impatient de vous voir. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais vous savez, certaines de ces dames françaises sont pires quand il s’agit de se faire passer devant… »
Le directeur du studio ouvrit une petite porte dans le mur aveugle du bâtiment et, avec une familiarité soudaine et réjouissante, Rosemary le suivit dans la pénombre. Çà et là, des silhouettes se détachaient dans la pénombre, lui tournant leurs visages cendrés comme des âmes du purgatoire observant le passage d’une mortelle. Il y avait des chuchotements et des voix douces et, apparemment au loin, le doux trémolo d’un petit orgue. Au détour d’un coin formé par des décors, ils tombèrent sur la lueur blanche et crépitante d’une scène, où un acteur français — dont le devant de la chemise, le col et les poignets étaient teintés d’un rose vif — et une actrice américaine se tenaient immobiles, face à face. Ils se regardaient fixement, les yeux déterminés, comme s’ils étaient dans la même position depuis des heures ; et pendant longtemps, rien ne se passa, personne ne bougea. Une rangée de lumières s’éteignit dans un sifflement sauvage, puis se ralluma ; le tapotement plaintif d’un marteau implorait l’admission vers nulle part au loin ; un visage bleu apparut parmi les lumières aveuglantes au-dessus, criant quelque chose d’incompréhensible dans l’obscurité supérieure. Puis le silence fut rompu par une voix devant Rosemary.
« Chérie, si tu n’enlèves pas tes bas, tu vas abîmer dix paires de plus. Cette robe coûte quinze livres. »
En reculant, la personne qui avait parlé heurta Rosemary, sur quoi le directeur du studio dit : « Hé, Earl… Mlle Hoyt. »
C’était leur première rencontre. Brady était vif et énergique. Lorsqu’il lui prit la main, elle le vit la dévisager de la tête aux pieds, un geste qu’elle reconnaissait et qui la mettait à l’aise, mais lui donnait toujours un léger sentiment de supériorité sur celui qui le faisait. Si sa personne était une propriété, elle pouvait exercer tous les avantages inhérents à cette propriété.
« Je pensais que vous arriveriez d’un jour à l’autre », dit Brady d’une voix un peu trop convaincante pour la vie privée, avec un léger accent cockney provocateur. « Vous avez fait bon voyage ?
— Oui, mais nous sommes heureux de rentrer chez nous.
— Non ! protesta-t-il. Restez encore un peu, je veux vous parler. Laissez-moi vous dire que votre film, Daddy’s Girl, était formidable. Je l’ai vu à Paris. J’ai immédiatement envoyé un télégramme sur la côte pour savoir si vous aviez signé.
— Je venais de le faire… Je suis désolé.
« Mon Dieu, quel tableau !
Ne voulant pas sourire bêtement pour marquer son accord, Rosemary fronça les sourcils.
« Personne ne veut être connu pour toujours pour un seul tableau », dit-elle.
— Bien sûr, c’est vrai. Quels sont tes projets ?
« Ma mère pensait que j’avais besoin de repos. À mon retour, nous signerons probablement avec First National ou nous continuerons avec Famous.
« Qui est-ce ?
— Ma mère. C’est elle qui décide des questions professionnelles. Je ne pourrais pas me passer d’elle.
Il la regarda à nouveau de haut en bas, et, ce faisant, quelque chose en Rosemary se révéla à lui. Ce n’était pas de l’affection, pas du tout l’admiration spontanée qu’elle avait ressentie pour cet homme sur la plage ce matin-là. C’était un déclic. Il la désirait et, dans la mesure où ses émotions virginales le lui permettaient, elle envisageait de se livrer à lui avec sérénité. Pourtant, elle savait qu’elle l’oublierait une demi-heure après l’avoir quitté, comme un acteur embrassé dans un film.
« Où loges-tu ? demanda Brady. — Oh, oui, chez Gausse. Eh bien, j’ai déjà des projets pour cette année, mais la lettre que je t’ai écrite tient toujours. Je préfère tourner un film avec toi plutôt qu’avec n’importe quelle autre fille depuis que Connie Talmadge est enfant.
— Je ressens la même chose. Pourquoi ne reviens-tu pas à Hollywood ?
— Je ne supporte pas cet endroit. Je me sens bien ici. Attends la fin du tournage et je te ferai visiter.
En entrant sur le plateau, il se mit à parler à l’acteur français d’une voix basse et calme.
Cinq minutes s’écoulèrent. Brady parlait, tandis que le Français bougeait de temps en temps les pieds et acquiesçait. Brusquement, Brady s’interrompit et cria quelque chose aux éclairagistes, qui se mirent à bourdonner bruyamment. Los Angeles parlait beaucoup de Rosemary à présent. Imperturbable, elle traversa une fois de plus la ville aux cloisons minces, souhaitant y retourner. Mais elle ne voulait pas voir Brady dans l’état d’esprit où elle le sentait après avoir terminé, et elle quitta le plateau, encore sous le charme. Le monde méditerranéen était moins silencieux maintenant qu’elle savait que le studio était là. Elle aimait les gens dans les rues et s’acheta une paire d’espadrilles sur le chemin du train.
Sa mère était contente qu’elle ait fait exactement ce qu’on lui avait demandé, mais elle voulait toujours la pousser à partir. Mme Speers avait l’air en forme, mais elle était fatiguée ; les lits de mort fatiguent beaucoup les gens, et elle avait veillé à côté de deux couples.
VI
Se sentant bien après avoir bu du vin rosé au déjeuner, Nicole Diver croisa les bras suffisamment haut pour que le camélia artificiel sur son épaule touche sa joue, et sortit dans son joli jardin sans herbe. Le jardin était délimité d’un côté par la maison, d’où il s’écoulait et dans laquelle il se jetait, de deux côtés par le vieux village, et du dernier côté par la falaise qui tombait en pente vers la mer.
Le long des murs du côté du village, tout était poussiéreux, les vignes tortueuses, les citronniers et les eucalyptus, la brouette abandonnée là depuis un instant, mais déjà envahie par la végétation, atrophiée et légèrement pourrie. Nicole était toujours quelque peu surprise de constater qu’en tournant dans l’autre sens après un parterre de pivoines, elle se retrouvait dans un endroit si vert et si frais que les feuilles et les pétales étaient recourbés par une douce humidité.
Noué à sa gorge, elle portait un foulard lilas qui, même sous le soleil achromatique, projetait sa couleur sur son visage et autour de ses pieds en mouvement dans une ombre lilas. Son visage était dur, presque sévère, à l’exception de la douce lueur de doute pitoyable qui se lisait dans ses yeux verts. Ses cheveux autrefois blonds avaient foncé, mais elle était plus belle à vingt-quatre ans qu’à dix-huit, quand ses cheveux étaient plus brillants qu’elle.
Après une promenade marquée par une brume intangible de fleurs qui suivait les bordures de pierres blanches, elle arriva à un espace surplombant la mer où se trouvaient des lanternes endormies dans les figuiers, une grande table, des chaises en osier et un grand parasol de Sienne, tous rassemblés autour d’un énorme pin, le plus grand arbre du jardin. Elle s’y arrêta un instant, regardant distraitement une plante de capucines et d’iris enchevêtrées à ses pieds, comme si elles avaient poussé à partir d’une poignée de graines semées négligemment, écoutant les plaintes et les accusations d’une querelle dans la maison. Lorsque ces bruits s’évanouirent dans l’air estival, elle continua à marcher, entre des pivoines kaléidoscopiques regroupées en nuages roses, des tulipes noires et brunes et des roses fragiles aux tiges mauves, transparentes comme des fleurs en sucre dans la vitrine d’un pâtissier, jusqu’à ce que, comme si le scherzo de couleurs ne pouvait atteindre une intensité plus grande, il s’interrompit soudainement en plein air et que des marches humides descendirent à un niveau situé un mètre cinquante plus bas.
Il y avait là un puits dont le rebord était humide et glissant, même par temps clair. Elle monta les escaliers de l’autre côté et entra dans le potager ; elle marchait assez vite ; elle aimait être active, même si elle donnait parfois une impression de repos à la fois statique et évocatrice. C’était parce qu’elle connaissait peu de mots et n’en croyait aucun, et dans le monde, elle était plutôt silencieuse, ne contribuant qu’à sa part d’humour urbain avec une précision qui frisait la maigreur. Mais au moment où les étrangers avaient tendance à se sentir mal à l’aise en présence de cette économie, elle saisissait le sujet et s’en emparait, fébrilement surprise d’elle-même, puis le ramenait et l’abandonnait brusquement, presque timidement, comme un chien obéissant, ayant été à la hauteur et même plus.
Alors qu’elle se tenait dans la lumière verte et floue du potager, Dick traversa le chemin devant elle pour se rendre à son atelier. Nicole attendit silencieusement qu’il soit passé, puis elle continua à travers les rangées de salades en devenir jusqu’à une petite ménagerie où des pigeons, des lapins et un perroquet lui adressaient un mélange de cris insolents. Descendant vers un autre rebord, elle atteignit un mur bas et incurvé et regarda sept cents pieds plus bas vers la mer Méditerranée.
Elle se trouvait dans l’ancien village perché de Tarmes. La villa et son terrain avaient été construits à partir d’une rangée de maisons paysannes adossées à la falaise : cinq petites maisons avaient été réunies pour former la maison et quatre avaient été détruites pour créer le jardin. Les murs extérieurs étaient intacts, de sorte que depuis la route en contrebas, la villa se confondait avec la masse gris violet de la ville.
Pendant un moment, Nicole resta debout à regarder la Méditerranée, mais elle ne pouvait rien y faire, même avec ses mains infatigables. À ce moment-là, Dick sortit de sa maison d’une seule pièce avec un télescope et regarda vers l’est, en direction de Cannes. En un instant, Nicole entra dans son champ de vision, sur quoi il disparut dans sa maison et ressortit avec un mégaphone. Il possédait de nombreux appareils mécaniques légers.
« Nicole, cria-t-il, j’ai oublié de te dire que, dans un dernier geste apostolique, j’ai invité Mme Abrams, la femme aux cheveux blancs.
— Je m’en doutais. C’est scandaleux.
La facilité avec laquelle sa réponse lui parvint semblait rabaisser son mégaphone, alors elle éleva la voix et cria : « Vous m’entendez ?
« Oui. » Il baissa le mégaphone, puis le releva obstinément. « Je vais inviter d’autres personnes. Je vais inviter les deux jeunes hommes.
« D’accord », acquiesça-t-elle placidement.
« Je veux organiser une fête vraiment horrible. Je suis sérieux. Je veux organiser une fête où il y aura des bagarres, des séductions, des gens qui rentreront chez eux blessés dans leur amour-propre et des femmes évanouies dans la salle de bains. Vous verrez. »
Il retourna dans sa maison et Nicole vit qu’il était pris d’une de ses humeurs les plus caractéristiques, cette excitation qui emportait tout le monde et qui était inévitablement suivie de sa propre forme de mélancolie, qu’il ne montrait jamais mais qu’elle devinait. Cette excitation à propos des choses atteignait une intensité disproportionnée par rapport à leur importance, générant une virtuosité vraiment extraordinaire avec les gens. À l’exception de quelques personnes à l’esprit rigide et éternellement méfiantes, il avait le pouvoir de susciter un amour fasciné et inconditionnel. La réaction venait lorsqu’il réalisait le gaspillage et l’extravagance que cela impliquait. Il repensait parfois avec admiration aux carnavals d’affection qu’il avait offerts, comme un général pourrait contempler un massacre qu’il aurait ordonné pour satisfaire une soif de sang impersonnelle.