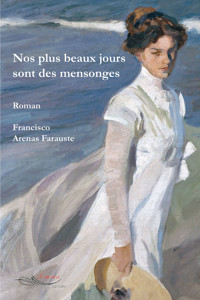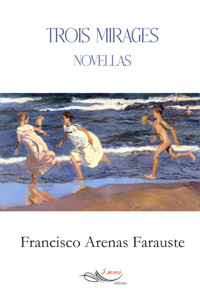
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Trois romans courts, trois « novellas »… Le comte foudroyé, 2022, sélection prix du LÀC 2023 - Nos plus beaux jours sont des mensonges, 2023 - Le capitaine sur la Falaise, 2024, sélection prix Lettres Frontière 2025
Chers lecteurs, vous tenez entre vos mains des oeuvres qui explorent le vertige qui nous saisit tous un jour : ce décalage abyssal entre ce que nous croyons voir du monde et la nature profonde des êtres et des événements qui nous entourent. Ces textes parlent d’illusions, de rêves et de mensonges. De toutes ces circonstances immatérielles qui, pourtant, façonnent nos existences et bâtissent notre avenir. Car n’est-ce pas l’illusion qui est le socle même de l’espoir ? Francisco Arenas Farauste nous propose un ballet des faux-semblants au rythme des saisons de la vie. Il observe avec une infinie justesse la relation que nous entretenons avec l’illusion, une relation qui se transforme à chaque étape de notre parcours.
Extrait de la préface de Sandrine Bourgeois
À PROPOS DE L'AUTEUR
Auteur espagnol vivant en Suisse, Francisco Arenas Farauste conçoit ce triptyque en 2021 et publie les trois textes entre 2022 et 2024. Édités à l’origine sous la forme de trois romans séparés, ils sont réunis pour la première fois dans un recueil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Francisco Arenas Farauste
Trois mirages
Novellas
« La vie et le mensonge sont synonymes. »
Fiodor Dostoïevski
Préface
La trilogie de Francisco Arenas Farauste n’est pas une simple lecture ; c’est une invitation à un voyage littéraire qui éveille les sens, une immersion dans un univers où l’élégance classique se mêle à une profondeur philosophique qui nous interroge et nous trouble.
Dès son premier roman, Le Comte foudroyé, l’écrivain a su captiver le Jury du Prix du LAC, révélant un talent unique que les deux romans suivants confirment avec une maîtrise éblouissante.
Fils d’immigrés espagnols, Francisco Arenas Farauste vit en Suisse depuis plus de 40 ans et réside désormais à Genève. Autodidacte au parcours inspirant, il a gravi les échelons pour occuper des fonctions dirigeantes au sein d’une grande entreprise suisse. Mais sa véritable passion, celle qui l’anime depuis l’enfance, a toujours été la littérature. Lecteur insatiable, il a longtemps gardé pour lui le désir d’exprimer ses émotions à travers l’écriture. En 2021, un déménagement devient le catalyseur d’une renaissance : la redécouverte de ses anciens textes ravive une flamme que trente années n’avaient pu éteindre. Plutôt que de simplement raconter sa vie, il a choisi une voie plus universelle, à savoir témoigner à travers ses fictions, des douces folies et des poignantes absurdités de notre monde.
Cette trilogie se déploie tel un triptyque de contes philosophiques, portés par une plume fluide et gracieuse. Son style, que l’on pourrait qualifier de classique, voire délicieusement suranné, constitue paradoxalement le cœur de sa modernité et de son originalité.
Francisco Arenas Farauste nous offre une prose riche et ciselée, où chaque mot semble pesé avec une précision d’orfèvre pour résonner avec une profondeur intemporelle.
Avant de vous plonger dans chacune de ces trois « novellas », permettez-moi de vous confier une clé de lecture. Elle vous ouvrira les portes de leur architecture secrète, de la mécanique narrative qui les anime et de la finesse de leur construction.
Chers lecteurs, vous tenez entre vos mains des œuvres qui explorent le vertige qui nous saisit tous un jour : ce décalage abyssal entre ce que nous croyons voir du monde et la nature profonde des êtres et des événements qui nous entourent.
Ces textes parlent d’illusions, de rêves et de mensonges. De toutes ces circonstances immatérielles qui, pourtant, façonnent nos existences et bâtissent notre avenir. Car n’est-ce pas l’illusion qui est le socle même de l’espoir ?
Mais l’élément le plus fascinant de cette trilogie est la manière dont l’auteur orchestre ce ballet des faux-semblants au rythme des saisons de la vie. Il observe avec une infinie justesse la relation que nous entretenons avec l’illusion, une relation qui se transforme à chaque étape de notre parcours.
Dans la fougue de la jeunesse, l’illusion est une ennemie. L’homme, au commencement de sa vie d’adulte, voit le monde tel qu’il voudrait qu’il soit, un miroir de ses aspirations. Il se refuse à voir la vérité en face, préférant l’ardeur de ses rêves à la complexité du réel.
Puis vient l’âge mûr. Fort des expériences qui ont forgé son caractère, il apprend à composer avec les mirages permanents qui dansent autour de nous, et parfois même, à s’en accommoder avec une sagesse nouvelle.
Enfin, au soir de son existence, l’homme prend conscience que ses souvenirs les plus chers sont peut-être ceux qu’il a lui-même façonnés. Et dans un ultime acte d’espérance, il choisit d’y croire, pour que le grand récit de sa vie ne soit ni vain, ni creux. Ce destin fantasmé devient alors sa plus belle consolation face au silence à venir.
C’est ce cheminement philosophique et profondément humain que vous vous apprêtez à découvrir.
Voici un aperçu des trois étapes de ce voyage :
La jeunesse : Le Comte foudroyé vous entraîne dans le sillage d’un comte sévillan désargenté, frappé par un amour si intense qu’il en perd pied. Ce coup de foudre le propulse dans un périple à travers l’Europe des Années folles, où les destins s’entrelacent dans une apothéose de rêves et de réalités. Plus qu’un roman d’aventure, c’est une interrogation qui vous est lancée : et si les apparences n’étaient que des mirages nous empêchant de voir l’essentiel ?
L’âge mûr : Dans Nos plus beaux jours sont des mensonges, une simple lettre vient faire voler en éclats l’existence feutrée de la belle et mystérieuse Mathie. Dans son hôtel particulier parisien, ce courrier fait resurgir un passé trouble et des secrets enfouis : « Je t’ai toujours menti. Du premier jour, lorsque je t’ai aperçue, au dernier instant lorsque tu as disparu. Te souviens-tu de ce matin-là ? »… Vous voilà immédiatement transporté au cœur du mystère, où les vérités d’hier deviennent les illusions d’aujourd’hui.
La vieillesse : Avec Le Capitaine sur la falaise, préparez-vous à une histoire poignante de guerre et d’amour absolu. Sur une île méditerranéenne baignée de lumière, un ange se révèle. À Turin, un homme au crépuscule de sa vie raconte son histoire à un inconnu. Né en 1911, il a tout connu la douceur d’une jeunesse dorée, la fascination pour le Duce, l’engagement dans une guerre qui le changera à jamais. L’auteur explore ici la puissance de la mémoire et nous rappelle avec une infinie tendresse que le souvenir du merveilleux, même inventé, ne s’efface jamais.
Observateur acéré de nos âmes, Francisco Arenas Farauste témoigne avec une acuité rare des masques que nous portons et des vérités que nous préférons parfois ignorer. Avec cette trilogie, il s’impose comme un conteur hors pair qui nous invite à repenser notre propre rapport au monde. Alors, laissez-vous emporter par la magie de son écriture. Plongez dans cet univers où chaque histoire est une fenêtre ouverte, non seulement sur l’âme des personnages, mais peut-être aussi, sur la vôtre.
Sandrine Bourgeois
Présidente du comité du Festival du LÀC
Fondatrice du « Cercle des lectrices bienveillantes »
Le comte foudroyé
Chapitre I – La rencontre
Pedro Sanchez de Tendilla n’aimait pas la lente monotonie des dimanches après-midi lorsque le soleil descendait sur l’horizon et éclairait les visages de sa mère et de sa tante de rayons peu flatteurs pour leurs faciès ridés ornés, ici et là, de verrues velues.
Pedro n’avait qu’une envie lors de ces moments d’oisiveté, prendre ses jambes à son cou et se perdre dans les dédales de la vieille ville. Laisser son esprit vagabonder entre deux ruelles et découvrir des lieux inconnus cachés dans le ventre de la cité.
Comte sévillan désargenté, Pedro aimait à penser qu’il faisait partie de la caste des élus, des privilégiés, des nantis. Persuadé d’être promis à un destin exceptionnel, il avait une haute opinion de sa personne.
Sa mère Dolorès le confortait dans cette idée en lui contant par le menu les exploits imaginaires de feu son père Fernando mort peu avant sa naissance. Le patriarche avait trépassé durant la guerre hispano-américaine de 1898 et était considéré par l’ensemble de la famille Sanchez de Tendilla comme un héros bien qu’il fût mort après avoir contracté le paludisme à Cuba et qu’aucun acte glorieux ne pût être porté à son actif.
La famille habitait dans un petit palais, entretenu tant bien que mal et qui dégageait un parfum étrange, mélange d’urine de chat et de jasmin. Au centre, un patio orné d’une fontaine desservait des pièces en enfilade cachées derrière de massives portes de bois peintes en noir. Les après-midi, lorsque le lourd soleil andalou écrasait les rues, les places et même l’intérieur des églises de Séville, le comte prenait sa canne et son chapeau et marchait seul dans la ville. Les battements de son cœur résonnaient entre ses tempes humides. La cité était assoupie, la sieste étant la seule activité envisageable en cette heure où l’on ne croisait pas une âme qui vive, tout juste quelques chiens errants qui cherchaient de l’ombre et de la fraîcheur.
Pedro trouvait que ces instants étaient les plus agréables pour découvrir les mystères que recelait Séville. La chaleur donnait un halo mystique aux bâtiments et l’air vibrait d’ondes invisibles. Cette illusion était aisément explicable par un phénomène physique lié à la température de l’air, mais il aimait à considérer ce mirage comme magique.
Le chemin de Pedro passait inlassablement devant la cathédrale, vaste monument chrétien dressé sur les fondations d’une ancienne mosquée. La basilique possédait des dimensions considérables. Laide et informe, son seul charme résidait dans un clocher gracieux, un ancien minaret qui s’élevait au milieu d’un ciel diaphane et toujours bleu.
La cathédrale permettait de trouver un peu de fraîcheur, mais Pedro ne s’y arrêtait jamais. Malgré le profond attachement de sa famille aux traditions catholiques, le comte n’était pas croyant. Il considérait l’Église comme une institution corrompue qui s’enrichissait en profitant de la détresse et de la crédulité des pauvres gens.
À ses yeux, les curés étaient des notables gras et apathiques qui abusaient de leurs privilèges. Pedro n’aimait rien de moins que les sermons dominicaux qui culpabilisaient les fidèles en décrivant par le menu leurs tares, leurs péchés, leurs faiblesses. Il abhorrait ces longues heures de prières et détestait plus que tout « la Semaine sainte », lorsque des processions interminables défilaient dans la ville au son des tambours, dans une atmosphère irrespirable de sueur et d’encens.
Afin d’éviter les églises, le gentilhomme se forçait à contourner soigneusement les secteurs les plus dévots de la ville et se dirigeait vers le quartier de Triana. Ce faubourg situé sur l’autre rive du fleuve abritait la communauté gitane, les strates les plus humbles de la société sévillane, et quelques nouveaux commerces.
Une place en particulier jouissait du privilège de ses visites hebdomadaires. Il s’agissait d’un lieu isolé et solitaire. La statue d’un poète désormais oublié ornait l’espace et de majestueux eucalyptus apportaient de l’ombre aux quelques bancs installés aux quatre coins. L’endroit était charmant et paisible, il jouxtait l’arrière d’un grand magasin qui étalait ses vitrines opulentes sur le boulevard voisin. Ces devantures constituaient une nouveauté, car en ce début de siècle, la plupart des commerces de Séville étaient toujours de petites échoppes où des vendeuses débonnaires conseillaient la clientèle.
Le grand magasin, construit loin de la vieille ville pour des raisons pratiques, longeait une grande artère fraîchement ouverte dans le quartier. Les expropriations et les déménagements s’étaient succédé pendant des mois et les travaux avaient ensuite été menés tambour battant par des architectes et ingénieurs français.
Assis sur un banc sous un eucalyptus centenaire, Pedro profitait enfin d’un peu de fraîcheur en cette chaude après-midi d’août. Il n’y avait pas un bruit, pas une feuille ne bougeait.
Plongé dans ses pensées, il songeait à l’affreuse soirée qui l’attendait. Sa mère avait décidé que sa vingt-cinquième année devait être celle de son mariage. Fils unique, le comte avait l’obligation de convoler rapidement dans le but de donner de nombreux descendants à la noble famille Sanchez de Tendilla, car faute de temps, son père n’avait pu accomplir cette tâche avant sa mort.
Dolorès avait jeté son dévolu plus sur un clan que sur une personne, il s’agissait des Lopera, une famille bourgeoise fort aisée qui avait fait fortune dans la transformation de l’huile d’olive en savon. Les Lopera avaient une fille prénommée Carmen qui, par chance, était en âge de se marier. Cette soirée dominicale constituait donc un excellent prétexte pour présenter les deux jeunes gens.
Pedro maugréait en lui-même lorsque soudain, il aperçut dans l’angle opposé de la place une silhouette féminine. Il s’agissait d’une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années, assise presque le dos tourné et qui paraissait plongée dans une profonde réflexion.
Le comte n’y voyait pas très clair, car par avarice autant que par coquetterie, il se refusait à porter des lunettes pour corriger sa myopie. Il força donc sa vue afin d’apercevoir les traits de la jeune fille, sa joue, son nez et surtout son cou gracieux qui semblait avoir été spécialement conçu pour qu’on y déposât des baisers. Seule sa main qui lissait machinalement ses cheveux était pourvue de vie tandis que le reste de sa personne immobile dégageait une sérénité et une grâce infinie. Vêtue à la dernière mode parisienne, elle était d’une beauté stupéfiante. Pedro tressaillit. Plus il l’observait, plus il était gagné par son charme, et plus il ressentait la nécessité d’entrer en contact avec elle.
Cependant, en cette époque et en ce lieu, il n’était pas aisé d’approcher une jeune personne du sexe opposé. Il n’était pas envisageable de l’aborder sans la présence d’un chaperon. Par conséquent, il échafauda dans son esprit divers stratagèmes : demander son chemin en prenant l’air égaré, se présenter à elle comme un gentilhomme soucieux de la voir seule en cette heure dans un parc isolé. Car l’endroit était désert, tout juste y avait-il là deux ouvriers affairés qui se tenaient à une certaine distance de la demoiselle.
Mais plus il réfléchissait, plus il trouvait l’entrée en matière maladroite. Il se disait que cette approche n’était pas digne du visage magnifique qui se tournait désormais vers lui. Des traits fins et réguliers, des yeux mi-clos perdus dans leur rêverie et qu’il souhaitait plus que tout voir se lever sur lui.
Toutefois, elle n’en fit rien. Elle restait perdue dans ses songes, insensible aux regards ardents que Pedro posait sur elle.
Il réfléchissait toujours au moyen de l’aborder quand il lui parut que la solution la plus simple était d’établir avec elle une relation épistolaire. Il griffonna quelques mots simples à son attention sur un papier – que par chance il avait sur lui –, et se mit aussitôt à la recherche d’un badaud qui aurait la gentillesse de lui porter le message.
Il tomba nez à nez avec un enfant gitan à l’air malin qui devait traîner dans le quartier en quête d’un mauvais coup. Il lui offrit une chica, soit cinq centimes, pour remettre la précieuse missive à la jeune fille. Puis, il lui communiqua son adresse de façon que le jeune garçon puisse lui apporter une éventuelle réponse. Par bienséance autant que par lâcheté, il lui demanda toutefois d’attendre son départ. Il ne souhaitait pas être présent lorsqu’elle lirait sa lettre, redoutant un rire ou une moue, qui serait signe de moquerie ou de désintérêt.
Le comte prit le chemin du retour pendant que le gitan courait en direction de la jeune fille. En chemin, il pensa à ce destin qui lui avait permis de croiser une si belle demoiselle, enfin une rencontre, une passion qui était digne de sa noble lignée. Lorsqu’il arriva chez lui, sa mère et sa tante étaient dans une grande agitation. Elles l’avaient cherché tout l’après-midi. L’heure du dîner chez les Lopera approchait et il convenait que Pedro s’y présentât sous son meilleur jour.
Ses plus beaux costumes avaient été sortis des penderies, une chemise neuve et des chaussures cirées l’attendaient dans ses appartements. Sa chambre donnait directement sur le patio. Les soirs d’été, il laissait toujours la porte ouverte pour entendre le doux ruissellement de la fontaine qui le berçait avant son sommeil.
Pedro s’apprêta prestement, l’heure avançait. Il n’éprouvait aucun intérêt pour la soirée qui l’attendait. Il baignait encore dans l’euphorie de sa brève rencontre avec la jeune fille du parc. Il guettait le moindre passage dans sa rue, espérant que le gitan viendrait lui apporter une lettre parfumée.
Mais rien ne se passa. Pedro, sa mère et sa tante partirent donc en calèche en direction de la vaste demeure des Lopera. Elle se trouvait en dehors de la ville et étalait son luxe depuis les hauteurs d’une colline avoisinante.
Les Lopera s’apprêtaient à recevoir les Sanchez de Tendilla avec les honneurs dus à leur rang. Des domestiques en livrée vinrent les accueillir et les escortèrent jusqu’à la grande salle à manger où Joaquin Lopera, son épouse Ana et leur fille Carmen les attendaient.
Joaquin Lopera était un homme corpulent et trapu. Sa tête semblait avoir été placée directement sur son tronc sans qu’on eût trouvé de place pour loger un cou. Anna était la figure même de la désolation. Son visage maigre, entouré de cheveux noirs tirés en chignon, était semblable à un champ de bataille où la bouche, le nez et les yeux n’ayant pu trouver un terrain d’entente avaient finalement décidé de s’éloigner au maximum les uns des autres.
Carmen, enfin, ressemblait à un rongeur apeuré, elle jetait des regards craintifs sur le comte, et dans ses petits yeux noirs et fiévreux transparaissait une expression de résignation, comme si ce mariage répondait à une volonté divine.
Joaquin Lopera présenta par le menu les qualités de sa famille, son immense fortune, les vertus de sa fille, qui avait été élevée par des religieuses et qui, selon lui, avait tous les attributs requis pour être une femme dévouée et une excellente mère. Cet inventaire s’apparentait plus au boniment d’un vendeur de chevaux durant une foire aux bestiaux qu’à l’argumentaire d’un père aimant.
Pedro, perdu dans ses pensées, l’écoutait à peine. Le visage de la jeune fille du parc lui revenait sans cesse en mémoire, l’obsédait et l’empêchait de trouver la soirée tout à fait désagréable. Comme si le doux moment vécu l’après-midi se prolongeait encore.
Les Lopera possédaient une œuvre magistrale qu’ils tenaient absolument à faire admirer aux Sanchez de Tendilla. Il s’agissait d’une Madone du XVIIIe siècle qui trônait au milieu d’une chapelle tout spécialement érigée en son honneur au centre de la demeure.
Après le dîner, comme s’il s’agissait d’une procession, l’ensemble des convives se dirigea vers cette fameuse chapelle. Haute d’environ deux mètres, la statue de bois et de plâtre représentait une Vierge à l’enfant couverte d’or, de soieries et de pierres précieuses. Elle ressemblait à une pièce montée où l’on aurait remplacé la crème fouettée par les bijoux de la reine d’Angleterre.
Pedro la trouva hideuse et fut stupéfait par la profonde dévotion manifestée par la famille Lopera. Ils vouaient à cette statue une foi presque païenne et lui attribuaient tous les bienfaits dont la vie avait bien voulu les gratifier. La Vierge del Pilar – ainsi se nommait-elle – était donc à l’origine de la fortune, de la santé, de la beauté imaginaire de Carmen, de la guérison de l’ongle incarné de Joaquin et même de la disparition du furoncle d’Ana. Pedro considérait cette bondieuserie absurde. Il trouvait puéril de vénérer de la sorte une idole en plâtre, un veau d’or rococo. Consterné, il observait les Lopera. Il venait enfin de prendre pleinement conscience que les plans de sa mère consistaient à lier sa vie à celle de ces grenouilles de bénitier pour qui l’absolue vérité se trouvait cachée au milieu de deux mètres de dentelle et de verroterie. Il ne pouvait envisager d’unir sa destinée à celle d’une famille de bourgeois si ordinaires.
Il décida d’écourter la soirée, prétextant un vertige lié au profond choc mystique que lui avait procuré la vision de la Vierge. Il fit appeler sa calèche et rentra chez lui.
Durant le trajet, sa mère et sa tante essayèrent de le rappeler à ses responsabilités. Ce mariage représentait le salut de la famille, une stabilité financière nécessaire pour des nobles qui ne pouvaient se trouver dans la gêne.
De retour chez lui, une lettre l’attendait. Le jeune gitan avait apporté un petit mot écrit d’une main maladroite sur un papier ordinaire. Il disait dans un espagnol hésitant : « Eres encantador, yo también te note, senti algo, vuelve mañana.1 »
Chapitre II – La Madone
Cette nuit-là fut interminable pour le comte. Il imaginait toute sorte d’aventures et de situations : la jeune fille était promise aux griffes d’un malfrat dont il se devait de la tirer ; il parvenait à la sauver d’un mariage arrangé avec un vulgaire roturier ; elle était mélancolique, car elle avait perdu un parent proche et seul l’amour du noble sévillan pouvait consoler sa peine. Il se disait, aux lueurs de l’aube, que l’esprit humain était décidément plein de ressources et que les vies rêvées pouvaient être à la fois extrêmement précises et réalistes.
Au réveil, il était fébrile. Atteint par une légère démangeaison au cœur, une gêne dans la poitrine qui l’avait empêché de dormir. Il avait été foudroyé. Cette subite rencontre l’avait immédiatement transformé. La forte attirance qu’il avait éprouvée pour cette belle inconnue avait été amplifiée par l’ahurissement de la surprise. Sa morne existence, promise à l’ennui d’un mariage forcé, venait de s’illuminer inopinément par la seule présence de la jeune femme.
Enfin, son statut de gentilhomme trouvait désormais pleinement sa justification, car cette passion naissante était l’affirmation de sa noblesse. Le comte se devait d’avoir une vie sentimentale hors du commun. Une mystérieuse inconnue, un coup de foudre, une relation épistolaire, un avenir radieux, c’étaient là les attributs qui devaient distinguer les amours de l’héritier des Sanchez de Tendilla des relations insipides que tissait le commun des mortels.
Il déjeuna légèrement, revêtit son costume clair de la veille puis, fou d’impatience, attendit toute la journée l’heure à laquelle il avait aperçu la demoiselle le jour précédent. Le cœur battant, il courut au parc, sans même se soucier de la lettre des Lopera qui était arrivée ce matin-là.
Il retrouva la jeune fille assise dans la même position mais ne se hasarda pas à s’en approcher, car sur ce même banc, se trouvait une femme d’un certain âge à l’air grave. Était-ce sa mère ? Une parente ? Un chaperon ? Il n’en savait rien, aussi se contenta-t-il de rester à distance à contempler la beauté de la jeune femme toujours immobile. Il considéra qu’il était risqué de s’aventurer à se présenter à elles, sans connaître l’identité de la personne assise aux côtés de la demoiselle.
Il remarqua que, contrairement à la veille, de nombreux cartons à chapeaux ainsi qu’une malle étaient posés à proximité du banc. Comme si elle s’apprêtait à quitter la ville ou comme si, à l’inverse, elle venait d’arriver. Soudain, la femme plus âgée se leva, elle se tenait désormais de dos entre Pedro et la demoiselle qui elle n’avait pas bougé.
À cet instant, Pedro prit son courage à deux mains et osa s’approcher lentement, de manière à y voir plus clair, car sa vue ne lui permettait pas de distinguer l’inscription qui barrait la lourde malle. « Mode Féminine Plantin, Paris » chaque lettre rouge paraissait se détacher du fond marron comme une invitation. Ainsi, cette jeune femme était certainement parisienne, son allure, ses vêtements n’étaient certes pas ceux d’une Sévillane. Elle ressemblait plus à une héroïne de roman romantique français qu’à une autochtone endimanchée.
Devait-il s’approcher davantage ou en savait-il assez ? La communauté française en Andalousie était fort restreinte et le comte pensa qu’il serait aisé de retrouver sa belle inconnue en utilisant les informations désormais en sa possession.
Car oui, il la tenait l’explication ! Une Parisienne en visite à Séville, certainement fascinée par l’opéra de Bizet ou voulant s’imprégner de la vie de l’impératrice Eugénie. Aucune Sévillane n’avait une telle élégance, aucune ne portait des vêtements avec autant de grâce, avec autant de perfection dans le tombé de la jupe ou le plissé des étoffes.
L’explication était évidente, car le mot qu’il avait reçu semblait paradoxalement venir d’une personne ayant peu d’éducation. Il comportait des fautes d’orthographe et l’écriture était maladroite. La jeune femme n’était pas de langue espagnole, ce qui expliquait sa maladresse et c’était également la raison pour laquelle elle était accompagnée d’une domestique afin que celle-ci puisse la guider dans les méandres de la ville et le cas échéant, traduire les informations pertinentes.
En revanche, le comte était persuadé que la lettre venait de la demoiselle elle-même, car aucune jeune fille élégante n’aurait partagé un courrier intime. Le fait qu’elle eût malgré tout réussi à écrire ces quelques mots en espagnol était une évidente preuve d’intérêt.
Brusquement, l’accompagnante se retourna et regarda fixement dans la direction du jeune homme. À n’en pas douter, elle était espagnole, ses traits grossiers, sa tenue débraillée, ses cheveux mal coiffés, elle avait effectivement l’allure d’une domestique, d’une domestique ibère. Tout concordait.
Il était temps pour lui de se retirer, mais non sans avoir pris le temps de communiquer encore avec la belle inconnue. Il était à présent aisé de lui faire parvenir un mot, car le jeune gitan – qui avait flairé l’argent facile –, passait et repassait sans cesse en attendant le prochain message qui lui permettrait de gagner sa précieuse chica. Pedro écrivit une lettre plus longue, la donna au jeune garçon et partit rapidement.
En arrivant dans son petit palais embaumé du parfum des jasmins et de l’odeur forte et tenace des chats du voisinage, il constata que la lettre des Lopera était toujours là. Il s’agissait d’une invitation à une messe privée dans leur petite chapelle. Ils avaient été impressionnés par la crise mystique du comte et souhaitaient le revoir. Sa mère insista, et il finit par accepter.
Lorsqu’il se présenta chez les Lopera, il fut introduit immédiatement dans la chapelle où l’attendait toute la famille. Un jeune curé galicien fraîchement sorti du séminaire célébrait la messe dans un latin qui ressemblait à du portugais. À la fin de l’office, il demanda à chacun de s’approcher de la Madone pour embrasser le bas de sa robe en signe de dévotion. Pedro ne pouvait s’y résoudre, il trouvait ce geste de soumission incompatible avec sa noblesse et surtout digne des traditions les plus obscures et les plus primitives.
Il ne s’agissait là que d’une couronne en laiton reposant sur une statue en plâtre. Pourtant ces personnes simples et crédules faisaient reposer leurs craintes de la mort et leurs espoirs de vie éternelle sur ce pantin, cette poupée sans vie.
Il s’ouvrit aux Lopera et leur signifia son profond dégoût pour de telles superstitions. Il refusa d’embrasser la Madone et déclara au jeune ecclésiastique que l’adoration de ces idoles était contraire, selon lui, à l’esprit même de la religion catholique.
Ana Lopera poussa un cri de stupéfaction, pendant que Carmen gloussait d’effroi et que Joaquin s’étranglait dans une cravate qui lui remontait jusqu’au menton. Une terrible colère s’empara de Joaquin Lopera et, le visage rouge, il se mit à mugir des insultes et à maudire le comte. Personne ne pouvait se permettre de refuser un baiser à la Vierge del Pilar, personne ne pouvait se considérer au-dessus de cette représentation de la mère de Dieu, personne ne pouvait avoir une réaction hérétique devant cette magnifique incarnation de la foi chrétienne et de la maternité.
Après quinze minutes de palabres et d’imprécations à la Madone, tout le monde sembla enfin d’accord sur un point : les Lopera et les Sanchez de Tendilla n’uniraient jamais leurs destins à la suite de la déclaration blasphématoire que le comte venait de faire.
Il partit immédiatement en ne songeant qu’au parc, à la jeune fille et à la deuxième lettre qu’il lui avait fait porter. Sa mère l’accueillit avec méfiance et lorsqu’il lui eut conté dans le détail la soirée chez les Lopera, elle s’évanouit en criant : « C’est la fin, c’est la fin ! »
Les jours qui suivirent, Pedro attendit fiévreusement une lettre ou un signe. Mais rien ne venait, pas une nouvelle, pas un pli, pas un parfum porté par le vent, rien.
Il retourna pendant des jours dans le parc, mais ne vit ni la jeune fille, ni la domestique qui paraissait l’accompagner.
Cependant un matin alors qu’il commençait à perdre espoir, il croisa par hasard le jeune gitan qui buvait bruyamment l’eau d’une fontaine publique. Il lui demanda fébrilement s’il avait bien remis sa deuxième lettre, s’il avait revu la jeune fille, s’il savait où elle était, si tout cela n’était pas un rêve. Le jeune gitan bredouilla qu’il ne savait rien, mais à la vue de la chica qui scintillait désormais dans la lumière dorée du matin, son regard s’illumina. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte à épingles en fer-blanc.
Le comte saisit brusquement l’objet. Ainsi, il n’avait pas rêvé. L’apparition de la merveilleuse Parisienne n’était pas un songe. Sur l’écrin, une inscription rouge indiquait : « Mode Féminine Plantin, Paris ».
Le jeune garçon reprit la boîte et lança un regard noir au gentilhomme. Ce précieux souvenir provenant d’un pays lointain était un trésor pour un bohémien qui n’avait jamais voyagé.
Il déclara simplement : « Elle me l’a donnée avant de repartir là-bas. »
Chapitre III – Paris
En 1923, Paris était une ville bouillonnante, les privations de la Grande Guerre n’étaient plus qu’un vieux souvenir, et la respiration de la ville avait repris comme à la belle époque, quand Paris était à la fois une inspiration et un soupir.
Pedro avait emprunté un peu d’argent à son cousin Antonio et décidé d’entreprendre seul ce voyage. Il avait vécu sa rencontre avec la jeune Parisienne comme dans un rêve et il lui était désormais impossible de revenir à sa triste réalité. Il avait donc pris le chemin de fer de Séville à Madrid, traversé la frontière à Irun, puis longé l’Atlantique jusqu’à Bordeaux avant de monter dans un train direct pour Paris. Il avait voyagé de nuit, dans un wagon-lit. Il aimait éteindre les lampes et admirer, comme devant un écran de cinématographe, l’obscurité qui défilait devant ses yeux. Il apercevait des lumières au loin, celles des villes inondées par le halo des lampadaires qui se reflétait dans les trottoirs luisants. Il imaginait alors les mystères de cette foule silencieuse, de cette humanité endormie, cachée derrière chaque fenêtre et dont il percevait soudain l’existence sous l’éclairage blafard d’une ampoule de salle de bains. Durant tout ce voyage, il n’avait cessé de penser à elle. Il savait comment la retrouver, les établissements Plantin étaient devenus son obsession. Fraîchement arrivé à Paris, le comte se logea dans un meublé coquet du XVe arrondissement nommé l’hôtel Ares. Il avait choisi cet établissement pour son calme. Le provincial n’était pas habitué au tumulte d’une capitale. Certes, les automobiles étaient courantes à Séville, mais cette circulation étourdissante lui était insupportable. Le nombre de véhicules avait explosé durant l’après-guerre et la Préfecture de police de Paris avait dû se résoudre à installer récemment le premier feu de signalisation au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol.
Le choix du jeune Sévillan s’était également porté sur l’hôtel Ares en raison de sa proximité avec la tour Eiffel, qu’il avait visitée dès le premier jour de son arrivée.
Mais Pedro n’était pas à Paris pour faire du tourisme, il avait renoncé à un avenir confortable à Séville, abandonné sa mère et sa tante à leur désespoir, et avait décidé de suivre son instinct pour retrouver cette inconnue qu’il lui semblait apercevoir à chaque instant.
Les Parisiennes étaient fort semblables à la jeune fille du parc, et peut-être l’avait-il déjà croisée sans même s’en apercevoir. Il décida d’utiliser un peu de son pécule pour aller enfin voir un opticien-lunetier et corriger sa myopie. Il redoutait l’aspect sévère que pouvait lui donner une paire de lunettes, mais les montures parisiennes très fines et dorées étaient à peine visibles. Une fois muni de cet accessoire dûment adapté à sa vue, il se mit en chasse des établissements Plantin.
Une visite rapide au Registre du commerce lui donna l’adresse de la maison Étienne Plantin et Cie. La société était située dans le Ve arrondissement. Elle avait pour activités la fabrication de prothèses orthopédiques et la mode féminine. Il s’agissait là de deux domaines bien différents et dont la coexistence au sein d’une même entité commerciale était pour le moins saugrenue.
Pedro se rendit en taxi à l’adresse indiquée. Elle correspondait à un entrepôt abandonné, situé au fond d’une cour pavée. Une pancarte clouée sur la porte indiquait : « Cessation d’activité pour raison familiale ». La société n’existait plus et le lieu était désert et lugubre.
La loge de la concierge était située à proximité. Après avoir sonné à la porte, Pedro interrogea la gardienne dans un français hésitant et approximatif. Il lui demanda si elle savait où trouver le propriétaire des établissements Plantin. Cette dame acariâtre qui ressemblait à un bouledogue s’enquit de la raison pour laquelle il cherchait Étienne Plantin. Le comte ne pouvait donner le vrai motif.
Parfois, il prenait conscience de la dimension ridicule de sa quête. Une jeune femme entraperçue, un jeune noble sévillan traversant l’Europe entière pour la retrouver, tout cela était certes romanesque, mais soulignait aussi la vacuité de sa propre existence qu’il essayait de combler avec cette chimère. Il se cacha derrière un prétexte facile, des affaires en cours, une possible collaboration commerciale. La concierge lui raconta alors dans le détail la destinée tragique d’Étienne Plantin.
Originaire du nord, de la région de Lille, Étienne était apparemment quelqu’un d’extraordinaire, un héros du front maintes fois décoré. Il s’était établi à Paris après la guerre avec sa femme et son fils et y avait fait fortune. Un an auparavant, un drame était survenu et l’avait détruit. Son fils était décédé subitement et son épouse folle de chagrin avait fui, l’abandonnant à son deuil. Depuis, il avait fermé son établissement et vivait reclus dans un petit appartement du boulevard Montparnasse. La concierge lui donna la nouvelle adresse en sanglotant, car sous ses airs insensibles, elle avait été sincèrement touchée par ce drame familial.
Il faisait désormais presque nuit et Pedro pensa qu’une visite à cette heure tardive à un père accablé par le chagrin n’était pas très opportune. Il décida de remettre son entrevue au lendemain et partit dîner. Il se rendit dans une grande brasserie parisienne. Ces établissements étaient une découverte et un émerveillement pour un jeune étranger de passage.
Des tablées interminables, des clients assis côte à côte dans une promiscuité incompatible avec leur élégance, des plats ruisselants remplis de fruits de mer voyageant tels des navires au-dessus de la foule. Et puis, il y avait les serveurs en tabliers immaculés qui incarnaient les marées avec le flux et le reflux des divers services. Tout cela était différent, Séville était bien loin, la petitesse d’esprit de sa famille, la stupidité de la piété, l’adoration des idoles en bois et en plâtre. Seule la douce tiédeur de l’Andalousie lui manquait.
Attablé seul, Pedro songeait à la rencontre avec Monsieur Plantin. Comment l’aborder, comment lui soutirer des informations sans avoir l’air stupide, et si la vérité était la seule bonne réponse ? Un homme accablé par le chagrin et le deuil sait ce que signifie perdre quelqu’un qu’on aime. Il saurait certainement le comprendre et partager ce qu’il savait sur cette inconnue.
Le lendemain, quand midi carillonna à l’église Notre-Dame des Champs, le comte monta quatre à quatre les marches de l’escalier qui menaient au sixième étage de l’immeuble où résidait Étienne Plantin.
Il sonna et la porte s’ouvrit sur un petit appartement jonché de livres et d’assiettes vides et sales. Étienne se tenait debout face à lui, il devait avoir trente ans, mais en paraissait soixante. Il était maigre et pâle, une chevelure épaisse encadrait son visage émacié. Son regard bleu acier semblait être une fenêtre ouverte sur le vide.
Pedro peinait à trouver ses mots, il ne savait pas comment expliquer la raison de sa visite. Monsieur Plantin semblait absent et répondait par des « oui » et des « non » évasifs. Le comte décida donc d’expliquer dans son français rudimentaire les vraies raisons de son intrusion. Il se présenta comme un noble espagnol vivant à Séville qui avait aperçu une magnifique jeune femme dans un parc, assise sur un banc à proximité d’une malle comportant le nom de la société de Plantin et Cie. Il avait été subjugué par la beauté céleste de cette inconnue et désirait ardemment la revoir.
À l’écoute de cette histoire, Étienne Plantin, fut saisi d’une incompréhensible frénésie. Il se leva d’un coup et s’écria : « Je la connais, je la connais ! Je sais qui c’est ! »
Il criait désormais : « C’est magnifique, enfin c’est magnifique ! » Il prit le comte dans ses bras et le serra fort contre lui. Le jeune Espagnol fut pris de dégoût, car Monsieur Plantin sentait l’alcool, la sueur et devait avoir une hygiène douteuse.
Qui était-elle ?
La jeune femme du parc, la jeune Parisienne s’appelait en réalité Élise de Boulonac, fille du duc de Boulonac, un riche aristocrate normand originaire de Rouen et qui avait fait fortune dans le commerce de tissus.
Élise était une jeune fille fort belle qui avait hérité d’une somme considérable au décès de son père. Elle avait décidé de se faire confectionner des vêtements modernes et confortables avant de se lancer dans la visite des plus belles villes européennes. Un ami de feu le duc de Boulonac, un ancien officier de cavalerie du nom d’Antoine Honoré Amiel, l’accompagnait dans ses voyages et veillait à ce que personne n’importunât la jeune fille. Le duc de Boulonac avait été très clair dans son testament, sa fortune reviendrait à Élise seulement si elle épousait avant sa vingt-deuxième année un homme digne de son rang. Il convenait donc de tenir à distance les prétendants indésirables.
Un an avant le tragique décès de son fils qui s’était noyé accidentellement dans la Seine, Étienne avait rencontré Mademoiselle de Boulonac dans sa boutique. Élise lui avait paru être une jeune fille merveilleuse. Il lui avait confectionné des tenues avec les étoffes les plus précieuses en suivant les nouvelles coupes à la mode. Ces coupes qui avaient depuis peu libéré le corps de la femme.
Tout était clair à présent. Élise visitait l’Europe. Durant son étape espagnole, elle avait remarqué le jeune aristocrate sévillan, échangé une lettre maladroite tout en craignant l’intervention de l’officier, puis elle avait quitté Séville sans donner de nouvelles, car son penchant pour un jeune Andalou pouvait lui coûter sa fortune et sa réputation.
Où était-elle maintenant ?
Étienne Plantin souriait désormais, laissant apparaître ses dents gâtées par l’alcool et la tristesse.
Une amie d’un ami lui avait dit qu’après avoir visité Séville, elle était à présent à Florence pour quelques mois. Mademoiselle de Boulonac souhaitait visiter les merveilles de la Toscane. Elle resterait sans doute dans cette région jusqu’à Noël.
Le comte pensa qu’il saurait la convaincre. Il saurait lui prouver sa noble ascendance, amadouer le garde-chiourme et rallier le capitaine Amiel à sa cause. Un Sanchez de Tendilla ne pouvait être considéré comme un prétendant indigne d’une duchesse normande. C’était décidé, il partait pour Florence.
Avant de quitter Monsieur Plantin, il eut cependant cette impression étrange qu’Étienne lui cachait quelque chose. Son regard dément, ses gestes frénétiques et le filet de bave qu’il avait remarqué à la commissure de ses lèvres ne le rassuraient guère. Mais il n’avait pas d’autre piste et il se devait de suivre son instinct.
Chapitre IV – L’annonce
Le voyage jusqu’à Florence fut pénible. Pedro dut se résoudre à contacter par téléphone son cousin dans le but de lui demander davantage d’argent.
Le cousin Antonio avait hérité par sa mère de vastes étendues herbeuses perdues dans les montagnes andalouses. Des cochons ibériques obèses se vautraient à l’ombre des chênes-lièges et lui assuraient des revenus confortables grâce à leurs jambons.
L’aventure de Pedro amusa Antonio et il accepta sans rechigner de lui faire parvenir des sommes importantes afin que celui-ci pût continuer son périple.
Pedro arriva finalement à Florence au petit matin alors que la ville se réveillait. Le train s’immobilisa dans la gare centrale. Une douce chaleur qui paraissait provenir des pierres elles-mêmes réchauffait le comte. Florence ressemblait à Séville, c’était un mélange d’histoire, de traditions et de religion.
Il trouva à se loger à la pensionne Gioia, située sur les bords de l’Arno. L’endroit était charmant et il aurait pu s’abandonner à la douceur du lieu, mais il ne cessait de penser au conseil de son cousin.
« Tu ne sais pas dans quelle aventure tu t’embarques, tu dois être prudent, tu devrais t’acheter une arme pour te protéger », l’avait averti la voix bienveillante d’Antonio à l’autre extrémité d’un combiné téléphonique grésillant. Le jeune aristocrate andalou avait participé à de nombreuses parties de chasse et la possession d’armes à feu lui était familière.
Il commença par visiter Florence. Son aversion pour la religion catholique ne l’empêcha pas de trouver la ville magnifique et de ressentir la vibration presque mystique que la ville dégageait.
Il s’arrêta chez un petit armurier et acheta un revolver d’ordonnance Bodeo, marque fort commune après la guerre. Ces armes avaient été produites à des milliers d’exemplaires de façon à équiper les officiers italiens. Pedro était désormais paré pour retrouver Élise, mais par où commencer ? Florence comptait des centaines d’hôtels et de pensions, il devait donc soit compter sur le hasard, soit inventorier tous les logements possibles et les contacter un par un.
Alors que Pedro visitait le cinéma Teatro Odeon, chef-d’œuvre d’Art nouveau qui venait d’ouvrir ses portes, il eut une idée toute simple. Faire paraître dans un journal local une annonce qui certainement attirerait l’attention soit d’Élise, soit de l’hôtelier qui l’hébergeait.
Il se rendit au siège d’un quotidien nommé Il Nuovo Giornale. Une grande agitation y régnait. Des journalistes bavards couraient dans tous les sens en s’extasiant sur le dernier discours du nouveau chef du Conseil transalpin, un certain Benito Mussolini. Bien que le comte ne parlât pas l’italien, cette langue était suffisamment proche de l’espagnol pour qu’il pût comprendre dans les grandes lignes les sujets des conversations. Ce Mussolini était apparemment un homme brillant et même si sa face de butor le rendait antipathique aux yeux du jeune Andalou, les Florentins semblaient vouer une grande admiration au personnage. Le chef du Conseil haranguait les foules lors de discours interminables, le menton dressé pour défier le monde avec une attitude semblable à celle d’un boucher observant sa pièce de bœuf avant de la découper. Le comte pensait que cet énergumène allait probablement causer bien des tourments à l’Italie.