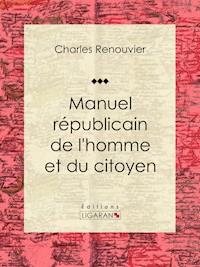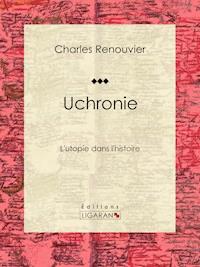
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Cet écrit m'a été transmis par mon père, et je vous le lègue, mes enfants, il vous confirmera mes leçons en vous apprenant à juger les temps passés, à connaitre le vice des passions qu'ils vous ont transmises, et celui des opinions desquelles nos contemporains ont le plus coutume de disputer..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335030310
©Ligaran 2015
PAR UN AUTEUR DU XVIIe SIÈCLE
POUVANT SERVIR DE PRÉFACE
À MES ENFANTS
Cet écrit m’a été transmis par mon père, et je vous le lègue, mes enfants, il vous confirmera mes leçons en vous apprenant à juger les temps passés, à connaître le vice des passions qu’ils vous ont transmises, et celui des opinions desquelles nos contemporains ont le plus coutume de disputer. Je désire que vous soyez affranchis de ces liens de la manière que je l’ai été moi-même.
Mon père, dont vous vous rappelez le visage triste et l’inaltérable douceur, fut longtemps pour son fils une énigme imposante. Il y avait un secret dans sa vie : on aurait dû le soupçonner ; on ne le soupçonnait pas pourtant, et je l’ignorais comme les autres. Les mêmes conséquences peuvent s’expliquer de bien des manières, et le parti le plus simple est souvent de ne se les point expliquer ; c’est aussi le plus sûr. J’aurais cherché longtemps et fait beaucoup de suppositions sans découvrir le secret de mon père.
Il était établi à Amsterdam, et il y occupait, quand je naquis, un emploi modeste au service de la banque qu’on venait d’instituer. On savait qu’il était Français de sa naissance, mais personne n’aurait pu dire à la suite de quelles traverses il avait quitté son pays, ni pourquoi sa connaissance du monde, qu’il ne pouvait pas toujours s’empêcher de laisser paraître, était tant au-dessus de son état, non plus que par quelle bonne fortune un étranger, un inconnu comme lui, avait obtenu la confiance de l’un des quatre magistrats vérificateurs. Il vivait dans la solitude, à cela près de quelques visites rares et longues, faites à ce magistrat, qui lui témoignait une considération particulière. Nulles instances n’avaient réussi à lui faire accepter une place qui comportât une application moins mécanique de l’esprit, et qui donnât un plus digne emploi au caractère qu’on imaginait de son génie. Il suivait avec une exactitude scrupuleuse les exercices religieux de notre culte réformé, sans se permettre jamais une observation, un raisonnement, une comparaison, un mot quel qu’il fut, d’où l’on put inférer que les devoirs de la religion parussent à ses yeux d’une autre nature que ceux de la tenue des livres. Vous auriez pu croire, à voir son attitude, qu’il n’existait point de culte au monde hormis le sien, point de divisions de conscience entre les États de l’Europe et entre les citoyens mêmes de ces États. Une telle absence de chaleur d’âme, en matière des choses dites du ciel, ne déplaît point aux pasteurs et plaît beaucoup aux magistrats.
Mais cette espèce de vacuité et de néant de mon père, à l’endroit des sentiments religieux, semblait fort étrange dans sa famille. Ma mère, zélée réformée, n’avait jamais obtenu ni surpris de la part de son époux l’expression d’une pensée qui ne fût point publique et comme officielle, ou de répulsion à l’égard du catholicisme, ou de préférence pour l’une des Églises réformées, ou enfin sur ce que nous devons à Dieu, à ce qu’elle-même croyait, indépendamment de ce que la naissance nous incline et de ce que le magistrat nous oblige à confesser et à pratiquer. En sorte qu’il y avait là une plaie secrète de l’amour conjugal ; et ce mal entre eux ne fut jamais guéri, car la religion plus passionnée d’une part que de l’autre met une fâcheuse séparation d’esprit entre les sexes.
Moi aussi j’étais frappé, dès mon enfance, de la froideur avec laquelle mon père surveillait mon éducation religieuse, et de la direction de morale appelée mondaine que je sentais dans ses préoccupations habituelles. Le respect extraordinaire que sa tendresse grave et la fermeté douce de son caractère toujours serein m’inspiraient pour lui, obtinrent sur moi tout l’effet qu’ils devaient avoir à ce moment. Je regardai donc les enseignements de ma mère et du ministre de notre communion comme des leçons de convenances publiques, du quelque chose d’approchant, sans bien m’en rendre compta, ni sans en rien témoigner, et je ne sentis pas pour lors l’aiguillon du prosélytisme religieux. Cet état de tranquillité ne devait pas durer.
Aux premiers feux de ma jeunesse, encore que retardés grâce à d’heureuses habitudes de famille, des semences de fanatisme commencèrent à germer dans mon âme. Apparemment ce qui avait transpiré jusqu’à moi du monde et peut-être mon sang avaient dû les y déposer. Une ardeur inquiète, qui ne trouvait point son objet naturel et ne pouvait dès lors se satisfaire, me porta vers ces songes d’une autre vie dont l’obsession conduit les hommes à se former un enfer de celle-ci. Car ils promènent la torche sur la terre, en voulant forcer leurs semblables à penser comme eux, afin de se sauce comme eux ; et sinon, à accepter le combat contre eux, jusqu’à la mort, jusqu’au supplice que la foi du plus fort réserve à l’obstination du plus faible. C’est assez dire que la grâce prétendue qui m’envahissait, la sainte fureur de dogmatiser et de persécuter, cette rage d’assurer ce qu’on ne peut savoir, de multiplier les dogmes et d’anéantir quiconque ne les affirme point, ce mal sacré devait difficilement s’arrêter avant de m’avoir conduit jusqu’au catholicisme. Ce n’est pas que les réformés n’eussent donné des exemples terribles du zèle sanguinaire pour Dieu, mais l’organisation de l’Église catholique me semblait tout autrement puissante pour le bien forcé des âmes ; et le dogme aussi me paraissait, dans cette église, avoir quelque chose de plus plein, de plus résolu et comme de plus scientifique dans l’antiscience. Je traduis exactement mes pensées de ce temps, quoique en des termes que j’eusse estimés blasphématoires. Au reste, j’omets quelques circonstances qui m’avaient mis en rapport avec un émissaire papiste, adroit et convaincu, si bien que j’avais ouvert sérieusement l’oreille à ses leçons.
Aux seconds symptômes du mal dont les premiers l’avaient réjouie, ma mère commença à s’affecter, et mon père, pour la seule fois à mes yeux, se montra profondément troublé, plus troublé même que le cas ne semblait le comporter, ce qui est beaucoup. J’éprouvai alors le plus grand étonnement qui me fût réservé en ma vie, et voici comment. Quelques jours après qu’il eût repris son calme habituel, votre grand-père vint m’éveiller pendant la nuit, s’empara de mon chevet dans l’obscurité, me parla jusqu’au jour sans me laisser la parole ; et il en fut de même les nuits suivantes.
Je compris depuis qu’il avait voulu s’établir fortement dans mon imagination ébranlée, me tenir dans l’état passif que secondait ma vénération pour sa personne, jusqu’à ce qu’il fût parvenu à faire naître en moi des passions intellectuelles, jointes à des impressions domestiques d’un ordre tout nouveau.
Il me dit d’abord qu’il ne me demandait point ma confiance, parce qu’il n’en avait nul besoin, sachant mieux que moi-même tout ce qui se passait en moi. Au contraire, c’était lui qui m’apportait la sienne et qui entendait me faire juge de sa vie et de ses pensées. Mais je devais pour cela me laisser instruire des faits et consentir à le suivre avec condescendance au point où il voulait conduire mes réflexions. Après cela je serais libre, libre de m’abandonner à la commune fougue des appétences religieuses… en portant toutefois le théâtre de mes ardeurs le plus loin possible de la maison paternelle… jusqu’à ce qu’elles fussent éteintes ou calmées… si les hasards de la vie me permettaient ce retour.
N’allez pas croire là-dessus que mon père entreprit la satire des sentiments religieux, ni du christianisme et de ses sectes. Mais « que sais-tu, me disait-il, qu’as-tu vu, qu’as-tu étudié ? où sont tes veilles ? où prends-tu ta morale ? de quel droit voudrais-tu imposer aux hommes les convictions que tu cherches encore, la croyance qu’il te plaira te donner demain ? Car tu n’as point encore une foi sincère, et déjà tu songes à répandre par séduction ou par violence les dogmes dont tu es décidé à te procurer la certitude à tout prix. L’unité religieuse des âmes te semble le premier des biens, et tu accuses la réforme qui a brisé cette unité d’aller elle-même en se dispersant et se divisant sans fin. Est-ce donc un vrai bien celui que la tyrannie seule assure et que la sainte liberté des consciences fait perdre, celui que la guerre et les bûchers affermissent, celui que la paix et la charité rendent inutile ? Mais je veux que ta foi, je dis la tienne, se puisse arrêter inflexiblement, malgré la mobilité naturelle de ton cœur, fait apparemment comme celui des autres ; cette foi sera-t-elle nécessaire au genre humain parce que tu te l’es faite, ou qu’elle te vient de quelques-uns qui n’étaient pas plus autorisés que toi quand ils l’affirmèrent les premiers ? Dieu a parlé à ceux-là, diras-tu ? Dieu a parlé et parle tous les jours à beaucoup d’autres, si tu veux les en croire, et les choses qu’il leur a dites ne s’accordent point. C’est que ce sont eux qui pensent l’entendre, ce sont eux qui le comprennent et qui le traduisent, ce sont eux qui le font parler, ce sont eux qui parlent pour lui. »
Ce qui me confondit, ce fut la sagacité, la force des réflexions de mon père, et surtout cette hauteur et cette froideur passionnée du ton qu’il prit pour me tracer le tableau de mes sentiments, de mes peines et de mes ardeurs, de tout ce grand tumulte de mon âme dont j’étais fort éloigné de me rendre compte. J’avais beau résister intérieurement et refuser de me voir dans le miroir qui m’était mis durement en face, il fallait bon gré mal gré que je me reconnusse aux moindres traits. L’odieux du portrait me soulevait seul contre sa vérité ; encore me sentais-je fléchir, en même temps que j’étais pénétré d’une curiosité tendre et respectueuse, quand mon père me disait :
« Je te juge de bien haut, mon fils, et je t’humilie. Mais à mon tour je m’humilierai devant toi ; je te dirai ma vie, et tu sauras que je ne te connais si bien que parce que je me suis connu. Il est juste pourtant que je te parle d’abord de ce qui est d’intérêt commun, et que je t’informe d’un certain nombre de vérités que tu ignores. Nos personnes viendront après.
Tu te crois peut-être bien savant parce qu’on t’a appris ce que l’esprit reçoit et rembourse en monnaie courante des écoles. Mais que de choses qu’on ne veut pas ou qu’on n’ose pas dire, et que les purs amateurs du vrai découvrent dans les parages infréquentés ! Combien d’autres qui frapperaient la vue grossière d’un qui n’aurait point le parti pris de détourner les yeux en les rencontrant ! L’histoire tout entière et les idées des cinq zones du monde semblent ne pas exister pour nos petites sociétés chrétiennes, habituées à ne regarder qu’elles-mêmes et à tout dédaigner hors du cercle de leurs petites discussions théologiques. Je t’apprendrai l’histoire et je te raconterai les voyages. J’agrandirai l’univers à ta vue, et avec l’univers ton âme. Le temps est venu où je devais te mettre en face de bien des connaissances que les petits enfants eux-mêmes posséderont peut-être un jour, mais dont on trouve aujourd’hui du danger, entre hommes, entre amis, à se transmettre l’esprit, ou à se faire apercevoir les plus simples conséquences.
Commence par élever tes yeux au-dessus du point de l’espace où nous sommes placés », continua mon père, et il m’exposa rapidement les vérités de l’ordre du monde, alors nouvelles, et qui circulaient avec peine entre quelques savants : la doctrine de Copernic, les découvertes de Kepler, celles de Galilée, ce grand homme qu’il me peignit à genoux devant le tribunal de la Sainte Inquisition, au moment même où il me parlait. Puis il me montra la contrariété des notions grossières du peuple hébreu et du véritable système de l’univers, dont je pus, grâce à quelque instruction que j’avais reçue dans les mathématiques, comprendre la grandeur et la force. Une nuit entière se passa dans ces communications que j’accueillis avidement, car la vérité et la nouveauté apportaient à mon esprit un aliment que je cherchais naguère dans l’obscurité des dogmes antiques.
« Élève tes yeux au-dessus de l’horizon de nos religions de Hollande et des pays circonvoisins. »
Cette fois mon père m’offrit le tableau des religions de la terre, et forçant mon esprit à l’impartialité, me montra chez les grandes nations de l’Orient des mystères profonds, quelquefois barbares, quelquefois touchants, presque toujours du genre de ceux que nous adorons, seulement appuyés sur d’autres légendes et sur d’autres miracles. Voulons-nous les entendre grossièrement, n’y voir que sottise, puérilité, mensonges ? appliquons alors ce mode d’interprétation facile à nos propres traditions ; pourquoi pas ? les peuples étrangers et lointains ne s’en font point faute, car ils nous jugent aussi. Voulons-nous au contraire pénétrer jusqu’à l’essence de nos dogmes abstrus, ne les croire absurdes qu’en apparence ? Alors traitons avec la même justice tous ces systèmes de trinités, d’incarnations et d’eucharisties, dont la spéculation orientale a été prodigue. J’ignore quels livres, quels voyageurs avaient instruit mon père sur les opinions de tant de nations dont nous n’avons pas les livres sacrés ; mais j’ai lieu de croire qu’il puisait principalement dans les récits oraux de quelques missionnaires jésuites, parce que la place où il avait été autrefois lui avait permis de recueillir de la bouche de certains, des renseignements, des conjectures, des doutes, qu’on se garde de publier. Son intelligence fort exercée et en éveil avait aussi mis à profit les relations confuses apportées par les marchands hollandais. Quoi qu’il en soit, je conçus pour la première fois que les peuples avaient pu se faire des religions comme la nôtre et nous une religion comme les leurs. Mon père acheva cette fois la veillée par une estimation approchante des nombres d’hommes attachés aux diverses croyances qui existent sur la terre.
« Considère les dogmes du christianisme, avant le moment où l’Église a tout enfermé sous son autorité. Informe-toi de leurs origines. Envisage-les en soi, non point dans l’unité factice et dans l’invariabilité prétendue qui est le postulatum des théologiens, mais dans la suite des évènements de l’histoire, des débats de la philosophie, des luttes de la politique et des intrigues du clergé ; car l’histoire des variations, pour parler comme cet évêque, n’a pas commencé de notre temps ; elle s’est reprise et continuée après quelques siècles d’une fixité apparente qui était le produit de la violence. »
Ici vint se placer un abrégé des annales ecclésiastiques, des hérésies, des conciles, et de ces révolutions de l’Église qu’on a ramenées à la soi-disant orthodoxie par une méthode aisée, en qualifiant d’orthodoxe chaque opinion qui triomphait à l’issue de chaque lutte.
« Regarde enfin la morale de l’Église, je veux dire celle qui paraît dans sa conduite et dans la conduite des princes qui l’ont servie ou qui se sont servis d’elle, depuis Constantin jusqu’à Philippe II ; connais les maximes qu’on te recommandera et les actes qui te seront proposés pour modèles. »
Je ne pus m’empêcher de frémir, de demander grâce à l’interminable tableau des persécutions, des supplices à cause de la foi, et des crimes d’État des rois et des pontifes, durant plus de mille ans de la loi d’amour, desquels mon père semblait avoir composé les éphémérides lugubres : il était vraiment la vivante chronique des égarements de la religion. Arrivé à notre temps, il ne montrait le système de l’intolérance théologique, également puissant sur les esprits des princes et sur ceux des particuliers, les gouvernant jusque dans le moment où ils se pensaient devenus libres, quelle contradiction ! et donnant le signal de plusieurs guerres horribles, commandant des assassinats et des massacres. Tant les exemples fournis par une politique cruelle et par la soi-disant orthodoxie conservent de force dans l’affranchissement même et sur les cœurs de ceux qu’on appelle hérétiques et qui veulent avoir leurs hérétiques aussi !
Après ce préambule, dont je ne saurais, mes enfants, vous transmettre que le squelette, mais auquel je joindrai quelques notes sur les points historiques qui y sont touchés, mon père en vint à l’histoire de sa vie, que j’attendais avec impatience. La voici renfermée dans ses points principaux, car je ne me sens pas capable de vous la traduire avec autant de force en la rapportant toute de mémoire, que je peux le faire en l’abrégeant. L’éloquence des faits est grande.
« En l’année 1572, j’avais deux ans, me dit mon père. Le 24 août, mes parents furent massacrés à Paris pour avoir voulu défendre un huguenot réfugié dans leur maison. Ils étaient cependant catholiques. Leurs biens furent acquis à leurs assassins, et moi je fus élevé par charité dans un couvent, et instruit dans les principes qui avaient causé leur mort. Je fis honneur à mon éducation.
J’étais moine et encore imberbe, quand je fis mes premières armes à la journée des Barricades. Dévoré de toutes les passions de la Ligue, je crus quelque temps que la chimère du franc gouvernement ecclésiastique allait devenir une réalité grâce à l’Espagne, à la compagnie de Jésus et à la farouche piété du peuple et des étudiants. La jeunesse croit volontiers que les grandes choses sont réservées à son temps, et que la pure vérité a son siège là même où son orgueil, joint avec son amour du bien public, imagine trouver l’universelle réponse à ses doutes et à ses désirs. Ma foi de ligueur se tourna en une rage lors du siège de Paris, mais fit place à l’abattement quand je vis réussir la conversion du roi de Navarre, et finalement au désespoir, pendant cette année décisive qui vit l’édit de Nantes, la paix avec l’Espagne, la mort de Philippe II. J’avais déjà vingt-huit ans. Les tentatives d’assassinat sur le roi Henri IV me semblèrent des rébellions tardives d’un parti qui restait puissant dans la république, mais dont les hautes vues étaient ajournées de force, principalement devant les progrès des sceptiques et des politiques. Les livres de ces derniers, j’entends les livres de philosophie et de morale, et nommément les Essais de Michel de Montaigne, que je lus à cette époque, apportèrent du trouble dans mes esprits. J’espérai trouver un remède au dégoût qui m’accablait en France, et aux doutes dont j’éprouvais la première atteinte, et je partis pour aller trouver la foi catholique dans son centre, afin de m’y régénérer si je le pouvais. Les recommandations de mon passé, et le zèle dont j’avais encore toutes les apparences, me valurent à Rome une place importante et confidentielle, celle de confesseur des accusés du saint office. L’expérience des intrigues romaines, l’étalage de vice des cardinaux, leur incrédulité peu déguisée et les mœurs mondaines du clergé de tous les étages, me forcèrent à bien des réflexions, comme autrefois Luther, mais avec cette différence de moi chétif au grand hérésiarque, que ma foi dans le catholicisme n’y put résister. J’appris d’ailleurs, au cours de mes fonctions, avec quelle ardeur le monde entrait dans de nouveaux chemins et quelle espèce de nouveaux ennemis s’élevaient jusque du sein des mathématiques contre l’Église. Un inquisiteur seul peut savoir tout ce que le siècle passé a produit en secret pour l’entière subversion de la religion, s’il fût venu à se répandre. Ce grand effort est étouffé. Pour combien de temps encore ? Il nous en est demeuré certaine ardeur qu’on voit pour les sciences, avec la défense de toucher, sinon très délicatement, les points réservés à la théologie ; mais il est certain que les articles permis tiennent aux articles défendus par mille liens qui se découvrent inévitablement chaque jour.
Je dois dire aussi qu’environ le même temps, j’avais donné accès en mon esprit aux deux principaux adversaires de la foi : les lettres anciennes, avec l’histoire, et les sciences nouvellement agrandies. La discipline claustrale et puis les passions du ligueur m’avaient tant enchaîné à la vie du corps artificiel qui est l’Église, que ce fut pour moi une sorte de renaissance, mieux nommée que celle du baptême, de lire en ce temps Homère, Sophocle, Platon et le véritable Aristote, encore que ce ne pût être jamais que dans le latin ; et Virgile, Cicéron, Tite-Live, Plutarque, Tacite ; car je m’appris à regarder l’humanité d’un œil nouveau, et moi-même à me sentir autrement homme. Je reculai, par le souvenir des lettres conservées, jusqu’à ces républiques où, sans messe ni moines, on était des hommes non plus, déchus que les nôtres, mais affranchis d’esclavage spirituel plus que ceux qui s’appellent chrétiens. À l’égard des sciences, la doctrine de Philolaüs, restaurée par Copernic, me fit entrer en quelque façon dans l’immensité de la nature, et bientôt la construction factice de la foi me parut une prison pour l’esprit, sombre, étroite et suffocante, de laquelle je trouvais les plans imaginaires imités dans la réalité par ceux des architectes de l’inquisition.
Je vis périr sur le bûcher, à ce moment, un hérétique, homme fort savant, mais exagérateur imprudent, que j’avais entendu deux ans auparavant soutenir le mouvement de la terre jusque dans les prisons de Venise. Ce moine, car il l’était comme moi, avait couru le monde, méprisant les liens de notre ordre, prêchant de tous côtés certain Dieu un et tout, qu’il n’avait point l’art d’accommoder selon le goût des théologiens. Je n’aimais point sa théologie, car elle me semblait ne sortir de l’étroit sentier des dogmes chrétiens et judaïques que pour s’engager dans les routes décevantes où se sont égarés jadis les prêtres égyptiens et les bracmanes ; mais j’admirais la force de son génie et celle de son audace, et j’aimais sa candeur, car il en avait, quoique affectant des allures de provocation. Sans le libertinage qu’il étalait, on l’aurait comparé à ces sujets pleins d’enthousiasme qui fondèrent des religions dont ils n’imaginèrent jamais les suites. Je le vis donc brûler, j’étais là, je l’entendis quand il accabla ses juges de cette parole, mais qui n’était peut-être pas si véritable qu’il la pensait cire en ce qui les concernait : « Vous tremblez, vous qui me condamnez, mais moi je n’ai pas peur. » Au surplus, je demeurai étranger non seulement à la procédure, où ma place ne m’appelait jamais, mais encore aux longues tortures et à l’exécution de la victime.
Je me sentais chaque jour plus pénétré de la tristesse qui n’est pas selon Dieu, de cette tristesse du monde qui produit la mort de l’âme, dans la définitive contradiction des nouveaux sentiments où j’étais et de mon office : ministre de colère ou de grâce d’un Dieu duquel je ne savais plus bien si je devais accorder même l’existence, vis-à-vis de malheureux que j’abusais, dans quel cas plus indignement, je l’ignore, soit qu’ils y crussent eux-mêmes ou qu’ils n’y crussent pas ! Et vivre de ce rôle odieux ! manger le pain de ce mensonge ! Fallait-il donc fuir ? Mais où, comment, avec quelles ressources ? Fallait-il me déclarer, affronter une mort cruelle ? Je ne sais si j’aurais eu ce courage, n’étant soutenu ni par l’ardeur philosophique de Brunus, ni par la haine où m’a semblé prendre son principal mobile, quelques années après, le malheureux Jules César un autre de mes confrères, ni par les plans de réformes dans l’État, desquels un troisième dominicain, le père Campanella, a retiré vingt-sept ans de cachot et ses membres disloqués.
Il arriva que je fus appelé à assister dans sa prison le supérieur d’un notable couvent de notre ordre, vieillard presque octogénaire qu’on avait longtemps soupçonné d’indifférence secrète plutôt que d’impiété formelle et, comme l’on dit, malicieuse. Il n’avait donc été signalé que faiblement à la congrégation du saint office, lorsque tout d’un coup ses proches ennemis, les gens de la cabale fanatique de son couvent, servis par le hasard d’une maladie et d’une syncope, surent s’emparer d’un manuscrit terrible, tout entier de sa main, qui le perdait irrémissiblement. Dans cet ouvrage, maintenant détruit, mais dont la lecture me fut permise, le père Antapire (c’était le nom d’auteur que le manuscrit portait, nom forgé selon le gout du temps), soutenait par une suite d’arguments fort serrés les propositions que voici :
1° Que le problème de l’origine des choses, ainsi que de leur cause, est insoluble non de fait seulement, mais établi tel par démonstration, encore que toutes les choses du monde aient eu, par nécessité logique, des commencements d’être dans le temps ;
2° Que la conception d’un être qui aurait toujours existé et toujours pensé à tous les moments supposables, en remontant une chaîne de durées sans commencement, implique contradiction ;
3° Que rien d’infini, en aucun genre sujet au nombre, ne saurait être donné actuellement, mais que l’idée de l’infini en choses numérables est simplement une idée de la possibilité abstraite de compter ;
4° Que l’intelligence humaine s’applique seulement aux choses en tant que relatives entre elles, étant elle-même toute formée d’éléments qui expriment des relations, en sorte que l’être absolu et tout ce qu’on entend par la perfection métaphysique est, selon la droite raison, le nom d’une idée impossible et contradictoire.
Si de semblables thèses avaient eu l’accompagnement ordinaire, et non sans une suffisante apparence de bonne foi, de la formule à l’usage des savants qui veulent désarmer la tyrannie ecclésiastique ; si le père Antapire, après avoir fait sur la théologie l’épreuve de la raison, avait ensuite humilié la raison à genoux dans la poussière ; s’il s’était écrié :
« Ô Dieu, vos secrets sont impénétrables ! notre raison n’a de force que pour se détruire elle-même et nous courber devant vous, anéantis ! nous adorons vos mystères sur la foi de vos envoyés, et nous croyons vos envoyés d’autant plus que, parlant contre la raison, leurs arguments et leurs succès sont des miracles, »
les théologiens de l’école auraient levé les épaules, et nombre de frères mendiants auraient célébré la piété du bon père. Mais, loin de là, l’auteur, poursuivant sa pointe jusqu’au bout, prétendait trouver la satisfaction triomphante de la raison dans les bornes que la raison se pose à elle-même, et se déclarait le vrai antipode du pyrrhonien. Il n’admettait pas que la foi pût rien là contre, parce que, disait-il, la foi est une fonction indispensable et vraiment excellente, laquelle nous sert à décider touchant telles choses que la raison estime être du nombre des possibles, à savoir dans les cas où l’inaction ne serait pas raisonnable ; mais c’est l’excès de la sottise humaine de croire que la foi a charge de nous certifier les impossibilités logiques. Enfin le père Antapire ne voyait pas de quelle utilité il peut être pour nous de nous guinder à toute force à connaître ce qui n’est point connaissable ; car de prétendre déterminer ce qui enveloppe de tous les côtés notre être, c’est-à-dire la cause première, la nature du tout et la dernière des fins du monde, n’est-ce pas se vouloir consoler de l’ignorance nécessaire par l’extravagance gratuite ?
Les théologiens aperçurent le comble de la malice et du venin dans un certain parallèle que l’auteur instituait entre les religions qui crurent plusieurs dieux et les dogmes chrétiens ; non pas que la religion fût le sujet de son livre, mais seulement pour donner un exemple de sa méthode. Les Grecs et les Romains ont reçu dans leurs croyances des divinités de chair et d’os, s’il plaît de le dire ainsi. Mais pour cela même ces dieux et déesses : un Mercure, une Vénus, une Minerve, un Jupiter leur véritable père, une Junon leur marâtre, étaient, selon le P. Antapire, des personnages d’une existence encore que fort douteuse, si l’on n’en accueillait les traditions, au moins dont l’entendement n’avait point à se plaindre. De fait, il n’y avait à reprocher à nuls d’entre eux de ce qu’on n’en pouvait saisir sans contradiction les essences. La religion du Christ a conservé quelque chose de cela, puisqu’elle a ses saints, et par-dessus eux des êtres de nature angélique qu’elle assure être éminemment réels et vivants, créés comme nous. Mais quand les chrétiens spéculent Dieu même en son essence, il en est tout autrement : là ils croient suivre une science particulière, la théologie, et par la voie de cette science échapper à l’arbitraire des fictions de la mythologie. Mais à parler équitablement, c’est tout le contraire d’un vrai savoir. Quel rapport imaginer entre notre Père qui est dans le ciel, entre le Fils qui mourut pour nous et qui est assis à la droite de son Père, et une essence antérieure au temps, que l’espace n’enserre point, et en laquelle une pensée sans distinction ni origine n’eut éternellement aucun autre objet que soi-même ? Ils parlent d’un être hors duquel il ne subsiste lien, et dont les œuvres sont néanmoins différentes de lui. Il est un, il est immuable ; et il nous crée et nous connaît, ce qui ne se peut faire sans modifications en lui. Pour comble, il nous a donné la liberté de faire ce qu’il sait de toute certitude que nous ne ferons pas, et de ne point faire ce qu’il est inévitable que nous ferons. Ces dogmes se sont infiltrés d’une certaine métaphysique fort ancienne en la religion ; mais ils seraient mieux nommés des centons agencés de dires contradictoires, en sorte que, selon la raison, il serait enjoint de les rejeter à celui-là même qui ne refuserait pas de prêter une ombre de possibilité jusques aux pures fantaisies des plus extravagants mythologues.
Le père Antapire justifiait son nom de guerre en philosophie par des raisonnements curieux qu’il avait très industrieusement composés sur l’idée de l’infini. Il ramenait cette idée à celles de l’indétermination et de la possibilité, et ne lui concédait nulle autre valeur pour la connaissance humaine. Il tirait de là cette conséquence que l’infini ne saurait être lui-même substance ni se prendre jamais pour attribut dénotant quelque chose d’actuel. Toutefois il se gardait fort de cette opinion commune des sectes qui se réclament d’Épicure ou même d’Aristote, lesquelles soutiennent que la conception de ce qui est sans borne est un effet de la sensation de ce qui est borné. Suivant lui, les conceptions négatives généralissimes, telles que l’idée de la négation même, ou du néant ; l’idée de l’être pur, qui n’en diffère point, celles de l’absolu, de l’indéterminé et autres semblables sont au nombre des traits caractéristiques de la fonction intellective, dont elles expriment éminemment le pouvoir abstractif. De l’usage de ces pures conceptions, et de la liberté que nous avons de diriger et de modifier nos pensées, leurs objets en nous, leurs effets propres, il montrait comment nous tirons l’idée du possible, laquelle n’existe pas si distinctement chez les animaux ; puis l’idée du possible indéfini ; et de celle-ci, appliquée à la numération abstraite ou concrète, comment nous composons l’essence qu’on prétend de l’infini de quantité.
Puis, s’attaquant corps à corps à cette imagination qu’il disait tenir à l’espèce d’illusion propre au pouvoir humain de marquer les genres par des signes, que l’on croit par après être ceux de choses autres que ces mêmes genres, il montrait par syllogismes comment le philosophe réaliste assurant l’existence d’un tel infini en acte peut être contraint d’avouer une contradiction in terminis, laquelle toutefois il a coutume de déguiser, en alléguant que cela qu’il lui plaît à lui-même de dire, il ne le comprend point.
Le livre manuscrit du P. Antapire a été brûlé par l’ordre de l’inquisition, sans qu’il ait été possible d’en tirer aucune copie ; et c’est une perte fort touchante ; car tout semble se préparer pour une certaine grande rénovation de la philosophie, laquelle sera la suite de la rénovation des sciences ; et l’on doit craindre que les errements de la scolastique contre lesquels elle sera dirigée, n’y conservent encore une trop forte part. Je connais surtout ici un jeune gentilhomme français, singulier habitant d’Amsterdam que je suis fondé à croire capable de changer plusieurs des idées de nos plus habiles gens, quand il voudra leur faire connaître sa méthode pour les découvertes ; et par la suite il pourrait arriver que le train du monde s’en ressentit au-delà de ce que nos marchands estimeraient possible. Mais quand je vois ce génie fléchir lui-même sous l’autorité d’Angustin ou d’Anselme, je regrette amèrement que je n’aie à lui opposer que l’imparfaite mémoire des raisonnements d’un homme que je n’ose nommer. Je ne suis à ses yeux qu’un pauvre comptable, son compatriote, que parfois il écoute, mais de qui les paroles ne sont pas de tel poids qu’elles méritent toute son attention. S’il savait ma vie, estimerait-il seulement quelque chose un obscur fanatique de 1590, devenu un obscur libertin de 1630.
J’y reviens, à cette triste histoire de ma vie, car j’ai hâte d’échapper à des souvenirs lugubres. Le prisonnier fit de moi son disciple ; le pénitent confessa son confesseur, dont il avait aisément surpris la faiblesse. Quel enseignement ! il devint mon consolateur, lui, cet homme dévoué à un supplice infamant, après des tortures atroces, consolateur d’un misérable de la robe de ses juges et de ses bourreaux ! Il fit pénétrer en moi deux grandes vérités, dont la méditation et la pratique me rendirent la paix de la conscience, jusques au sein du désespoir que me causait toujours le spectacle de ce monde : l’une de ces vérités : que la pensée de l’homme est libre de soi, dans le mouvement des motifs ou passions qui inclinent la croyance, aussi bien qu’elle est incoercible à l’égard des puissances extérieures.
J’appris de là à rejeter par un acte viril ce pesant fardeau des traditions mensongères, des préjugés, des habitudes qui courbaient mon âme, au lieu de vouloir justifier ma lâcheté par la force des choses, ou d’attribuer, comme certains le font, mes déchirements intérieurs aux combats de la grâce et du démon dans un cœur qui s’abandonne et que doit entraîner la puissance d’un vainqueur. De ce jour j’examinai sans aucune prévention la foi de mon enfance et je la renonçai. Je jugeai que je faisais en la sacrifiant l’auto-da-fé profond. L’acte de foi clairvoyante qui délivre ; au lieu qu’on a donné ce nom qui doit nous être abominable à l’assassinat commis par la foi qui s’aveugle.
L’autre vérité, c’est celle que les théologiens ont dite, mais non point qu’ils ont comprise : que Dieu nous est incompréhensible ; c’est à savoir que de lui nous ne pouvons rien connaître, hormis que nous portons dans notre cœur un clair sentiment qu’il nous est commandé de bien faire, et que notre entendement nous engage par sa nature à imaginer que toutes choses ont origine en au bien pour leur état dernier, nonobstant le mal qui paraît. Il pourrait donc y avoir des fins de félicité pour les créatures qui gémissent en ce monde et aspirent à un monde à venir, et, qui sait ? pour celles-là aussi que nous voyons enchaînées maintenant, sous l’empire des basses perceptions. Peut-être est-ce là toute la vérité renfermée dans ce système fameux des métempsycoses. À tout le moins peut-on croire en une certaine condition future réservée aux personnes qui ont pleine et parfaite conscience de leur être et destinée, puisque celles-là ne feraient ainsi que tenir de la même nature qui leur fit don de leurs pensées et de leurs désirs la satisfaction convenable à ces mêmes puissances de vie, comme elles se montrent, et puisqu’il existe une harmonie des appétits et des fins dans toute cette nature, au témoignage des plus savants en elle.
Voilà ce que mon maître pensait et ce que j’appris de son enseignement ; et je crus encore à son instar en l’existence de personnes supérieures à toutes les autres, et auxquelles conviendrait le nom de Dieux, si nous consultions l’usage des religions, de préférence aux abstractions et songes creux des philosophes. Mais nous ignorons tout de ces Dieux, jusques à leur façon d’être par nombre ou unité. Si quelqu’un se veut feindre des rapports de sa personne propre avec de telles personnes, celui-là embrasse une religion ; mais ce sont croyances qu’on ne se donne volontiers qu’en la compagnie des peuples entiers ou en celle des âges, et il est fort malaisé qu’un qui a pu se soustraire, en choses de cette nature, à certaine foi ancienne, ait la simplicité qu’il faut avec l’ardeur pour se lier solidement à une toute nouvelle. Il nous-reste donc la philosophie. Celle de mon maître n’accepte point que la connaissance du premier principe divin nous appartienne, ni que celle que les théologiens nous ont forgée soit rien de plus qu’athéisme caché ; en sorte que je demeure libre de croire en un Dieu vivant, n’étant point tenu au respect des billevesées solennelles du temps qui est tout entier avant qu’il s’écoule, et de l’espace où ne sont nulles parties, et de l’être inaffecté en ses affections mêmes, duquel le connaître s’étend où il n’y a rien à connaître. Ce sont fantaisies destructives de vrai savoir et rêveries de faux mystiques, bonnes en leur appareil de pédanterie pour river les chaînes dont se chargent à l’envi les générations des philosophes.
Ce maître qui me fut vite cher, mais combien, hélas ! ses fortes leçons devaient être abrégées ! dédaigna de pallier ses véritables sentiments devant ses juges. Il leur dit qu’un remords le poignait de ce qu’il n’avait point voué sa vie passée à rendre témoignage à ce qu’il savait être de la vérité ; que toutefois ce remords allait s’adoucir par le martyre dont la bassesse d’une condition toute renfermée ne le défendait pas jusqu’au bout. C’était même trop d’honneur pour lui, le sacrifice étant nul à son âge, disait-il. Pour moi je n’étais point à la hauteur de ce courage, car mon âme n’a jamais eu la trempe de la sienne. Je descendis jusques à lui parler d’une rétractation comme d’une voie ouverte à sauver du moins ses jours ; je le conjurai de vivre, lui représentant qu’au milieu du débordement de la folie humaine, le sage s’abstient et renonce ; que l’innocent, quand il est entouré d’ennemis, peut se cacher et mentir ; et qu’enfin, contre la violence triomphante, le bon droit est excusable de recourir, pour défendre ce qui lui reste, à l’arme de la ruse. Il me répondit par des conseils, ou plutôt par des ordres touchant ce que j’avais à faire moi-même. Il exigea que je l’abandonnasse dès avant le jour du supplice, que je prisse la fuite pour aller vivre en un lieu de liberté, y professant la religion réformée pour sauvegarde et protestation contre le fanatisme papiste ; et en vue d’une postérité plus heureuse il voulut me confier le testament de sa pensée. C’était un nouveau livre qu’il avait eu la force d’écrire en peu de mois dans sa prison, grâce aux privilèges que j’avais pu lui procurer. Au surplus, le vieillard fut inébranlable à toutes instances de partager mes chances de salut, ce qui eût été en les diminuant. Il aurait, je le crois, refusé même un saint certain, non comme Socrate, afin d’obéir aux lois (les lois de l’Église !), mais parce qu’il succombait déjà, sentant l’approche des tortures que ses aveux ne lui pouvaient éviter jusqu’à la fin, à ce vertige de l’esprit qui se communique aux sens chez les martyrs et les met comme en extase.
Au jour qu’il me fixa résolument, voulant se réserver le temps de connaître le succès de ma fuite, je quittai la prison, plus pâle que je ne laissais la victime dévouée. J’emportais sous mon vêtement de prêtre un livre contre l’institution temporelle de l’Église, le plus étonnant, le plus terrible au sacerdoce que jamais homme ait songé d’écrire. Ce livre, mon fils, vous mériterez peut-être un jour d’en avoir connaissance, puisque je vois que manifestement la confession de votre père vous touche et que vous ne devrez point vous arrêter là. En attendant, il doit demeurer profondément caché, car il est contraire à une partie des choses que nous tenons encore dans la religion de laquelle je fais profession en ce pays. Une suite d’accidents que je puis dire heureux y favorisèrent ma fuite, et j’y trouvai le repos sous l’égide des lois civiles. Le P. Antapire a été consumé vivant sur le bûcher, au Champ des Vaches, ancien forum des orateurs romains, le 23e de juillet de l’an 1601. »
Invasion de l’Occident par les doctrines orientales. – Les dissidents du monde romain. – Crise de la Judée. – Les chrétiens.
Dès la haute antiquité, les nations de l’Orient obéirent à des prêtres ou à des rois absolus. Sur les confins de l’Orient et d’un Occident barbare ou inconnu, vers le commencement de notre ère, les races helléniques et italiques montrèrent des dispositions différentes. Ces peuples favorisés de l’esprit et de la nature, les Grecs, les Italiens, ignorèrent le pouvoir des prêtres ou le subordonnèrent aux intérêts civils. Au lieu de grandes monarchies, ils eurent des cités libres et furent les inventeurs de la Loi, cette abstraction destinée à devenir une des grandes réalités des établissements humains. La personne civile et politique n’obtint pas, il est vrai, dans leurs républiques toute, l’indépendance qu’on eut souhaitée, et que l’état de guerre entre les nations rendait impossible ; mais la somme de libertés que permettait la sûreté de l’État vis-à-vis des étrangers, le citoyen la gagna et la conserva à travers beaucoup de vicissitudes. L’asservissement des foules dans la plus brute ignorance qui se puisse imaginer fit place à de beaux systèmes d’éducation destinés à élever chaque citoyen à toute sa valeur virile. Les femmes passèrent de l’état d’esclaves à celui de mères de famille, leur dignité s’accrut, leur influence commença. Tandis que les théocraties de l’Orient livraient leurs sujets à la fièvre des hallucinations religieuses, ou les laissaient croupir dans un amas de superstitions malsaines, les peuples nouveaux organisèrent des cultes simples qui étaient des devoirs et des fêtes de famille et de cité, plus encore que de religion. De libres mystères, dénués de toute signification et de toute action politiques, furent ouverts aux esprits qui ne se contentaient pas du lot de la commune croyance.
Au reste, ces hommes si émancipés pensèrent comme ils vivaient, et ne craignirent pas de regarder le ciel en face. De nombreuses écoles spéculatives tentèrent de déterminer les principes et les éléments des choses par la force naturelle du génie, jusqu’à ce que, lassées à la poursuite du problème impossible de la nature universelle et de l’origine première, elles fissent un retour sur elles-mêmes et entreprissent de sonder la conscience et de créer des méthodes : direction nouvelle qui marque mieux que jamais le caractère humaniste de la civilisation grecque. Pendant ce temps, les sciences abstraites s’organisaient, ces instruments futurs de tant de découvertes ; les sciences d’observation naissaient ; la poésie et les arts plastiques atteignaient la perfection. Telles furent, en un petit coin du monde, loin des grandes puissances politiques et sacerdotales de cet âge, les conséquences d’une seule institution spontanée : l’égalité civile d’un certain nombre d’hommes libres distribués en groupes nationaux.
Celui qui comparera les mœurs de l’Orient avec celles de notre antiquité occidentale apercevra une autre grande différence. Le travail, d’un côté, méprisé et exclusivement servile, de l’autre, devient l’objet d’un commencement de considération morale, quand l’existence de la petite propriété l’impose à des hommes que l’on respecte. Sans doute, le citoyen grec ou romain est avant tout un guerrier, et il n’en pouvait être autrement, mais il est souvent aussi un cultivateur. À Athènes, il est quelquefois un commerçant, un marchand, un artisan même ; et on se tromperait en regardant comme un paradoxe tout à fait isole la préférence que Diogène le cynique accordait au conducteur d’ânes sur le général d’armée.
Mais toutes les choses du monde ne sont qu’action et réaction, parce que les idées directrices des évènements procèdent ainsi elles-mêmes, chez l’individu et chez les nations, et parce que les peuples, que différentes pensées gouvernent, luttent sans cesse pour s’influencer ou se faire violence. Et, quand ils ne se combattent plus, s’ils se connaissent, c’est qu’ils s’imitent. On n’a point encore vu jusqu’ici, dans cette malheureuse humanité dévorée de la passion de soumettre ou de se soumettre, les relations entre peuples, non plus qu’entre personnes, se régler sérieusement sur la reconnaissance de la liberté. En effet, la propre maxime de la guerre étant : Imposer ma volonté, anéantir la volonté d’autrui, il est clair que la paix ne saurait subsister pour des États ni pour des concitoyens, tant que certains d’entre eux se refusent à respecter la liberté chez les autres, ou à l’exercer eux-mêmes, et ne voient point d’alternative entre obéir et commander. Les hommes libres, eux aussi, sont alors dans la nécessité de se faire craindre, et quelquefois de se faire obéir ; voilà pourquoi les Grecs et les Romains, alors même que leurs principes d’égalité et de liberté eussent été sans mélange d’exclusion et d’oppression, c’est-à-dire d’injustice, et il s’en fallait bien, se seraient encore vus obligés d’être les maîtres pour n’être pas les esclaves. Ils furent les maîtres, en effet, jusqu’au moment où, eux-mêmes surmontés par le flot de l’ancienne servitude (dont ils n’étaient pas d’ailleurs sans avoir une source intérieure profonde, dans l’une de leurs grandes institutions, qu’il est superflu de nommer) et se sentant submerger, ils entendirent une grande voix du côté de l’Orient qui criait : « Courbez la tête et adorez. » Que firent-ils alors et qu’advint-il du monde ? C’est ce que nous avons à raconter.
La première injonction vint à la Grèce avant son déclin, et dans le temps du plus grand éclat de son principe : ordre de livrer la terre et l’eau, et de se prosterner aux pieds du Grand Roi. Elle fut victorieuse à Marathon, à Salamine, à Platée. Ce fut une lutte héroïque, une gloire sans pareille dans l’histoire des hommes. Puis, cette Grèce divisée, qui se livrait misérablement aux jeux de la force entre ses propres cités, céda à l’ascendant militaire d’un monarque du Nord, d’une nation disciplinée, dont les mœurs étaient encore les siennes, mais non la liberté. Alexandre, généralissime des Grecs, porta la guerre en Orient. C’est ainsi qu’après la défense vint la conquête ; avec la conquête, tes généraux, les maîtres et les rois : c’est dans l’ordre. La conquête eut encore un autre effet fatal, immense. L’Orient fut soumis mais non transformé ; l’Occident fut pris de l’ivresse orientale. Les Macédoniens murmuraient d’abord en baisant la terre devant le Fils de Jupiter, ensuite ils épousaient des Persanes. Les successeurs d’Alexandre trouvèrent des sujets obéissants et entretinrent des bandes stipendiées de soldats à peu près sans patrie, avec lesquelles ils pesèrent sur les villes grecques ou se les assujettirent. Enfin la décadence commença et fut rapide. Il peut être vrai que les destinées humaines, s’il en est de générales, comportent des rapports continuels et en réclament de plus en plus intimes entre les hommes de toute origine et de toute doctrine. Ce n’en est pas moins un mal certain et fait pour attrister le philosophe, que ces cataclysmes moraux qui réalisent une fusion nécessaire au prix de l’anéantissement des créations partielles où la vérité et la beauté resplendissaient dans l’œuvre des nations privilégiées.
Cet âge intellectuel qui se décèle par les suites de la conquête d’Alexandre, et dont le moment le plus fort est aux premiers siècles de l’empire romain, nous l’appellerons Moyen Âge, comme ayant été l’intermédiaire de la liberté antique et de la liberté moderne, des mœurs et des sciences de la Gréco-Rome et des nôtres. L’âge moyen, l’âge de fusion de la Grèce et de l’Orient est déjà déclaré pour un œil clairvoyant, à l’époque où les Grecs, qui, ignorant les temps et les lieux de leur enfance, avaient développé spontanément l’esprit de leurs institutions et de leurs croyances originaires, essayent de remonter aux doctrines profondes qu’ils croient avoir oubliées, considèrent l’Orient comme la source des vérités sublimes et de toute sagesse, et s’efforcent, à l’aide de traditions suppléées, d’analogies puériles, d’étymologies ridicules, d’identifier leurs divinités civiles et leurs mythes riants avec les dieux substantiels, les sombres croyances et les dangereux arcanes des races vouées à l’adoration et à la vie contemplative. Les philosophes eux-mêmes cèdent quelquefois au courant de la réaction, bien que les plus puissants chefs d’école, Aristote, Zénon, Épicure, Pyrrhon, tous, excepté peut-être Platon, construisent des doctrines essentiellement grecques, appelées à donner encore force et durée à l’esprit humaniste. Mais le platonisme, quand il ne passe point aux sceptiques, penche à la mysticité, et orientalise de bonne heure et de plus en plus. Grâce aux rapports pacifiques établis entre les peuples, au commerce, à la facilité des voyages et à la curiosité proverbiale des Grecs, l’Égypte, la Perse, l’Inde, apportent au sourd travail des intelligences de nombreux éléments dont la perte de tant de livres ne nous permet de connaître l’importance que par les résultats obtenus. Un esprit différent de tous les autres, à beaucoup d’égards, l’esprit hébreu, se jette à son tour dans l’universelle fusion, quand une colonie entière de Juifs s’établit dans la principale des villes fondées par Alexandre, dans celle-là même qui porte encore son nom.
Le Moyen Âge n’eût été qu’une ère locale, restreinte à quelques contrées de la langue grecque. Mais, déjà universalisé par l’effet des communications et des fondations dues à la conquête du généralissime des Grecs, il devint une ère de l’Occident tout entier, grâce à la conquête plus stable et plus étendue des armes romaines. La Grèce avait organisé dans son sein des républiques plus ou moins démocratiques, même communistes ou à peu près pour un temps ; mais elle-même ne fut jamais qu’une grande république fédérative, anarchique, aux guerres civiles perpétuelles, et dont les forces se neutralisaient. La discipline et l’unité firent toujours défaut à ce corps admirable dont toutes les parties, jusqu’aux moindres et aux moins illustres, eurent trop de vigueur pour supporter une tête unique. Ces parties, à leur tour, ces petites républiques furent livrées à de continuels déchirements et manquèrent de tout esprit de suite dans leurs entreprises : effet naturel de l’excès de développement des personnalités, dans un temps où, plus que jamais, il eut fallu de la force, et pour la force, l’union, et pour l’union, des sacrifices. Rome, au contraire, se distingua par la solidité de ses traditions d’État, pendant les cinq siècles de durée de ses institutions républicaines. Son aristocratie, élevée pour la politique et pour la guerre, privée de la distraction des arts et des sciences, étrangère à toute pensée capable de l’affaiblir, développa les qualités sans rivales d’une étonnante persévérance. La distribution des terres conquises multiplia les familles et les soldats. Des lois fortes, dont le peuple romain eut le génie, lui donnèrent, malgré de nombreuses crises politiques, où les citoyens trempaient leur vigueur, cette sécurité des possessions et des transactions nécessaire dans un État, surtout vaste et toujours croissant. Le respect systématique, et toutefois naturel en sa source, des mœurs et des institutions religieuses ou même civiles des provinces, la protection administrative et la paix, bien que chèrement payées, assurèrent la fidélité des races une fois assujetties. Et ce fut ainsi que ce grand peuple vainquit ses voisins, puis surmonta l’énergie militaire du commerce de Cartilage, puis soumit la Grèce elle-même en l’admirant et en l’étudiant, puis enfin et l’Hispanie, et la Gaule, et tout l’Orient riverain de la Méditerranée. Cela fait, ce fut au conquérant de craindre la conquête.
Ce conquérant s’était déjà bien transformé. Non qu’un général ou un proconsul eut rien à perdre pour lui ou pour la patrie à parler grec, à aimer les arts, à discuter avec les philosophes : rien de ce qui ennoblit, instruit et civilise l’homme ne saurait lui nuire. Ce n’est pas même le progrès du luxe dans la cité qui perdit la cité. Les anciens qui ont cru cela auraient cherché la cause du mal dans le plus innocent de ses symptômes, s’ils n’avaient aperçu dans ce fait de luxe que la portée et le sens qui nous sont familiers. Mais quand les suites des grandes guerres eurent donné à la plaie de l’esclavage une extension démesurée ; quand l’agriculture libre eut disparu ; quand le soldat cessa d’être un propriétaire et ne se connut plus comme citoyen ; quand le citoyen eut cessé de vivre de son travail ; quand l’affranchi, c’est-à-dire l’étranger, l’homme de toutes idées et de toutes mœurs, tint une place importante dans le peuple ; quand le gouverneur de province opprima la province pour s’enrichir, et s’instruisit à gouverner le monde suivant les coutumes qu’il voyait prévaloir dans le monde, en Orient surtout ; quand les suffrages s’achetèrent en grand sur le forum ; quand la popularité s’obtint par des actes qui exigeaient trop de puissance entre les mains d’un seul ; enfin quand des généraux en rivalité se trouvèrent à la tête de légions affiliées, aux mœurs rapaces, à l’esprit exclusivement militaire ; quand tous ces effets sortirent d’une cause unique, la conquête, il est clair que Rome ne lut plus Rome. D’une république désormais sans citoyens il ne resta que ces trois choses : un organisme militaire, un système d’administration dont les traditions se transmettaient dans une certaine classe, un prestige immense. C’était assez pour la durée d’une république, romaine de nom, mais la monarchie était fatale, et la libre communication de toutes les parties de l’Empire, dans une paix intérieure perpétuelle, allait commencer l’ère du Moyen Âge romain.
Il y eut donc des sujets et des princes. Mais il n’y eut point de religion régnante, uniforme, dogmatique, absolue. S’en formerait-il une, soit par l’ascendant des empereurs, soit par le mouvement spontané des populations ignorantes, à la suite d’un prédicateur enthousiaste, afin que s’achevât la ressemblance de l’empire romain et des anciens empires du monde ? Telle était évidemment la question capitale des IXe et Xe siècles des civilisations libres.
Il y eut des sujets et des princes. Néanmoins, les empereurs, si nous exceptons ceux que saisit le vertige des hautes cimes, durent se sentir habituellement observés et obligés par le jugement d’une classe d’hommes qui continuaient de penser, qui spéculaient du moins sur les actes politiques, depuis qu’ils étaient réduits à l’impuissance d’agir. Les titres des fonctions anciennes, accumulés sur la personne du prince, lui rappelaient que le pouvoir est une charge publique. Ce sénat, que les historiens nomment volontiers une ombre, était l’ombre de quelque chose de grand et qui imposait encore. Enfin, la philosophie et les notions morales dont tant d’esprits étaient pénétrés, ne pouvaient pas être absolument étrangères aux chefs de l’État. Peut-être même, un jour, se réaliserait le rêve de Platon : la philosophie sur le trône. Pour toutes ces raisons, l’empire romain était encore loin des errements de l’Orient, et il était permis de concevoir de sérieuses espérances de salut.
Il n’y eut point de religion régnante. Ce n’est pas que les Gréco-Romains ne crussent à l’unité de la religion ; tout au contraire, c’est qu’ils y croyaient. Lorsque, abordant par la conquête une contrée nouvelle, ils y trouvaient des dieux de tels noms et de tels attributs, leur première pensée était de chercher lesquels de leurs propres dieux étaient ces dieux-là, et il était rare que le problème ainsi posé manquât de solution. Et lorsqu’ils venaient à rencontrer des symboles décidément différents de ceux des autres cultes à eux connus, ils y respectaient l’application des principes communs à toutes les religions : une tradition ancienne, une possibilité morale, une liberté de croire, un appui que chaque peuple distinct est porté à chercher dans certaines puissances supérieures et protectrices. En réunissant ce peuple à cette sorte de fédération civile et religieuse qu’elle organisait sous son hégémonie après que la conquête politique était accomplie, Rome se reconnaissait des dieux nouveaux, que leurs anciens du Panthéon ne jalousaient point. De là une tolérance parfaite, mais qui pourtant devait trouver des bornes dans l’intolérance d’autrui. Les dieux de Rome ne pouvaient décemment accueillir ceux qui entraient pour les chasser de la maison.
Les divinités exclusives, les sacerdoces à prosélytisme farouche étaient mai venus à se plaindre en se trouvant exclus du bénéfice commun.
Il ne peut exister que trois systèmes logiques de rapports entre l’État et les Églises : l° l’État les ignore toutes ; 2° l’État les reçoit toutes, sans leur imposer d’autres conditions que celles qui sont inhérentes à sa constitution générale et aux lois civiles ; 3° l’État fait son choix, s’identifie avec l’une d’elles et persécute les autres, afin de les anéantir. Les systèmes intermédiaires sont de fâcheux compromis, à la fois injustifiables devant la raison, dangereux par les conséquences de la lutte sourde qu’ils supposent, incapables de concilier des prétentions, toujours contradictoires de leur nature. Le troisième système, celui de l’intolérance, appartient aux États théocratiques ; il supprime la liberté des personnes en ce qu’elle a peut-être de plus intime, le droit de croire ou de nier les opinions incertaines, le droit de douter, le droit de chercher : une liberté qui fait presque toute la démarcation de l’homme et de la nature. Pendant que notre salut terrestre est assuré, grâce à la tyrannie politique, il veut aussi que notre salut céleste soit assuré par la tyrannie religieuse, et il ignore que notre premier salut, en tout genre, est de décider de nous-mêmes, selon la conscience que nous avons de ce que nous devons être. Le second système, ou système romain, s’il était appliqué rigoureusement, et s’il s’étendait non seulement aux divers cultes nationaux, reçus et consacrés dans la métropole de plusieurs nations, mais encore aux opinions ou pratiques religieuses de divers citoyens dans une même cité, en sorte qu’il fut licite à un homme, à une secte quelconque d’avoir ses dieux, sans nul égard aux dieux voisins, arriverait à se confondre avec le système que nous avons nommé le premier et qui est un des caractères du monde moderne. En effet, que l’État ignore les formes du sentiment religieux, comme étrangères a lui-même et à sa fonction, ou qu’il les accepte sans discernement, le fait est le même : les acceptant toutes, il ne peut se revêtir d’aucune ; les ignorant, il ne peut en exclure aucune ; dans l’un comme dans l’autre cas, il ne saurait faire autrement que d’en soumettre l’expression publique aux lois générales de la civilisation qui sont les siennes. Mais, historiquement, le système romain ne put atteindre à cet absolu ; il ne fut pas la conséquence d’un principe clairement aperçu, mais le simple résultat des circonstances du syncrétisme impérial ; et il ne tarda pas à se voir battu en brèche par tout ce que le monde contenait de fanatiques, prêts à tout entreprendre et à tout souffrir pour introniser une croyance sur les ruines de toutes les autres.