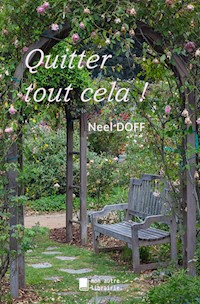Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Quatre nouvelles, autour de quatre personnages savoureux de la Campine flamande. C'est une région que l'auteur connaît bien, pour y être née. Ces quatre portraits, fortement teintés de souvenirs personnels, nous emmènent entre l'Escaut et Amsterdam, au début du XXe siècle, visiter une couche sociale nettement défavorisée. Neel Doff prend pour nous décrire les détails de la vie quotidienne la même plume simple et sans fioritures que pour nous faire partager les émotions les plus tourmentées. Le témoignage n'en est que plus poignant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une fourmi ouvrière
Neel DOFF
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition René Hilsum, Au Sans Pareil, Paris, 1935.
Couverture : Maria Konstantinovna Bashkirtseva
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-81-2
Table des matières
Une fourmi ouvrière
Hanna
Stientje
Le grelotteux
Une fourmi ouvrière
Par une douce matinée de dimanche de mai je descendais ma route pour aller au village. Au bas je rencontrai Mietje, fillette de sept ans, tenant par la main son petit frère Rémi qui en avait trois. Elle avait sa robe et son tablier de dimanche, et dans ses yeux noisette au reflet vert une expression rayonnante aussi de dimanche. Tous ses cheveux chatoyants et ondés étaient étalés autour de la tête et sur son dos, ses tout petits pieds pris dans de gros bas à trous et de lourds souliers usés et pas nettoyés. Ses minces bras d’enfant pas soigné, nus ; les menues mains encore crasseuses d’un lavage incomplet, et les ongles ourlés d’un bord de boue qui les soulevait. Rémi, tout recroquevillé de malaise, avec des croûtes dans le cou, les oreilles coulante, deux sillons rouges sous le nez, qu’on venait de lui essuyer jusqu’au sang, me souriait de son regard pâlement lumineux. C’était dimanche, ils portaient tous les deux les traces du sale torchon imbibé de savon noir avec lequel on avait essayé de les débarbouiller, ce qui ne leur arrivait jamais dans la semaine. Mais ils avaient tout de même autour d’eux ce halo qui nous fait sentir, même au milieu des bois, que c’est « dimanche ».
J’allai vers eux.
– C’est vous, Mietje et Rémi ? Quels beaux cheveux tu as, Mietje.
Et je promenai la main dans la masse ondée, mais la retirai vite en voyant les légions de poux que je dérangeais. Elle avait levé les yeux sur moi, le rose de la joie aux joues, la bouche humide en ce retroussis qui lui découvrait les gencives et faisait pointer son petit nez aigu. De ses yeux une âme frémissante débordait.
– Tu promènes Rémi ?
– Oui, mère lave les autres enfants.
Laver ! Mon Dieu !
– As-tu déjà été à l’église ?
– Oui, ce matin à six heures ; père gardait les enfants.
– Tiens, voilà pour acheter des boules de sucre.
Je leur donnai à chacun vingt-cinq centimes. Rémi, qui n’avait rien dit, eut un soubresaut de joie.
J’entrai chez la petite femme. La puanteur me fit reculer. Je ne pus me taire.
– Voyons ces poux ! Les beaux cheveux de Mietje mangés de poux et de lentes, et un doigt de croûte et de saleté sur le cuir chevelu ! tout de même !
– Il n’y a plus moyen de les nettoyer sans couper les cheveux.
– Si je peux couper ses cheveux, je lui nettoierai et guérirai la tête !
Mietje était entrée derrière moi et se sauvait dans l’étable en sanglotant.
– Couper mes cheveux ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas !
La petite femme, ramassée et terreuse comme une Esquimau, me regardait de son regard d’adoration.
– Mais Door l’épouille à midi pendant qu’il mange ; il en tue des tas de son ongle, à côté de son assiette, mais on n’en vient pas à bout ; c’est une enfant à poux que Mietje, elle en a plus que les autres enfants.
– Voyons, c’est bête ce que vous dites. Elle en a davantage parce qu’elle a une masse de cheveux, et que vous ne faites rien de sérieux pour l’en débarrasser. Que sont les quelques poux que Door écrase à côté de son assiette ?
J’eus un tel soulèvement que je dus m’en aller. Elle me suivit tout effarée.
– Comment faire ? Je ferai ce que me dira Madame.
– Couper ! Couper ! criai-je.
Mietje sanglotait :
– Non ! Non !
La petite femme se levait le matin, inondée d’urine d’enfant, épuisée d’avoir eu son petit au sein toute la nuit, ahurie des fureurs de Door qui, ne pouvant dormir à cause des cris du bébé, s’était sauvé dans la grange pour achever la nuit. Alors, le cerveau et les membres endoloris, elle ne pensait qu’à se faire du café. Les enfants, les vaches, les cochons, les poules clamaient pour avoir leur pitance, mais elle n’entendait rien avant d’avoir absorbé plusieurs bols de fort café très chaud.
Alors, passant le bébé à Mietje, elle courait au plus pressé : d’abord aux vaches que les voisins entendaient meugler et qui en potineraient ; puis aux cochons dans leur trou noir à côté des latrines et aux poules qui avaient envahi la maison et sautaient sur la table picorer les tartines. Après aux enfants qui devaient aller à l’école. Elle ne les peignait ni ne les lavait ; elle essuyait leur nez et leur frottait le visage avec la mucosité qui en découlait puis les faisait déjeuner : du café allongé sur celui qu’elle s’était préparé, des tranches de pain mal cuit beurrées de beurre crème, du jambon rissolé, et elle n’y regardait pas à une tranche, du pain d’épices et du spéculos. Du reste, dès que le cochon était tué, et ils en tuaient quatre par an, on ripaillait ; c’était de la cochonnaille du matin au soir, que les enfants en vomissaient et en faisaient dans leur lit.
Une fois les enfants partis pour l’école, elle se sentait désemparée et courait en face chez Byntje, ou plus loin chez Trieneke, et, à elles toutes, un enfant pendu aux mamelles, ou enceintes, ou les deux à la fois, elles bavardaient, médisaient et s’entredéchiraient innocemment. Midi moins dix les surprenait. Mon Dieu, les hommes allaient rentrer, alors il fallait courir, s’essouffler pour préparer le repas de midi. Quand Door ouvrait la porte, les pommes de terre ne bouillaient pas encore et le regard apeuré, les gestes humbles, elle s’empressait, expliquait que l’enfant avait sans doute des crampes, que son petit caca était tout vert, qu’elle avait demandé conseil à Trieneke, qu’un peu d’alcool à l’anis était le seul remède.
– Oui, il faudra que ce soir tu ailles chez le docteur en demander un peu.
Door ne disait rien, attendait et se mettait à épouiller un enfant. Quand les pommes de terre et les légumes à moitié cuits et croquant de terre étaient sur la table, il disait le Notre Père et le Salut Marie, pendant que la petite femme en courant, les enfants en riant et en suivant du regard ce qu’on leur servait, dégoisaient les réponses.
– Salut Marie.
– Hé, hi, hi !
– Pleine de grâces.
– Hanna qui chipe le plus gros morceau de lard !...
Mietje, qui mangeait très peu et avait fini avant les autres, devait ordinairement s’agenouiller entre les genoux du père pour se laisser épouiller. Puis le pauvre homme, sans avoir desserré les dents, s’en allait à la besogne.
Elle, la petite femme, ne mangeait pas de cette nourriture. Elle prendra quand tous seront partis du café, des tranches de pain tartinées d’une triple couche de beurre, de fromage blanc et de sirop, puis du jambon, des œufs, du pain d’épices et d’amande. Quand il n’y avait pas d’argent elle achetait à crédit, surtout des friandises. Hah ! pourvu que Door ne le sache pas. Mais dès qu’une des boutiquières réclamait son dû, elle se fâchait et s’en allait en claquant la porte. Elle recommençait ailleurs en débinant celle qu’elle venait de quitter, car tout cela se passait entre femmes, l’accord était parfait pour cacher tout aux hommes. Pourvu que Door ne le sache pas ! Tout était là.
Les enfants partis pour l’école et aussitôt qu’elle avait mangé, elle retournait chez une voisine sans s’occuper de ranger quoi que ce fût dans son ménage. Puis venaient les colporteurs, dont elle achetait sans argent des choses inutiles, simplement parce qu’elle ne savait pas refuser. Elle leur offrait du café et des tartines au jambon. Le soir, il y avait toujours à leur table l’un ou l’autre vagabond qui partageait leur repas, passait la soirée avec eux et pouvait dormir dans le foin. Ces soirées lui étaient délicieuses : assise sur une petite chaise basse, l’enfant à la mamelle, les yeux mi-clos de tiède bien-être, elle écoutait et riait à s’entrechoquer les histoires scatologiques que les hommes débitaient.
Mietje grandissait au milieu de cette incurie où rien n’avait son heure ni sa place. À l’école, elle apprenait bien et les enfants de son milieu l’aimaient, mais ceux des boutiquiers et des bourgeois du village, bien que d’une propreté douteuse eux-mêmes, s’en éloignaient à cause de sa saleté excessive et de ses vêtements dépenaillés. Elle croyait que c’était parce qu’elle n’était pas une enfant de riches. Pour eux tout ce qui n’était pas des paysans ou des colporteurs étaient des riches et pas des leurs, mais le paysan le plus riche était des leurs à cause de ses mœurs, de sa saleté et de son incurie.
En grandissant, son physique ne changea guère : elle resta plutôt petite, d’ailleurs quelconque. Elle portait sa grande masse de cheveux châtains, poisseux, mal soignés, comme ces filles qui, un panier au bras, vont de porte en porte vendre des lacets et du fil : une raie de côté, une large mèche en travers du front, bouffant sur les oreilles, pour cacher les plaies de saleté dont s’exhalait une odeur nauséabonde. Le reste tordu sur l’arrière de la tête en un chignon qui se débraillait aux moindres mouvements. Le coup d’œil de ses yeux qui fusionnaient du gris-mauve à l’or pâle était intelligent. Sa bouche, qui découvrait ses gencives en riant, montrait de belles dents encrassées ; son petit corps maigre, au cou trop frêle et comme renfoncé, avait d’étroites épaules ramassées en avant qui lui creusaient la poitrine, où pointaient à peine deux petits seins écartés. Les bras, les mains, les jambes et les pieds étaient ni grands ni petits, et de forme banale, recouverts d’une peau à papilles protubérantes et à écailles de crasse. Elle n’avait nullement l’allure classique des paysannes de Campine, aux jupes multiples, froncées et bouffantes autour des hanches, au petit châle croisé sur la poitrine et la croix d’or au cou, mais l’allure des vagabondes, à la jupe collée aux reins et aux bas troués. Sa tendresse naturelle était cachée sous la rudesse et la brutalité des mœurs du milieu. Quand Rémi, le cou scié et envahi de croûtes jaunes que lui causait le col crasseux de son habit, lui disait : « Mietje, j’ai mal », elle le repoussait rudement avec un : « Va, tout le monde a cela ». Sa voix aux inflexions naturellement douces avait adopté, pour crier après les enfants et répondre à sa mère, les sons incolores et colériques du fer-blanc que l’on secoue. Pour Sander seulement, le valet de ferme d’en face, qu’elle aima avant sa quinzième année, sa voix se fondait, quand il la tenait dans ses bras, et que le regard levé dans le sien, elle frémissait d’amour.
Au sortir de l’école, elle calqua la vie de sa mère qui, se sentant allégée, ne démarra plus de chez les voisines ; rien ne changea donc dans le ménage. Le chaudron des vaches servait de réceptacle aux eaux ménagères ; un baquet d’eau purulente restait en permanence à côté pour laver la vaisselle qui gluait entre les doigts ; des langes d’enfant souillés étaient en tas dans un coin. Un peigne rempli de cheveux et de crasse à côté du pain ; ce pain pétri dans un baquet de zinc, jamais nettoyé, était façonné sur la table et voisinait avec les poux écrasés par Door. Le samedi, Mietje récurait les locaux à grande eau, faisait une rivière de la maison dans laquelle on pataugeait une demi-journée, éclaboussait les meubles et faisait sauter la crasse autour d’elle sur les clenches des portes, et autour de celles-ci était une épaisse couche de crasse accumulée depuis des années. Dans la cour de la ferme une vase, mélangée de fumier, montait au-dessus des chevilles les jours de pluie : la petite femme sur son petit banc, son nourrisson dans le giron, y pelait ses pommes de terre, ou plutôt les découpait tant la pelure était épaisse, et respirait l’air putréfié qui montait de ce cloaque. Les vaches enfonçaient et devaient se coucher dans le fumier qui les encroûtait jusqu’à mi-corps ; elles meuglaient toute la nuit de malaise. Les porcs, dans leurs excréments, occupaient un réduit totalement privé de jour. Les enfants étaient couchés sur des paillasses de paille réduite en poudre, imbibée d’urine et grouillante de poux ; leur tendre chair était jaspée de rouges morsures. Tout recroquevillés sur eux-mêmes, ils gémissaient en dormant. Les petits se levaient le matin à moitié asphyxiés, avec des maux de tête et des vertiges, par l’odeur d’étable et de pourriture qui régnait dans la maison. Il fallait les porter dehors pour les remettre. Tous étaient pâles, terreux, bouffis et envahis de vers intestinaux qui leur donnaient des tremblements convulsifs.
J’y allais tout de même, attirée par le charme de la petite femme qui déambulait dans tout cela, tranquille, sans comprendre, prête à rire, à donner, à consoler, à rendre service, et qui trouvait tout comme cela devait être, n’ayant jamais rien vu d’autre ni chez ses parents ni ailleurs. Quand, dégoûtée, je me permettais de dire que la saleté chez eux m’empêchait d’y venir plus souvent ou d’y boire une tasse de lait, elle me regardait de son regard de primitive qui ne saisit pas, et après, quand je passais la maison sans entrer, elle pleurait en une détresse de petite fille. D’autres fois, elle et ses enfants se cachaient en me voyant venir, n’osant se montrer tant ils étaient repoussants. Mietje, elle, se fâchait plutôt quand je lui disais qu’elle devait récurer la table, où traînaient les carcasses de poux et des cheveux remplis de lentes, avant d’y façonner le pain.
– Mais ça s’est toujours fait ainsi, ça se fait partout ; pourquoi le changerions-nous ? Notre pain est bon.
– Non, il n’est pas bon ; il n’est pas assez pétri, pas suffisamment cuit, et vous devez souvent en retirer des cheveux.
La petite femme se levait du pétrin, congestionnée et maculée de pâte de haut en bas.
– Je pétris autant que je peux.
– Mais c’est bien, faisait Mietje d’un ton rageur ; cela s’est toujours fait ainsi, nous avons toujours vécu de cette façon et mangé de ce pain, pourquoi serait-ce mauvais tout d’un coup ?
Elle me planta là, avec une expression sur la figure qui indiquait clairement que je n’avais pas à me mêler de leurs affaires ; mais pour cela, ils m’intéressaient déjà trop. Leur âme avait la fraîcheur des êtres de Breughel ; leur manière de s’asseoir, de marcher, l’expression de leurs visages, étaient identiques à celles des primitives créatures qui se meuvent dans ces tableaux.
Nous eûmes encore plusieurs altercations de ce genre. Un jour que je m’apitoyais sur Mileke qui hurlait en se frottant rageusement ses yeux bouffis qui lui brûlaient, dans ses orbites, elle me répondit :
– Mais je n’ai jamais vu d’autres enfants, ils hurlent tous parce qu’ils sont méchants ; allez voir partout, vous n’en trouverez pas d’autres ; ils grandissent tout de même et n’en meurent pas.
– Mais tout n’est pas d’arriver à grandir, à ne pas mourir, mais tout est d’être heureux et de ne pas souffrir ; croyez-vous que l’enfance est une étape d’inconscience qu’il est indifférent de franchir ainsi ou ainsi ? L’enfant a des joies et des peines comme l’adulte. Je vous vois toujours rabrouer les enfants quand ils se plaignent de douleurs ou de leurs petits chagrins, qui sont pour eux souvent bien gros, ou encore les tourner en ridicule quand ils racontent leurs enfantines affaires, plus sérieuses pour eux que les nôtres pour nous. Il ne faut pas : pour eux, je vous le répète, ce sont des tourments ou des joies graves qu’il ne faut pas négliger. Rappelez-vous donc. Étiez-vous une petite brute qui ne sentait pas quand je voulais couper vos cheveux ? Rappelez-vous votre émoi. Donc, il ne suffit pas de grandir tout de même, il faut leur éviter autant que possible la souffrance morale et physique, et tâcher de les rendre heureux. Se sentir heureux, tout est là, Mietje. Vous autres paysans de Campine vous ne faites rien pour les enfants que de les flanquer dans le monde. Vous faites moins pour eux que pour vos cochons dont vous escomptez le lard. Les enfants, chez vous, grandissent comme les mauvaises herbes au bord de la route, mais ne sont pas élevés : voyons, comprenez-moi. Leur intelligence, leur petit cœur, rien ne peut se développer. Avec ce malaise sur eux que donne le manque de soins, ils ne peuvent jouir de rien et rien produire. Je sais que ce n’est pas manque d’affection, mais ignorance. En attendant, ces petits êtres s’étiolent.
Quatre enfants s’étaient ajoutés aux cinq qui grouillaient dans la boue depuis que j’allais chez eux. Quatre petites créatures fines et achevées qui criaient et gémissaient ; quatre petites créatures au petit cul brûlé de séjourner dans l’urine, les entrecuisses écorchés, et puant tous les plis du corps enflammés ; la tête envahie d’une carapace dans laquelle les cheveux ne faisaient qu’une croûte où grouillait la vermine, et d’où découlait une sanie qui se répandait sur la figure et le cou ; les oreilles encroûtées exhalaient une odeur nauséabonde ; le nez souligné de deux sillons rouges où coulait constamment une morve jaune que les lèvres absorbaient ; les yeux bouffis et douloureux les brûlaient et leur donnaient des crises de hurlements, pendant lesquelles ils les frottaient jusqu’au sang de leurs petites mains boueuses. J’avais essayé d’amener la petite femme à les laver, les nettoyer, je les avais souvent lavés moi-même, mais elle n’arrivait vraiment pas à en saisir la nécessité. Et Mietje prenait le même chemin. C’était odieux !
Elle avait maintenant dix-sept ans. Une maigrichonne quelconque, dont se dégageait une odeur d’étable et de menstrues, les jupes attachées avec des épingles, coiffée avec un art de mauvais aloi ; rétive, ne soupçonnant dans mon attachement pour eux qu’un intérêt personnel. Cependant je la savais autre. Un jour, elle était encore petite fille, nous avions cherché des mûres ensemble ; pour me faire passer par les ronces, elle avait pris les devants : elle empoignait les longues lianes à dards, les pliait, les courbait des mains et des sabots avec une énergie farouche, puis en prenait de grosses touffes en main, les tenait écartées pour me laisser passer. Il y avait en ce moment sur son insignifiant visage tant de volonté, tant de désir de me plaire, sa bouche et ses yeux étaient si éclairés de joie, que je sentis mon âme chaude.
Il fallait seulement savoir toucher cette âme, lui donner la conscience. Aussi, je ne me fâchais jamais contre elle. Je tâchais d’agir par la persuasion. Mais comment persuader quelqu’un qui ne comprend pas ? Elle n’aimait plus le valet de ferme ; il l’avait choquée en la voulant toute. La religion lui avait enseigné qu’en dehors du mariage, c’était le plus grand des péchés. Il s’était fait un revirement en elle qui l’éloignait des choses sexuelles. Elle ne voulait plus le voir.
Pour causer avec elle, je la faisais venir le dimanche après-midi chez moi. Elle s’extasiait devant les arbres fruitiers, les fleurs, surtout les roses, mais le meilleur goûter la laissait indifférente : du moment que sa faim était apaisée, il ne lui fallait pas autre chose ; une tartine avec un petit morceau de lard et du café le matin, à midi des pommes de terre avec une salade, le soir du café et des pommes de terre réchauffées lui suffisaient. Elle ne comprenait pas la goinfrerie de sa mère et de Hanna, que la mangeaille obsédait.
C’est par un de ces après-midi de dimanche, où tout son être se dilatait dans la paix de mon jardin, que je suis arrivée à lui faire comprendre que leur vie était indigne de gens convenables, que les gestes extérieurs de la cagoterie ne faisaient pas les gens méritants. Votre allure est celle de ces filles qui vont de porte en porte plutôt mendier que vendre une marchandise ; vous êtes des cultivateurs qui vivez de vos biens et ne dépendez de personne. Il faudrait donc que vous, les enfants, la maison, répondiez à cet état social. Puis les enfants que vous aimez souffrent, sont laids et repoussants à cause de cette incurie. Les paysans dans votre rue, même les plus riches, sont comme vous, mais les autres gens du village parlent de vous avec mésestime et dédain. Vous pouvez changer tout cela si vous le voulez. Je vous aiderai.
Elle me regarda bien au fond des yeux, cherchant à comprendre ce qui me guidait, quel pouvait être mon intérêt.
– Voyons, Mietje, il ne s’agit en rien de moi ; je n’y ai et ne puis y avoir aucun intérêt, mais il me navre de voir de jolis et de bons enfants et votre père dans cet état d’avilissement et de souffrance. Avant de connaître votre père j’étais effrayée de son allure chaque fois que je le rencontrais : le lundi, il avait le même bourgeron sale et déchiré que le samedi précédent, les mêmes bas à trous et les mêmes sabots envahis de bouse, son étrange chapeau à large bord, crasseux comme s’il venait de le ramasser sur le fumier, sa figure encrassée dans les rides noires, et des mains !... Cependant tous les travailleurs mettent des vêtements propres pour commencer la semaine. Mais surtout son air morne, comme s’il portait sur lui les calamités du monde, me saisissait. Et ainsi, il poussait sa brouette encroûtée de boue séculaire. Et tout cela, Mietje, à cause de la veulerie de votre mère. Elle n’en est pas tout à fait responsable : elle n’a jamais rien vu d’autre autour d’elle. Mais sachez que vous autres, qui ignorez les misères de la privation, vous pourriez être des gens heureux et estimés, et vous ne l’êtes pas. Vous, Mietje, vous pouvez changer tout cela si vous voulez. Je vous aiderai.
Elle me regarda encore bien à fond, et, persuadée cette fois que je parlais sans intérêt personnel, la bouche frémissante, les yeux agrandis, elle me dit avec conviction :
– Je le ferai, Madame ; par où faut-il commencer ?
– Par laver les enfants, Mietje ; demain matin, pour les envoyer à l’école, vous leur ferez déjà un premier lavage sérieux de la figure, du cou et des mains ; puis vous les peignerez bien. Quel jour cela vous arrange-t-il le mieux pour les laver en entier ? Car il faut les laver en entier au moins une fois par semaine, avec de l’eau chaude au sel de soude et beaucoup de savon, puis les rincer avec beaucoup d’eau propre. Vous avez le chaudron des vaches, on peut bien y mettre une dizaine de seaux d’eau ; du reste je serai là pour commencer et apporterai ce qu’il faut comme essuie-mains. Demain, déjà, vous allez inaugurer cette ère nouvelle en vidant les paillasses, en lavant les toiles – c’est tout de suite sec au soleil – par récurer au savon noir les interstices des bois de lit ; par secouer, battre et brosser les couvertures et les pendre au soleil, en attendant que vous puissiez les laver. Il faut avant tout que les puces disparaissent des lits. La vermine des têtes, je m’en charge, vous n’avez pas la manière. Les garçons, vous les ferez tondre chez le barbier, je m’occuperai de Fineque et de Hanna. Je dirai à Door que je guérirai leur tête si je puis couper les cheveux. Il me laissera faire.
– Mais mère, elle trouvera ça si inutile.
– Dites-lui que je ne mettrai plus un pied à la maison si elle ne nous laisse pas faire. Car maintenant, Mietje, nous sommes des associées.
Et, enthousiasmée, je ne pus m’empêcher de battre des mains.
Elle resta grave comme devant une action qui devait bouleverser leur vie. Et en effet, cela bouleversa leur vie.