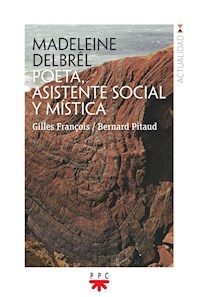Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
« J'avais été et je suis restée éblouie par Dieu. » Quelques semaines avant sa mort, Madeleine Delbrêl déclarait cela à des étudiants, résumant ainsi sa vie où se mêlent d'une façon très unifiée l'expérience intime de ce qui fut semé lors de sa conversion, le 29 mars 1924, et l'élan missionnaire d'une vie donnée à Dieu en plein monde.
Au long de ces pages, le lecteur fait un premier parcours dans ce que Madeleine dit de sa conversion, la plupart du temps de nombreuses années après l'événement. Puis, un deuxième parcours propose une relecture de ses poèmes de jeunesse‚ principalement d'octobre 1923 à mars 1924. Elle y déploie des images pour exprimer à la fois l'amertume, le désir, les hésitations, l'appel et l'accueil libre de celui qui vient. Et aussi la place très grande de la Vierge Marie, médiation de sa prière hésitante.
"Viens à moi" : la réponse qu'elle fit à cet appel fut un consentement au désert. Celui-ci devint fécond, ainsi que le manifestent les vingt-et-un témoins cités dans la troisième partie. Tous connurent Madeleine, dont trois au temps de son athéisme puis de sa conversion.
Les auteurs,
Gilles François et
Bernard Pitaud, sont les artisans de l'édition des
oeuvres complètes. Ils ont aussi produit une biographie générale,
Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale et mystique, des études et six livres thématiques sur des traits saillants de sa spiritualité : "la miséricorde", "la vocation", "souffrance et joie", "la Parole de Dieu", "prêtres et laïcs", "l'Eucharistie". Le pape François l'a reconnue vénérable le 26 janvier 2018 et il en a fait, mercredi 8 novembre 2023, le sujet de sa catéchèse.
À PROPOS DES AUTEURS
Bernard Pitaud est prêtre de Saint-Sulpice et spécialiste des écrits de Madeleine Delbrêl.
Gilles François est prêtre du diocèse de Créteil, historien et postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viens à moi
Gilles François & Bernard Pitaud
Viens à moi
Le désert est un immense appel
Couverture : Richard Garcia
Photo : © Amis de Madeleine Delbrêl et travaux photo Jacques Faujou
Tous droits de traduction,d'adaptation et de reproductionréservés pour tous pays.
© 2024, Groupe ElidiaÉditions Nouvelle Cité9 espace Méditerranée – 66000 Perpignan10 rue Mercoeur – 75011 Paris
www.editionsnouvellecite.fr
ISBN : 978-2-37582-578-5
Introduction
Un événement spirituel, quel qu’il soit, échappe toujours aux prises d’un regard extérieur, parce qu’il affecte la conscience d’une personne en son intimité. Même si l’intéressé s’en explique, décrit ce qu’il a vécu, tente de se faire comprendre avec le plus d’objectivité possible, ce qu’il en dira ne sera jamais que des indications pour suivre une piste qui conduira toujours au seuil de l’inexprimable. Les investigations les plus abouties s’achèveront toujours sur le bord du mystère de la personne. Cela vaut à plus forte raison lorsque l’événement spirituel en question implique un rapport avec Dieu. On ne met pas la main sur une personne, on met encore moins la main sur la rencontre de Dieu avec cette personne. Cela vaut éminemment pour cette rencontre initiale qu’est une conversion. Tous ceux qui ont vécu cette expérience ont pu retracer les chemins qui les y ont conduits, les témoignages qui les ont interrogés et mis sur la route ; mais l’expérience ellemême demeurera toujours indicible, sinon en des termes très généraux. Madeleine Delbrêl a prononcé cette petite phrase, souvent transformée, à force d’être dite et redite sans vérification : « J’avais été et je suis restée éblouie1. » Une image, celle de l’éblouissement, l’invasion intérieure d’une lumière qui aveugle et qui, paradoxalement, éclaire, donne sens à ce qui, jusqu’ici, n’avait pas de sens. Mais la rencontre elle-même n’a pas eu de témoin, sinon Madeleine elle-même qui ne peut la décrire que par une image.
Il faut donc bien s’entendre sur ce que nous cherchons lorsque nous voulons rendre compte de la conversion de Madeleine Delbrêl. Que nous le voulions ou non, nous nous arrêterons toujours au seuil d’un mystère, celui de la rencontre d’une personne avec son Dieu. Pour le croyant, ce sera dans une attitude d’adoration, pour celui qui ne croit pas, ce sera dans une attitude de respect, l’un et l’autre se refusant à s’approprier ce qu’aucun des deux ne possèdera jamais ; « le lieu que tu foules est une terre sainte », dit Dieu à Moïse, du cœur du buisson ardent. Et Moïse s’arrêta respectueusement devant le feu ; mais c’est justement ce qui lui permit d’entendre Celui qui parlait au cœur du feu. Paradoxalement, c’est peut-être le respect qui rend libre pour appréhender quelque chose du mystère. À celui qui accepte de ne pas chercher à s’emparer par force de ce qui ne peut lui appartenir, quelque chose du mystère sera révélé.
Dans cette attitude de respect, l’historien va pouvoir très librement recueillir tous les indices que Madeleine ellemême ou éventuellement des témoins nous ont laissés de sa conversion. Ce sera même pour lui un devoir de rechercher toutes les traces qu’il pourra déceler dans les écrits de l’inté-ressée ou ailleurs, pour tenter de donner une forme concrète à cet événement particulièrement décisif pour elle, puisqu’il a déterminé toute son existence.
1. Madeleine DELBRÊL, La question des prêtres ouvriers, tome X des OC, Nouvelle Cité, p. 217.
PREMIÈRE PARTIE
QUAND MADELEINE DELBRÊL PARLE DE SA CONVERSION
Il faut bien reconnaître cependant que Madeleine ellemême ne nous aide pas beaucoup. Elle n’aime pas parler d’elle. Elle met cette discrétion sur le compte de son origine gasconne. Mais on peut dire aussi qu’elle ne conçoit pas le témoignage sur le mode du récit de sa conversion, mais sous un mode beaucoup plus objectif. Pour elle, témoigner, ce n’est pas raconter son propre itinéraire spirituel, c’est montrer le Christ aux autres, par sa vie et sa parole, montrer son amour, sa joie, sa bienveillance, sa douceur, sa vérité. Pour cela, il n’est pas besoin de se raconter. Le narcissisme n’est jamais loin quand on parle de soi. Quand le Christ l’a trouvée, son premier et son unique travail a été de la transformer en lui, et son effort à elle a consisté simplement à consentir à ce travail, à consentir à devenir le Christ chaque jour un peu plus, c’est-à-dire à s’effacer de plus en plus pour laisser apparaître en elle celui qui l’aimait et qu’elle aimait.
Dans son livre Au-delà de la mort de Dieu, Robert Cheaib cite cette phrase d’un des convertis célèbres du XXe siècle, André Frossard : « Je donne maint détail qui peut paraître insignifiant. Le lecteur voudra bien considérer que l’on est fort enclin à entrer dans les détails, quand on a eu l’étrange fortune d’assister à sa propre naissance. » Il est clair que Madeleine Delbrêl ne se situe pas dans cette perspective. Et non seulement nous n’aurons pas de détail, mais elle ne nous expliquera rien non plus sur son entrée dans la foi : « Mais la plus grande de ses richesses, le chrétien ne peut pas vous la donner. Si Dieu permet qu’on verrouille ou qu’on crochète les cœurs, il ne donne à personne le droit de traverser les mêmes cœurs pour y être cru comme vrai1. » Ou encore : « Beaucoup, plusieurs infidèles recevront la bonne nouvelle : nul ne sait lequel sera appelé à la foi. Donner la foi n’est pas au pouvoir des hommes, même de ceux qui se donnent euxmêmes. C’est sans doute la plus grande de leurs pauvretés : ne pas pouvoir donner ce qu’ils ont de plus cher2. »
En clair, le croyant ne peut pas communiquer sa foi. Ce qui veut dire que Dieu seul la donne. La foi ne peut être reçue d’une autre personne humaine, pas plus qu’elle ne peut être conquise. Si l’incroyant est seul, puisqu’il renonce à Dieu comme faisant partie de son existence, le croyant est seul aussi, puisque son expérience est unique. Il communie certes à la foi de ceux qui croient comme lui, il les rejoint dans un Credo, dans une pratique, dans l’obéissance à une parole, sa foi peut être aidée, soutenue, stimulée par celle des autres, mais il ne croit pas parce que les autres croient. Il croit parce que Dieu l’a rencontré.
Dans Ville marxiste terre de mission
C’est bien ce que Madeleine Delbrêl essaie d’expliquer aux communistes dans les dernières pages de son livre : Ville marxiste terre de mission. Car la plus longue confidence qu’elle fasse sur sa conversion se trouve dans ce livre, où elle invite ses amis marxistes à un dialogue dans la vérité dont elle risque la première démarche. Elle explique d’abord sa position lorsqu’elle professait un athéisme qui lui semblait une question réglée. La religion était à ses yeux un simple comportement social. Dieu était une hypothèse absurde, et par le fait même, le monde, censé être l’œuvre de Dieu était également absurde. La vie du monde n’était qu’une grande farce monumentale, puisqu’au bout du compte, il y avait la mort. Cette conviction, elle l’avait affirmée dès ses dix-sept ans, dans le texte célèbre : « Dieu est mort, vive la mort », où elle dénonçait le caractère dérisoire de la vie humaine, dont les protagonistes (entre autres les amoureux) se voilaient la face en se promettant des « toujours » qu’ils ne réaliseraient forcément jamais.
Mais voici qu’interviennent ceux qu’elle appelle, sans doute avec un sourire malicieux puisqu’elle sait que des communistes vont lire son livre, ses « camarades ». Qui sont ces camarades? Elle ne précise pas. Probablement ceux qu’elle rencontre dans l’orbite du salon philosophique et littéraire du docteur Armaingaud qu’elle fréquente régulièrement à Paris avec son père. Ceux avec lesquels elle va danser le samedi soir, les mêmes et peut-être d’autres, et qui l’emmènent à la messe avant de rentrer chez eux.
Ce qui la frappe dans l’attitude de ces camarades, c’est que Dieu fait partie de leur vie comme un réel aussi réel que la vie elle-même : « Oui, ils étaient fort à l’aise dans tout mon réel ; mais ils amenaient ce que je devais bien appeler “leur réel”, et quel réel ! Ils parlaient de tout, mais aussi de Dieu qui paraissait leur être indispensable comme l’air… Le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui, il n’aurait pas semblé plus vivant. Oui, ils travaillaient, il leur arrivait des plaisirs et des ennuis comme à tout le monde, tout cela était parfaitement pour eux, mais ils étaient tout autant intéressés par ce qui apparaissait comme le grand changement de situation de leur vie et la réunion avec ce Dieu qu’ils étaient d’avance si contents de voir3. » « Plusieurs chrétiens, ni plus vieux ni plus bêtes, ni plus idéalisés que moi, c’est-à-dire qu’ils vivaient la même vie que moi, discutaient autant que moi, dansaient autant que moi. Ils avaient même à leur actif plusieurs supériorités. Ils travaillaient plus que moi ; avaient une formation scientifique et technique que je n’avais pas, des convictions politiques que je n’avais pas et ne pratiquais pas4. »
Madeleine était très sensible au réel, elle ne se payait pas de mots. Or, voici que la foi vécue par ses camarades s’affirme à ses yeux comme un réel, une réalité tangible. Des jeunes normaux, qui aiment la vie comme elle, qui aiment danser et qui, pourtant croient. De plus, des jeunes intelligents, qui avaient suivi des études scientifiques et qui revalorisaient à ses yeux le pari pascalien : « J’étais bien trop fière des facultés intellectuelles de l’homme pour me laisser démissionner dans un “pari”. Parier et se miser soi-même était, au sens fort, une des grandes capitulations humaines. Depuis j’ai nuancé ce jugement, en voyant que les “parieurs” étaient le plus souvent des gens à tempérament ou à formation scientifique5. »
Elle se laisse donc déstabiliser, interroger par les convictions de ses amis. Elle révise ses jugements, elle les affine, signe que sa fierté intellectuelle allait de pair avec une grande honnêteté. Son sens de la vérité l’emportait sur son orgueil. Elle s’aperçoit en particulier que les esprits scientifiques fonctionnent autrement que le sien : « Mieux que moi ils connaissaient sans doute ou pressentaient l’importance d’une intuition et d’une hypothèse dans les recherches expérimentales ; ils concevaient l’invention moins comme une imagination créatrice que comme une imagination divinatrice. » Notons d’abord le : « mieux que moi ». Mais dans la deuxième partie de la phrase, la concision du style de Madeleine laisse le lecteur perplexe. Que veut-elle dire ? Peutêtre que la découverte du chercheur n’est pas de l’ordre de la création, mais de l’ordre de la mise au jour, de l’avènement à la clarté de quelque chose qui est déjà là. D’où l’humilité nécessaire du savant qui ne serait pas un créateur mais l’accoucheur d’une vérité préexistante. Et, en passant, cette intuition géniale : « Peut-être, après tout, Pascal, en étant le promoteur du “pari”, était-il plus savant que philosophe. » En 1956, dans une note écrite à l’attention des Équipes sur le silence, Madeleine parlera du recueillement par lequel le savant « recueille le fruit d’une expérience » pour entrer « en contact avec un peu plus du secret du monde6 ». Le secret appartient au monde ; le savant ne fait que le dévoiler avec respect, dans le recueillement silencieux, dans une attitude en quelque sorte contemplative.
La place de Jean Maydieu, lettres à Paulette Maydieu
La question de la place de Jean Maydieu au milieu de ces camarades anonymes se pose inévitablement. Car un autre document, beaucoup plus bref, mais non moins clair, doit être pris en compte à propos de la conversion de Madeleine. Il s’agit d’une lettre écrite à Paulette Maydieu à l’occasion de la mort de son frère en 1955. Madeleine connaissait Paulette Maydieu, car elle avait passé des vacances à Arcachon chez le docteur Armaingaud dont la villa était proche de celle des Maydieu. Le 29 avril 1955, deux jours après la mort de Jean, Madeleine écrit à Paulette : « Mieux que nulle autre, vous savez ce que je dois au Père ; de tout mon cœur, je demande à Dieu de solder ma dette… » Quelques jours plus tard, le 5 mai, elle précise : « Ma gratitude pour votre frère est double : celle de m’avoir fait rencontrer Dieu… et celle de s’être en allé7. » C’est la première expression qui nous intéresse ici : celle de m’avoir fait rencontrer Dieu. On ne peut pas faire fi de cette indication. Madeleine attribue à Jean Maydieu un rôle majeur dans sa conversion. D’où cette question que certains ont inévitablement posée : les « camarades » qu’elle évoque dans Ville marxiste sont-ils le pluriel discret qui cacherait l’influence du seul Jean Maydieu, ingénieur de Centrale, qu’elle ne veut pas révéler, ou au moins l’influence majeure, parmi quelques autres, de celui qu’elle aimait ? Question sans réponse ; gardons les deux textes qui sont probablement vrais l’un et l’autre, sans que nous puissions faire la part de ceux qui resteront anonymes et de celui qui sera à la fois le grand amour et la grande épreuve de sa jeunesse quand il la quittera pour entrer chez les Dominicains.
Il y a en tout cas une hypothèse qui n’a pas manqué d’être évoquée, mais que la chronologie nous empêche de prendre en compte : Madeleine se serait convertie suite à un chagrin d’amour. Quand Jean Maydieu rentre chez les Dominicains, Madeleine avait déjà retrouvé la foi. Sa conversion date exactement du 29 mars 1924, nous y reviendrons, et Jean Maydieu est entré au noviciat des Dominicains en septembre 1925, après avoir accompli son service militaire, à Fontainebleau. Madeleine avait commencé sa recherche depuis longtemps, et même si Jean Maydieu s’éloignait, elle était sans doute trop « fière » pour « capituler » non plus cette fois devant un pari, mais devant ses sentiments8.
Retour à Ville marxiste
Revenons au texte de Ville marxiste. Madeleine s’est honnêtement laissé interroger par la foi de ses amis. Comme elle le dit, elle ne pouvait plus, dès lors, laisser Dieu dans l’absurde, ne serait-ce que par respect pour ces jeunes qu’elle fréquentait et qui étaient croyants. Depuis qu’elle était devenue athée, sa question était : « Comment se confirme l’inexistence d’un Dieu ? » Maintenant, elle devient : « Dieu existerait-il ? » Dieu n’était plus « rigoureusement impossible ». Il ne « devait pas être traité comme sûrement inexistant ».
C’est là que s’opère chez elle un changement radical d’attitude : elle se met à prier : « Je choisis ce que me paraissait le mieux traduire mon changement de perspective : je décidai de prier. » Elle choisit ce qu’elle a entendu dire de Thérèse d’Avila, un jour, « à l’occasion d’un tintamarre quelconque », c’est-à-dire sans doute à l’occasion d’une de ces rencontres bruyantes, entre « camarades », où peuvent se dire aussi dans le bruit des choses graves et profondes : Thérèse d’Avila, « disant de penser silencieusement à Dieu pendant cinq minutes tous les jours ». Mais, en prenant cette décision, elle n’est déjà plus dans l’attitude de celle qui cherche Dieu simplement avec l’aide de sa raison. Quand elle dit dans La leçon d’Ivry, conférence prononcée devant des étudiants parisiens quelques semaines seulement avant sa mort, dont nous reparlerons, « une conversion violente suivit une recherche religieuse raisonnable9 », elle ne mentionne pas cette étape, essentielle pour elle, de la prière. Car prier, c’est passer au stade du désir. C’est chercher à établir une relation, c’est vouloir entrer dans une expérience qui ne met pas en jeu seulement l’intelligence.
Elle dit qu’elle a prié longtemps, des mois : « Dès la première fois, je priai à genoux, par crainte, encore, de l’idéalisme. » Quel est donc cet idéalisme ? Sans doute cette tentation dont elle sent bien qu’elle la menace : en rester au stade de l’intellect, celui qu’elle aime tant, celui où elle brille, et ne pas vivre dans ce réel qu’elle trouve chez ses amis sous deux formes, aussi prégnantes l’une que l’autre : le réel de la vie ordinaire et le réel de la foi, profondément liés l’un à l’autre, puisque le second fait, comme naturellement, irruption dans le premier.
« Je l’ai fait ce jour-là, et beaucoup d’autres jours, et sans chronométrage. » Elle s’est donc tenue longtemps, humblement, à la porte, sans se décourager. Et elle ajoute : « Depuis, lisant et réfléchissant, j’ai trouvé Dieu, mais en priant, j’ai cru que Dieu me trouvait, et qu’il est la vérité vivante et qu’on peut l’aimer comme on aime une personne. » En réfléchissant, on peut trouver Dieu, c’est-à-dire penser non seulement que Dieu n’est pas une hypothèse absurde, mais qu’il est raisonnable de le poser comme existant. Mais la foi qui lui advient par la médiation de la prière est d’un autre ordre : c’est Dieu qui la trouve et qui se révèle à elle comme « la vérité vivante » qui l’aime et qui se propose à aimer. Dieu fait désormais partie de son réel, parce qu’il est réel. L’intelligence ne lui suffira plus. L’ayant trouvée, Dieu l’entraîne dans une aventure amoureuse, qui s’appelle tout simplement le témoignage.
Au cours de sa « recherche religieuse raisonnable » dont elle nous parle, Madeleine s’est-elle appuyée sur un livre ou sur des livres ? Elle ne nous le dit pas. Il lui arrive cependant, comme le Petit Poucet, de laisser traîner derrière elle quelques petits cailloux, comme des traces de son cheminement difficile. Ainsi, dans une de ses méditations poétiques des années 1945-1946, qu’elle a intitulée : « Pauvreté de celui qui va10 », elle fait parler des gens qui s’attachent à la foi, mais à une foi non encore purifiée de certains restes d’idéologie, non encore détachée de l’échafaudage qui leur ont permis de l’atteindre. Et quand ils veulent la transmettre, ils cherchent à communiquer aussi l’échafaudage ou le brin d’idéologie qui lui demeure lié. Ainsi :
« Moi Monsieur, c’est par saint Thomas que j’ai compris qu’après tout, Dieu était peut-être vraisemblable. Mais qui me dit que, pour vous, saint Thomas n’est pas le plus ennuyeux, le plus incompréhensible des maîtres. »
« J’ai compris qu’après tout, Dieu était peut-être vraisemblable. » N’est-ce pas la première étape de son propre cheminement vers la foi ? On se prend à imaginer que le futur dominicain qu’elle aimait et qui parlait déjà volontiers de saint Thomas aurait bien pu l’orienter vers telle ou telle partie de la Somme théologique. Il faut se garder de l’imagination, mais c’est aussi ce que l’on peut entendre à travers le témoignage d’Hélène Jung, publié dans la troisième partie de l’ouvrage. Ce dont nous sommes certains, c’est que, plusieurs années plus tard, le 1er avril 1927, quand elle énumère à son amie Louise Salonne ses lectures très éclectiques, saint Thomas (sans plus de précision) figure parmi les nombreux auteurs qui sont sur sa table de travail et qu’elle appelle ses « idoles de papier11 ». Le Docteur angélique y voisine, apparemment sans heurts, avec Baudelaire, Péguy, Claudel, saint Jean de la Croix, Bossuet et d’autres. Mais plus tard, quand elle rend compte en style télégraphique à Mgr Veuillot de son itinéraire spirituel, saint Thomas vient après le Dieu raisonnable et le Dieu vivant, donc semble-t-il après sa conversion. Mais il est bien difficile de tirer quelque certitude de ces quelques mots rapidement jetés sur le papier12.
Une leçon sur la foi
Quoi qu’il en soit, en nous racontant son expérience, Madeleine nous fait d’abord une leçon sur la foi. La foi véritable, celle qui change la vie, qui fait passer du stade de l’intelligence à celui de l’engagement de toute l’existence, n’est pas au pouvoir de l’homme. C’est Dieu qui nous trouve et qui établit avec nous cette relation qui transforme la vie en témoignage. La foi est donc la grâce par excellence : « Nous apprenons que, pour nous proposer la foi, Dieu appelle chacun par son nom, que la foi n’est pas un privilège dû à l’hérédité ou à notre bonne conduite : qu’elle est la grâce de savoir que Dieu fait grâce ; la grâce d’être dans le monde voué avec le Christ à sa mission de rédemption13. » La foi n’est donc pas au bout de nos raisonnements, même quand ils aboutissent à poser Dieu comme vraisemblable, voire comme vrai.
Ce qui n’empêche pas les hommes de jouer un rôle dans l’ouverture à la foi : « Ce sont des hommes qui m’ont aidée à la rencontrer, à la savoir possible, à apprendre les premiers mots de ce qu’elle est. » Ce ne sont pas ses amis qui lui ont donné la foi. Mais sans eux, sans le témoignage de leur vie, en aurait-elle reçu la grâce ?
Mais la foi n’est pas seulement la rencontre de Dieu. Elle est la rencontre d’un Dieu qui relativise tout ce qui n’est pas lui. Car il est ce qu’elle appelle : « Le seul bonheur absolu des hommes, celui qui grandit tous les autres bonheurs en les faisant relatifs14. » Paradoxe : comment être grandi tout en étant relativisé ? C’est une question de logique. Si Dieu est le seul bonheur absolu, tous les autres bonheurs ne peuvent être de vrais bonheurs que s’ils sont envisagés dans leur relation avec lui. Madeleine ne pense pas seulement aux biens matériels qui ont toujours tendance à vouloir se déployer et prendre toute la place, y compris celle de Dieu, tout en finissant par décevoir, les uns après les autres. Elle pense d’abord à l’amour du prochain lui-même, puisqu’elle vit en contexte marxiste; l’amour du prochain n’est vrai pour un chrétien que s’il entraîne le prochain vers son bonheur absolu qui est Dieu : « Si notre amour fraternel ne va pas jusque-là, il reste infirme: envers Dieu que nous devons aimer plus que tout et de tout nous-mêmes, envers notre prochain que nous devons aimer pour Dieu comme nous-mêmes15. »
C’est pourquoi elle affirme aussitôt : « L’amour apostolique est une œuvre de justice. » On peut accuser les chrétiens de faire du prosélytisme, mais priver quelqu’un de l’annonce de son bonheur absolu est une injustice. Madeleine réexprime à sa manière le « nous ne pouvons pas ne pas parler » des Actes des Apôtres. Il ne s’agit pas pour elle d’une simple information sur quelque chose d’intéressant qu’elle aurait trouvé. Il s’agit de montrer par sa vie et sa parole que le bonheur absolu vient de s’imposer à elle et qu’elle doit cette bonne nouvelle à tous ceux auxquels celle-ci reste étrangère. C’est plus que : je vous invite à trouver avec moi le bonheur qui vient de m’envahir, comme la femme de l’Évangile qui vient de retrouver la drachme qu’elle avait perdue et qui réunit ses amies pour partager sa joie de l’avoir retrouvée. C’est : j’engage ma vie pour communiquer ce bonheur que j’ai reçu. C’est : je vais maintenant mettre ma vie en forme d’ouverture à ce bonheur, de façon à ce que d’autres puissent y avoir accès à leur tour.
Autrement dit, la conversion de Madeleine et sa vocation apostolique sont indissociablement liées : « Cette vérité reçue gratuitement, je la dois gratuitement : je la dois à Dieu qui me l’a donnée, je la dois aux hommes16. » Il s’agit bien pour elle d’une « œuvre de justice ». On peut noter qu’elle parle ici de vérité. L’expérience qu’elle a faite s’impose pour elle comme la vérité, non pas comme une vérité parmi d’autres, mais comme la vérité de sa vie, celle à partir de laquelle elle va ordonner toute son existence. Ne pas mettre sa vie en forme de communication de cette vérité constituerait une injustice. Ce qui ne veut pas dire, naturellement, que Madeleine a tout de suite compris la forme de vie que sa conversion finirait par entraîner. Il se passera plusieurs années avant qu’elle puisse l’envisager. Il faut du temps pour que les fruits d’une conversion se développent et prennent forme. Cela veut dire simplement que les fruits sont en germe dans l’expérience initiale.
Cette vérité est « la vérité vivante », elle est quelqu’un, « un quelqu’un » comme elle dira plus tard ; « on peut l’aimer comme on aime une personne », parce qu’elle est une personne. La vérité dont elle témoigne est l’amour de sa vie. On comprend qu’elle associe facilement le mot « conversion » au mot « violent » : « À 20 ans, une conversion violente suivit une recherche religieuse raisonnable17. » Elle avait même écrit d’abord, puis rayé : « À 20 ans, à une recherche raisonnable succéda une conversion trop violente pour que je ne l’accepte pas. » Elle fait écho ainsi aux paroles évangéliques : ce sont les violents qui l’emportent. Mais avant d’être emporté par les violents, c’est le Royaume lui-même qui fait violence à la personne qu’il investit. Il change l’axe de son désir et il redistribue toutes choses selon un ordre qui n’était pas jusqu’ici le leur. La vie se simplifie, mais elle se creuse, elle exige soudain des combats auxquels la personne n’était pas préparée. La paix et la joie qui se sont instaurées se mêlent à l’angoisse de ne pas être à la hauteur du retournement qui vient de se produire. Ainsi Madeleine, qui sera immédiatement confrontée à son orgueil alors qu’elle vient de découvrir Dieu comme le bonheur absolu : « Ne vous regardez plus, faites-moi face », fait-elle dire à Dieu dans La leçon d’Ivry, en évoquant les premières pages de l’Évangile qui appellent au retournement, à la « métanoia ».
Conversion et conversions
Naturellement, toutes ces paroles que nous citons, Madeleine les prononce dans les dernières années de sa vie, trente ans et plus après l’événement. L’expression qu’elle en donne, en 1957, pour Ville marxiste et à quelques semaines de sa mort pour La leçon d’Ivry