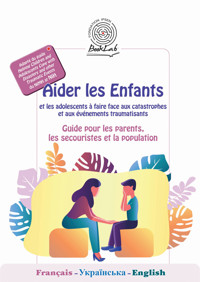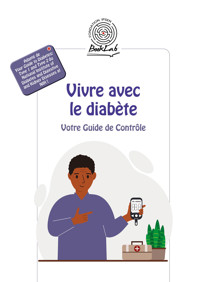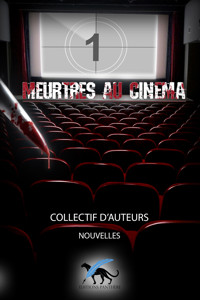Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Le Muscadier
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Francis Eustache aborde avec justesse et concision la maladie d’Alzheimer, depuis la découverte de son existence jusqu’aux méthodes employées pour la traiter
Nous connaissons presque tous une personne touchée par la maladie d’Alzheimer. Pourtant, cette pathologie – dont les conséquences sont souvent dramatiques, tant pour le malade que pour son entourage – reste mal connue de la plupart d’entre nous. Quelles sont ses causes ? ses symptômes ? Comment la déceler, puis la suivre ? Quand le diagnostic est-il possible et souhaitable ? Quels sont les traitements disponibles ? Comment évolue-t-elle ? Est-elle inéluctable ou peut-on agir, au moins partiellement, sur sa survenue et sur sa progression ?
Depuis quelques années, la recherche a accompli des avancées notables, souvent porteuses d’espoirs. Synthèse des connaissances les plus récentes sur l’Alzheimer, cet ouvrage permettra à chacun – et notamment aux aidants familiaux – de mieux comprendre la maladie, et d’améliorer les conditions de vie des patients et de leurs proches.
Un ouvrage éclairant et instructif qui permet d’avoir une vision plus concrète de cette maladie.
EXTRAIT
Sans adopter pour autant une vision angélique de la maladie – ce qui reviendrait à ne pas reconnaître la souffrance des malades et de leurs proches –, l’évolution actuelle incite à une vision moins pessimiste qu’il y a encore quelques années. Les progrès, qui ont connu une accélération récente, ont permis de renouveler la prise en charge des malades, mais les représentations restent à changer. Partant de ce constat, ce livre est conçu comme un outil pour découvrir, ou redécouvrir, la maladie d’Alzheimer, pour aller vers un mieux-être des malades et de leur entourage. Quels sont les symptômes de la maladie ? Comment la déceler, puis la suivre ? Quand le diagnostic est-il possible et souhaitable ? Quels sont les traitements disponibles ? Peut-on prévenir la survenue de la maladie et ralentir son évolution ? Quelles sont les grandes pistes pour la recherche ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce livre destiné à un large public, aux proches des patients et notamment aux aidants familiaux.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
« Cet ouvrage n’est pas un livre académique et ne donne aucune leçon, si ce n’est que l’alliance de cliniciens et de chercheurs de renommée internationale pour son écriture donne un très utile ouvrage dans la collection Choc santé, destinée au grand public mais pas que. » –
Neuroscoop.net
A PROPOS DES AUTEURS
Francis Eustache est directeur d’études à l’École pratique des hautes études et directeur de l’unité de recherche 1077 « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine » (Inserm-EPHE-Université de Caen Basse-Normandie). C’est l’un des plus grands spécialistes internationaux des questions liées à la mémoire.
L’
Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) est un établissement public à caractère scientifique et technologique spécialisé dans la recherche médicale. Son expertise est reconnue internationalement dans de nombreux domaines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Coordinateur:
Francis Eustache
Contributeurs:
Gaëlle Chételat
Béatrice Desgranges
Vincent de La Sayette
Alzheimer:fatalité ou espoir?
DANS LA MÊME COLLECTION
Dépression: s’enfermer ou s’en sortir?
© Le muscadier, 2014
48 rue Sarrette – 75685 Paris cedex 14
www.muscadier.fr
Directeur de collection: Jérôme Dallaserra
Couverture & maquette: Espelette
Adaptation : Marguerite-France Brun-Cottan
Illustration de couverture : © lightwise
ISBN: 9791090685390
Chacun aspire à une bonne santé. Alimentation, activité physique, hygiène de vie en général sont devenues des préoccupations significatives pour une majeure partie d’entre nous. En matière de traitement et de prévention, les progrès scientifiques de ces dernières décennies ont ouvert des perspectives sans précédent. Toutefois, nous ne savons pas toujours où trouver l’information la plus pertinente d’autant que, dans ce domaine en particulier, on entend ou on lit souvent tout et son contraire.
Qui croire? Comment s’y retrouver?
La collection CHOCsanté a pour ambition de rendre accessibles au plus grand nombre, aussi objectivement que possible, les connaissances de pointe établies par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui, depuis maintenant plus de 50 ans, organise la recherche publique dans le domaine de la santé. Le lecteur y trouvera non seulement les avancées médicales les plus récentes, mais également des conseils pratiques qui lui permettront d’améliorer sa santé et celle de ses proches.
Remerciements
Nous souhaitons remercier les membres du Département de l’information scientifique et de la communication (DISC) de l’Inserm, ainsi que les éditions du Muscadier pour leur confiance. Nous sommes également redevables aux différentes institutions et aux personnels de celles-ci qui nous permettent de réaliser cette recherche clinique difficile, mais tellement importante pour le progrès des connaissances et le soin des malades: l’Inserm, l’École pratique des hautes études (EPHE), l’université de Caen Basse-Normandie, le GIP Cyceron et le CHU de Caen. Nombre d’idées et de résultats présentés dans ce livre ont été discutés avec des collègues et étudiants de l’unité de recherche 1077, ainsi qu’avec des collaborateurs de différentes équipes de recherche de la communauté scientifique Alzheimer. Une pensée particulière s’adresse aux malades, à leurs familles et aux sujets contrôles qui donnent de leur temps en participant à nos recherches avec un esprit militant.
Pourquoi ce livre? Peu ou pas connue du grand public pendant longtemps, la maladie d’Alzheimer est aujourd’hui vécue comme une épidémie. Au niveau mondial, environ 35 millions de personnes seraient touchées (selon les critères actuels de diagnostic) et l’on compterait en France 850 000 malades. Ce chiffre explique que nous ayons tous dans notre entourage, plus ou moins proche, une personne concernée par la maladie. De fait, la maladie d’Alzheimer, définie par des troubles de la mémoire associés à d’autres troubles cognitifs ayant des répercussions dans la vie quotidienne, représente la forme de démence la plus répandue dans la population (environ 70 % des cas de démence). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, d’ici 2050, ce sont près de 115 millions d’individus qui seront atteints dans le monde dont 1,8 millions d’individus en France. Pourtant, il ne faudrait pas tirer de conclusions trop alarmistes de ces chiffres, qui pourraient être revus à la baisse. De plus, depuis une trentaine d’années, la maladie est de mieux en mieux connue et les disciplines qui composent l’Alzheimerologie (physiopathologie, neuropsychologie, neuro-imagerie, épidémiologie, etc.) ont connu une progression impressionnante des connaissances.
Sans adopter pour autant une vision angélique de la maladie – ce qui reviendrait à ne pas reconnaître la souffrance des malades et de leurs proches –, l’évolution actuelle incite à une vision moins pessimiste qu’il y a encore quelques années. Les progrès, qui ont connu une accélération récente, ont permis de renouveler la prise en charge des malades, mais les représentations restent à changer. Partant de ce constat, ce livre est conçu comme un outil pour découvrir, ou redécouvrir, la maladie d’Alzheimer, pour aller vers un mieux-être des malades et de leur entourage. Quels sont les symptômes de la maladie? Comment la déceler, puis la suivre? Quand le diagnostic est-il possible et souhaitable? Quels sont les traitements disponibles? Peut-on prévenir la survenue de la maladie et ralentir son évolution? Quelles sont les grandes pistes pour la recherche? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce livre destiné à un large public, aux proches des patients et notamment aux aidants familiaux.
Cet ouvrage a en effet une volonté d’éducation thérapeutique: en intégrant les progrès réalisés ces dernières années, il permet de mieux comprendre les malades, bien différents les uns des autres, et les situations multiples, propres à chaque stade d’évolution de la maladie. Même si les avancées thérapeutiques sont encore modestes, le progrès scientifique, s’il est bien compris, peut se traduire par un mieux-être pour les patients et leur entourage.
La première description de la maladie est l’œuvre du neuropathologiste Aloïs Alzheimer qui, en 1906, constate des troubles spécifiques chez une femme de 51 ans, Augusta D., hospitalisée à l’hôpital de Francfort-sur-le-Main. Il relève chez plusieurs malades des symptômes communs: troubles de la mémoire, du langage et des autres fonctions cognitives, modifications de la personnalité, hallucinations, idées délirantes – tous ces symptômes conduisant progressivement à un état de démence. Aloïs Alzheimer explique ces différents symptômes par des lésions cérébrales dites dégénératives: les plaques séniles (maintenant appelées plaques amyloïdes) et les dégénérescences neurofibrillaires (qu’il a découvertes).
La piste des neurotransmetteurs
À partir des années 1960, les chercheurs qui étudient la maladie émettent une hypothèse pour expliquer la dégénérescence cérébrale, l’hypothèse cholinergique. La maladie serait liée à un défaut du système de production d’un neurotransmetteur, l’acétylcholine. Cette hypothèse s’intègre dans une conception de la recherche biomédicale selon laquelle les grandes maladies psychiatriques et neurologiques seraient rattachées à l’atteinte de systèmes de neurotransmission. Le cas emblématique est celui de la maladie de Parkinson dont les symptômes sont en grande partie liés à un déficit en dopamine, et dont un traitement (la lévodopa) a permis en 1967 d’améliorer significativement l’état des patients. Il se trouve que, pour la maladie d’Alzheimer, l’hypothèse était doublement fondée puisqu’il est établi que l’acétylcholine joue un rôle dans les processus de mémorisation et d’apprentissage, et que la production de ce neurotransmetteur est effectivement altérée de façon précoce dans cette maladie. Cette hypothèse a permis d’élaborer les premiers traitements pharmacologiques dont les résultats thérapeutiques se sont toutefois révélés modestes. D’autres mécanismes influent manifestement sur le développement de la maladie.
L’hypothèse de la cascade amyloïde
La piste des neurotransmetteurs s’étant révélée insuffisante, une autre hypothèse est devenue majoritaire à partir des années 1990, celle de la cascade amyloïde. Selon cette hypothèse, le point de départ de la maladie serait lié à la modification du métabolisme de la protéine Aβ (bêta-amyloïde). L’accumulation anormale de cette protéine conduirait à lui faire perdre ses capacités protectrices en entraînant la formation de plaques appelées plaques amyloïdes. Par effet domino, ces plaques engendreraient des dégénérescences neurofibrillaires dont l’effet serait d’altérer la cohésion des neurones, menant à leur mort. Les découvertes récentes ont conduit à relativiser le poids des protéines bêta-amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer: celles-ci semblent en effet constituer un élément nécessaire, mais non suffisant – tout du moins dans la majorité des formes de la maladie. Par ailleurs, il existe un lien fort entre la progression des dégénérescences neurofibrillaires et l’aggravation des symptômes, ce qui est beaucoup moins vrai pour la charge amyloïde. En conséquence, la relation présentée comme causale entre l’accumulation de bêta-amyloïde et la formation des dégénérescences neurofibrillaires a été remise en cause.
Plaques amyloïdes et dégénérescences neurofibrillaires
Les plaques amyloïdes résultent de l’agrégation et de l’accumulation anormales d’une protéine (le peptide Aβ ou bêta-amyloïde) dans le milieu extracellulaire (en dehors des neurones). Parallèlement, l’hyperphosphorylation d’une autre protéine, la protéine Tau (tubule associated unit), aboutit à une conformation anormale de celle-ci en paires de filaments hélicoïdaux qui s’agrègent à l’intérieur des neurones sous forme d’amas: ce sont les dégénérescences neurofibrillaires (DNF). Ce processus induit un détachement de la protéine Tau des microtubules, altère le cytosquelette et interrompt le transport intracellulaire. Cela se traduit par un dysfonctionnement des neurones et une altération de l’activité cérébrale, puis par leur mort, conduisant, au niveau macroscopique, à une atrophie du cerveau.
Des modèles en constante évolution
Les processus responsables de la maladie d’Alzheimer restent donc encore incertains. En effet, le rôle de la cascade amyloïde est dorénavant contesté, et certains auteurs considèrent que les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires seraient deux processus qui peuvent apparaître en partie indépendamment avant d’interagir. D’autres considèrent que l’un des maillons de la cascade (l’hyperphosphorylation de la protéine Tau, ou tauopathie) serait en fait le processus pathologique fondamental de la maladie d’Alzheimer. Des études portant sur des personnes de moins de 30 ans montrent en effet que la tauopathie débuterait plusieurs décennies avant l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes. Sans remettre en cause l’importance de la pathologie amyloïde, il semble bien que, si l’on s’en tient à l’hypothèse de la cascade amyloïde, la tauopathie soit intégrée trop tardivement dans le processus physiopathologique. Une autre évolution théorique importante avance l’existence d’un processus de propagation par contamination des formes anormales de protéines bêta-amyloïdes et Tau, de proche en proche, via des réseaux fonctionnels de neurones interconnectés, de façon comparable à ce qui est observé dans les maladies à prions. Malgré l’importance de cette idée, il n’existe pas aujourd’hui d’hypothèse avérée sur la façon dont s’effectuerait cette contagion, y compris d’ailleurs dans les maladies à prions. C’est en fait une contamination qui affecte de proche en proche la conformation de la protéine.
Afin d’établir les origines de la maladie, les chercheurs continuent d’élaborer des modèles propres à préciser la séquence des différents événements. Ces modèles ont tendance à proposer une évolution standard, univoque, qui ne rend pas compte de la variété des situations. Toutefois, des pathologies connexes apparaissent d’autant plus souvent que la personne est âgée. Sans remettre en cause les explications physiologiques qui viennent d’être évoquées, certains travaux avancent une hypothèse multifactorielle.
Les hypothèses multifactorielles et les risques modifiables
Les liens entre pathologie vasculaire et pathologie dégénérative sont étudiés avec soin. En dehors des lésions neuronales dont il a été question, il apparaît aujourd’hui indéniable que les lésions et dysfonctionnements neurovasculaires (infarctus cérébraux, hémorragies, lacunes, ischémie chronique de la substance blanche) jouent un rôle important dans la maladie d’Alzheimer. De façon plus large, l’hypothèse multifactorielle cherche à tenir compte des facteurs propres à favoriser ou défavoriser la survenue de la maladie, impliquant des facteurs de probabilité génétique, mais aussi des risques dits modifiables. Il est essentiel de prendre en compte ces risques modifiables, puisqu’ils permettent d’envisager des actions de prévention – ce qui prend tout son sens pour une maladie dont les premières lésions apparaissent tôt et progressent ensuite sournoisement pendant des années, voire des dizaines d’années, et pour laquelle les traitements disponibles ont des effets modestes. Schématiquement, ces risques modifiables comprennent tous les risques cardiovasculaires (hypertension, diabète, obésité, etc.) ainsi que des risques liés au mode de vie comme l’alimentation, l’activité physique, ou les activités intellectuelles et sociales (voir chapitre « Des messages d'espoir »).
Une position extrême de l’hypothèse multifactorielle insiste sur l’ensemble des facteurs modifiables, qu’ils soient délétères ou protecteurs, pour décrire les cas de démence chez les personnes âgées de plus de 80 ans. Selon cette perspective, bien différente des modèles évoqués jusqu’à présent, c’est cette accumulation de facteurs de risques génétiques et environnementaux qui conduirait à la démence. Ce modèle s’inscrit dans un courant de pensée selon lequel la maladie d’Alzheimer n’est pas une maladie à part entière. Il a été proposé dans un premier temps dans un cadre polémique, « le mythe de la maladie d’Alzheimer », qui a choqué de nombreuses personnes, soignants ou aidants, en contact avec les malades. Appliqué aux personnes les plus âgées, ce modèle prend aujourd’hui une forme plus policée et argumentée. Ainsi, pour une personne d’un grand âge, il serait difficile de dissocier les causes de la démence liées au vieillissement et à la maladie d’Alzheimer. Pour autant, ce type d’observation ne doit pas nous conduire à considérer la maladie d’Alzheimer comme un mythe, ce qui risquerait d’aboutir à une mutualisation de la démence et de la dépendance, et entraverait la progression des connaissances ainsi que la mise en place de structures de soins adaptées. La position extrême de l’hypothèse multifactorielle a au moins eu le mérite de poser avec acuité deux grandes questions: qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer? et quels rapports entretient-elle avec le vieillissement?
Une maladie multiforme
La maladie d’Alzheimer présente deux formes distinctes, dont les prévalences sont bien différentes.
La forme familiale héréditaire
Elle est causée par une mutation sur l’un des gènes impliqués dans le métabolisme amyloïde, dont on a vu que le dérèglement occupe une place significative dans la maladie. Ces formes autosomiques dominantes à pénétrance totale de la maladie d’Alzheimer sont exceptionnelles puisqu’elles affectent moins de 1 % des patients. Elles sont autosomiques car la mutation n’affecte pas les chromosomes sexuels (il y a donc autant d’hommes que de femmes atteints); dominantes parce qu’il suffit d’avoir un seul gène muté (celui hérité du père ou de la mère) pour que la maladie se développe; à pénétrance totale car un individu porteur de la mutation développera avec un risque de 100 % la maladie.
Ce sont des formes graves car précoces, débutant presque toujours avant 50 ans, souvent autour de 40 ans, voire de 30 ans. C’est pour cela que les sujets jeunes, ceux qui ont moins de 65 ans, sont soumis à un interrogatoire rigoureux à la recherche de cas semblables dans leur famille, ce qui peut aboutir à la recherche d’une mutation génétique avec leur consentement. Dans une même famille, le début de la maladie est prédictible car les premiers symptômes surviennent au même âge de génération en génération chez chacun des individus porteurs de la mutation. Dans un tiers des cas, les signes cliniques inauguraux sont inhabituels et ne portent pas sur un déficit de la mémoire épisodique. Il peut s’agir d’une aphasie, d’un syndrome frontal, mais aussi de signes et symptômes non cognitifs – épilepsie, myoclonies, syndromes cérébelleux – et aussi d’accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques ou ischémiques.
Cette forme de la maladie par mutation génétique est très rare, mais elle donne lieu à de nombreuses recherches d’un intérêt majeur. Les descendants des porteurs de la mutation ont un risque sur deux d’hériter de la mutation et de développer la maladie à leur tour. Les porteurs de ces mutations permettent d’étudier la maladie à ses stades les plus précoces (vers l’âge de 20 ou 30 ans), bien avant que les premiers symptômes ne se soient déclarés.
Les formes autosomiques dominantes de la maladie d’Alzheimer ont ainsi permis de beaucoup apprendre sur la physiopathologie et le mode de progression et d’extension des lésions. Dans la mesure où l’on peut savoir avec une certitude absolue quelles sont les personnes qui développeront la maladie et, avec une bonne fiabilité, l’âge d’apparition des premiers symptômes, l’étude des biomarqueurs (en imagerie cérébrale et par dosage de la protéine bêta-amyloïde et de la protéine Tau dans le liquide céphalorachidien) a démontré que les premières modifications de concentration de la protéine bêta-amyloïde, suivies d’une succession ordonnée d’autres modifications (hypométabolisme, atrophie, etc.), surviennent 20 à 30 ans avant les premiers symptômes. Ce sont des données essentielles en faveur de l’hypothèse de la cascade amyloïde et cette population s’avère particulièrement adaptée pour tester les traitements dirigés contre la formation de la protéine bêta-amyloïde et des plaques amyloïdes qui ne seraient efficaces qu’aux stades très précoces de la maladie. Afin d’améliorer les connaissances sur la maladie, il est donc important que ces personnes, dont on sait avec certitude qu’elles développeront une maladie d’Alzheimer, participent aux recherches. Des essais thérapeutiques sont actuellement en cours avec pour objectif d’enrayer le processus pathologique chez les personnes porteuses de la mutation génétique, avant la survenue de tout symptôme. Reste à démontrer si ce modèle est précisément transposable et généralisable aux formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer.
Les gènes impliqués dans la maladie d’Alzheimer
(retour chapitre 3)
(retour chapitre 5)
Environ 85 % des formes autosomiques dominantes correspondent à l’un des quatre types d’anomalie génétique actuellement connus: mutation du gène de l’APP (amyloid precursor protein, la protéine dont la dégradation anormale va former la protéine bêta-amyloïde), duplication du gène de l’APP, mutation du gène de la PSEN1 (préséniline 1), mutation du gène de la