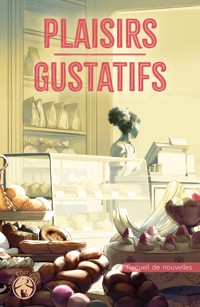Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Geste Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Les amis, auteurs et autrices de Geste éditions, ont tenu à rendre hommage à Joël Nivard en écrivant douze nouvelles et un poème.
Les 12 nouvelles sont rédigées par :
Yves Aubard Jean-Louis Boudrie Laurent Bourdelas Franck Bouysse François Clapeau Philippe Grandcoing Julia Malinvaud Martine Janicot Demaison Patrick Granger Laurine Lavieille Franck Linol François Tacot Fabrice Varieras Christian Viguié
À PROPOS DU Collectif
Un Collectif composé de ses amis, auteurs et autrices de Geste éditions, a tenu à lui rendre hommage :
Yves Aubard,
Jean-Louis Boudrie,
Laurent Bourdelas,
Franck Bouysse,
François Clapeau,
Philippe Grandcoing,
Julia Malinvaud,
Martine Janicot Demaison,
Patrick Granger,
Laurine Lavieille,
Franck Linol,
François Tacot,
Fabrice Varieras,
Christian Viguié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Limoges,
Nocturnes
Hommage à joël nivard
© – 2024 – 79260 La Crèche
Tous droits réservés pour tous pays
Non, il n’y pas de beaux jours pour mourir.
Franck Linol
Joël Nivard, un maître du roman noir.
Le roman noir est un sous-genre de la littérature policière. Un roman qui exprime le malaise social, le roman de la crise, de la violence, un roman de la critique radicale d’un monde à bout de souffle. Le genre du roman noir naît aux États-Unis dans les années vingt, avec pour ambition de rendre compte de la réalité sociétale du pays : crime organisé et terreau mafieux.
Le travail de Joël s’articulait autour de trois axes : d’abord les personnages : ils sont solitaires, sans illusions, des losers, des rebelles, des marginaux, des durs à cuire, souvent des hommes, sans issue. Des personnages qui ont un goût prononcé pour l’alcool, la musique (jazz, rock et blues), la ville, la nuit. Des types usés. Il y a aussi des femmes…fatales. Attirantes et séduisantes, mais dangereuses et qui provoquent la perdition des hommes qui tombent amoureux d’elles.
Ensuite un univers : la nuit, la ville. Limoges. Comme Izzo avec Marseille, Hervé Le Corre avec Bordeaux, Dessaint avec Toulouse. Cette ville qu’il aimait tant. Outre la ville la nuit, Joël décrivait l’univers d’un monde en crise sociale, morale, politique aux mains des mafieux, des flics pourris, des politiques véreux, des délinquants.
Enfin, l’écriture : Joël était un amoureux du style. Toujours à la recherche d’une esthétique, dans ce monde laid. La phrase qui claque comme les talons d’une femme qui marche dans la salle des pas perdus de la gare de Limoges. Les mots, comme des uppercuts. Ça doit faire mal. Il recherchait le rythme. « Je suis de la syncope, pas de la syntaxe. » disait-il en paraphrasant Richard Borhinger*.
Une écriture dont ses lecteurs s’accordent à dire qu’elle est cinématographique.
Dans ce livre, publié en hommage à Joël, vous lirez douze nouvelles et un poème. Nous avons intercalé des extraits des romans de Joël Nivard dont le décor est la ville, la nuit. Et une nouvelle déjà publiée…
Le cahier des charges était d’écrire une nouvelle dans le genre littéraire de son choix avec, comme conducteur, un mot clé révélateur de l’œuvre de Joël.
Les auteurs et autrices qui ont accepté de participer à ce projet sont tous des écrivains qui connaissaient bien Joël et entretenaient avec lui des rapports amicaux.
Tous ont été publiés chez Geste éditions ou le sont actuellement.
Un grand merci à eux d’avoir accepté de participer à cette aventure collective.
Merci à Romain Naudin qui a, sans hésiter et avec enthousiasme, donné son accord pour que ce livre hommage voit le jour.
Bonne lecture.
* « Je suis pas un gars de la syntaxe. Je suis de la syncope.Du bouleversement ultime.Je me fous du verbe et de son complément.Faut pas faire le malin avec les mots. Faut les aimer.Ça file du bonheur les mots. »
Richard Borhinger (2011)
Autres ouvrages par Joël Nivard
Romans
La révolte des vaincus, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2023
Meurtres en Corrèze, avec Franck Linol, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2023
Mourir au Soleil, avec Franck Linol, Moissons Noires, 2022
Les rebelles meurent à l’aube, Moissons Noires, 2021
La route des mortes, avec Franck Linol, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2020
Il n’y a pas de beau jour pour mourir, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2019
N’oublie pas de nous dire adieu, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2018
Sans-Cible, Geste Éditions, collection Geste Noir 2017
Solo pour une nocturne, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2016
Little Bighorn, un été en Limousin, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2015
Le linceul de l’aube, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2013
Dernière sortie avant la nuit, Geste Éditions, collection Geste Noir, 2011
On dira que c’est l’été, deux ou trois jours avant la nuit, Albin Michel 1986
Loser, Éditions Denoël collection Sueurs Froides, 1983
Théâtre
On est bien peu de chose, 2014
Salle des pas perdus, 2012
Faut-il abattre les tringleurs de rideaux, 2008
Chronique du trolley, 2008
Limoges, avril 1905, 2005
Rien n’arrive pour rien, 2000
On pourra pas dire qu’il a pas fait beau aujourd’hui, 1999, Aux Éditions Le Bruit des Autres
Nouvelles
Dérive de sang, dans 7 opus 3, Geste Éditions 2019
Partir à l’heure, dans Terminus, la gare en noir, Geste Éditions, 2017
Je ne me souviens de rien, dans 7 opus 2, Geste Éditions 2017
Le crépuscule d’un flic, dans 7, Le Geste Noir - Geste Édition, 2015
Quai C voie 3, dans Noir Express, Éditions Le Bruit des Autres, 2014
Partir à l’heure
Joël Nivard
Sa ligne d’horizon, c’était le jour se levant dans l’enchevêtrement des rails, au bout de son regard, sur les voies désaffectées de la gare de triage de Puy-Imbert. Et au-delà, les entrepôts vides, les ateliers silencieux, les machines immobiles. À l’écart, les carcasses des voitures abandonnées. Comme des trains fantômes oubliés par le temps et dont la corrosion aurait lardé, ici ou là, la tôle rouillée de plaies béantes. L’été, la patine du soleil tremblait sur l’acier que les roues avaient usé. Et plus loin encore, la chaleur ondulait dans l’air au-dessus du ballast, déformant la géométrie des axes d’acier jusqu’à un point fixe, là où se rejoignent les parallèles.
Droit devant, c’était le nord. La ligne de Paris. Châteauroux. Vierzon. Les Aubrais. Et le terminus gare de Paris-Austerlitz. Longtemps il pouvait rester face à l’écheveau ferroviaire. Défier les potences des caténaires hachant l’infini d’un ciel le plus souvent crayeux tôt le matin, quand il empruntait la passerelle Montplaisir pour se rendre au chagrin. Un parcours qu’il aurait pu faire les yeux fermés, depuis le temps que, chaque jour, il quittait son logement de la rue Jean-Baptiste-Carpeaux pour gagner la rue Aristide-Briand et, enfin, encaper sous le pont la passerelle qui enjambait les voies.
Mais, ce matin, il ne faisait pas chaud et une brume de fin d’automne mouillait les arches de la passerelle, laissant sur le goudron de la chaussée une pellicule grasse entre les flaques gisant dans les ornières. Les réverbères qui jalonnaient les trottoirs secoués par un vent du nord dispensaient un faisceau tremblotant dans la nuit finissante. Le jour se levait au-dessus de la ville. Il aimait cette heure-là. Il aimait le matin. Comme la nuit. Les heures incertaines où la lumière bascule dans les ombres diluées des clairs-obscurs urbains.
C’est alors qu’il changeait de trottoir. Qu’il prenait le temps d’allumer une cigarette, de s’accouder à la rambarde et de planter son regard en face. Dans le vide de la nuit, jusqu’à ce qu’il se heurte, au bout des quais déserts, à l’imposante structure de la gare des Bénédictins dont l’éclairage découpait l’architecture sur le fond tendu d’un ciel résolument tourné vers l’ouest.
Et, chaque fois, il se laissait embarquer, comme ce matin-là, dans l’inspection minutieuse d’un décor qu’il connaissait par cœur, mais devant lequel il ne pouvait s’empêcher, même au bout de trente-sept années, de rester fasciné. Curieux, un peu comme si un détail avait pu lui échapper. Sur le campanile, dressé par tous les temps, dominant cette partie basse de la ville. Sur le dôme bombé, fessier callipyge de cuivre capable d’affronter les gifles de tous les vents comme la frappe des pluies incessantes. Jusqu’aux vitraux embrasés tel un feu qui couverait à l’intérieur, envoyant, dans la nuit, la chaleur de son antre.
La gare, elle l’avait nourri. Elle lui avait donné les plus belles années de sa vie ouvrière. C’était un cheminot. Dans l’âme. Dans les tripes. Et cet attachement-là n’avait pas de logique. C’était comme ça. Pour toute sa génération, l’entreprise, ça voulait dire quelque chose. Tous ensemble s’étaient battus pour elle. Ils avaient lutté contre le dépeçage, contre les dérives d’une gestion de marché. La rentabilité à tout crin. Les lois d’une économie qu’ils n’accepteraient jamais. Tant qu’ils seraient debout.
Et même aujourd’hui, au bout de sa carrière, il tenait par-dessus tout, selon l’expression consacrée, à « partir à l’heure ». Comme arrivaient les trains auparavant. À l’heure, pour lui, ce sera demain.
Il n’aurait pas su expliquer cette dépendance ferroviaire avec des mots. Les histoires d’amour non plus n’ont pas de sens commun. Il tira une longue bouffée sur sa Gitanes, avant de balancer le mégot rougeoyant dans le vide.
Il s’est levé comme à l’accoutumée. Sans avoir recours au réveil. Depuis combien de temps avait-il les yeux ouverts, plantés dans le ciel du plafond de la pièce ? Attendant que l’appel du muezzin sur l’écran de son ordinateur vienne le sortir de cette torpeur dans laquelle se forgeaient ses certitudes.
Inlassablement, les images lui reviennent. Le ciel d’un bleu immaculé. Le sable couleur de latérite. La poussière qui jaillit des bavettes des garde-boue enrobant la longue procession des Toyota sur les pistes défoncées. Les yeux sombres des hommes dans l’espace laissé par le shemagh noir. Tous le même. L’appartenance. Le djihad en marche. L’armée des purs contre les porcs de l’Occident. La main serrée sur la crosse de la Kalache. Le doigt tétanisé sur la queue de détente de la gâchette. Et le vent qui fouette à l’arrière des pickups. La foi, indéfectible. Le drapeau noir claquant dans les rafales qu’accentue la vitesse des 4 X 4 lancés à vive allure. Daesh ! Rien ne peut nous arrêter. Les mécréants crèveront la gorge ouverte et leur sang purifiera la terre du califat.
Allahu Ackbar !
Allahu Ackbar !
Il ferme les yeux, l’odeur du massacre entre dans tous les pores de sa peau. La couleur du sang brouille son regard. La guerre. Jusqu’au bout, jusqu’à la mort. Mourir pour le prophète. Allahu Ackbar !
La longue mélopée des appels du muezzin lui rappelle l’essentiel. La première prière de sobh. Alors que le jour n’est pas levé et que, derrière les volets clos, la lumière de la rue peine à parvenir dans la chambre. Il va jusque dans la salle de bains. Sans allumer les éclairages du couloir. Lui parvient le son assourdi d’un poste de télévision. Il se déshabille et se glisse dans le bac. Il est obligé de s’accroupir, les genoux heurtant la faïence des rebords. L’eau coule glacée. Les nœuds des muscles se défont peu à peu. Il serre les dents. Quand c’est fini, il sèche son corps dans la serviette rêche. Puis il revient dans la chambre. S’habille dans des vêtements propres et commence à psalmodier des phrases des sourates du Coran avant de s’agenouiller sur le tapis orienté vers l’est. Plusieurs fois il prosternera son corps. Et peu à peu, la foi en Allah entrera en lui. Plus présente que jamais. Ravivant la force qui l’habite. La détermination. Aujourd’hui est un grand jour. Allahu Ackbar ! Puis il se lève. Éteint son ordinateur. Enfile son blouson. Vérifie la vacuité de ses poches. Et sans bruit, ses chaussures à la main, dans l’obscurité, il gagnera la porte au fond du couloir. En passant devant l’ouverture de la salle de séjour, il jettera un œil furtif sur le canapé, sur le corps écroulé d’un homme bouche grande ouverte. Le ronflement surdimensionné couvrant le faible volume de la télé allumée. Des cadavres de canettes de bière sur la table. Un cendrier dégueulant de mégots. Par la porte ouverte de la chambre, il peut entendre un autre bourdonnement également soutenu. Et l’odeur d’alcool et de tabac froid l’accompagnera tout le long de la descente des onze étages qu’il effectuera à pied, face à la énième panne d’ascenseur. En bas dans l’entrée, quelques ombres furtives emmitouflées sous des capuches le salueront brièvement. Même dans l’agonie de la nuit, les affaires continuent.
Au-dessus de la barre d’immeubles, le jour point froid sous la couverture nuageuse. Il consulte le cadran de sa montre-bracelet. Il est à l’heure. Il cherche dans sa tête s’il a oublié un détail. Ne trouve rien. Un appel de phare sur le parking. Salim est là. Comme prévu.
Il remonte le col de sa canadienne. La fourrure synthétique vient caresser sa joue. Il enfonce ses mains dans ses poches. Les doigts serrés sur le briquet. Au fond, là où restent toujours des brins de tabac échappés du paquet rigide. À la fin de la passerelle, après la courbe, des rafales venant du nord s’engouffrent dans l’alignement des façades aux volets clos des maisons de l’avenue Locarno qui trace sa ligne droite vers la butée de la rampe des Bénédictins. Au bout, une lueur trahit la montée d’un jour sale. Gris et maussade au-dessus de l’enseigne B and B de l’hôtel low cost. Il laisse son pas dériver dans la pente douce. L’hiver est là. En avance. L’odeur des feuilles décomposées sature l’air glacé. Des bourrasques virevoltantes envoient les derniers résidus des poubelles renversées se répandre au gré du vent. Les automobiles rasent les bordures des trottoirs, c’est l’heure de déhotter, direction le chagrin. Un matin comme un autre pour celui qui a du taf.
Une bouffée d’adrénaline grimpe dans son corps. Pour lui, c’est fini. Demain, il fera ce trajet pour la dernière fois. La retraite. Trente-sept ans au compteur. De belles années encore, devant. Sans doute. Peut-être. On n’en sait jamais rien. L’avenir, c’est toujours un pari sur la camarde. Tellement de potes qui ont dételé avant. Bousculés dans la fosse commune par des maladies innommables. La liste serait longue. Il entend les voix des autres : « Tu l’as préparée, ta retraite ? Il faut anticiper. J’en connais qui… Méfie-toi… On s’imagine que… C’est pas si simple… etc., etc. » On en connaît tous. Il n’a rien préparé. Simplement dans sa tête, des cours d’eau pour ferrer la truite, des chemins forestiers pour laisser son pas se perdre et sa main s’accrocher à une tige de noisetier. Se dire que l’heure n’a plus qu’une importance relative. Boire un verre au Baroudeur à l’angle des rues Henri-Lagrange et de la Brégère en regardant passer les gens pressés, les bus bondés et les automobilistes taciturnes.
Il entend la longue plainte d’un train qui se perd dans le suaire de l’aube. Départ 6 h 47, arrivée 9 h 52 à Paris-Austerlitz. Partir à l’heure. La sienne a sonné. Toute sa vie, il a respecté avec rigueur la contrainte des horaires, des règles d’une organisation le plus souvent décidée sans concertation, et c’est l’une des fiertés de sa carrière que d’avoir eu l’exigence des exécutants besogneux, exigence qu’il n’a pas toujours observée chez les autres, ceux qui décident, qui managent et dont le mépris parfois se lit sur le visage, dans le regard arrogant du chef pour son subalterne. Du maître pour son chien. Le chef, aux ordres. Le traître qui vient du rang. Juste un clébard comme les autres, mais qui a le sentiment de s’être sorti de la meute.
Il n’est pas sûr que ça lui manquera.
Demain.
Il avance et se prend à regarder de plus près ces pierres grises qui ont bâti cette avenue paisible longeant la voie ferrée. Des maisons individuelles plus hautes que larges. Des toits d’ardoises pentus. Des volets clos. Des vitres hautes, obscures, fermées sur des espaces confinés. La propriété. Celle des classes moyennes, voire laborieuses. Ça sent l’économie d’une vie entassée à la Caisse d’Épargne. Quatre murs à soi. Dans la pierre. Au bout d’une vie. Pas de quoi pavoiser. Mais rien à redire non plus.
Après le bar-tabac-journaux Le Locarno, sur la gauche, les Coutures. L’enceinte de la cité ouvrière. Quatre étages aux façades en briquettes de parement. Les premières « barres » de la ville, bâties en 1929. Avec, en bordure, le square dans lequel, les soirs d’été, on vient sur un banc attendre la fraîcheur de la nuit, contempler la lumière s’enliser dans la torpeur estivale et humer l’odeur des buissons de troènes. Voir les chiens des vieux se sentir le cul avant de pisser contre le tronc d’un frêne. Il connaît tout ça par cœur. Ça fait partie de son parcours quotidien.
Maintenant, au-dessus des toitures d’ardoises, le jour soulève la paupière de la nuit. Définitivement. Sur le parking de Grand Frais, un camion livre. Il peut apercevoir la clarté vive qui sort par les portes ouvertes de la réserve. Les mains qu’on frotte en soufflant dessus. La braise des cigarettes. Entendre l’échange des mots indistincts. Les fermetures de la glissière qui claquent. Le rythme régulier des 400 chevaux du camion au repos. Le ronronnement frigorifique des moteurs. Des images d’une vie, la sienne. Argentique en noir et blanc. Diluées à l’envi. Tatouées dans sa mémoire.
Avant d’arriver à l’entrée de ce qui était la gare de marchandises jadis, allée de Seto aujourd’hui, il voit s’avancer le vieux labrador beige balayant l’air froid de sa queue. Le corps chaloupe en une démarche hasardeuse. Une complicité passe dans le regard de l’animal aux yeux vitreux, bouffés par le glaucome. Un vieux chien. Comme lui. Le museau froid se glisse dans la paume de sa main. Il caresse le poil humide et fouille de l’autre dans sa poche. Le carré de chocolat est au fond. Enveloppé dans le papier alu. Dans ce rituel de tous les matins où ils se rencontrent, on retrouve la connivence des vieux pour les sucreries. Les amitiés innommables pour une tendresse fugitive.
Il n’a jamais su à qui appartenait le chien. Ni comment il se nommait. Alors il l’a baptisé Misère, en souvenir d’un autre chien qui n’avait que trois pattes. La plupart du temps, il était là. Et cette présence le réconfortait. Avant de passer l’entrée du parking. Plus loin, il le regardait s’enfuir, tout de guingois, en mâchouillant sur ses vieux chicots et disparaître dans la nuit. Jusqu’à demain peut-être. Ou pas. Mais demain, ce sera adieu le chien.
Et, de ça, il n’est pas certain de pouvoir s’en passer.
La voiture le frôle juste au moment où elle franchit les bandes matérialisées du passage piéton. Il fait un écart. Croise un regard dans l’obscurité du véhicule. Pourquoi celui-ci s’imprime-t-il dans sa mémoire ? Aussi fugitif fût-il ?
Les yeux.
Noirs au milieu d’un visage blême.
Défait.
Des yeux morts.
Maintenant, le jour grimpe à l’assaut du ciel. Il se planque encore derrière les barres des quartiers nord. Mais les nuages tanguent dans le vent et on aperçoit juste un point lumineux planté dans la ouate dispensant sur la ville une luminescence monochrome. La voiture file le long des avenues vides. Salim a la main ferme sur la gaine usée du volant. Sa main ne tremble pas. Il fixe droit devant. Sans un mot. Pourtant, à l’intérieur. Mais rien ne passe.
À côté, il ne cesse de réciter les sourates dans sa tête. Hochant ostensiblement le buste au rythme des épaules. À la recherche du vide. Au bout, il y a Allah. La lumière.
Les vitrines des magasins défilent. Les odeurs aussi, celle de la boulangerie, la devanture envahie par la buée et la porte ouverte, charriant les effluves de la mie chaude, de la croûte craquelée. L’image de ce vieux que l’insomnie a viré de son pieu, avec sa baguette de pain sous le bras, son journal dans la poche, la casquette enfoncée jusqu’à la garde des oreilles, le regard plongé dans le sol et, devant lui, l’immensité d’une journée dont il ne saura pas quoi faire. L’odeur des poulets embrochés à l’étal sur le trottoir de la boucherie halal. Les clients déjà, emmitouflés dans de lourds manteaux. Les habitués du bar-tabac, dehors, qui fument en terrasse, comme s’il faisait bon. Comme s’il faisait chaud. Les cafés qui tiédissent sur le zinc. Les petits blancs dans la paume calleuse des mains ouvrières. L’agonie du croissant dans la panière au bout du comptoir à côté du Populaire du jour, ouvert à la page des annonces légales. La bonhomie affectée d’un serveur qui en a déjà plein les bottes. La vie qui se lève. La vie qui passe. Les trolleys qui charrient vers la ville leur cargaison de gens pour qui chaque jour est d’une évidente platitude répétitive.
Il ne voit rien de tout ça.
Pas plus que Salim.
Ils contournent le bassin de la place Carnot. Ils n’ont pas échangé le moindre mot depuis leur rencontre sur le parking derrière la rue Georges-Braque. Comme si le silence était le seul compagnon de leur voyage. C’est au moment de s’engager dans la rue Théodore-Bac qu’ils voient la lueur des gyrophares de la voiture de police, juste derrière eux. Puis qu’ils entendent la sirène, comme si elle était à l’intérieur de l’habitacle. Ils échangent un bref regard. Une inquiétude fugitive. Mais celui de Salim revient droit devant dans l’axe de descente de la rue. Insensiblement, il se dirige vers la droite, au ras du trottoir. Il ralentit.
« Ô vous les infidèles !
Je n’adore pas ce que vous adorez.
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore…
Dans sa tête. Qu’il balance d’avant en arrière. Les yeux grands ouverts derrière le pare-brise. La voiture de police double, il s’apprête à se garer le long de la chaussée. Inch Allah. Ils sont trois à l’intérieur dont une jeune femme qui, l’émetteur en main, semble donner des instructions, ou en recevoir. Les traits tirés par la fatigue de la nuit. Ils passent en trombe, sans un regard, et dévalent la rue en direction de la place Maison-Dieu, toutes sirènes hurlantes.
La main de Salim crispée sur le volant. Les doigts aux jointures blêmes. Dans sa tête, toujours.
Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez.
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
À vous votre religion, et à moi ma religion ».
Le pied de Salim lâche l’embrayage. Le moteur hoquette. Il cale juste au moment où le feu passe au vert. Derrière, le klaxon rageur d’une fourgonnette envoie sa salve de stridences agressives. Il lui faut quatre tentatives avant de repartir. Le temps de voir la trogne du conducteur vociférant et dont ils devinent à peu près les imprécations de « sales bougnoules ». Ils parviennent enfin à repartir tandis que la patronne du Théodore pose sur le trottoir le chevalet maintenant l’ardoise rédigée à la craie et indiquant le menu du jour.
En bas de la rue, le campanile jaillit dans la brume. On devine l’horloge et le lettrage de la marque Brillié enfouie dans le taffetas vaporeux des limbes. Sous les abris des bus, les silhouettes s’entassent. Les cols des blousons et manteaux relevés, les écouteurs enfoncés dans les oreilles sous le revers du bonnet. Les mains et les yeux pris par les écrans tactiles. Les épaules charriant le sac à dos volumineux. Un monde en ordre de marche. Ce n’est plus le leur désormais, si tant est qu’il l’ait été un jour.
Ils remontent la rampe des Bénédictins, longent le parvis. La file des taxis et les gens pressés, envahis de bagages. Qui courent. Vitupèrent. Et s’enfoncent dans l’antre de la coupole.
Ils n’ont toujours pas échangé le moindre mot.
Guide-nous dans le droit chemin,
Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,
Non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
Ils pénètrent dans le parking par l’allée de Seto.
Pour un peu, ils auraient pu renverser le vieux dont ils ne devinèrent qu’au dernier moment la silhouette dissimulée dans la brume.
Son regard file le long des voies au-delà du parking. Il ne reste plus rien. Que les épis des emplacements vides des véhicules qui se perdent au loin. Vers le sud. Avant, les hangars battus par le vent laissaient les quais de déchargement au cul des camions. Les lumières tremblotantes dans les rafales. Et les heurts des chariots transportant les marchandises de la profondeur des semis jusqu’à l’obscurité des wagons immobiles.
Avant, c’était la gare de marchandises. Les entrepôts Pomona, ceux frigorifiques de la STEF. Le vacarme des moteurs activant la congélation. Les portes ouvertes des chambres froides. La vapeur glacée qui se glissait dans les nuits tièdes de l’été. La sueur des hommes. Des femmes. La nuit au chagrin. Les casse-croûte avant l’aube. L’odeur du pâté de tête. De l’échalote rôtie dans le beurre. De la viande qui rissole dans le cul de la poêle. Le coup de rouge pour éponger les tartines de pain noyées dans la sauce. Les corps des uns et des autres qui s’enlacent, un peu à l’écart. L’étreinte furtive de l’adultère conventionnel. La baise occasionnelle d’une tromperie forcément pathétique. La nuit, le plaisir a le goût du péché pour tous les culs-bénits. Et le mensonge n’est jamais qu’un aveu de faiblesse.
Le travail, c’était aussi ça. Et personne n’avait rien à redire. Chacun y mettait du sien. Au bout du bout, chacun y trouvait son compte.
Longtemps, il avait travaillé de nuit. Ici. Jusqu’à ce que des engins viennent raser les murs, les infrastructures métalliques, les entrepôts désaffectés et que les spécialistes estiment qu’un parking servirait au mieux les intérêts des usagers et de l’entreprise. Dont acte. On avait bâti une passerelle pour gagner le hall de la gare, laissant un espace baptisé CIEL qui était en fait une plate-forme pour l’envolée des bus desservant ce que le train n’assurait plus.
Le vent s’enroule autour des pylônes maintenant les éclairages fixes. Comme un sifflement qui passerait entre deux dents, entre deux lèvres. Il aurait tant à dire sur ce lieu. Et forcément l’histoire et la fin de cette grève. 1995. Un mois debout. Porté par la volonté de ne rien céder. De ne pas laisser les chiens bouffer la part de la révolte. Un ciel immense et nu. Un froid de gueux. Des palettes enflammées réchauffaient la détermination des piquets de grève. Sur chacun des visages que la fatigue rongeait se lisait l’incertitude. L’usure n’avait pas de prise sur ce conflit-là. La solidarité de tous jouait à fond : amener du bois, de la bouffe pour alimenter les casse-croûte et l’enveloppe pour ceux dont la fin du mois commençait le 10. C’était ça aussi, la fraternité militante. Tandis qu’à la télé un ministre droit dans ses bottes affirmait qu’il ne céderait rien, jusqu’à ce que les cheminots lui bottent le cul le 21 décembre.
Il revoit encore les doigts d’Annie assemblant le méchant drap et coudre le drapeau qui sera hissé tout en haut du campanile, tendu sur la hampe, fouetté dans le vent glacé. Un ciel d’une pureté sans partage. Depuis vingt-sept ans qu’on n’avait pas vu ça. La gare, insurgée. Un mois de lutte. Le drapeau rouge, vigie de sang sur la pierre grise, tachant le cuivre verdâtre du campanile.
Il allume une dernière Gitanes avant d’encaper la montée des escaliers qui l’amèneront jusqu’au hall après avoir parcouru la passerelle du bâtiment au-dessus des voies. Ces souvenirs-là lui laissent toujours un frisson sur la peau. Un voile de brume sur les pupilles de son regard. Comme des larmes que le temps aurait figées. Et qui ne voudrait pas avouer que ce sont des larmes. La nostalgie, camarade. Sans doute. C’est dans sa chair. Un tatouage que rien n’effacera jamais. Pas même cette putain de mémoire qui s’enfuit et trafique les souvenirs comme ça l’arrange.
Des gens autour de lui s’essoufflent et ahanent en tirant à leur suite la valise à roulettes qui chaloupe dans la montée. On le dépasse. On le bouscule. Des pas s’activent sur les marches en bois. Des talons claquent. Le vent rugit entre les parois de tôle. On entend la voix standardisée de Simone annoncer les arrivées et les départs. Dehors, la lumière du jour grimpe, éteignant les réverbères. Le parking est plongé dans la gaze de l’aube. Une grisaille ruisselante de laquelle s’extirpent les halos tremblotants des fanaux qui balisent les quais. Plus loin encore, les feux arrière d’une machine s’enfonçant dans la brume.
C’est peut-être dû au corps déstabilisé par le poids du fardeau au bout du bras. À ce sac de voyage, la virgule Nike partiellement effacée. Aux baskets usées dont les semelles avachies chuintent sur le revêtement du sol. À cette silhouette mince à la taille bizarrement ample. Des vétilles sans doute. Pour cet homme qui, le pas résolu, passe devant lui. À ce visage ostensiblement tourné vers le sol. Il pourrait asséner des détails confondants. Juste parce que son œil s’est arrêté sur cette image d’un homme dont le bagage semble disproportionné. Et il ne saurait dire pourquoi. Mais on ne sait jamais à quoi ça tient.
Le hasard.
Ils ont garé la voiture un peu à l’écart. Puis ils sont restés dans le véhicule. Sans un mot. Ils entendent le vent s’embarquer sur le parking. Cogner contre la carrosserie vétuste. Ils voient le soleil s’embraser derrière un ciel opaque qui restera terne. Sans issue. Des cars arrivent et vont à l’opposé dans les emplacements réservés aux terminaux. Des grappes humaines descendent. Frileuses, les yeux rougis, chargées de bagages et le pas hésitant. Ils encapent l’escalier. Pressés de partir. C’est Salim qui, le premier, ouvre la portière, laissant le vent envahir l’espace. Marouane suivra. Empêtré dans les sourates.
Il est Allah, Unique.
Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.
Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus.Et nul n’est égal à Lui.
Puis ses lèvres cesseront de balbutier. Son regard enfin se fondra dans celui de Salim. Il rassemblera en lui les ultimes forces qui lui manquent. Et il laissera la volonté d’Allah guider définitivement les gestes de sa main.
Le hayon de la Clio vibre dans les secousses venant du nord. Salim tend la ceinture à Marouane. Elle est lourde et il manque de louper le cran de la fermeture. Mais l’axe de la boucle s’enfonce dans l’œillet de cuir. Une traction du poignet, et la lanière vient se plaquer sur sa taille. Il vérifie de la main si tous les pains sont en place. La poignée de commandement. Il connaît les gestes par cœur. Le temps qu’il faut avant que ne se déclenche l’explosion. Il repense aux mois de répétition. À la minutie de chaque manipulation. À la prudence. Aux consignes de sécurité. Aux détails maintes fois répétés. Juste avant ce jour. Il rabat le pull sur son torse et s’engonce dans le manteau de pluie. Il regarde le ciel. Le seul endroit d’où peut venir une réponse qu’il a déjà en lui.
Maintenant, il est prêt.
Salim finit de boucler la sienne. Les mêmes gestes. La même sérénité de l’acte parfaitement exécuté. Il remonte la fermeture Éclair de sa parka. Et cale ses épaules dans les emmanchures du vêtement. Rajuste le bas du trois-quarts molletonné. Dans le fond du coffre, ils vérifient promptement que les Kalaches sont là, les chargeurs à portée de main. Dans les deux sacs de sport. Chacun s’empare du sien, saisit la poignée.
C’est Salim qui rabat le hayon. Dans la voiture, il ne reste aucune trace. Personne. Il n’a pas besoin de refermer les portières à clef. La voiture a été volée hier au soir et les indices pour retrouver les auteurs sont de l’ordre du dérisoire. Leurs regards, insensiblement, vérifient la détermination de l’autre. Pas une once de doute. La foi absolue. Une étreinte sans chaleur. Mais la main qui s’empare de l’épaule. De la nuque. L’haleine qui se glisse contre la joue. Allahu Ackbar ! Inch Allah ! Ils vérifient les cadrans de leur montre-bracelet.
Puis ils se séparent.
Salim rajuste le col de son vêtement et s’engage vers la sortie par la rampe des Bénédictins tandis que Marouane remonte le parking, un poing dans la poche et l’autre serré sur l'anse de cuir, jusqu’au pied des escaliers.
Le plan, c’est le principe de la nasse. À l’heure dite. On occupe les issues et on abat les incrédules. Les incroyants. La guerre, il ne fallait pas croire qu’on puisse la faire loin d’ici. Qu’il suffisait de quelques bombes lâchées sur des terrains exotiques pour se rassurer et gendarmer le monde. La guerre, elle est profonde. Elle est ici. Là, ou ailleurs. Mais elle durera. Aussi longtemps que perdureront les déséquilibres entre l’Occident et le reste du monde.
Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes.
Le Souverain des hommes,
Dieu des hommes,
contre le mal du mauvais conseiller, furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes,
qu’il soit un djinn, ou un être humain.
Même si la semelle de la basket est éventrée, le pas reste résolu.
Et le vent du nord s’enroule dans les câbles tendus et fait mugir les caténaires.
La lueur du jour passe au travers des vitraux et s’engouffre par les portes automatiques donnant sur le parvis. La lumière ocre des éclairages baigne l’espace sous le dôme soutenu par les quatre caryatides représentant les provinces que desservait la ligne Paris-Orléans. Dans le hall, le brouhaha des pas, des voix, des annonces impersonnelles et le martèlement des roulettes des bagages résonnent sous la coupole. C’est l’heure de pointe. Arrivées, départs. L’affluence de la vie ordinaire, jetée dans la pâture de l’urgence. Des visages hagards semblent suivre des lignes tracées d’avance. Des couloirs sans autre surprise que la foulée d’un vent emportant sur son passage des emballages déchiquetés, des pages de journaux abandonnés et des tickets de transport périmés.
Il s’arrête. Prend le temps de découper du regard ce paysage qu’il connaît par cœur. Et qu’il verra désormais sous un autre angle. Au fond, le buffet ouvert sur la salle des pas perdus. Les dos qui s’échinent courbés par l’intensité du service. Le poignet sur le manche du percolateur. La main vissée sur la manette de la tireuse à bière. Le coude accompagnant le débit de la bouteille de vin blanc dans le col du ballon. Le chiffon hâtif sur le zinc et le bruit de la monnaie dans la sébile en bakélite.
Plus loin, les gens entrent et ressortent du point presse, le quotidien sous le bras, le chewing-gum sous la dent déjà, pour dissiper l’envie de fumer. Ils lèvent le nez vers les écrans indicateurs qui dirigeront leurs pas jusqu’au bon quai, jusqu'à la bonne voie. L’assurance que le voyage restera sans surprise. Le train, se laisser conduire dans la stakhanoviste répétition de la monotonie des stances des variations du chemin de fer.
Le reste n’est qu’une clameur envahissant le volume sonore de la coupole. Et, là encore, il ne peut s’empêcher de lever son regard. Le jour filtre par les interstices des vitraux de la verrière centrale, nimbant les corps avantageux des quatre caryatides dans une lueur de bordel clandestin. Son œil glisse sur les fesses de la Gascogne dont les mains saisissant un pampre de vigne restent pour lui le sommet de l’érotisme ferroviaire.
Et, forcément, il n’est pas prêt d’oublier ce jeudi 5 février 1998. Il avait terminé son service à 13 heures, sur la ville un ciel froid tendait la bâche d’un bleu immaculé. Il achevait un premier pastis bien tassé, accoudé au comptoir du Bénédictins, en écoutant, d’une oreille qui se voulait bienveillante, les habituelles certitudes de Maurice sur la vie en général et la sienne en particulier, quand ils avaient entendu cette clameur venue de la rue. La stupeur et l’effroi lorsque leurs regards s’étaient projetés dehors et qu’ils avaient observé la langue noire d’une fumée jaillissant du dôme, embrasant le cuivre de la coupole et vomissant des escarbilles virevoltantes dans le ciel, enrobant l’édifice d’un linceul de suie.
Ils étaient restés là. Incapables de bouger leur cul des tabourets rangés face à la rue. Fascinés par le ballet incessant des camions de pompiers. Des sirènes hurlantes. Des voitures de police ceinturant l’esplanade. Jusqu’à ce que la nuit s’étende sur la gare dont pas une seule lumière ne trahissait la présence. Un mur planté dans l’obscurité. Des gens entraient par la porte du Bénédictins, commentaient. Tout le monde avait un avis. Les bières n’en finissaient pas de mousser dans les bocks, les glaçons de tinter dans les verres et les langues de se délier sur des informations invérifiables.
— Tu vois, Gérard, quand on n’en sait pas plus que ça, vaut mieux fermer sa gueule, avait lancé Maurice à la cantonade, visage fermé et mine revêche des grands jours, puis il avait rajusté sa casquette sur son crâne dégarni, endossé son paletot de taupier avant de sortir dans la nuit, la dégaine chaloupée par un apéritif qui avait duré plus que de raison, même s’ils avaient pris dans l’après-midi un solide casse-croûte à base de charcutaille et d’un civet de pieds de cochon longuement mitonné sur le feu basse température du piano.
Il était 21 h 30 et les lances d’incendie achevaient de détremper ce qu’il restait du plancher de sapin qui supportait la couverture en cuivre. Les tuyaux s’enroulaient sur l’axe des dévidoirs. Ça sentait la fin. La maîtrise. La sueur sous les cottes de protection. Le brouillard dans les yeux derrière les visières des casques.