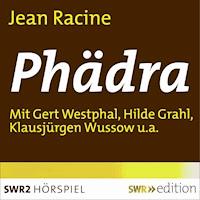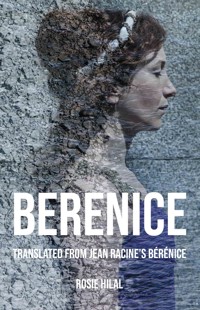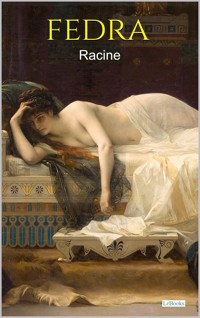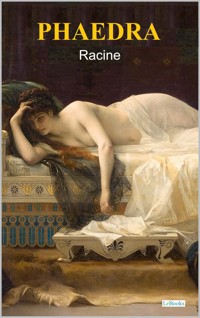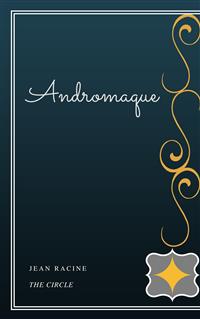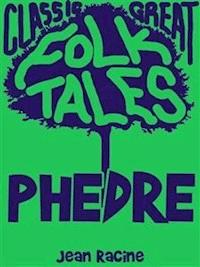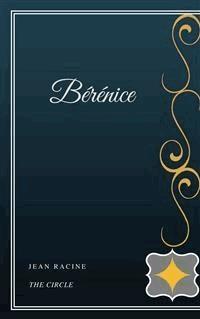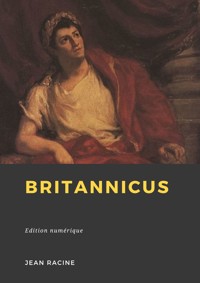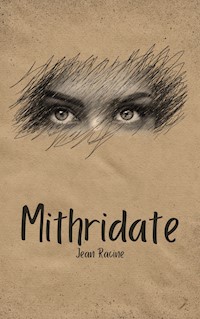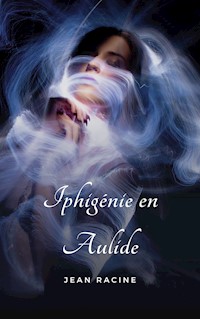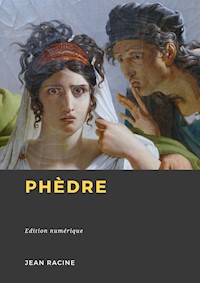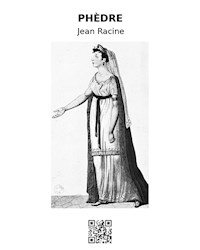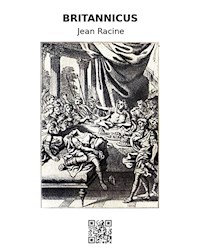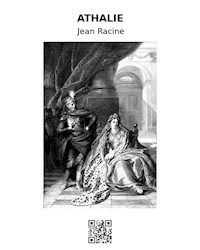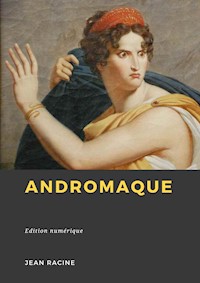
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Andromaque est un drame épique écrit par Jean Racine en 1667. Il raconte l'histoire d'amour tragique entre Andromaque, veuve du roi troyen Hector, et Pyrrhus, fils d'Achille. Le livre explore les thèmes de l'amour, de la loyauté et de la trahison, tout en offrant une réflexion sur les conséquences de la guerre. Racine utilise une écriture poétique et des personnages complexes pour créer une histoire captivante qui reste pertinente jusqu'à nos jours. Si vous aimez la littérature classique française, vous ne voulez pas manquer Andromaque de Jean Racine.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Racine était un écrivain et dramaturge français du XVIIe siècle, considéré comme l'un des plus grands maîtres du théâtre classique français. Il est surtout connu pour ses tragédies comme "
Andromaque", "
Phèdre" et "
Britannicus". Il a également écrit des pièces historiques telles que "
Bérénice" et "
Esther". Racine a exercé une grande influence sur la littérature française et est encore célébré aujourd'hui pour sa maîtrise de la langue, sa puissance émotionnelle et sa capacité à explorer les thèmes universels de l'amour, de la jalousie et de la politique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andromaque
Jean Racine
– 1667 –
NOTICE.
« Le 17 novembre (1667) Leurs Majestés eurent le divertissement d’une fort belle tragédie, par la troupe royale, en l’appartement de la Reine, où étoient quantité de seigneurs et de dames de la cour. » Ainsi parle la Gazette du 19 novembre 1667, sans nommer d’ailleurs cette fort belle tragédie. Mais nous savons que c’était Andromaque ; car dans la lettre en vers de Robinet, de même date que l’article de la Gazette, nous lisons :
La cour, qui, selon ses désirs, Tous les jours change de plaisirs, Vit jeudi certain dramatique, Poëme tragique et non comique. Dont on dit que beaux sont les vers Et tous les incidents divers. Et que cet œuvre de Racine Maint autre rare auteur chagrine.
En marge de ces vers on lit le nom d’Andromaque.
Cette représentation, donnée dans l’appartement de la Reine le jeudi 17 novembre, et avant laquelle nous n’en trouvons mentionnée par les contemporains aucune autre de la même pièce, fut-elle la première de toutes ? Cela n’est pas impossible. Iphigénie aussi fut jouée à la cour, avant de l’être à la ville ; et il n’y aurait pas à s’étonner si la tragédie d’Andromaque qui naissait sous les auspices d’Henriette d’Angleterre, avait eu le même honneur. N’est-il pas remarquable que la lettre en vers de Robinet et la Gazette s’accordent à en parler pour la première fois à propos du divertissement royal ? On donne cependant assez généralement à la première représentation d’Andromaque la date du 10 novembre ; mais il est clair qu’on se borne à répéter une assertion de l’Histoire du Théâtre françois[1]. Nous croyons que les auteurs de cette histoire n’ont fait que nous donner une conjecture qu’ils ont prétendu appuyer sur la lettre de Robinet du 19 novembre. Ils ont supposé que la représentation à la cour, dont il est parlé dans cette lettre, avait du nécessairement être précédée d’une représentation à l’Hôtel de Bourgogne, et, par suite, ils ont cru pouvoir, avec vraisemblance, placer celle-ci à la date du vendredi de la semaine précédente[2]. Ils se sont du reste trompés, en disant que le jeudi dont parle Robinet était le 16 ; c’était, nous l’avons dit, le 17. Ainsi, quand on déférerait à leur autorité dans ce qui ne paraît être de leur part qu’une pure hypothèse, on devrait dater du 11 novembre la première représentation à l’Hôtel le 10 était un jeudi, et par conséquent un des jours où la troupe ne jouait pas. Dès qu’il ne s’agit d’ailleurs que d’une conjecture, cette représentation peut aussi bien avoir été donnée la veille même du jour où la lettre de Robinet fut écrite, c’est-à-dire le vendredi 18. Dans tout cela une seule chose est certaine, c’est qu’Andromaque, lorsque Robinet la vit, entre le 20 et le 25 novembre, était encore dans toute sa nouveauté ; car dans sa lettre du 26, il dit :
J’ai vu la pièce toute neuve D’Andromaque, d’Hector la veuve.
Quel que soit le jour où l’Andromaque ait paru pour la première fois sur la scène française, ce jour marque une grande époque dans les annales de notre théâtre, une époque semblable à celle du Cid. Perrault l’a très-bien dit[3] : « Cette tragédie fit le même bruit à peu près que le Cid, lorsqu’il fut représenté. » La comparaison semble juste de tout point. Andromaque s’éleva tout à coup au-dessus de la Thébaïde et de l’Alexandre, comme le Cid au-dessus de Médée ; chacun de ces deux chefs-d’œuvre fut, après des essais qui n’étaient pas sans promesses, la première révélation d’un grand génie ; et non-seulement ils sont l’un et l’autre par là une mémorable date dans la vie de nos deux poëtes dramatiques, ils en sont une surtout dans l’histoire de l’art. Avec le Cid on vit naître chez nous la tragédie fière, sublime, héroïque, qui agrandit les âmes ; avec Andromaque, la tragédie pathétique, qui connaît tous les secrets, toutes les faiblesses du cœur dans leurs nuances les plus délicates, dans leurs replis les plus profonds, et qui sait peindre avec la vérité la plus saisissante les plus terribles orages des passions.
Il ne faut pas s’attendre à ce qu’un témoin tel que le burlesque Robinet nous rende au moindre degré la vive impression des premiers spectateurs de l’admirable tragédie[4]. Ne l’interrogeons que sur les noms des acteurs qui jouèrent d’original dans Andromaque. Il nous les fait connaître dans sa lettre du 26 novembre. Voici, d’après son témoignage, la distribution des principaux rôles :
Andromaque,
Mlle du Parc.
Pyrrhus,
Floridor.
Oreste,
Montfleury.
Hermione,
Mlle des Œillets.
Le Mercure de France de juin 1740[5] dit que le sieur d’Hauteroche, qui jouait parfaitement les grands confidents, remplissait le rôle de Phœnix : c’était sans doute dès ces premiers temps. La création des premiers rôles est du reste seule intéressante pour nous. Le talent des quatre acteurs qui en furent chargés avait déjà été mis à l’épreuve par Racine dans son Alexandre : celui de Floridor, de Montfleury, de Mlle des Œillets à l’Hôtel de Bourgogne, celui de Mlle du Parc sur la scène du Palais-Royal.
Mlle du Parc avait quitté la troupe de Molière après la clôture du théâtre aux fêtes de Pâques de cette même année 1667, et s’était engagée à l’Hôtel de Bourgogne pour y débuter dans la nouvelle tragédie. Le poëte, amoureux alors de cette charmante actrice, l’avait décidée à la désertion, pour lui faire suivre sa fortune.
Il est très-probable que le rôle noble et touchant d’Andromaque, s’il prêtait à de moins grands effets que quelques autres de la même pièce, n’était point cependant celui que Racine avait le moins à cœur de faire interpréter à son gré. On dit que par la perfection avec laquelle elle le joua, Mlle du Parc, dont la beauté et les grâces faisaient d’ordinaire le plus grand succès, parut se surpasser elle-même[6]. Lorsqu’à la fin de l’année suivante une mort prématurée l’enleva au théâtre, l’éclat de son triomphe dans Andromaque n’avait pas encore pâli, témoin ces vers de Robinet :
L’Hôtel de Bourgogne est en deuil,Depuis peu voyant au cercueilSon Andromaque si brillante,Si charmante et si triomphante[7].
Nous avons dit, dans la Notice sur Alexandre[8], combien était aimé du public Floridor, à qui fut confié le rôle de Pyrrhus. L’Hermione manquait de jeunesse et de beauté : Mlle des Œillets avait alors quarante-six ans ; elle était petite et maigre ; mais son art était consommé, et si quelques années après elle trouva une rivale qui interpréta plus vivement qu’elle et avec plus d’énergie les scènes les plus passionnées de son rôle, il lui resta la supériorité d’un goût fin et délicat.
Montfleury était né, dit-on, à la fin du seizième siècle, ou tout au moins au comencement du dix-septième ; il était donc bien vieux en 1667 pour jouer le rôle d’Oreste. À en juger par le portrait que Molière, qui était, il est vrai, son ennemi, nous a donné de lui, quelques années avant, dans l’Impromptu de Versailles, on aurait d’autres raisons encore de douter que ce rôle lui convînt parfaitement. Montfleury n’était pas de taille galante, mais « gros et gras comme quatre, entripaillé comme il faut, et d’une vaste circonférence. » Il appuyait sur le dernier vers d’une tirade, pour faire faire le brouhaha, et prenait un ton de démoniaque[9]. Un contemporain, Gabriel Gueret, nous paraît confirmer par son témoignage cette dernière critique de Molière. Dans le Parnasse réformé[10] il fait ainsi parler Montfleury lui-même : « J’ai usé tous mes poumons dans ces violents mouvements de jalousie, d’amour et d’ambition… Souvent je me suis vu obligé de lancer des regards terribles, de rouler impétueusement les yeux dans la tête comme un furieux, de donner de l’effroi par mes grimaces…, de crier comme un démoniaque, et par conséquent de démonter tous les ressorts de mon corps… » Il est à croire que Gueret dépeint ainsi Montfleury d’après le souvenir surtout du rôle d’Oreste : il écrivait son opuscule au commencement de 1668, lorsque ce comédien venait de mourir, dans le cours des représentations d’Andromaque, au mois de décembre 1667. Cette mort, selon lui, aurait été la suite des violents efforts qu’avait faits Montfleury dans les fureurs d’Oreste[11] : « Qui voudra savoir de quoi je suis mort, qu’il ne demande point si c’est de la fièvre, de l’hydropisie ou de la goutte ; mais qu’il sache que c’est d’Andromaque… Ce qui me fait le plus de dépit, c’est qu’Andromaque va devenir plus célèbre par la circonstance de ma mort, et que désormais il n’y aura plus de poëte qui ne veuille avoir l’honneur de crever un comédien en sa vie. » Les auteurs de l’Avertissementdu théâtre de MM. Montfleury[12], s’appuyant sur l’autorité de Mlle Desmares, arrière-petite-fille du premier interprète des fureurs d’Oreste, disent que Gueret a fait un conte. On pourrait supposer en effet que cette histoire de Montfleury, tué par son jeu forcené, n’a été imaginée que pour faire pendant à celle de Mondory, qui avait été frappé d’une attaque d’apoplexie en jouant les fureurs d’Hérode dans la Mariane de Tristan. Il est bien difficile cependant de récuser le témoignage contemporain de Robinet, dont les termes nous semblent assez clairs dans la lettre en vers du 17 décembre 1667, où il annonce la mort de Montfleury,
Qui d’une façon sans égaleJouoit dans la troupe royale,Non les rôles tendres et doux,Mais de transports et de courroux,Et lequel a, jouant Oreste,Hélas ! joué de tout son reste.Ô rôle tragique et mortel,Combien tu fais perdre à l’HôtelEn cet acteur inimitable !
Qu’importe au surplus ? La tragédie de Racine n’avait pas besoin, pour conquérir la célébrité, de tuer un malheureux comédien. Ne cherchons, si l’on veut, dans l’anecdote, vraie ou fausse, qu’une preuve de l’impression produite sur les spectateurs de ce temps par la violence du jeu de Montfleury. Mais la dernière scène d’Andromaque n’a pas été faite pour être jouée de sang-froid ; et cette fois les transports démoniaques de l’acteur purent ne pas mériter de reproches. Du reste les défauts qu’il paraît avoir eus ne l’empêchèrent évidemment pas d’être fort admiré dans la tragédie de Racine, puisque M. de Lionne écrivait à Saint-Évremond que « la pièce étoit déchue par sa mort. » Ajoutons que Montfleury, si sévèrement jugé par Molière, avait cependant la réputation d’un des meilleurs comédiens de ce temps. Chapuzeau le place à côté de Floridor. Ils étaient l’un et l’autre « les grands modèles, dit-il[13], de tous ceux qui veulent se dévouer au théâtre[14]. » Il y a lieu de penser que, dans l’ensemble, le chef-d’œuvre fut loin d’être trahi par ses premiers interprètes.
On alla même jusqu’à prétendre (car c’était toujours, en pareil cas, le thème des détracteurs) qu’Andromaque devait surtout aux acteurs son éclatant succès. « Elle a besoin, disait Saint-Évremond[15], de grands comédiens, qui remplissent par l’action ce qui lui manque. » Ne croirait-on pas qu’il s’agit d’une pièce qui resterait froide et languissante, si elle n’était réchauffée par la passion des comédiens, d’une action dont le vide veut être dissimulé par le mouvement entraînant de la représentation théâtrale ? La vérité est, au contraire, que, tout en ayant ce caractère essentiel aux œuvres vraiment dramatiques de produire tout leur effet à la représentation, cette tragédie, si féconde en émouvantes péripéties, et d’un intérêt si puissant par elle-même, n’est guère moins admirée à la lecture, et qu’en tout temps elle a fait les grands acteurs, au lieu d’être faite par eux. Mais Saint-Évremond, engagé dans la cause de Corneille, était de ceux qui ne se résignaient pas à lui reconnaître un rival. Il est curieux de le voir, partagé entre sa passion et les avertissements plus justes de son sens droit, se débattre contre son involontaire admiration. On lui avait envoyé Andromaque avec Attila, joué la même année, quelques mois plus tôt[16]. « À peine ai-je eu le loisir, écrivait-il à M. de Lionne[17], de jeter les yeux sur Andromaque et sur Attila ; cependant il me paroît qu’Andromaque a bien de l’air des belles choses ; il ne s’en faut presque rien qu’il y ait du grand. Ceux qui n’entreront pas assez dans les choses, l’admireront ; ceux qui veulent des beautés pleines, y chercheront je ne sais quoi qui les empêchera d’être tout à fait contents… Mais, à tout prendre, c’est une belle pièce, et qui est fort au-dessus du médiocre, quoique un peu au-dessous du grand. » Le même jugement, au fond très-favorable, mais embarrassé des mêmes restrictions subtiles, se retrouve dans une autre lettre qu’il adressait encore à M. de Lionne[18] : « Ceux qui m’ont envoyé Andromaque m’ont demandé mon sentiment. Comme je vous l’ai dit, elle m’a semblé très-belle ; mais je crois qu’on peut aller plus loin dans les passions, et qu’il y a encore quelque chose de plus profond dans les sentiments que ce qui s’y trouve ; ce qui doit être tendre n’y est que doux, et ce qui doit exciter de la pitié ne donne que de la tendresse. Cependant, à tout prendre, Racine doit avoir plus de réputation qu’aucun autre après Corneille. » Après Corneille, c’est tout ce que voulait Saint-Évremond : c’est à cette conclusion qu’il prétendait arriver par des critiques cette fois si vagues. Il fallait que dans Corneille seul il y eût « du grand et des beautés pleines. » On ne pouvait d’ailleurs rencontrer plus mal que de refuser à Andromaque le mérite d’aller assez loin dans les passions et de donner aux sentiments toute leur profondeur.
Saint-Évremond ne disputait du moins que sur le degré de beauté de la pièce. Il chicanait plutôt l’admiration qu’il ne la refusait. Racine trouva des censeurs moins réservés. Il fut, au milieu de son succès, inquiété par plus d’une attaque, et dans ce temps il n’en souffrait aucune avec patience. On connaît par les deux épigrammes sanglantes qu’il fit, l’une contre le duc de Créqui, l’autre contre ce même duc et le comte d’Olonne, la malveillance avec laquelle ces grands seigneurs avaient jugé sa tragédie. Les traits qu’il leur renvoya les frappaient en plein visage avec une si terrible justesse qu’on se demande si c’étaient bien précisément ceux-là que, par leurs imprudentes critiques, ils lui avaient eux-mêmes fournis. Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut surtout voir dans ces épigrammes, c’est avec quelle vivacité le poëte entrait dans cette guerre, sans se laisser effrayer par des ennemis si qualifiés. Parmi les objections, souvent contradictoires, que l’on fit au caractère de ses personnages, et qui tombaient tantôt sur Pyrrhus, tantôt sur Oreste ou sur Andromaque, il en est une qu’on attribue au grand Condé, et que ce prince soutenait sans doute avec cette hauteur impérieuse et cet emportement dont il avait, nous dit-on, l’habitude, particulièrement lorsqu’il avait tort. « Pyrrhus, disent Louis Racine et Brossette, parut au grand Condé trop violent et trop emporté. » Était-ce donc lui (on serait bien tenté de le croire) que Racine prenait à partie dans ce passage de sa première préface ? « Il s’est trouvé des gens qui se sont plaints que Pyrrhus s’emportât contre Andromaque et qu’il voulût épouser cette captive à quelque prix que ce fût. » Si ce n’était pas avec un héros que le poëte avait ce démêlé, il nous semble qu’on ne s’expliquerait plus très-bien sa riposte : « Tous les héros ne sont pas faits pour être des Céladons, » où le mot tous serait de trop. Toutefois la hardiesse eût été grande, bien autrement surprenante que celle de l’épigramme contre d’Olonne et Créqui ; et bien des personnes hésiteront à penser que Racine, si peu maître qu’il fût de retenir ses sarcasmes, ait pu s’en permettre un semblable contre un prince du sang, couvert de tant de gloire, qui avait été d’ailleurs un des admirateurs les plus déclarés de la tragédie d’Alexandre, et qui traitait d’ordinaire le jeune poëte avec tant de bienveillance.
Racine disait que pour s’embarrasser du chagrin de deux ou trois personnes, il avait trouvé le public trop favorable à sa pièce[19]. Mais évidemment les critiques ne le laissaient pas si indifférent. Plus que toutes les autres, celles de Boileau l’auraient certainement touché, s’il était vrai qu’un ami, si peu suspect de préventions hostiles, eût dans un des rôles d’Andromaque, dans celui de Pyrrhus, signalé quelques parties qu’il n’approuvait pas. Cela tout d’abord se concilie assez difficilement avec ces vers de l’épître VII, où Boileau parait mettre les censeurs de Pyrrhus au nombre des envieux :
Mais par les envieux un génie excitéAu comble de son art est mille fois monté…Et peut-être ta plume aux censeurs de PyrrhusDoit les plus nobles traits dont tu peignis Burrhus[20].
S’il avait été lui-même un de ces censeurs, comment, dira-t-on, ne pas s’étonner qu’il l’eût alors oublié ? Comment ne se pas demander si Monchesnay a été bien informé, lorsqu’il dit dans le Bolæana[21] : « M. Despréaux n’étoit pas du tout satisfait du personnage que fait Pyrrhus, qu’il traitoit de héros à la Scudéry, au lieu qu’Oreste et Hermione sont de véritables caractères tragiques ? » Mais tout s’explique par les souvenirs plus précis que nous trouvons dans l’Examen d’Andromaque par Louis Racine. L’exactitude du passage du Bolæana y est confirmée, particulièrement en ce que l’on y dit du jugement sévère de Boileau sur la scène v de l’acte II, entre Pyrrhus et Phœnix. Dans cette scène, il lui semblait que la tragédie, par la peinture des extravagances amoureuses, s’abaissait jusqu’à la naïveté comique, et que l’auteur d’Andromaque se montrait beaucoup trop l’émule de Térence. Louis Racine tenait cette remarque de la bouche même de Boileau. Mais il avait en même temps appris de lui qu’il ne l’avait pas toujours faite, que longtemps au contraire il avait admiré cette même scène, ce dont il se repentait, parce que, s’il se fût avisé moins tard de la faute commise par Racine, « il l’eût obligé à supprimer ce morceau. » La critique de Boileau n’est donc pas un fait douteux ; mais il faut le mettre à sa date, à une époque où les corrections n’étaient plus possibles, peut-être même après la mort de Racine.
L’opinion de Boileau, ce juge excellent, était, on le voit, devenue justement le contre-pied de celle de Condé, à qui Pyrrhus ne semblait pas assez honnête homme. Elle se rapprochait peut-être de celle que l’épigramme attribue à Créqui :
Créqui dit que Pyrrhus aime trop sa maîtresse.
Racine, nous devons le reconnaître, a, dans sa préface, choisi pour sa défense le terrain où elle était le plus facile et le moins nécessaire : « J’avoue que Pyrrhus n’est pas assez résigné à la volonté de sa maîtresse, et que Céladon a mieux connu que lui le parfait amour. » Le point vraiment faible était où Boileau a fini par le voir ; et, quoi qu’en dise Racine, Pyrrhus avait un peu trop « lu nos romans. » Non, ce n’est pas là ce farouche fils d’Achille, tel que nous le font entrevoir Euripide et Virgile ; ce n’est pas ce brutal guerrier de l’âge héroïque, qui n’a jamais traité ses plus nobles esclaves qu’en concubines. On alléguerait en vain le cœur de l’homme qui ne change pas ; il est trop évident que si les passions sont au fond toujours semblables, leur expression varie suivant les mœurs des temps et des peuples. Mais il faut se placer au vrai point de vue du théâtre de Racine, et accepter le monde de convention, le monde presque tout idéal, où se meuvent ses créations. Si de tous les personnages d’Andromaque Pyrrhus est celui qui, par le plus visible anachronisme, soulève surtout des objections, il est cependant placé par le poëte dans un milieu où il ne manque pas de vérité relative ; et le condamner trop sévèrement serait condamner toute la pièce. La couleur de ce rôle en effet n’est pas sensiblement en désaccord avec celle des autres rôles. Toute cette tragédie antique est écrite sur un ton différent de celui de l’antiquité : on peut dire qu’elle est transposée ; et tel est sans nul doute, plus qu’on ne le croit souvent, la loi nécessaire de l’art. S’imagine-t-on que l’Andromaque et les Troyennes d’Euripide, quoiqu’elles aient conservé un accent très-sauvage, s’imagine-t-on que toutes les tragédies grecques en général et l’Énéide de Virgile, si on les compare avec les poèmes d’Homère qui en sont la source, ne soient pas transposées également ? Racine connaissait l’antiquité mieux que la plupart de ceux qui lui reprochent aujourd’hui de l’avoir défigurée ; il était profondément imbu de ses beautés éternelles, et savait les rendre à son siècle sous la forme où elles pouvaient être intelligibles pour lui. Il sentait qu’une traduction servile des idées et des mœurs antiques, à supposer qu’un esprit moderne fût entièrement capable d’un tel effort, ne toucherait pas assez des cœurs nourris de tout autres sentiments.