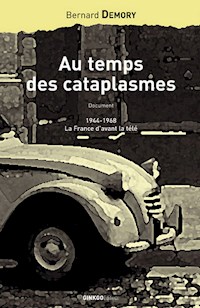
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Comment avons-nous vécu depuis la Libération jusqu’en Mai 68 ? Comment avons-nous pu survivre dans ce « lointain Moyen Âge » sans télévision, sans hypermarchés, sans surgelés, sans téléphones portables ? Construit à partir des souvenirs de l’auteur, ce livre propose une vingtaine de thèmes (la vie au quotidien, les vacances, la religion, le cinéma, etc.) qui se croisent et se répondent. Expériences vécues, observations ethnologiques et sociologiques, tissent une « trame de mémoire » propre à faire resurgir, de façon vivante et amusée, une époque à jamais révolue.
EXTRAIT
En fait, l’avenir ne nous causait aucun souci. Après le bac, on verrait bien. L’époque se prêtait à cette insouciance : le chômage était pratiquement inexistant, les portes des Facultés et des grandes écoles étaient largement ouvertes pour des élèves sortant d’un lycée comme le nôtre.
Nous vivions dans une espèce de bulle privilégiée que les problèmes et les conflits de l’extérieur ne parvenaient pas à pénétrer. Le lycée, en ce temps-là, était un monde à part entièrement voué à l’acquisition de connaissances et à la gymnastique de l’esprit.
Il faut reconnaître qu’il y avait un décalage énorme entre notre maturité intellectuelle et notre maturité psychologique et sociale. Capables de disserter brillamment sur une pensée de La Rochefoucaud nous restions des gamins de la vie affective. J’ai parlé de cette photo de classe de seconde (cf. : La vie au quotidien) sur laquelle les garçons du premier rang portent encore des culottes courtes. Les jeunes à qui je la montre hurlent de rire quand je leur raconte que ces élèves pas encore sortis de l’enfance jouaient aux petites autos en attendant l’ouverture de la porte. Quelques années plus tard, ils entraient dans les premiers à Polytechnique, à Normale Supérieure ou à l’ENA.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un livre passionnant qui nous fait comprendre ce qu'était la vie "d'avant"... Avant la télévision, avant le téléphone portable, avant les grandes surfaces, avant les divers robots ménagers, etc. Les touches d'humour rendent cet ouvrage très attrayant et nous donneraient (presque) une certaine nostalgie "bon temps". -
Latviane, Babelio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Colette et Bruno.
Pour Anne-Laure, ce témoignage d’un autre temps.
Pour Jean-Bruno Duméril, Danielle Guillot, Raymond Fuzellier,
Jacques Gauthier et Claude Monget-Sarrail, mes aide-mémoire.
Avec toute ma gratitude à mon frère dont les critiques, les corrections et les suggestions m’ont grandement aidé lors de la rédaction de ce livre.
Mes chaleureux remerciements à Anne Mellion
Préface
Au temps des cataplasmes n’est pas une autobiographie et pourtant, j’y parle beaucoup de moi. Ce n’est pas non plus une étude ethnologique et pourtant, je m’attache à y décrire aussi minutieusement que possible les mœurs et coutumes d’un groupe social (une tribu dirait-on aujourd’hui) : la bourgeoisie catholique du quartier parisien de Saint-Thomas-d’Aquin.
Recherche sociologique alors ? Pas d’avantage et, cependant, je m’efforce d’analyser de façon rigoureuse le fonctionnement d’une certaine société au cours de la période 1944 – 1968.
De quoi s’agit-il alors ! d’un itinéraire !
Raconter avec le maximum de précision le cheminement de l’enfant et du jeune homme que je fus, en tentant de montrer comment les influences techniques, sociales, religieuses, etc. qu’il subit en déterminèrent le cours.
Mais, il ne s’agit pas uniquement de ma petite personne. Un peu naïvement peut-être, je considère que mon itinéraire personnel a une certaine « valeur d’exemple ». Beaucoup de garçons de mon milieu et de mon âge ont éprouvé des sentiments et vécu des situations identiques et possèdent des souvenirs communs. Les conversations que nous avons eues, les témoignages qui m’ont été adressé, m’ont conforté dans cette voie : il était salutaire de faire revivre cette période dont l’évocation engendre chez tous ceux qui l’ont vécue une nostalgie certaine.
Nostalgie d’une jeunesse enfuie, sans doute, mais également parce que ces années-là, ainsi que j’ai tenté de le faire ressentir, avaient une coloration particulière fort différente de celles d’aujourd’hui, que l’on pourrait résumer d’un mot : l’insouciance.
Si cet ouvrage s’adresse aux gens de ma génération en quête de leur jeunesse, il est tout autant destiné aux générations suivantes pour qui ce « Temps des cataplasmes » apparaît comme un lointain Moyen Âge.
Quand je raconte à ma fille, à ses amis ou à mes étudiants qu’il fallait attendre des années une ligne téléphonique, que l’on communiquait par pneumatiques, que nous ne possédions pas de télévision (ou au mieux un téléviseur en noir et blanc recevant une chaîne d’État) mais un vieux poste de radio crachotant, que prendre l’avion était réservé à une petite élite et qu’il fallait presque une journée pour se rendre à Marseille, ils me regardent comme une espèce de dinosaure issu d’un autre âge.
Avec leur portables, leurs Palm, leurs DVD, leurs ordinateurs, eux, qui à vingt ans ont déjà parcouru la moitié du monde, me demandent très sérieusement comment nous avons pu survivre dans un tel monde sous-developpé.
C’est aussi pour eux, ces enfants du XXIème siècle que j’ai rédigé ce livre. Il leur permettra de comprendre, je l’espère, quels bouleversements techniques et sociaux nous avons vécus depuis la fins des années sombres.
1 – LA FAMILLE
Dans la plupart des récits de souvenirs, il est d’usage de consacrer le premier chapitre à l’histoire de la famille de l’auteur. Ces biographies, qui remontent souvent fort loin en arrière, à de rares exceptions près, ont le don de m’ennuyer. La plupart du temps je les ignore pour entrer dans le vif du sujet.
Aussi, vais-je m’efforcer d’épargner au lecteur la tentation de passer outre en ne lui fournissant que les repères essentiels. De toute façon, la construction même de cet ouvrage lui permettra de retrouver ma famille au cours des différents chapitres racontant l’existence que nous menions alors.
C’est ainsi que j’ai préféré parler de ma famille maternelle dans le chapitre consacré à La campagne, là où j’ai tenté de la faire revivre dans son cadre d’origine.
Du côté paternel, l’histoire est plus intéressante. Si je sais que la famille Demory prend ses racines au village de Mory, dans l’Aisne, en revanche le mystère demeure en ce qui concerne mon grand-père, Eustache Clément Demory, mort en 1929.
Lorsque nous interrogions mon père sur notre aïeul, il restait évasif et détournait la conversation. Parfois, il était comptable, parfois juriste. Lors de l’enterrement de ma grand-mère, Marthe Marie Désirée Delevacque, enterrée à Suzanne, quand les convives, échauffés par les vins, commencèrent à parler du grand-père, mon père les fit taire promptement.
S’était-il suicidé, comme je l’ai longtemps cru ? Avait-il rendu l’âme dans les bras d’une maîtresse ? Nous ne connûmes la vérité qu’après la mort de mon père en fouillant les archives familiales.
La réalité était beaucoup plus simple : mon père avait honte d’avouer que ses parents étaient concierges au 198 boulevard Saint-Germain et fit tout, durant sa vie, pour masquer des origines modestes qui n’avaient pourtant rien de déshonorant.
Mes grands-parents eurent trois enfants : Marie, morte prématurément, Marthe, née en 1892 et Roger, né en 1897.
Roger épousa Germaine Combettes, en 1932. Malgré deux fausses couches, ma mère réussit à mettre au monde trois enfants : Bruno, né en 1934, Bernard en 1939 et Colette en 1942.
Ces quelques repères biographiques précisés, j’en arrive au personnage insolite de cette famille somme toute très banale : ma grand-mère paternelle que nous appelions « bonne-maman » (alors que mes grands-parents maternels étaient « pépère » et « mémère ». On saisit la nuance.).
Cette femme que j’ai toujours détestée vivait avec ma tante Marthe au 40 rue du Dragon dans un appartement qui, malgré la hauteur des plafonds, était perpétuellement plongé dans une demi-obscurité.
Cet immeuble vétuste, qui avait dû connaître son heure de prospérité ainsi qu’en atteste une superbe rampe en fer forgé, était imprégné d’une odeur de poisson pourri provenant de l’atelier de fabrication de nuoc-mâm Hong Lien situé au rez-de-chaussée de la cour. Dans des cuves en bois se décomposaient des crevettes et des poissons dont on extrayait le jus pour fabriquer ce condiment indispensable à la cuisine asiatique.
À l’odeur de poisson se mêlait la senteur puissante des cabinets à la turque où les locataires allaient vider leurs seaux hygiéniques (les quelques appartements du côté cour ne comportaient, en guise de sanitaires, qu’un unique poste d’eau).
L’appartement en lui-même était constitué de deux pièces, d’une petite cuisine et d’une alcôve faisant office de chambre.
C’est dans cet antre à l’odeur indéfinissable de poussière (les lourds rideaux qui masquaient en partie les fenêtres n’avaient jamais dû connaître le teinturier), de poisson, de vieux, que vivaient ma grand-mère et ma tante.
On entre ici dans un roman de Mauriac. Depuis son plus jeune âge, ma bonne-maman avait inculqué à Marthe ce principe hautement chrétien que le destin d’une fille est de se consacrer à sa mère. Abandonnant toute velléité d’indépendance (on évoquait bien un vague fiancé, mort à la guerre) ma tante était devenue la servante – pour ne pas dire l’esclave – de sa mère.
Admirable abnégation ! diront certains. Chantage pervers et cruel puis-je affirmer ayant vu ma pauvre tante mener cette vie de cloporte. Remarquablement intelligente elle aurait pu prétendre à une brillante carrière intellectuelle. Au lieu de quoi, grâce à son habilité manuelle, elle dut se contenter d’une des pires professions : couturière en chambre.
Tout au long de la journée elle pédalait sur sa machine à coudre pour confectionner manteaux, jupes et corsages que lui payait pour un salaire de misère un grossiste-soutier du Sentier.
Comme les travailleurs immigrés qui peinent quinze heures par jour dans des caves ou des greniers, elle ne possédait évidemment aucune existence légale, donc pas d’heures supplémentaires (elle était payée à la pièce), pas de congés payés ni de sécurité sociale.
Ses déplacements étaient réglementés par ma grand-mère qui avait fixé des barèmes pour le temps nécessaire aux courses et à la livraison de son travail. Tout retard lui valait une scène. Peut-être la battait-elle ?
Quand mon père se maria (il avait trente-cinq ans et ma tante quarante !), ma grand-mère interdit à la tante Marthe de se rendre à cette noce qu’elle désapprouvait ouvertement. Jusqu’au dernier moment, elle avait espéré que son fils suivrait l’exemple de sa sœur et se consacrerait corps et âme à sa « pauvre mère ».
Ma mère, qui était la bonté même, éprouva, je crois, une seule haine dans sa vie : ma tante et ma grand-mère à qui elle ne pardonna jamais cette humiliante défection.
Après Mauriac, nous passons à Beckett. Un jour, ma « bonne-maman » décida qu’elle était sur le point de mourir. Elle se mit au lit dans le galetas éclairé par une sinistre lampe de 25 watts qui lui servait de chambre et attendit la fin. Cette attente dura une bonne dizaine d’années.
C’est le souvenir que je garde d’elle : une vieille femme à l’odeur rance adossée à des oreillers douteux, qu’il fallait embrasser en cachant sa répugnance.
Mais la moribonde n’avait pas perdu son caractère dictatorial. Lorsque ma tante tardait à rentrer de ses livraisons de vêtements, elle retrouvait sa vitalité, s’extirpait de son lit et, oubliant toute pudeur, allait s’installer sur un pliant à la sortie du métro Croix Rouge (cette station a disparu). Quand ma tante apparaissait en haut des escaliers, elle subissait, comme une petite fille, une sévère semonce.
Ce manège grotesque prit fin le jour où un passant, croyant avoir affaire à une pauvresse, glissa une pièce de monnaie à ma grand-mère. Terriblement humiliée, elle renonça à ses attentes au sortir du métro.
Quand elle mourut ma tante cessa de vivre, au sens propre du mot. Elle renonça à s’alimenter et parvint à un tel point de décrépitude que mon père, malgré ses protestations, fit venir un médecin. Effrayé par son état de maigreur – elle pesait trente-sept kilos et ressemblait à une rescapée de Dachau – il la fit immédiatement entrer aux urgences de l’hôpital Saint Joseph.
Bien soignée, partie un an en maison de repos (c’est durant cette période que j’investis son appartement pour en faire mon « atelier » – cf. : Les jeunes filles et les dames), elle vécut jusqu’à quatre-vingt-treize ans. Tristes années où elle eut tout loisir de méditer sur sa vie gâchée. Devenue aveugle, elle passait ses journées à écouter France Culture et France Musique. J’allais souvent prendre le thé avec elle dans son petit studio du 7 rue du Dragon où elle m’avait succédé.
Ma mère était ce qu’il convient d’appeler « une femme au foyer ». L’essentiel de son activité consistait à s’occuper de son mari et de ses enfants.
Levée avant tout le monde, elle préparait les petits-déjeuners, surveillait notre habillement, vérifiait le contenu de nos cartables, etc.
Avant de partir à son bureau, mon père lui remettait l’argent de la journée (ma mère n’a jamais possédé de compte en banque). Parfois, sur le pas de la porte, elle lui rappelait doucement qu’il avait oublié quelque chose. Comme à regret, mon père sortait son portefeuille et déposait quelques billets sur le buffet de la salle à manger. Quand je fus en âge d’apprécier les choses, cette dépendance économique totale me parut particulièrement humiliante.
Une fois la famille partie, elle faisait les lits, rangeait, balayait, lavait la vaisselle du petit-déjeuner, etc.
Puis elle descendait « faire les courses ». J’ai noté (cf. : La vie au quotidien) que les foyers qui possédaient un réfrigérateur constituaient l’exception. Il était donc nécessaire de renouveler chaque jour, surtout par temps chaud, les denrées périssables comme les produits laitiers (sitôt rentrée, elle faisait bouillir le lait avec l’anti-sauve lait de peur qu’il ne « tourne »), la viande ou le poisson.
Les courses chez les multiples commerçants où l’on devait faire la queue occupaient une bonne partie de la matinée. Mais ces moments d’attente dans les boutiques, qui paraîtraient aujourd’hui insupportables, étaient l’occasion pour ma mère de rencontrer les autres dames du quartier et d’échanger avec elles les petites nouvelles de la vie quotidienne. En fait, ces pauses qui nous semblent aujourd’hui des moments perdus, devaient lui rappeler sa campagne natale (dans les villages et les petites villes, malgré l’apparition des super marchés, le moment des courses est resté l’occasion de bavarder et de connaître les nouvelles fraîches). Elles permettaient également de faire côtoyer la bonne, la femme d’ouvrier et la grande bourgeoise qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrées.
Lestée de ses paniers et de ses sacs, après l’inévitable halte chez le concierge, elle remontait nos quatre étages et se mettait à préparer notre déjeuner.
On aurait du mal à imaginer, de nos jours, le travail qu’exigeait la confection d’un repas pour cinq personnes (mon père rentrait déjeuner à la maison et mon frère qui avait, paraît-il, le foie fragile avait droit à un menu spécial à base de haricots verts, d’épinards et de salade cuite).
Les appareils électriques, les auto-cuiseurs et autres ustensiles qui ont considérablement facilité la tâche des cuisinières n’existaient pas. Les légumes pré-épluchés et les surgelés ne feraient leur apparition que beaucoup plus tard.
Il fallait donc éplucher, écosser, piler, hacher, battre à la main. Confectionner une purée, par exemple (les produits lyophilisés étaient, bien sûr, inconnus) exigeait d’éplucher les pommes de terre, de les faire cuire et de les écraser à la fourchette avec du lait et du beurre. Essayez et vous verrez le temps et l’effort que cela demande.
Comme ma mère mettait son point d’honneur à varier les menus et à les faire copieux pour satisfaire nos robustes appétits, on peut estimer que le tiers de son temps passait en cuisine.
Rentrés de l’école, nous attendions avec impatience d’entendre le pas de mon père dans l’escalier accompagné d’une toux caractéristique qui ne le quitta jamais (sans doute due au fait d’avoir été gazé à la guerre de 14 et aux cigarettes et pipes qu’il ne quittait jamais). Dès qu’il avait pianoté l’appel scout (cf. : Le scoutisme) sur la porte d’entrée, nous nous précipitions à table.
À la fin du repas, sans perdre un instant, à tour de rôle, nous essuyions la vaisselle que ma mère lavait dans une bassine d’eau chaude tandis que mon père sirotait son café et s’accordait dix minutes de sieste.
Après le départ de la famille, ma mère disposait enfin de quelques instants de répit. Elle les mettait à profit pour lire un peu (elle était passionnée d’histoire) mais surtout pour entretenir le linge, repasser, tricoter ou broder (sur chaque drap, chaque taie d’oreiller, chaque serviette de table, figure le monogramme de la famille DC.).
Je possède une pleine malle de napperons, sets de table et serviettes ornés ainsi de savantes broderies. Le tricot (après la guerre, on détricotait les chandails devenus trop petits pour en récupérer la laine) occupait également une grande partie de ses « loisirs ».
En fait, je ne l’ai jamais vue inactive. Elle mettait en pratique le principe qu’on lui avait inculqué dans sa jeunesse : « une femme comme il faut ne doit jamais avoir les mains inoccupées ».
Quand nous rentrions du lycée et du Cours Désir, c’était la sacro-sainte heure du thé. Cette pause, cette halte dans une journée harassante, pour rien au monde elle ne l’aurait omise. En dégustant son savoureux cake aux fruits confits (chacun de nous évoque avec émotion le plat que sa mère confectionnait comme nulle autre et dont il n’a jamais retrouvé la saveur), nous lui racontions notre journée, nos déceptions ou nos succès.
Tandis que nous faisions nos devoirs et apprenions nos leçons, elle retournait aux fourneaux préparer le dîner. Nous l’interrompions fréquemment pour qu’elle nous explique une règle de grammaire ou nous fasse répéter une récitation (elle n’avait pas poussé le dévouement jusqu’à apprendre le grec pour nous aider dans cette redoutable épreuve qu’était la composition de récitation).
Le dîner commençait invariablement par une soupe. Chaque jour elle devait faire preuve d’imagination pour en proposer une nouvelle qui réponde aux goûts de l’ensemble de la famille (je n’ai jamais pu absorber les soupes au tapioca, ces horreurs !).
De même lui fallait-il du talent pour trouver une utilisation aux restes. Traditionnellement, nous dînions, le dimanche soir, avec un pot-au-feu qui permettait de servir en entrée le bouillon gras. Si le lundi, chez les Lequesnoy de La vie est un long fleuve tranquille « c’est jour de raviolis », chez nous il était jour de hachis parmentier (ici non plus, je n’ai jamais retrouvé la saveur des hachis qu’elle confectionnait).
Les restes de pain (« gaspiller le pain est un péché ! ») servaient également à confectionner des plats comme la panade, substance aussi repoussante que le tapioca. Pilés et séchés, ils fournissaient la chapelure pour les escalopes et les gratins.
Après le dîner, tandis que mon père buvait des thés plus noirs que du café, nous prenions notre tour à l’essuyage de la vaisselle.
Enfin, après le traditionnel baiser, nous allions nous coucher, laissant à nos parents quelques moments d’intimité ponctués par le clic-clac des aiguilles à tricoter de ma mère.
Malgré cet emploi du temps surchargé (et je n’ai pas parlé des promenades au « petit square » de la rue de la Planche ou aux Tuileries – cf. : La vie quotidienne et Les loisirs), j’ai toujours vu ma mère d’une humeur égale, sans emportements, toujours disponible pour panser nos plaies physiques ou nos peines de cœur. Sans doute n’a-t-elle pu retenir quelques gifles lorsque je devenais trop insupportable. Mais j’avais conscience de vraiment les mériter.
Lorsque je devenais franchement odieux, elle proférait la suprême menace : « tu vas voir ce que ton père va dire quand il rentrera ! ». Mais, au retour de celui-ci, elle avait oublié le prétexte de la menace, le calme était revenu et nous pouvions nous mettre sereinement à table.
La douceur, la tendresse, la modestie, ces trois adjectifs disent tout sur la chance que nous avons eue de profiter abusivement d’une mère comme celle-ci.
« Votre mère était une sainte ! » affirmait mon père après la mort de celle-ci en 1975. Ce à quoi ma sœur, exaspérée, lui rétorqua un jour que la vraie raison de sa sainteté fut d’avoir supporté toute sa vie un mari comme lui.
Bien qu’un peu exagérée, cette réflexion ne manque pas de justesse.
Le moins qu’on puisse dire est que mon père avait un caractère affirmé.
Le couple formé par mes parents était une sorte de « modèle » au sens où il se conformait à une tradition chrétienne solidement établie dans le milieu où nous vivions. La mère assurait la bonne marche du ménage, gérait le quotidien, s’occupait de l’entretien et de l’éducation des enfants, etc. Le père, quant à lui, assumait son rôle de chef de famille.
Jamais cette expression n’a aussi bien convenu qu’à mon père.
Un psychologue trouverait sans doute dans les origines modestes qu’il s’efforça toujours de nous cacher les raisons profondes de son appétence à jouer, dans quelque situation qu’il se trouvât, ce rôle de chef.
Je ne suis pas psychologue, mais les faits sont là. À l’Amicale Saint-Thomas d’Aquin, il fut capitaine de l’équipe de football, animateur de la troupe de théâtre (cf. : Le théâtre) puis Président. Aux scouts (cf. : Le scoutisme) il s’accrocha jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans à son poste de chef de groupe. Il fallut une véritable révolution de palais, dont il mit longtemps à se remettre, pour lui faire abandonner sa fonction. Au lycée Henri IV, il devint rapidement Président de l’Association des parents d’Elèves. Et je ne parle pas des nombreuses associations de lutte contre le bruit, de défense de l’environnement et de l’obstruction à la Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux qu’il monta et, bien sûr, présida.
C’est incontestable : il possédait une énergie et un charisme propres aux natifs du Taureau, qui l’amenaient naturellement à prendre la tête des mouvements auxquels il adhérait.
Mais, pour des raisons que nous ne sommes jamais parvenus à élucider (Rigueur morale ? Sens profond de l’honnêteté ? Refus des compromissions ? Naïveté, selon certains ? Peur de l’échec ?) il ne prenait le pouvoir que si celui-ci avait un but totalement désintéressé.
Avec son talent, il aurait pu se lancer dans une carrière politique (au temps de la splendeur du MRP il consentit à figurer sur une liste électorale mais à un rang qui ne lui laissait aucune chance d’être élu).
Il aurait pu devenir chef d’entreprise, diriger une troupe de théâtre ou réussir dans la promotion immobilière. Non, il consacra toute son énergie à des actions destinées au service des autres. C’est peut-être cela vivre en accord avec sa foi chrétienne.
Comment fonctionnait le couple que formaient mes parents ? Aujourd’hui, on dirait que ma mère était une femme soumise. Jamais elle ne se rebellait contre les décisions de son mari. Avec tact et gentillesse, elle s’efforçait de réparer les impairs et les esclandres que le caractère impétueux de celui-ci avait provoqués.
Leur relation était empreinte de pudeur. Ils se vouvoyaient alors que nous les tutoyions (chez certains de mes amis, les enfants vouvoyaient leurs parents). Jamais ils ne se permettaient ces gestes de tendresse spontanée qui nous paraissent aujourd’hui si naturels. Un baiser sur le front, un « mon chéri » représentaient pour eux le maximum des privautés autorisées. Inutile de dire que je n’ai jamais vu mes parents nus.
S’agissait-il de froideur ? Je pense qu’il faut plutôt parler de retenue et du poids d’une éducation dans laquelle toute effusion était considérée comme un manquement aux règles. J’ai moi-même mis un certain temps à me débarrasser de cette pudeur.
En revanche, leur correspondance laissait apparaître une affection profonde, affection teintée d’un mysticisme qui pourrait prêter à sourire s’il ne témoignait pas d’une élévation de sentiments qui force le respect.
Dès qu’ils étaient séparés – pendant la période où nous réfugiâmes en Indre et Loire (cf. : La campagne) ou durant les vacances – ils s’écrivaient chaque jour. Non pas des petits mots hâtifs et impersonnels mais des épîtres de plusieurs pages dans lesquelles chacun décrivait minutieusement ses activités, ses sentiments et ses inquiétudes (j’étais souvent le principal sujet d’inquiétude de ma mère).
Ces lettres ne cherchaient pas l’effet littéraire – Madame de Sévigné est bien loin – mais, grâce à leur simplicité et à leur chaleur, atteignaient parfois une qualité affective qui me fait songer à ces Lettres de Poilus récemment éditées où le sublime côtoie le banal et, par ce contraste même, engendre une irrésistible émotion.
Pour suivre la vie de la famille, nous avons disposé d’un précieux document : le livre de comptes tenu journellement par ma mère jusqu’aux dernières années de sa vie.
En filigrane, les dépenses familiales permettent de découvrir les difficultés financières auxquelles mes parents se sont affrontés, les affres du quotidien, les embellies qui permettaient quelques « folies ». Ces cahiers de dépenses racontent souvent mieux qu’avec les mots la vie quotidienne d’une famille comme la nôtre. C’est pourquoi nous les avons légués au Musée des Arts et Traditions Populaires en souhaitant qu’un chercheur puisse un jour en faire son miel.
Mon père exerçait deux activités professionnelles. Durant la journée, il se rendait à son bureau, rue Saint-Lazare, où il occupa, dans plusieurs sociétés successives, des postes de comptabilité et de gestion financière.
Tout cela reste assez flou car, à la maison, les problèmes économiques et financiers étaient pratiquement évacués. J’ai toujours ignoré ce qu’il gagnait, quelles étaient ses fonctions exactes, quels problèmes il rencontrait dans son travail.
Pourtant il dut en avoir de sérieux quand la société qui l’occupait depuis des dizaines d’années mit la clef sous la porte. Mes parents en parlaient à mots couverts, comme d’une affaire honteuse. Puis on apprit qu’une autre société, la CHM, qui gérait des hôtels de luxe, le chemin de fer à crémaillère de Superbagnères et la route du Pic du Midi l’avait repris à son service.
Je suppose que sa situation s’améliora. Il partait fréquemment faire des « audits » dans ces lieux dont les noms me faisaient rêver : Cabourg, Font Romeu, Port-Vendres, le Carlton de Vichy, le Grand Hôtel de Superbagnères.
Parfois mon frère ou ma sœur l’accompagnaient dans ces endroits magiques d’où je fus toujours exclu.
Le soir, après le dîner et un court sommeil, il attaquait son second métier.
Grâce à ses relations dans le milieu ecclésiastique, il était devenu conseiller juridico-financier de l’ordre des Maristes et des « demoiselles » du Cours Désir (cf. : Les études).
Ces congrégations religieuses possédaient un important patrimoine immobilier, dû à la générosité de pieuses personnes mortes sans héritier. Comme les vocations se faisaient de plus en plus rares, elles liquidaient progressivement leurs collèges et leurs châteaux que cette raréfaction du personnel religieux rendait impossible à maintenir en activité.
Devenu leur homme de confiance, mon père démêlait des comptes souvent embrouillés, analysait les plaidoiries des avocats et, surtout, les protégeait contre les requins qui, sous leurs airs patelins et leur respectabilité de bon aloi, ne cherchaient qu’à se goinfrer du gâteau que représentaient ces terrains et ces bâtiments.
Le soir, donc, il se plongeait dans ses dossiers. Souvent, réveillé au milieu de la nuit, je l’ai trouvé, perdu dans un épais nuage de fumée, compulsant les papiers étalés sur la table de la salle à manger.
Eut-il été moins honnête qu’il aurait pu largement profiter de la naïveté de ces braves religieux qui le payaient beaucoup plus avec de bonnes paroles qu’avec des honoraires que son travail de romain méritait largement.
Mais mon père était irrémédiablement honnête. La négociation de la vente du collège de la rue de Norvins, magnifiquement situé sur la butte Montmartre, ou de l’aménagement de la Cour du Dragon, au coin de la rue de Rennes et du boulevard Saint-Germain, auraient pu lui rapporter une fortune. Il n’en retira qu’un pourboire.
Pour compenser la maigreur des honoraires qu’il demandait à ses clients, il multipliait les activités. Le « bureau », où je couchais avec mon frère, croulait sous les dossiers. Il y en avait partout : sur les fauteuils, sur le divan, en haut des armoires. Retrouver un document, toujours urgent, relevait de l’exploit. Mon père entrait en fureur et, inévitablement accusait ma mère qui, depuis longtemps, avait renoncé à mettre de l’ordre dans ce fatras de papiers.
Je crois n’avoir jamais vu quelqu’un travailler autant que mon père. Il n’était pas rare qu’il se contente de quatre heures de sommeil. Mais, s’il déployait une énergie redoutable dans ses entreprises, c’était une énergie désordonnée qui lui demandait dix fois plus de temps et de force qu’une activité bien organisée.
Il se targuait d’être bricoleur. C’est vrai qu’il était assez habile de ses mains. Mais, comme dans beaucoup d’autres domaines, il avait des idées fermement arrêtées sur la manière de procéder. Par exemple, quand il entreprenait de repeindre une pièce, il fabriquait sa peinture sous prétexte que les produits du commerce étaient, comme il disait, « de la cochonnerie ». Il achetait donc des bidons de blanc de zinc qu’il mélangeait avec des colorants. Sans doute les professionnels agissent-ils ainsi. Mais ils ont le chic pour composer les dosages exacts permettant de reproduire la teinte précise. Ce qui faisait défaut à mon père. Une fois le bidon fini (en langage professionnel on dit « un camion »), il était incapable de retrouver la teinte primitive. Et, plus il s’énervait, moins celle-ci n’apparaissait.
Quand mes parents achetèrent la propriété du Loir et Cher, il trouva un chantier à sa dimension. À peine débarqué de la 2CV (cf. : Les voitures) il enfilait une salopette et se lançait dans des travaux surhumains. La seule vue de cette activité débordante, qui passait du jardinage (dans la jungle qu’étaient alors les jardins, il avait décidé de créer un parc à la française) à la menuiserie et à la maçonnerie, décourageait toute velléité de lui porter assistance.
Lorsqu’il entreprit de refaire les plafonds en plâtre – travail qui exige des spécialistes – après des journées où il s’obstina à recevoir sur la tête des paquets de plâtre qui le faisaient ressembler à un bonhomme de neige, il dut reconnaître son incompétence et faire appel à un professionnel (auquel il ne pouvait s’empêcher de donner des conseils).
Mon père étant pris dans une activité démentielle, mes parents ne sortaient pratiquement jamais. Je crois qu’ils ne se rendirent qu’une seule fois au théâtre.
De même recevaient-ils fort peu. Parfois, le dimanche, quelques-uns de leurs vieux amis venaient déjeuner et passer l’après-midi à évoquer des souvenirs. Mais, la plupart du temps, après la messe du matin, mon père et ma mère consacraient leur dimanche (sauf en temps de carême où ils écoutaient les sermons de Notre-Dame du Père Riquet – cf. : La religion) à remplir des bilans et des comptes d’exploitation avec les chiffres que ma mère avait additionnés durant la semaine sans l’aide de la moindre machine à calculer.
En fin d’après-midi, j’accompagnais mon père à la grande poste de la rue du Louvre pour expédier d’urgence les résultats de ces travaux de bénédictin.
Ces promenades, à la nuit tombante où nous traversions la Seine par le pont des Arts, me laissent un souvenir ému. Enfin débarrassé de ses préoccupations immédiates, mon père se laissait aller, se détendait, devenait rieur et évoquait ses souvenirs. Petits moments de grâce…
Quand, le matin, j’ouvre la porte de la maison pour me rendre dans mon atelier, je m’arrête un instant pour écouter le chant des oiseaux, contempler les arbres qui se couvrent de fruits, respirer les odeurs entêtantes des lis et des chèvrefeuilles. Et je ne puis m’empêcher d’évoquer toutes ces nuits blanches, ces après-midi à totaliser des chiffres incompréhensibles, ces nuits glaciales où mon père se rendait en mobylette dans de lointaines banlieues. Je pense aux fatigues de mes parents, à leurs angoisses, à tous ces renoncements de distractions et de plaisirs, à ce travail acharné qui leur ont permis de réaliser leur rêve en acquerrant, à l’automne de leur vie, cette propriété dont je profite aujourd’hui.
Moi, l’enfant gâté, je devrais en éprouver quelque culpabilité. Mais, bien au contraire, je m’en réjouis et leur rends une action de grâce. Eux qui croyaient si profondément à une vie dans l’au-delà, s’ils me voient, doivent éprouver un bonheur intense : celui d’une existence réussie.
Si mes parents m’ont beaucoup donné, à force d’affection et de renoncements, mon frère Bruno, sans même s’en rendre compte, a largement contribué à former, ce que je pourrais appeler avec quelque grandiloquence, mon armature intellectuelle.
Pourtant, nos débuts furent tumultueux. Enfant unique pendant cinq ans, né de parents relativement âgés (ma mère avait trente-quatre ans à sa naissance, mon père trente-sept ans, ce qui, à l’époque, était une bizarrerie), cajolé, dorloté, admiré, il était le centre de l’univers.
Ma mère, qui avait reporté sur lui ses ambitions religieuses, avait décidé d’en faire un prêtre. Les vieilles filles de la rue de Verneuil (cf. : La maison), entrant dans son jeu, avaient confectionné pour mon frère une panoplie de curé. Revêtu de ses ornements sacerdotaux, il célébrait la messe en baragouinant un charabia censé être du latin. Religieusement (c’est le cas de le dire) ces demoiselles lui présentaient les soi-disant objets du culte. Il était temps que je naisse pour le sortir de ce piège ridicule !
Adulé comme il était, la venue au monde d’un rival ne pouvait que lui causer un choc. Sur les photos et les films pris par mon père à cette époque, on voit son visage se fermer et se durcir. Il paraîtrait même qu’il tenta un jour de m’étouffer dans mon berceau.
Et puis les choses s’arrangèrent. Il devint le grand frère qui protège et qui instruit. Nos caractères différaient profondément. Autant j’étais turbulent et toujours disposé à faire quelque bêtise, autant Bruno se montrait sage et sérieux.
Je l’ai toujours vu plongé dans des livres où il emmagasinait des connaissances plutôt surprenantes pour un garçon de son âge.
Une de ses lectures préférées était un gros ouvrage en deux volumes reliés de carton rouge qui décrivaient, photos à l’appui, la faune du monde. À dix ans, mon frère n’ignorait rien des mœurs du kangourou ni de la nidification de la huppe cendrée.
Avec le ton légèrement professoral qui ne l’a jamais quitté, il remettait à leur place les chers frères de Saint-Thomas d’Aquin (cf. : La religion) qui supportaient mal qu’un gamin mît en évidence leur ignorance.
Sa période animalière le conduisait fréquemment au Jardin des Plantes où il avait entrepris d’apprendre par cœur les noms des animaux cloîtrés dans leurs cages. Ayant relevé une erreur, il n’hésita pas à écrire au conservateur pour la lui signaler (lequel lui répondit aimablement pour le féliciter d’une telle perspicacité).
Pendant que les enfants de son âge dépensaient leur énergie à taper dans des ballons, mon frère consacrait ses loisirs, en dehors de la lecture, à dessiner avec un acharnement et une minutie un peu maniaque, le monde qui nous environnait. Inlassablement, il reproduisait les voitures, les chemins de fer et les autobus (il se mit aussi en tête d’en connaître par cœur les itinéraires et les stations).
C’est cette passion du dessin qu’il parvint à me communiquer (cf. : La peinture) et qui décida, longtemps après, ma carrière de peintre.
Comme on le voit, mon frère était un original (j’ai connu un autre garçon de ce genre qui, à l’âge de douze ans, s’étais mit en tête d’apprendre la série des papes ; il a fini bénédictin). Son originalité se doublait d’une imagination fertile. Il inventait des histoires qui ravissaient notre petite sœur Colette.
Pour elle, il avait créé un pays imaginaire, La Nouvelle Flandre, dont il décrivait minutieusement, dans un gros cahier, les coutumes, les institutions, les modes de vie etc. Ce récit, qui aurait mérité d’être publié, était accompagné de dessins et de cartes si précis qu’on en arrivait à croire en son existence.
Passionné d’orgue, il écoutait religieusement, chaque jeudi après-midi, l’émission de Norbert Dufourcq consacrée à cet instrument. Comme un imbécile, je m’efforçais de brouiller la radio en introduisant des morceaux de fil de fer dans les prises électriques. (cf. : La musique)
À une dame qui lui demandait des conseils pour bien élever son enfant, Freud lui répondit : « Faites ce que bon vous semble. De toute façon, cela sera mauvais ». Si je considère le résultat d’une éducation identique, pareillement chargée de tendresse et de sens moral que nos parents appliquèrent à leurs trois enfants, on ne peut qu’être frappé de la diversité des résultats obtenus.
Mon frère vivait dans ses livres et dans ses songes alors que, pour moi, seuls comptaient le présent et l’action. Mais cette profonde différence, qui aurait pu engendrer de perpétuels déchirements (il y en eut quelques-uns, bien sûr), débouchait sur une précieuse complémentarité. Si mon frère enviait ma vitalité et mon assurance, j’admirais son imagination et sa capacité de réflexion. J’étais léger et rapidement satisfait de mes productions. Lui était posé, toujours insatisfait des résultats de ses cogitations qu’il creusait inlassablement (quand il rédigeait une dissertation, il lui fallait plusieurs corbeilles à papier pour contenir les feuilles de brouillon rageusement froissées).
Comme je le fais aujourd’hui avec les chapitres de ce livre, je lui soumettais, avant de les mettre au propre, mes dissertations et mes versions latines ou grecques. Il prenait mes feuilles, s’enfermait dans son bureau et, au bout d’un moment, ouvrait la porte, mes papiers à la main. Une fois sur deux, avec une ostentation qui me mettait en fureur, il les déchirait en menus morceaux. De rage en rage, j’appris ainsi la rigueur. (cf. : Les Études)
À l’adolescence, il devint un peu bizarre : il se mit en tête de s’identifier à celui qu’il estimait être le grand homme suprême, Napoléon. Pour cela, il se composa une sorte de rictus qui, paraît-il, caractérisait l’empereur (cela lui valut deux heures de colle d’un professeur excédé qui pensait que Bruno se payait sa tête). Ayant lu que Napoléon essuyait ses bottes crottées sur sa culotte, il l’imitait en grattant ses souliers sur son pantalon de golf devenu une guenille informe.
Ses lectures prirent une tournure différente. Il se plongeait dans Nietzsche et lisait, relisait, soulignait et annotait Sois un chef de Jean des Vignes Rouges qui devint sa bible.
Le chef étant, par principe, un solitaire, mon frère s’enferma de plus en plus dans sa solitude. Durant les vacances (cf. : Les vacances), tandis que nous formions de joyeuses bandes pour organiser des pique-niques ou monter des spectacles, il partait des journées entières arpenter les landes bretonnes ou se perdre dans la forêt vosgienne.
Ses années d’hypokhâgne et de khâgne, la découverte de la philosophie la plus absconse (Hegel, Husserl, Heidegger) ne facilitèrent pas son ouverture à la réalité. Progressivement, il s’enfermait dans un monde d’abstraction où il était bien difficile de le suivre. Ne parlons pas des femmes.
Ayant obtenu son CAPES, il partit enseigner en Tunisie. Ce départ à Sfax (on trouvera une cruelle description de cette ville dans Les Choses de Georges Perec) ressemblait plutôt à une fuite. Elle lui permit néanmoins de se réveiller des songes dans lesquels il était en train de se perdre en prenant un contact brutal avec la vie réelle (cf. : Les loisirs et les voyages). Quant à moi, ayant constaté les ravages que pouvaient opérer les années de préparations à Normale Supérieure, voie dans laquelle le Proviseur conseillait à mes parents de m’engager, je réussis à échapper à cet enfer où j’aurais probablement perdu une partie de mon âme.
Dans ma famille, Bruno était le modèle auquel j’étais sans cesse prié de me référer. Avec lui, jamais d’histoires, jamais d’initiatives calamiteuses, jamais de propos déplacés. Quand vint l’adolescence, lui ne traficotait pas avec les filles (je reprends une expression de mon père). Bref, le prototype de l’enfant sage !
Entouré de petits soins par ma mère, il jouissait d’un régime alimentaire privilégié. Comme la seule vue de la purée lui donnait la nausée, il ne se nourrissait que de haricots verts, de petits pois ou de salades cuites. Ma mère lui mijotait ces fades nourritures dans de petits plats d’aluminium destinés à son seul usage. Je les ai conservés comme des reliques. (cf. : La Vie au quotidien)
À la moindre contrariété, il souffrait de « crises de foie ». Aux premiers symptômes, ma mère se précipitait pour lui administrer du CALOMEL, lui préparer une bouillotte et disposer près de son lit une cuvette émaillée, réservée à cette seule fonction, au cas où il serait pris de nausées.
Dans une famille, l’aîné a la lourde tâche « d’essuyer les plâtres » : habituer les parents aux sorties nocturnes, les faire à l’idée qu’il est normal de sortir avec des jeunes filles, les préparer à l’arrivée de bulletins trimestriels catastrophiques, etc. (ce que j’écris au masculin est tout aussi valable au féminin).
Mon frère ne me fut d’aucune utilité dans cette fonction et je dus assumer seul l’initiation de mes parents aux incartades d’un adolescent. Compte tenu du caractère entier de mon père, les choses ne furent pas faciles et les scènes où je menaçais de quitter la maison assez fréquentes (cf. : Les jeunes filles et les dames).
Ma sœur Colette naquit aux moments les plus sombres de l’Occupation : Septembre 1942. Comme je le raconte ailleurs (cf. : La religion) nous demandions chaque soir dans notre prière que nous naisse une petite sœur « aux cheveux blonds et aux yeux bleus ». Le ciel nous entendit et le bébé fut en tous points conforme à notre souhait.
J’avoue ne pas garder de souvenirs marquants de mon enfance avec ma sœur. Comme tous les garçons, je pense, je passais mon temps à l’énerver avec des farces stupides, à lui tirer les nattes, etc. Pendant que mon frère lui confectionnait d’adorables maisons de poupée et des classes miniatures construites dans des cartons à chaussures, pendant qu’il lui inventait des histoires merveilleuses, moi je cherchais tous les moyens de la faire enrager. Pour donner un exemple dont je ne suis pas fier, je psalmodiais inlassablement : « Colette est une chipie, Colette est une chipie… ». Excédée, elle allait me dénoncer à notre mère qui m’ordonnait d’arrêter aussitôt sous peine d’un terrible châtiment « quand ton père rentrera… ». Malgré la menace, je continuais la litanie en gardant l’air sans les paroles. D’où nouvelle crise de larmes, nouvelle menace, etc.
Comme on le voit notre vie de famille se déroulait dans un climat serein et ne présentait pas d’originalité particulière. De petites brouilles suivies aussitôt de réconciliations, beaucoup de tendresse et un appétit constant de communication.
Si je partageais un grand nombre de goûts et d’intérêts avec mon frère, je vivais plutôt en parallèle avec ma sœur. Elle avait ses jeux, ses poupées, ses amies (même adolescent, aucune ne parvint à m’intéresser). Bref, c’était une fille et je ne voyais pas trop ce qui aurait pu nous réunir.
Ce qui n’excluait pas l’affection. J’ai de jolis souvenirs quand nous partions en excursion au Bon Marché nous ébahir devant cette profusion d’objets et de produits que nous ne posséderions jamais (cf. : La vie au quotidien) ou lorsque je « filmais » avec ma chambre noires des pièces interprétées par ses poupées Bleuette et Bambino (cf. : Le cinéma et la photo).
En fait, je ne la découvris que beaucoup plus tard, presque à l’âge adulte. En simplifiant, je puis dire qu’elle a hérité du caractère de mon père. Mais alors que celui-ci faisait passer ses idées en force, ma sœur pratique en douceur. C’est la même opiniâtreté mais avec le sourire et un charme auquel on ne peut que succomber.
Elle aussi ne résiste pas à l’appel des présidences : clubs et associations, séduits par son énergie et son sens pratique ne tardent pas à lui en confier la direction.
En 1975, année de la mort de ma mère et de la naissance de ma fille, nous étions tous réunis, durant l’été, dans la propriété familiale.
À l’époque, avec ma caméra BEAULIEU (cf. : Le cinéma), je filmais beaucoup. En visionnant les scènes que j’avais tournées, il me vint l’idée d’en tirer un pastiche d’émission religieuse telle qu’on en voyait à la télévision le dimanche matin. Le montage achevé, j’enregistrai le commentaire censé être celui d’un prêtre au fort accent auvergnat, le père Larzac. J’intitulai ma production Une belle famille chrétienne.
Les premières projections ne furent guère appréciées par la famille qui ne vit dans le film que l’aspect de dérision. Après plus de vingt-cinq ans, nous le regardons d’un tout autre œil. Ces images, au fond très banales, d’une famille se livrant à ses occupations quotidiennes prennent une densité qui efface toute l’ironie que j’avais voulu y mettre. Maintenant, seule demeure l’émotion de revivre un instant de bonheur à jamais disparu.
Déjà, à l’époque du tournage, nous suivions des voies différentes et parfois fort contradictoires. Mais, depuis, nous ne nous sommes jamais perdus de vue – ni de cœur.
C’est toujours avec un plaisir extrême que nous nous retrouvons pour évoquer nos souvenirs et poursuivre un dialogue qui n’a cessé de se nouer.
Quand je regarde autour de moi ces familles qui se détestent (on en trouvera un succulent exemple dans le film de Louis Malle, Milou en Mai), s’indiffèrent ou, lors des réunions familiales de façade, n’ont plus rien à se dire, je considère comme un petit miracle l’affection profonde qui nous soude toujours.
La phrase de Sigmund Freud que j’ai citée plus haut était sans doute une boutade. Bien sûr nos parents, en croyant bien faire, ont commis de nombreuses erreurs. Mais s’agissait-il vraiment d’erreurs puisqu’ils ont réussi, avec trois enfants, aussi dissemblables, à réaliser ce lien qui est sans doute la chose à laquelle je tiens le plus au monde.
Pour écrire ce livre, j’ai remué beaucoup de souvenirs, dépouillé de nombreuses archives, recueilli force témoignages.
Plus j’avançais dans mon travail, plus je prenais conscience de la chance que j’ai eue de naître dans une famille telle que celle que j’ai tenté de faire revivre.
En donnant, par dérision, ce titre à mon film, je ne me rendais pas compte que j’énonçais une vérité profonde. La foi de mes parents et leur mise en œuvre des vertus chrétiennes – même si j’ai abandonné assez tôt toute pratique religieuse et toute croyance – m’ont suffisamment marqué pour que j’évite la plupart des actions dont j’aurais aujourd’hui à rougir.
Beaucoup, je le crains, jugeront que je parle d’un temps révolu et d’un mode d’éducation totalement démodé. Tant pis pour eux !
Je ne propose pas ici un exemple. Loin de moi cette prétention ! J’ai simplement tenté de montrer comment une certaine forme de rigueur morale et de chaleur dans les relations (qui n’est pas exceptionnelle : beaucoup de mes contemporains ont eu la chance de recevoir une formation identique) nous a permis d’éviter de tomber dans les pièges de la frivolité : course à l’argent, aux honneurs, à la réussite sociale (C’est Alfred Capus, je crois, qui disait d’un personnage connu : « il est arrivé, mais dans quel état. »).
C’est grâce à l’exemple de mes parents que j’ai réussi à ne pas céder à la tentation de devenir un de ces « jeunes loups » aux dents longues, prêts à écraser tous ceux qui leur barrent le chemin pour m’efforcer de devenir, comme le dit la belle chanson d’Enzo-Enzo : « Juste quelqu’un de bien… ».
2 – LA MAISON
Louer un appartement peut paraître un acte anodin. Lorsqu’en 1933, mes parents emménagèrent au 60 de la rue de Verneuil, soupçonnaient-ils qu’ils s’ancraient là pour leur vie entière ?
Pour mon père, qui avait vécu depuis sa naissance à l’ombre protectrice de l’église Saint-Thomas d’Aquin, et pour ma mère, récemment débarquée de sa Touraine pour assumer la fonction de préceptrice auprès des enfants d’une grande famille du quartier, je suppose qu’il était impensable d’aller habiter ailleurs que dans cette partie du septième arrondissement.
Comment réussirent-ils à trouver un appartement en cette période où sévissait la crise du logement et que beaucoup étaient contraints de s’exiler à la périphérie (la zone disait mon père avec mépris) dans les fameux HBM en brique qui bordent les Boulevards des Maréchaux ? Ce sont les relations de mon père dans le milieu scout (cf. : Le scoutisme) qui lui permirent de profiter d’une rare aubaine.
En fait, ce n’était pas seulement un logement qu’ils occupaient mais, tout autant, un certain mode de vie qu’ils choisissaient. Hormis les conditions matérielles – montant du loyer raisonnable, bonne tenue de l’immeuble – ils devaient sentir, plus ou moins consciemment, que celui-ci les situait à leur rang, faisait partie de « leur monde ». Ils ne s’y trouveraient pas déplacés.
Ni trop cossu, ni trop « populaire », l’immeuble de la rue de Verneuil correspondait pour eux à une certaine conception de l’existence.
La situation, outre le fait qu’elle ne les dépaysait pas, avait également son importance : le quartier Saint-Thomas d’Aquin, tel que je l’ai connu durant mon enfance et une partie de mon adolescence (jusqu’à la fin des années 50) avait un côté feutré et rassurant, quasiment provincial.
C’est, je pense, cet aspect « province » qui séduisit mes parents. Ce petit univers, où chacun devenait rapidement familier, rappelait à ma mère le village de son enfance et le Tours de sa jeunesse.
La rue de Verneuil que j’ai connue constituait une sorte de village où se succédaient artisans et commerçants au contraire des deux parallèles, rue de Lille et rue de l’Université, qui respiraient la sérénité un peu morose de la vie bourgeoise.
Encore faut-il nuancer : de la rue de Poitiers à la rue de Beaune (en incluant la portion de la rue du Bac située entre Lille et Université) la rue de Verneuil menait sa vie remuante et colorée. Au-delà, jusqu’à la rue des Saints-Pères, elle devenait digne et réservée : un autre monde.
Pour être exact, la portion finale de la rue, à peu près en face de notre immeuble constituait un îlot à part où s’élevaient de superbes hôtels particuliers (l’un d’eux est devenu la Maison des Ecrivains). Sans transition, on passait de l’hôtel Pozzo di Borgo au bougnat puis aux maisons bourgeoises qui s’ouvraient sur de vastes cours où l’on garait jadis les voitures et leurs chevaux.
Le 60 rue de Verneuil
L’immeuble, en lui-même, ne présentait aucune originalité. Une façade banale et plate avec quelques balcons en fer forgé dans les hauteurs, c’était le type même de « maison de rapport » dont parle Balzac, destinée à de petits-bourgeois.
Dans la porte cochère à doubles battants était intégrée une porte plus petite qui s’ouvrait à l’aide d’une sonnette électrique. Je note ce détail car, à l’époque, chez certains de mes amis, persistait le système dit « du cordon ». Passées les vingt-deux heures il fallait réveiller la concierge qui exigeait que l’on donnât son nom pour actionner l’ouverture. En quelque sorte, l’ancêtre des digicodes et interphones actuels.
À gauche de la porte cochère s’ouvrait la boutique d’un encadreur et à droite l’antre poussiéreux et obscur de deux tapissiers taciturnes.
Une fois la porte franchie, on pénétrait sous une voûte bordée au sol de deux rangées de pierre blanche que la concierge mettait un point d’honneur à tenir méticuleusement propres en les lavant à grande eau chaque samedi.
Au bout de la voûte, à ma main gauche, une porte vitrée donnait sur l’escalier desservant l’immeuble côté rue. Jouxtant celle-ci, la loge de la concierge, Madame Deluard.
On débouchait alors sur la cour, en partie occupée par l’atelier d’un ébéniste et par celui de l’encadreur.
On trouvait également dans la cour l’habitacle aux poubelles. Ce vaste coffre en bois contenait une batterie de poubelles métalliques dans lesquelles chacun venait déverser sa boîte à ordures. Dès les premières chaleurs, montait de ce cloaque un délicieux fumet que l’on pouvait humer jusqu’à notre quatrième. À ces relents, se mêlaient, en une subtile harmonie olfactive, les riches odeurs provenant des cabinets à la turque situés à côté de la loge. Les mouches y trouvaient leurs délices… Ce mélange d’odeurs puissantes ne nous dépaysait pas : elle nous rappelait le village maternel avec ses relents de fumier et le passage du vidangeur (cf. : La campagne).
Au fond de la cour, une porte vitrée menait aux étages de l’autre partie de l’immeuble.
À gauche de celle-ci, s’ouvrait l’entrée des caves où l’on remisait le bois et le charbon. Pendant l’Occupation et les années de pénurie qui suivirent, on y conservait les denrées précieuses. Dans notre cave, par exemple, une énorme jarre contenait les œufs envoyés par ma grand-mère. Ceux-ci baignaient dans une mixture jaunâtre saturée de calcaire qui en permettait la conservation (c’est le principe des œufs de cane centenaires des chinois).
La cour et la voûte avaient leur vie propre. L’ébéniste y faisait résonner ses burins et ses maillets. L’encadreur crisser sa scie. Parfois, les tapissiers sortaient de leur tanière pour exécuter un travail délicat : à l’aide de gros pinceaux en poil de martre, ils détachaient délicatement les impalpables feuilles d’or réunies dans des sortes de carnets pour les appliquer sur les bras d’un fauteuil ou d’un canapé.
Tôt le matin, le mari de la concierge, M. Deluard, sortait les poubelles de leur réduit. Il les traînait jusqu’à la rue sans se soucier du sommeil des locataires. Comme la cour faisait caisse de résonance, nous étions réveillés en sursaut par ce concerto de ferrailles.
Sous la voûte, il avait installé une machine à griller le café (denrée rare jusqu’au début des années 50) dont l’arôme se répandait jusqu’aux derniers étages.
Grâce à je ne sais quel privilège octroyé par la concierge, un personnage énigmatique et furtif était autorisé à y garer son vélo. Sur le porte-bagages, il avait construit une boîte en contreplaqué qui nous intriguait. Quels mystérieux produits véhiculait-il chaque soir ? On ne sut la vérité que plus tard : maquilleur à la Comédie-Française, il enfermait à clef sa maîtresse dans leur chambre du sixième étage afin qu’elle ne puisse s’échapper durant son absence.
Mais le cœur de l’immeuble, son centre névralgique, son lieu tellurique, était, incontestablement, la loge de la concierge.
Celle-ci semblait y demeurer en permanence, comme la gardienne du temple chargée de veiller à la bonne ordonnance de son fief et à la tenue respectable de ses ouailles.
Le mot n’est pas trop fort. Madame Deluard était la grande prêtresse d’un rituel aux règles immuables qu’il eut été périlleux de transgresser.
La halte dans la loge, lorsqu’on rentrait de faire ses courses, était une obligation implicite. Sous des prétextes divers – voir si du courrier était arrivé, s’informer de la santé de tel ou tel, chercher un paquet, déposer un sac – chacun venait s’entretenir avec la concierge.
Dans ce réduit obscur, en partie envahi par un lit aux dimensions imposantes et quelques meubles lourds, Madame Deluard colportait les nouvelles, prodiguait des conseils, émettait des hypothèses sur l’activité des « mystérieux », vitupérait les uns et décernait ses louanges aux autres.
Bref, la concierge était à la fois notre radio locale, notre juge de paix (j’ai eu maintes fois à subir ses foudres pour avoir sali les sacro-saintes dalles de la voûte ou sauté une volée de marches au-dessus de la loge) et notre oracle.
S’aliéner ses faveurs, c’était le bannissement dans le clan des « mauvais locataires ».
Ceux-ci habitaient plutôt dans la partie de l’immeuble située en fond de cour. Une forme de ségrégation sociale s’était établie entre le « bâtiment rue » où nous habitions et le « bâtiment cour » peuplé, selon mon père, de gens « pas fréquentables ». La raison en était-celle cette femme qui faisait hurler sa radio, toutes fenêtres ouvertes et qu’il menaça de procès ? En tout cas, je crois bien ne jamais avoir mis les pieds dans cette partie de l’immeuble, craignant sans doute d’y faire des rencontres inquiétantes.
La partie sur rue comportait six étages, chaque étage comptant quatre appartements et un « studio ». Le sixième était occupé par les « chambres de bonnes ». Comme personne ne possédait de domestiques, ces chambres étaient habitées ou servaient de débarras.
On accédait aux étages par un escalier assez étroit et d’une escalade difficile. Chez la plupart de mes amis, l’escalier était recouvert par un tapis, retenu à chaque marche par une barre de cuivre (un de nos jeux « intelligents » consistait à retirer ces barres).
Que ce tapis fût souvent élimé n’enlevait rien, à mes yeux, au luxe qu’il pouvait représenter. J’avais honte de notre escalier nu et de ses murs peints en faux marbre dont la peinture s’écaillait.
Il était pourtant bien entretenu. Régulièrement, le neveu de la concierge, ahanant et transpirant, le grattait à la paille de fer puis l’encaustiquait à l’aide d’un gros pain de cire fixé dans une sorte de mâchoire reliée à un manche à balai.
Les appartements
Chaque appartement comportait une petite entrée sur laquelle s’ouvraient une minuscule cuisine (on dirait, aujourd’hui, une « kitchenette »), les toilettes, la salle à manger, une chambre à coucher et un réduit, sans doute destiné à servir de penderie. La salle à manger communiquait avec une troisième pièce, pompeusement appelée « bureau » où mon père entassait ses dossiers et dans laquelle, le soir, mon frère et moi déplions un divan-lit et un lit-cage, dissimulé derrière un paravent.
Les « studios » se réduisaient à une pièce avec une étroite cuisine dotée d’un simple évier.
Les appartements, s’ils avaient le privilège de posséder des toilettes (les demoiselles des studios devaient se contenter d’un « seau hygiénique » qu’elles allaient vider, avec la plus grande discrétion, dans les cabinets à la turque du sixième), ne disposaient, en matière de sanitaire, que du seul évier de la cuisine avec un robinet d’eau froide.
Dans un ouvrage sur les soldats américains de la libération, l’auteur raconte l’effroi des GI’S lorsque, priant leurs hôtes français de leur indiquer la salle de bains, ils se retrouvaient dans un réduit de ce genre et qu’ils découvraient que les toilettes, dans beaucoup d’immeubles, étaient encore des cabinets collectifs et puants situés dans l’escalier, à mi-étage.
La première initiative de mon père, épris d’hygiène, fut de transformer le cagibi en un « cabinet de toilette » (le terme de « salle de bains » eut été sans doute trop prétentieux pour qualifier cet espace où l’on avait peine à remuer.).
Avec beaucoup d’ingéniosité, il réussit à caser dans ce réduit une baignoire-sabot, un lavabo et un chauffe-eau électrique, juste capable de fournir assez d’eau pour prendre un bain de siège.
Le plombier qui réalisa cette installation, soit par ignorance, soit par incompétence, décréta que la pente était insuffisante pour permettre aux eaux usées de s’écouler jusqu’à la cuisine.
Il confectionna donc un système complexe de tuyauteries qui permettait, par dépression, de pomper les eaux usées du lavabo (sous lequel était placé un grand seau dissimulé par un rideau) et de la baignoire. En ouvrant le robinet de l’évier, la pompe aspirait lentement le contenu du seau dont il fallait surveiller fréquemment le niveau de remplissage pour éviter qu’il déborde (ce qui arrivait assez souvent).
Avec cette installation hydraulique, prendre un bain était une opération longue et fastidieuse. D’autant plus que mon père, pour gagner de la place, avait confectionné un couvercle de baignoire sur lequel s’entassaient différents produits de nettoyage et accessoires de toilette.
Lorsque nous désirions nous baigner, il fallait donc opérer un véritable déménagement, espérer qu’il restât assez d’eau chaude pour remplir une moitié de baignoire, pomper l’eau, nettoyer la baignoire à l’aide d’une pâte rose abrasive contenue dans une grande boîte ronde, le CURÉMAIL, rincer, repomper, remettre le couvercle et réintégrer le fourbi qui s’y trouvait stocké.
La salle de bains des années 50 mériterait à elle seule une analyse sociologique. Dans mon environnement, rares étaient les salles de bains telles qu’on les connaît aujourd’hui, celles dont je rêvais.
Soit la famille se lavait dans un simple lavabo ou, pire, sur l’évier. Pour effectuer les grands nettoyages, les voisins de mes parents qui n’avaient pu, avec quatre enfants, aménager une salle d’eau, se douchaient dans un tub, vaste cuvette identique à celle que nous utilisions à la campagne (cf. : La campagne). D’autres se rendaient aux bains-douches municipaux, où, pour une somme modique on vous fournissait une serviette et un savon (il en existe encore quelques-uns à Paris).
Soit, ce qu’on nommait « salle de bains » consistait en une baignoire posée dans un réduit où s’accumulaient balais, aspirateurs, produits d’entretien, etc. En général, celle-ci était alimentée par un chauffe-eau à gaz dont la mise à feu s’accompagnait d’explosions et de claquements inquiétants. Les tuyauteries gargouillaient tandis qu’un filet d’eau chaude s’écoulait lentement. Un autre système, encore plus rustique, consistait à chauffer l’eau du bain à l’aide d’une rampe à gaz placée sous la baignoire.
Il faut bien le reconnaître, jusqu’à la fin des années 50, l’hygiène corporelle, même dans des milieux évolués, n’était pas la préoccupation majeure. Pour ceux qui possédaient l’appareillage nécessaire, le bain était une pratique hebdomadaire et la douche quotidienne était considérée comme une lubie pour maniaques de la propreté. Ajoutez à cela que les déodorants n’avaient pas encore fait leur apparition et vous vous ferez une idée des odeurs que dégageait une foule dense, dans le métro, par exemple.
Dans notre appartement, chaque pièce, chaque meuble, avaient leur nom : « la chambre », « le bureau », « le cabinet de toilette ». On parlait de « la table de la salle à manger », de « la petite armoire de la chambre », de la « bonnetière » (petite armoire à une porte où les bonnetiers entreposaient leur production), du « petit buffet », de « la vitrine », du « grand buffet », etc.
Vivre à cinq dans un espace aussi confiné, d’autant plus que mes parents aimaient les meubles imposants « de style », était un excellent entraînement pour une future carrière de sous-marinier.
À l’inverse, les appartements de mes amis, rue de Lille ou rue des Saints-Pères, m’apparaissaient comme des lieux immenses où l’on pouvait s’ébattre à loisir, se cacher, organiser des parties de jeux à grand spectacle.
Toujours situés dans les étages élevés (quatrième ou cinquième), on y accédait par des escaliers imposants, recouverts d’un tapis rouge, dont on pouvait descendre les rampes à califourchon. Les pièces de réception de ces appartements, dotées de balcons, donnaient sur la rue alors que les chambres ouvraient sur de grandes cours pavées où l’on garait, jadis, les chevaux et les voitures.
Celui de Jean-Bruno Duméril, chez qui j’étais constamment fourré, s’ouvrait sur une entrée où l’on aurait pu faire tenir notre appartement. D’un côté, la salle à manger, de l’autre un vaste salon avec l’inévitable piano à queue. Donnant à l’arrière de la salle à manger, les appartements de sa grand-mère.





























