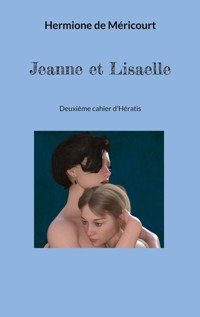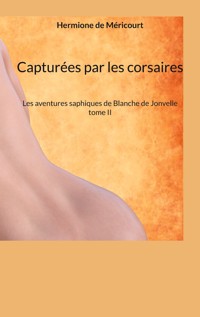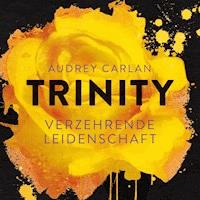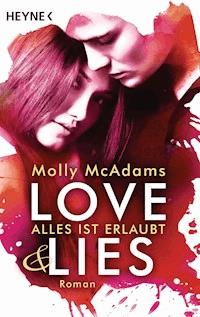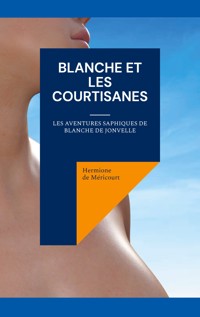
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Serie: Les aventures saphiques de Blanche
- Sprache: Französisch
Blanche quitte son couvent, à la mort de son jeune frère Philippe. De retour à Jonvelle, elle y retrouve Manon, son amie d'enfance. Manon éprouve pour elle, sans lui dire un violent désir. Mais, les parents de Blanche sont arrêtés sur ordre de Louis XIV. Blanche et Manon doivent alors entreprendre un long voyage vers Naples. Malheureusement, elles rencontrent Madame Serra et ses courtisanes. Fascinée par la beauté de Blanche, elle veut profiter de sa vulnérabilité. La jeune aristocrate parviendra-t-elle à échapper à ce destin de courtisane?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Blanche et les corsaires (à paraître)
Blanches et les concubines (à paraître)
Blanche et les amazones (à paraître)
Blanche et les Boyards (à paraître)
Le retour de Blanche (à paraître)
Hératis (à paraître)
« Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays. L’auteur ou l’éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »
Hermione de Méricourt
Hermione de Méricourt a découvert très tôt son amour des femmes et son goût pour un érotisme sensuel. Elle a écrit de nombreux récits où on la devine amoureuse de chacune de ses héroïnes. Mais cet amour n'est pas sans cruauté, Blanche, en particulier, devra supporter bien des humiliations et des douleurs avant de trouver la paix.
À Manon.
Table des matières
Chapitre 1: L'arrivée au château
Chapitre 2: Le bain
Chapitre 3: Blanche a changé
Chapitre 4: La visite du Vicomte
Chapitre 5: Marie d'Hautecroix
Chapitre 6: Le mariage impossible
Chapitre 7: Le Vicomte se venge
Chapitre 8: Blanche est courageuse
Chapitre 9: L'arrestation
Chapitre 10: Vincennes
Chapitre 11: Que faire de Blanche?
Chapitre 12: Le procès des Jonvelle
Chapitre 13: La chute du Comte
Chapitre 14: Un voyage en diligence
Chapitre 15: Manon et Blanche
Chapitre 16: La fin des espérances
Chapitre 17: Madame Serra
Chapitre 18: Compagnes de voyage
Chapitre 19: La machination
Chapitre 20: Manon est blessée
Chapitre 21: Avignon
Chapitre 22: Quitter la France
Chapitre 23: Embarquement pour Naples
Chapitre 24: L'éducation de Margot
Chapitre 25: Le plan fonctionne
Chapitre 26: Ajaccio
Chapitre 27: La soumission de Blanche
Chapitre 28: L'éducation de Blanche
Chapitre 29: Joséphine
Chapitre 30: Le triomphe de Madame
Chapitre 31: L'évasion de Blanche
Chapitre 32: Laura
Chapitre 33: La chute de Madame Serra
Chapitre 34: Margot
Chapitre 35: Margot et Blanche
Chapitre 36: Blanche de Jonvelle
épilogue: Naufragée
Préface
Les aventures saphiques de Blanche constitue le premier cycle de romans publiés par Hermione de Méricourt. Il s’agit des tribulations d’une jeune aristocrate française, au siècle de Louis XIV.
Avant-propos
Texte de l'avant-propos.
Chapitre 1: L'arrivée au château
1665 Quelque part en Méditerranée.
Blanche se blottit dans les bras d’Isabella qui l’embrasse sur le front. « Je vais te raconter mon histoire. Elle commence par mon retour au château de Jonvelle, l’ancienne demeure de mes ancêtres. Nous roulions depuis plusieurs heures, depuis que nous avions quitté le couvent de Fleurie. Les cahots de la route me réveillèrent soudain. Quelques heures plus tôt, j’avais pris congé de mes amies, des sœurs qui faisaient notre éducation, et puis, je m’étais inclinée, devant notre mère supérieure, en une révérence, pour la remercier de ses bons soins. Elle avait posé sa main sur ma tête, au-dessus de mes cheveux noirs qui descendaient en rouleaux sur mes épaules. Avec cérémonie, elle avait retiré la petite coiffe qui distinguait les pensionnaires du couvent, ensuite elle m’avait bénie avec affection. Contrairement à certaines, je ne fus pas été malheureuse au couvent. Les sœurs et mes condisciples m’y avaient toujours témoigné de l’affection. Mais, ce jour-là pour moi il était temps de partir, je devais quitter toutes celles qui m’avaient accueillie à Fleurie avec tant de gentillesse et de patience au début. Ma famille me demandait. Je devais, dans les plus brefs délais, regagner Jonvelle, la demeure de mon enfance. Tout y était en deuil, mon pauvre père et ma pauvre mère venaient d’être frappés par le destin. Philippe, mon petit frère que je n’avais pas vu grandir parce qu’il n’avait que trois ans lorsque je dus quitter le château ; Philippe que j’adorais et qui m’aimait tendrement venait de mourir. Alors depuis la veille, lorsque notre mère supérieure m’avait prise par la main avec compassion, et m’avait appris la nouvelle tragique ; je n’avais cessé de pleurer. J’avais les yeux cernés et épuisés de larmes. J’allais pleurer encore, mais désormais dans les bras de mes chers parents inconsolables eux-aussi.
Et puis, pour toute ma famille, cette mort était une catastrophe. Mon père allait devoir accepter que son frère Henri devienne son héritier. Moi, Blanche de Jonvelle, je ne pouvais pas devenir Comtesse, je ne pourrais pas lui succéder parce que je n’étais qu’une fille. On allait me marier. J’appartiendrais à ma belle famille Il fallait protéger le nom, la fortune et la propriété des Jonvelle. Quel malheur de perdre son seul fils ! Je remuais ces pensées sinistres alors que nous nous approchions du château. Le paysage devenait familier, je reconnaissais maintenant les fermes et les visages de certains parmi ceux qui me saluaient. J’inclinais la tête pour leur répondre en essayant de dessiner une sorte de sourire. Si j’étais vaniteuse, je te dirais que la plupart me regardaient avec étonnement et admiration, malgré ma tête affreuse. Je ne pouvais complètement ignorer leur contemplation muette.
J’essaye de le dire avec humilité, car je n’ai aucun mérite mais depuis que j’ai treize ans, il a bien fallu que je m’habitue à être regardée, même à l’intérieur d’un couvent. Quand je me confessais, j’avouais que parfois je trouvais plaisant ces regards. Il arrivait certains soirs d’été, lorsque la chaleur nous obligeait à déambuler en chemise que j’étais saisie par des yeux qui devinaient mes formes à travers le tissus léger. À cette époque, je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait vouloir dire mais me sentir explorée ainsi me faisait frissonner et me donnait la chair de poule. Il faut que je confesse encore que la réputation que me donnaient tous ces regards, si souvent posés sur moi, me rendait fière. J’ai souvent dû avouer ma vanité devant le prêtre. Je savais que c’était mal d’attirer sur moi des désirs auxquels je ne comptais, en aucun cas, répondre ; mais, je ne pouvais m’empêcher de le faire. On disait coquette et c’était vrai.
Avant d’arriver au château, j’ai sorti un petit miroir. Je ne voulais pas effrayer mes parents par un aspect trop affreux. Ils portaient déjà leur propre peine et n’avaient pas en surplus à supporter la mienne. J’ai inspecté mes traits fins ; le rose de ma bouche ourlée et pulpeuse, le bleu outremer de mes yeux rougis par les larmes, la courbe élégante et la finesse de mes sourcils, mon nez droit, ma peau si blanche mais qui rosissait avec tant de facilité, sans marque ni défaut à peine ornée de quelques taches de rousseur. J’ai toujours été consciente de plaire. Depuis quelque temps, je devine parfois un trouble dans les yeux de celles qui me contemplent. Être contemplée me trouble aussi parfois, à mon tour j’apprécie cette douce sensation même si je ne peux m’empêcher d’en rougir. Une activité physique régulière, sans trop me muscler a donné à mon corps de la vigueur et de la force. Ma gorge est ferme, si j’en crois les regards elle un de mes attraits principaux. Mes seins pressent doucement contre le tissus de ma robe. On me disait bien formée et très féminine, contrairement à certaines amies, comme cette pauvre Amélie qui à dix-sept ans passés était encore aussi plate qu’un garçon. Toutefois, je n’avais pas non plus cette gorge disproportionnée dont était affublée Henriette et qui lui donnait, quoiqu’elle fasse un air effronté voire indécent. Pour elles, ces « avantages » avaient l’inconvénient de lui attirer punitions et réprimandes. Trop souvent, j’ai dû la consoler à cause de la sévérité des sœurs qui l’avaient prise en grippe. Nous sommes entrés dans l’allée du château.
Alors toutes ces pensées s’évanouirent. Je revis mes parents pour la première fois après des années de séparation. Ils me semblèrent fatigués, fragiles et éplorés. En les apercevant, je fus envahie par une émotion indescriptible. La joie d’être de retour se mêlait à la tristesse de la circonstance. Je me suis blottie contre eux et nous avons pleuré encore, de chagrin et aussi du réconfort que nous donnait notre réunion. Au moins, cette tragédie me donnait l’occasion de leur montrer ma piété filiale, de passer du temps avec eux, de m’occuper d’eux, de faire mon possible pour les soutenir et les consoler.
Le château de Jonvelle est une ancienne bâtisse imposante et importante. Notre noblesse était antique, elle remontait presque au temps du roi Saint Louis. La famille Jonvelle avait su tout traverser : la peste noire, la guerre de cent ans et Crécy et Azincourt, et puis nous avions encore survécu sans trop de dommages aux troubles religieux du siècle passé. Nous appartenions à cette vieille noblesse d’épée que le jeune Roi Louis le Quatorzième jalousait parce qu’elle ne dépendait pas de lui et qu’il ne la contrôlait pas complètement. Il nous détestait parce que nous n’avions pas voulu nous humilier ou devenir courtisans. La tour de notre château, le donjon symbolisait cette résistance opiniâtre. Nous avions réussi à la conserver malgré Richelieu, malgré Mazarin et malgré encore ce jeune monarque qui lui aussi souhaitait l’abattre et nous abattre. Nos murs épais, nos tours, nos créneaux pouvaient encore protéger nos gens contre toute folie tyrannique. Certains le trouvaient gothique, ce vieux château de Jonvelle ; moi j’en étais fière. Il témoignait de temps héroïques et de toute cette grandeur que nous avions fait l’effort de conserver. Il avait survécu avec ses murs de pierre couverts de lierre, entouré de son grand parc. Il trônait au milieu de chênes tricentenaires sous lesquels nos aïeux rendaient la justice. La nature se pliait à nos caprices. Toutes les pelouses étaient taillées, bien vertes et elles dessinaient des formes géométriques jusqu’à l’étang et son eau toujours pure. J’entrais dans la grande cour. Le gravier faisait crisser les roues de la voiture. J’étais saluée par les deux grands lions de marbres, emblèmes de notre famille depuis les croisades.
En descendant du carrosse, la première personne que je vis fut ma si chère Manon qui semblait m’attendre avec impatience. Elle s’était, comme moi, transformée en jeune femme. Manon était devenue belle et forte. Je lui avais toujours envié la blondeur de ses cheveux. Elle aurait voulu être aussi brune que moi. Elle n’osait pas encore me sauter dans les bras. Je lui fit signe et enfin, je pus la serrer fort contre mon cœur. Je lui murmurai une invitation à passer me voir dans ma chambre dès que possible. Nous irions marcher toutes les deux dans le parc jusqu’au petit lac. Ensuite, je montai les quelques marches du porche. Deux domestiques en livrées avaient poussé la lourde porte en bois. Ils essayaient bien de garder un air distant et formel ; mais leurs sourires radieux trahissaient leur émotion. Si l’étiquette ne me l’avait pas interdit ; je me serais probablement jetée à leur cou. Ils me connaissaient depuis l’enfance. Je crois même que l’un d’entre eux, le plus âgé, Fernand avait une petite larme dans l’œil. Mais il fallait bien que je prouve que ce n’était pas en vain qu’on m’avait envoyée au couvent. Alors, cette fois, j’ai tenu mon rôle de demoiselle, gardé mes distances et répondu à leurs sourires émus par un simple hochement de tête.
L’intérieur du château fascinait tout comme l’extérieur par sa majesté imposante ; mais contrairement à l’extérieur, il était chaleureux et accueillant. Mes parents l’avaient beaucoup transformé. La vieille bâtisse glaciale était devenue une habitation commode et douce pour notre famille. Dans l’entrée immense, on avait installé un carrelage en damier noir et blanc. On avait habillé les murs de pierre de grandes tapisseries. Mes parents avaient, sur ce point, cédé à la mode en les commandant à la manufacture royale. Au centre descendait un lustre majestueux capable de refléter le jour, la lumière solaire et la nuit, de briller de son propre incendie ; après, il faut le reconnaître de longues opérations pour allumer chacune de ses cent dix bougies. Au fond, le grand escalier en marbre menait à l’étage supérieur. Enfin, de chaque côté, on apercevait depuis l’entrée les deux salons principaux : le rouge et le bleu. Le salon rouge était inspiré de l’orient. Les fauteuils étaient sculptés en bois de palissandre. Ils avaient sa couleur pourpre. Le salon était orné de porcelaines importées de Chine. Le rouge était aussi la couleur dominante du grand tapis et des tapisseries disposées sur ses murs.
En face, il y a le salon bleu. Ses meubles ont été assemblés dans l’ébène le plus précieux. Des miroirs somptueux se faisaient face et se reflétaient à l’infini. Derrière, le salon rouge, on entrevoyait l’immense salle à manger où se trouvait une table en chêne massif capable d’accueillir une trentaine de convives. Derrière le salon bleu, on découvrait ma pièce préférée : la bibliothèque. Ce véritable trésor avait été accumulé peu à peu. On y trouvait d’antiques manuscrits enluminés, des incunables mais aussi des livres modernes ; parmi eux, il y avait les écrits de Monsieur Corneille et pardessus tout Le Cid qui faisait tant battre mon cœur.
Mes parents m’attendaient dans l’entrée. Je regardais Papa. Derrière son apparente froideur qui n’était que de la dignité ; derrière ses mots toujours brefs parfois un peu brusques et maladroits ; je devinais son bonheur de me retrouver ainsi que l’océan de tristesse dans lequel il était piégé depuis la mort de Philippe. Ce jour-là, il m’embrassa contre lui comme il ne l’avait jamais fait auparavant. C’était un père très aimant, mais en général peu démonstratif, sans doute parce que c’était l’usage et qu’il avait été éduqué ainsi. Épuisé de chagrin, il contrôlait moins bien les mouvements de son cœur. Je crois même avoir entrevu ce jour-là un peu d’humidité orner ses yeux, contrastant avec son visage plein d’autorité et de force. Le malheur l’avait écrasé mais il était resté ferme. Ses lèvres fines étaient prêtes à lancer des ordres sans réplique. Le Comte de Jonvelle était un homme fier, orgueilleux, conscient de ce qu’il devait à ses ancêtres. Je l’avais toujours tant admiré. Il n’était pas impitoyable ; chaque habitant du château et de ses possessions aurait gaiement donné sa vie pour lui. Seul un homme bienveillant et généreux peut s’attacher de telles fidélités. Ma mère qui se tenait à ses côtés, m’embrassa à son tour. C’était une personne solaire, même si désormais son éclat serait obscurci par le drame qu’elle venait de vivre, même si ses yeux pervenche étaient pour longtemps encore inondés par les larmes qu’elle avait versées et devait verser encore. Son visage, son maintien, tout en elle émerveillait et charmait. La beauté de ma mère était angélique ; j’avais toujours maudit le sort qui m’avais privée de l’or de ses cheveux. Certains prenaient à tort cette blondeur et cette douceur pour de la fragilité ; alors que personne n’aurait osé la défier, encore moins en présence du Comte, mon père qui ne tolérait pas qu’on lui manque de respect. Il l’aimait comme lui seul savait aimer, passionnément.
Chapitre 2: Le bain
Je montais dans ma chambre, après avoir accepté une collation. La chambre était aussi confortable bien qu’un peu moins spacieuse que dans mes souvenirs. Peu avant ma naissance, on avait fait poser un parquet en bois sur le sol. Il était régulièrement et soigneusement ciré par nos domestiques et protégeait bien l’endroit du froid hivernal. Elle contenait peu de meubles, mais ils étaient choisis avec goût : une jolie armoire, un grand miroir, un bureau de chêne recouvert de velours bleu sur lequel il y avait un petit écritoire et une plume d’oie. Au fond de ma chambre, on avait disposé une commode sur laquelle une bassine de cuivre permettait que je me rafraîchisse. Enfin deux fauteuils de cuir bien rembourrés et un petit lit à baldaquin complétaient mon mobilier. La pièce était lumineuse, bien éclairée par une fenêtre protégée par de lourds rideaux bleus. Le matin, la lumière du soleil levant inondait ma chambre et venait la réchauffer. Pour le soir, on allumait un feu dans une petite cheminée. Le sol était couvert par un tapis importé d’orient dont, petite, je scrutais pendant des heures les représentations, tellement elles me fascinaient. Je les regardais autrefois et les imaginait prendre vie et danser sur le sol de ma chambre. On avait aussi tapissé les murs de couleurs claires dont les motifs élégants s’entrecroisaient.
Je me regardai dans le grand miroir. J’étais libre de le faire sans craindre aucune reproche. Au couvent, j’avais souvent peur d’être surprise dans ce plaisir coupable. Ici, je jouais, je prenais des poses, je dégrafais mon col. Après plusieurs poses, j’ai eu une idée un peu folle. J’ai plus amplement ouvert ma robe et déboutonné ma chemise. Je pouvais presque deviner les pointes érigées de mes seins. Quelle impudence ! Cela me fit frissonner. Très vite, je me rhabillai honteuse, c’était mal. Une fois encore, je m’étais montrée arrogante. Je me jetai sur mon lit. Étendue là, je me suis laissée aller et bientôt je somnolais. Au bout de quelques minutes, j’entendis quelques coups timides frappés à ma porte. Ma chère Manon, mon amie de toujours était là. Nous restâmes embrassées pleurant l’une contre l’autre la mort de notre petit Philippe. Ensuite, nous essuyâmes nos larmes. Manon avait mon âge, nous avions grandi ensemble et tout partagé depuis l’enfance. Quatre années de séparation n’avaient rien changé pour moi. Ma Manon remplaçait la sœur dont le destin m’avait privée. Elle m’avait apporté quelques vêtements plus rustiques pour notre promenade dans le parc ; mais j’avais une nouvelle chemise très jolie et brodée que je voulais porter. Je lui demandai de se tourner, ce qu’elle fit en riant, et en faisant mine de se retourner brusquement pour me surprendre. Je me dépêchais de passer mes habits : jupe, chemise et une petite gourgandine. Je prenais toujours un grand soin de mes vêtements. Manon était moins préoccupée de son apparence ; elle était vigoureuse et en bonne santé, cela lui suffisait. Dans nos jeux de l’enfance, elle tenait toujours le rôle de mon mari ou bien du chevalier voué à ma protection et à mon service. Moi, j’étais la dame de ses pensées, elle me regardait avec adoration et me traitait avec courtoisie. Pleine d’entrain et d’énergie, elle aimait à se coiffer d’une simple queue de cheval. Elle avait des épaules plus large que les miennes, sa poitrine plus opulente que la mienne emplissait la chemise simple qu’elle portait. Ses yeux étaient verts et pétillants, son regard vif dévoilait toute son intelligence, sa sensibilité et l’attention qu’elle me réservait. Elle riait à tout propos. Manon était courageuse jusqu’à l’intrépidité. Sous son influence, je m’étais laissée convaincre, malgré mes premières réticences d’apprendre à grimper aux arbres, à en sauter sans peur et sans dommages et même à nager.
Tout cela ne s’était pas fait sans quelques égratignures et quelques pleurs ; mais mon père aimait Manon et appréciait cette influence. Il pensait que la force et l’exercice n’étaient jamais inutiles même pour une jeune fille. Alors nos jeux purent continuer car personne n’aurait osé le contredire. Ensemble, nous avons appris à monter. Au bout de quelques années, nous étions toutes les deux devenues des cavalières émérites. Nos courses passionnaient les habitants du château. Je perdais souvent parce que, pour ne pas m’abîmer, il fallait que je monte en amazone alors que Manon faisait ce qu’elle voulait. Je dois dire, à ma grande fierté que je l’ai quelquefois battue. À l’épée, en revanche, on avait disposé les choses pour que toujours je l’emporte. Voyant notre intérêt pour cette arme, mon père n’aurait pas supporté que je risque d’être défaite par la fille de son intendant. Donc, il fit venir, pour moi seule, un maître d’armes. Le procédé n’était pas vraiment équitable, mais il fallait l’accepter, il était le Comte. Comme j’étais assez déliée, à douze ans je pouvais me battre très correctement, et selon Papa, me défendre en cas de problème. Hélas, un jour ces jeux avait cessé. Comme toutes les jeunes filles, il avait fallu quitter mes parents et le château de Jonvelle, théâtre adoré de mes jeux, ma place dans le monde était à ce prix. Quand je repense aux larmes versées par Manon ce jour-là, et puis aux miennes ; j’ai encore un serrement de cœur. J’avais le sentiment de la trahir, de l’abandonner. Après quatre années au couvent, je m’étais sans doute affaiblie, j’avais certainement beaucoup oublié. Placée au couvent pour acquérir les « qualités féminines », j’avais dû abandonner l’escrime et l’équitation. Mon programme était de devenir jolie, gentille et douce. J’ai fait de mon mieux.
Nous sommes sorties bras dessus, bras dessous en bavardant comme si nous ne nous étions jamais quittées. Ensuite, nous avons couru et c’est hors-d’haleine que nous nous sommes arrêtées juste devant le petit lac qui était au fond du parc. Sans l’ombre d’un doute, Manon se déshabilla et se jeta à l’eau comme autrefois. Puis, elle me fit signe de venir la rejoindre. J’hésitais un peu parce que je n’avais pas nagé depuis très longtemps et surtout, je me demandais si devenue femme, c’était acceptable de se laisser ainsi aller. Finalement, défiée par Manon, je délaçai ma gourgandine, retirai ma jupe et j’osai rejoindre Manon. J’avais été sotte d’hésiter l’eau était délicieuse et je savais encore nager. Il fallut enfin sortir de l’eau pour se sécher. C’était gênant, nos chemises collées à notre peau par l’humidité ne cachaient plus rien de nos formes. Je rougis parce que la mienne qui n’était pas conçue pour le bain, était devenue très transparente. J’étais exposée aux regards de Manon qui ne pouvait se détacher des pointes de mes seins, érigées par l’eau fraîche. Nous étions toutes les deux embarrassées. Ma pauvre Manon, troublée par cette vision ne parvenait pas à cacher son émoi. Elle rougissait plus que moi encore. Elle saisit mes mains de ses mains tremblantes, m’approcha tout contre elle comme si elle voulait m’embrasser. Tout mon corps désirait ce contact, mais il ne fallait pas. Après une seconde de sidération, je me libérai d’elle avec un rire un peu forcé dans lequel elle pouvait deviner tout mon désarroi. Dans un mouvement pudique, je recouvris mes parties. Je lui dis ensuite qu’elle était bien folle. Ensuite, un peu troublées encore ; nous nous sommes laissées sécher en silence. Heureusement, sur le chemin du retour au château, nous avions pu reprendre nos bavardages et oublier cet incident. Dans mon malheur, il y avait une consolation. J’avais retrouvé Manon.
Chapitre 3: Blanche a changé
Manon
Enfin, un matin sinistre on annonça la mort du petit Philippe de Jonvelle, l’héritier du Comte. Chacun au château prit le deuil. Le Comte n’eut pas besoin de le demander parce que tout le monde adulait Philippe. C’était l’héritier, le petit prince et il était adorable. À cause de la chaleur estivale, il a fallu l’enterrer sans même attendre le retour de sa sœur. Le Comte et la Comtesse se noyaient dans leur chagrin. Pauvre petit ange martyrisé par la maladie ! Manon s’était aussi habillée de noir, elle avait appris de la bouche même du Comte qu’on avait dépêché un courrier pour arracher Blanche au couvent où elle était depuis quatre longues années. Pour Manon, c’était la seule nouvelle capable d’atténuer l’atmosphère de désolation qui régnait au château. Elle s’inquiétait de savoir si Blanche et elle pourraient rester aussi proches et amies que du temps de leur enfance ; si dans son couvent elle n’avait pas appris à mépriser les roturières et si elles partageraient encore des jeux et des éclats de rires comme autrefois quand, ensemble, elles avaient appris à nager, à grimper aux arbres et parfois même à se battre.
Quand Blanche avait dû quitter le château de Jonvelle, elles n’étaient toutes deux que des gamines insouciantes. Celle qui allait revenir était, désormais, une demoiselle éduquée et prête à être épousée. Elle aurait changé en fréquentant d’autres demoiselles, d’autres jeunes femmes aussi nobles qu’elle qui, plus tard deviendraient ses amies. Manon devait se préparer à ces changements, ne pas trop attendre de ces retrouvailles. Seulement, elle ne pouvait pas sans empêcher. Elle espérait de toutes ses forces que son caractère d’autrefois n’avait pas complètement disparu. La veille du retour, elle était tour à tour anxieuse, excitée, heureuse, triste. Elle venait d’apprendre par son père, l’intendant du Comte que Blanche arrivait. Elle tournait en rond, s’agitait en tous sens, incapable d’une activité suivie. Les heures étaient interminables. Manon se demandait comment, le soir, elle parviendrait à trouver le sommeil. Elle trouva un moyen de s’occuper : vérifier la chambre de Blanche. Il fallait l’aérer, disposer un bouquet, faire le ménage qui n’était jamais assez bien fait, donc le refaire et puis vérifier et revérifier que tout était impeccable. Elle réussit à s’épuiser et parvint à s’endormir le cœur battant.
Le lendemain, elle sursautait à chaque bruit. Enfin, elle entendit le crissement des roues du carrosse dans le gravier de l’allée principale. Son cœur bondissait de joie. La porte du carrosse s’est ouverte. Blanche en descendit. Elle portait encore sa tenue d’écolière qui se composait d’une robe très sage, fermée par un petit col blanc, et d’une coiffe qui lui donnait l’aspect d’une nonne. Manon ne pouvait s’empêcher de sourire éblouie par l’apparence nouvelle de son amie, tellement celle-ci était devenue gracieuse et féminine. Quand Blanche tourna la tête vers elle, Manon revit avec plaisir cet air espiègle qui était vraiment celui de son ancienne complice. Alors, tous ses doutes et ses appréhensions s’envolèrent d’un coup. Tout serait comme avant. Blanche lui offrit un sourire radieux, lui fit signe de s’approcher et l’embrassa avec chaleur. Après ces retrouvailles si chaleureuses, Manon restait un peu perdue, sur son nuage et détachée du monde. Elle espérait recouvrer ses esprits, alors elle s’aspergea d’eau fraîche comme quelqu’un qui voudrait sortir d’un songe.
Un peu plus tard, obéissant à Blanche ; Manon vint avec timidité frapper à sa porte. Elle avait décidé de l’emmener jusqu’au lac. En marchant, elles bavardaient comme si elles ne s’étaient jamais quittées. Devant le plan d’eau, Manon retira sa robe et se jeta à l’eau. Elle nagea quelques brasses puis avec de grand gestes fit signe à Blanche de venir la rejoindre. Elle avait peu d’espoir, elle se disait que devenue une demoiselle comme il faut, Blanche refuserait sans doute. Peut-être même qu’elle ne savait plus nager ou bien que cela l’effrayerait maintenant. Mais pour tout cela, elle avait voulu la mettre au défi. Blanche hésita un moment et puis sa fierté l’emporta sur sa gêne. Il n’était pas question de fuir, les Jonvelle affrontaient tous leurs adversaires. Alors souple et agile, elle retira sa jupe et sa gourgandine et plongea, en chemise pour nager avec Manon. Elles firent la course jusqu’à l’autre rive. Manon gagna de peu
Quand elles se décidèrent à sortir de l’eau, Manon ne pouvait plus cacher son trouble. Elle fixait Blanche en rougissant. La jeune aristocrate, par une coquetterie qui était chez elle un défaut habituel, avait absolument souhaité porter une jolie chemise brodée qu’elle venait d’acquérir ; mais après le bain, ce tissus fin et délicat était devenu transparent et il ne cachait plus rien de son corps magnifique et sensuel. Alors Manon éprouva pour la première fois un désir intense pour son amie. Cela la bouleversa, c’était un désir nouveau très différent de ce qu’elle ressentait pour les garçons auxquels elle cédait. Elle avait l’impulsion de se jeter sur Blanche, de la prendre, d’embrasser chaque parcelle de son corps, de la faire gémir comme elle-même gémissait lorsque ses conquêtes la prenaient vulnérable et frémissante. Manon ne parvint pas à réprimer le mouvement qui l’entraînait vers elle. Le temps s’arrêta. Manon se demandait si Blanche allait l’embrasser ou la chasser pour toujours ; mais heureusement la demoiselle parvint à cacher son trouble derrière un rire forcé. Elle dit simplement « tu es folle ». Ensuite, le silence s’installa. Les deux amies se laissèrent sécher sans un mot, et sans un regard. La conversation ne reprit et ne s’anima que sur le chemin du retour.
Ce soir-là, Manon se retrouvait seule enfin dans sa petite chambre ; mais elle ressentait toujours ce désir qui la troublait. Jusqu’ici, elle se voyait comme une femme un peu trop sensuelle sans doute mais dont les désirs étaient ordinaires, elle était attirée par les hommes et les séduisait parfois. Jamais aucune autre femme n’avait ainsi capté son regard. Malgré sa jeunesse, elle était plutôt libérée et elle s’était déjà donnée à quelques amants. Elle avait apprécié ces étreintes. Elle était jolie et courtisée, elle aimait céder à de jeunes hommes valeureux qu’elle préférait forts et sûrs d’eux. Entre leurs bras musclés, elle avait pris goût aux plaisirs de l’amour. Jamais, jusqu’à ce bain avec Blanche, la beauté d’une femme ne l’avait tant émue, n’avait provoqué en elle cette chaleur, ce désir presque irrépressible. La peau de Blanche l’avait émue jusqu’au fond de l’âme ! Sa peau si claire paraissait tellement douce, sensible, Manon revoyait Blanche frissonnant au contact de l’eau. Elle attirait Manon comme un aimant attire le fer. Manon avait eu envie de la prendre, tremblante, de la faire gémir et de voir si dans le plaisir le plus violent, elle aurait encore gardé cette lumière, cette fragilité et cette innocence qui la rendaient folle. Manon tournait et se retournait dans son lit, incapable de chasser cette pensée. Au cœur de la nuit, elle s’est réveillée fiévreuse et la bouche sèche. Elle avait rêvé de son amie :
« Je serrais Blanche contre un mur, je l’embrassais. La jeune femme ne me résistait pas. J’ouvris son corset et j’embrassai sa poitrine durcie. J’en en avais gardé depuis le bain, le souvenir de sa forme parfaite. Je la massai avec tendresse. Les pointes se gonflaient peu à peu, devenant plus dures et plus sensibles. Blanche se mordait les lèvres. Elle se livrait peu à peu. Son corps s’offrait, réagissait à mes baisers sensuels. Mes mains qui couraient sur sa peau nue la faisaient frissonner. D’autorité, je la pris par la main et l’entraînai sur le lit. Je chevauchais la jeune aristocrate allongée sur le dos, offerte. Je me penchai pour embrasser mon amie avec sensualité, langueur tout en jouant avec un de ses tétons durcis. Maintenant Blanche soupirait, essayant vainement de reprendre son souffle. Elle sentait contre sa peau, la chaleur de mes caresses. Une main explorait son visage, son cou, la naissance de ses seins ; des lèvres je lui murmurais combien elle était belle. Je continuais à masser sa poitrine, sucer les pointes durcies, les tirer doucement. Blanche fermait les yeux, ses soupirs devenaient à chaque caresse, plus profonds. Mes lèvres descendaient le long de son ventre, s’approchaient peu à peu du centre de son désir. C’est là que je l’embrassai par-dessus la jupe d’abord. Quelques instants, je jouais avec cet obstacle voilant et dévoilant sa nudité ; l’embrassant à chaque fois. Puis d’un seul coup, j’arrachai la jupe, le dernier rempart de sa pudeur. Puis avec douceur, je déposai un premier baiser au creux de son intimité. La fille du Comte gémit de toute son âme, elle n’eut pas la force de retenir ce premier cri de plaisir. Je la goûtai, je la trouvai humide et prête, entièrement offerte à mes baisers. Blanche a encore gémi quand elle sentit contre sa fente tremblante de désir, la caresse délicate de ma langue qui l’ouvrait avec délicatesse. Elle serrait la couverture dans ses poings. Maintenant, elle ne pouvait plus se contenir, elle gémissait encore et encore alors que je m’insinuais toujours plus loin au cœur de son désir. Je buvais sa rosée délicieuse. Les gémissements de Blanche devenaient des cris. Son ventre tremblait. Déjà, elle était sur le point de jouir complètement offerte, à la merci de mes caresses indécentes. Je m’arrêtai et lui murmurai à quel point j’aimais la boire. Blanche rougit, ayant un peu honte de ce corps qui s’offrait tant pour la trahir.
J’approchai mon visage du sien. Dans notre baiser tendre, je souhaitais que la fille du Comte découvre son propre goût sur mes lèvres, trempées de son désir. Je me suis allongée contre elle puis je la pris avec mes propres doigts, tout en jouant encore avec son téton si dur et sensible. Blanche suffoquait emportée par un désir qui ne cessait pas de s’intensifier. De nouveau, son corps réclamait la jouissance. Je décidais de la faire encore un peu attendre. Je me déshabillais doucement Blanche gémissait de frustration. Alors d’autorité, j’ai retourné la fille du Comte sur le ventre, la tête dans les couvertures auxquelles elle agrippait désespéramment, les fesses levées pour être mieux prises. Alors, j’ai pris complètement possession d’elle. Blanche hurlait contre son oreiller. Elle avait perdu tout contrôle d’elle-même. Alors, enfin, elle explosa dans un bouquet de cris, de spasmes qui la secouaient. Je la suivis ressentant elle-même ce plaisir violent et sauvage. » Manon se réveilla, constatant qu’elle venait de jouir, son corps était encore humide du plaisir qu’elle venait de prendre. Elle eut du mal à se rendormir, un peu honteuse mais enfin satisfaite.
Le lendemain, Manon était inquiète. Elle avait déjà rencontré des filles qui étaient plus attirées par les autres filles ; qui se comportaient un peu comme des garçons. Elle avait trouvé cela étrange et assez inconvenant. Pour rien au monde, elle n’aurait voulu devenir l’une d’entre elles. Cela l’angoissait maintenant. Alors, très tôt elle partit retrouver Célestin qui était, au château, celui qu’elle préférait. C’était le fils du meunier, un homme bien bâti, grand et fort, très musclé. Célestin avait une figure virile mais avenante. Il lui plaisait tellement qu’elle avait déjà eu une aventure avec lui. Rien n’était terminé, mais ils ne formaient pas un couple. Manon se sentait vulnérable dans ses bras et appréciait par-dessus tout, sa manière de la couver du regard comme si elle lui appartenait. En rougissant, elle lui murmura de venir la retrouver dans le cellier qui était toujours vide à cette heure-là. Comme toujours, Célestin était content de venir. Manon, dès qu’il a commencé à l’embrasser, a senti réagir son corps, ses seins durcir, son intimité devenir humide. Elle était rassurée et contente, alors elle s’est donnée à lui plus qu’elle ne l’avait jamais fait. Elle se laissait prendre complètement, le laissa venir en elle malgré les risques ; elle le prit dans sa bouche ensuite jusqu’à ce qu’il durcisse encore et enfin, quand elle senti qu’il allait venir encore, elle le plaça entre ses globes, les serra, le caressa jusqu’à ce qu’il l’éclabousse. Ils se séparèrent en riant, il fallait maintenant que Manon se change. Célestin avait des étoiles dans les yeux et Manon était heureuse. Ce qu’elle avait ressenti pour Blanche était exceptionnel et elle n’avait pas changé de goûts. Elle restait femme au plein sens du terme. Elle n’aimait pas les femmes mais elle aimait les hommes et Blanche. Avec cela, elle pourrait vivre. De toute manières, son amour pour Blanche était interdit et impossible ; et puis, selon toute apparence, Blanche ne le partageait pas. L’incident était clos.
Chapitre 4: La visite du Vicomte
Journal de Blanche
Quelques semaines passèrent paisiblement. Au château, la vie semblait reprendre son cours et l’atmosphère était moins tragique. Je faisais tout mon possible pour réconforter mes parents, par de menus services je tentais de leur rendre la vie plus douce. Dans mon temps libre, je continuais à courir de ci, de là ; accompagnée de Manon. Je passais aussi beaucoup de temps dans la bibliothèque. Un jour, je remarquai sur une étagère un ouvrage qui parlait des méfaits de la piraterie, en Méditerranée. Les corsaires barbaresques terrorisaient les mers par leur cruauté. Leur présence faisait de chaque traversée, une aventure périlleuse. Ils capturaient des esclaves dans les villages de la côte ou bien sur les navires qu’ils arraisonnaient. Ils les emmenaient ensuite à Alger, ou à Tripoli où ils étaient vendus sur les marchés, comme du bétail. Une gravure illustrait ce chapitre. Elle représentait une jeune femme entièrement déshabillée, et montrée à une foule d’acheteurs. Sa beauté et la triste situation dans laquelle elle se trouvait me faisaient frissonner. La jeune femme se cachait le visage pour ne pas donner aussi sa honte en spectacle. Oh mon Dieu, je ne pus m’empêcher de m’imaginer à sa place. Déjà, le regard de Manon sur ma peau frissonnante m’avait bouleversée ; que serait-ce d’être détaillée, offert à des dizaines de paires d’yeux, brûlants de désir ? Une telle humiliation me faisait froid dans le dos mais me donnait des papillons dans le ventre. Je questionnais mon père. Il me répondait avec patience. Il m’expliqua que chaque année plusieurs centaines d’Européens étaient vendus comme esclaves en Orient. Les moins chanceux devenaient galériens sur les navires barbaresques. Leur seule consolation était la brièveté de cette misérable existence, les privations et les brimades avaient raison d’eux en quelques années seulement. Sur le sort des femmes, il ne m’en dit guère plus et je ne le questionnai pas plus avant ; je ne voulais pas avouer que c’était ce point qui avait piqué ma curiosité et réveillé mon désir.
Quelques jours après, ma mère m’annonça la venue du Vicomte de Fébranges, le frère cadet de Papa. Le Vicomte, comme tous les cadets, avait été privé de l’héritage familial. Alors, il s’était engagé dans un régiment de dragons. Mon père avait financé pour lui, l’achat d’un grade de Capitaine. Il l’en avait à peine remercié tellement il gardait au fond de lui de ressentiment. La guerre terminée, il était devenu courtisan et passait le plus clair de son temps, à la cour du jeune roi, surtout depuis que Louis XIV avait décidé de gouverner seul. Il tentait assez vainement d’obtenir ses bonnes grâces. Maman m’avait expliqué que cette manière de vivre était très dispendieuse ; mon oncle réclamait régulièrement les fonds dont il avait besoin afin de poursuivre son entreprise. C’était en général le grand motif de ses visites. Il quémandait de quoi survivre à la Cour. Comme sa présence dispensait mon père de se montrer au Louvre ; il acceptait de payer ce qu’il fallait.
Je ne doutais pas que ce serait une fois encore l’objet de sa visite. Nous l’attendions pour déjeuner et la grande table avait été dressée en son honneur, pourvue des plats succulents que nous avions l’habitude de servir à nos invités. Mes parents le recevaient toujours avec grâce et magnificence, ce qui semblait le laisser indifférent. Une fois encore, il arriva fort mécontent. Cette fois, il en avait contre Papa. Je crois qu’il s’était disputé avec lui, quelques jours auparavant. Tout de même, après quelques mots d’explication et de repentance, le repas a pu commencer. Mais l’oncle, sans façons, reprit le sujet de leur dispute. Il voulait faire comprendre ses idées sur la situation nouvelle créée par la mort de Philippe. Il y venait après un délai de décence, mais enfin il y venait. La succession lui paraissait complexe. Si Papa venait à mourir, il hériterait du titre de Comte mais pas de la fortune et de château qui me reviendraient. J’en étais fort surprise car je l’apprenais de sa bouche. C’était la volonté de mon père qui avait rétabli les finances de la famille grâce à ses efforts et à ses sacrifices et exigeait que le fruit de son travail me revienne. Le Vicomte s’énervait, il était outré. Il affirmait qu’un Comte de Jonvelle ne pourrait vivre qu’à Jonvelle. Cela lui semblait naturel. On pensait me marier, cela aurait pour conséquence de livrer le domaine à une autre famille. Voilà pourquoi, il proposait pour le bien de ma famille que je sois généreusement dotée, afin de prendre le voile dans l’institution de mon choix. Ainsi, Jonvelle appartiendrait toujours