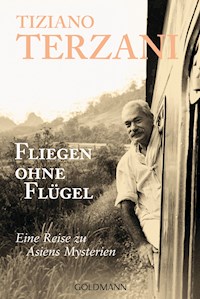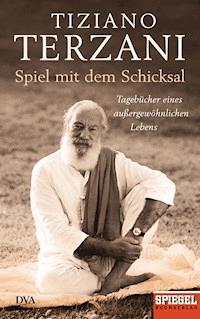Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En août 1991, Tiziano Terzani navigue sur le fleuve Amour lorsqu’il apprend qu’un coup d’État vient de renverser Gorbatchev. Il se lance aussitôt dans un long périple qui le mène pendant plus de deux mois à travers la Sibérie, l’Asie centrale et le Caucase jusqu’à Moscou, capitale de ce qui est en train de devenir la nouvelle Russie. Chemin faisant, Terzani compose l’oraison funèbre du communisme soviétique et un récit de voyage inoubliable.
L’auteur analyse les contradictions du communisme, mais aussi celles du capitalisme sauvage qui le remplace. De Samarcande à Boukhara, de Bichkek à Erevan et jusqu’aux confins du Birobidjan, Terzani observe le réveil des nationalismes et de l’islamisme sur les cendres encore chaudes du colonialisme soviétique. Trente ans après, cet ouvrage constitue une immersion fascinante pour comprendre le passé et peut-être surtout entrevoir l’avenir géopolitique de ce territoire qu’on appelait autrefois l’URSS.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Tiziano Terzani est une légende du grand reportage. Correspondant en Asie du Spiegel pendant près de 30 ans, il a été témoin de la chute de Saïgon, du génocide khmer et de la Chine maoïste.
Bonne nuit, Monsieur Lénine prouve une fois encore son talent de visionnaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
bonne nuit, monsieur lénine
TIZIANO TERZANI
Bonne nuit, monsieur Lénine
Voyage à travers la fin de l’empire soviétique
Traduit de l’italien par
Marta de Tena
ÉDITIONS INTERVALLES
À la mémoire de mon père, qui rêvait
1
Un voyage inattendu
Comme il arrive souvent avec les plus belles aventures de la vie, ce voyage a commencé, lui aussi, par hasard. En février 1991, j’avais réussi à obtenir un visa pour me rendre aux Kouriles, ces îles du bout du monde, la dernière frontière de l’empire soviétique, les « Territoires du Nord » comme on les appelle au Japon qui s’obstine à les revendiquer comme siennes. J’avais passé près d’un mois sur ces îles perdues enveloppées de mystérieux bancs de brouillard éternels, au milieu de l’océan Pacifique, fasciné par une nature incroyable et sauvage, faite de montagnes glacées et de lacs bouillonnants, plongé dans le destin de cette extraordinaire race d’hommes et de femmes installés là-bas, en provenance de Russie pour la plupart, avec l’idée d’y construire un avant-poste du socialisme et qui maintenant, déboussolés par la fin de ce rêve, livrés à eux-mêmes, se retrouvaient face à leurs vies gaspillées, sans plus de patrie où retourner, sans plus d’histoire dont se vanter, mais avec sur la peau les traces de tous ces sacrifices et épreuves dont plus personne ne leur serait reconnaissant.
Les Kouriles, à l’instar du long séjour un an plus tôt sur l’île de Sakhaline, que j’avais effectué cette fois à dessein pour le centenaire de la visite de Tchekhov, m’avaient mis face à cette expérience humaine qui, depuis des années, à différents endroits de l’Asie, venait m’interpeller : l’échec du socialisme, vu à travers les yeux de ceux qui y croyaient ou de ceux qui en étaient les victimes : les uns et les autres désormais égaux dans les décombres de ce désastre, la misère commune en partage.
« La Sibérie. La Sibérie. Là, vous y verrez des vies gâchées », me disait un jeune journaliste du Komsomolskaïa Pravda de Moscou rencontré par hasard à Kounachir, l’une des quatre îles soviétiques que les Japonais revendiquent. C’est alors qu’est née l’idée d’un voyage, de quelque chose de spécial à faire ensemble en Sibérie. Au bout de quelques mois, j’ai reçu cette proposition : participer à une expédition le long de l’Amour, le grand fleuve sibérien qui marque la limite entre l’Union soviétique et la Chine ; de la source à l’embouchure, quelque 4 350 kilomètres le long de l’une des plus longues frontières du monde, des plus sensibles, des plus reculées. Un voyage sur l’eau avec des haltes sur les deux rives. Les autres membres de l’expédition : trois journalistes soviétiques et trois journalistes venus de Pékin. Ce n’était pas exactement ce que je recherchais, mais l’idée de traverser ces régions à la renommée romantique lorsque l’Amour, au début du siècle, était la route la plus directe entre le Japon et la Russie, l’idée d’être l’un des premiers étrangers à redécouvrir des régions qui, à cause de la victoire communiste en Chine en 1949 et plus encore de la dispute sino-soviétique des années 1960, avaient été fermées aux visiteurs pendant des décennies, cette idée-là m’attirait. De toute façon, l’expédition me donnait une bonne raison de repartir en voyage, de retrouver cette joie unique que seuls les drogués des départs comprennent, ce sentiment de liberté qui monte lorsqu’on arrive dans des endroits où l’on ne connaît personne, dont on n’a entendu parler que dans les livres, ce plaisir inégalé d’essayer de connaître de première main et de comprendre.
Ainsi, début août, de Bangkok où je vis maintenant, j’ai mis le cap vers le nord, emportant juste ce tout petit bagage avec lequel – comme je l’ai découvert – je peux travailler partout : un sac sur l’épaule avec mon « bureau », un ordinateur, une imprimante, mon vieux Leica M2 acheté à Saïgon en avril 1975 à un voleur qui se sauvait après l’avoir volé à un Américain qui fuyait, et une sacoche avec un change de vêtements et les baskets pour les quatre ou cinq kilomètres que je cours juste pour entretenir mon souffle, vu que dans mon métier de journaliste, aussi « connecté » soit-il, pouvoir faire un bond et décamper peut encore s’avérer d’une importance vitale.
Je prévoyais de partir deux semaines, je suis parti deux mois. Je pensais que j’allais simplement longer un fleuve jusqu’à l’extrémité géographique de l’empire soviétique, je me suis retrouvé à voyager jusqu’à l’extrémité historique de cet empire.
Lorsque, à l’aube du 19 août, à Moscou, les putschistes ont diffusé le communiqué qui renversait Gorbatchev et remettait tout le pouvoir entre les mains de la junte, il était déjà 13 h 42 sur le fleuve Amour que mon bateau remontait, tant le décalage horaire à huit mille kilomètres de la capitale est grand. La même voix qui annonçait à ce moment précis la nouvelle à deux cent soixante-dix millions de citoyens soviétiques a résonné, métallique, dans les haut-parleurs du bateau et j’ai vécu ces minutes si tendues à travers l’émotion de l’équipage et des membres soviétiques de l’expédition.
Même dans l’absolue indifférence paisible du fleuve et de la nature alentour, j’ai tout de suite compris que cette nouvelle marquait un tournant non seulement pour l’Union soviétique, mais aussi pour le reste du monde et j’ai été saisi par cette étrange fièvre qui s’empare des gens de mon métier chaque fois que l’Histoire passe devant nos yeux et que l’on ne peut résister au désir de lui courir après, ne serait-ce que pour pouvoir en raconter un détail.
Une fois l’expédition arrivée à la petite ville de Nikolaïevsk, à l’embouchure de l’Amour, à l’extrémité orientale du continent soviétique, j’ai donc quitté le groupe pour me mettre seul en chemin, avec l’intention de voir ce que cette histoire de Moscou signifiait pour les habitants des provinces, quels changements provoquaient dans les différentes républiques les événements extraordinaires de la capitale. Je me suis tout simplement dirigé vers l’ouest, avec une étape en Sibérie puis à travers l’Asie centrale. Là, en visitant une par une les républiques qui, dans la désintégration de l’empire, se déclaraient indépendantes, j’ai vu exploser un nouveau nationalisme dangereux, j’ai vu les premières expressions de la vitalité de cette vieille force destinée à jouer un rôle nouveau, si important, dans cette partie du monde : l’islam.
Dans cette marche vers l’Ouest, en partie à rebours sur la route de la soie, je suis allé visiter les hauts lieux de l’histoire et chercher les racines d’anciens conflits qui, réprimés pendant des décennies sous le régime communistetotalitaire, revenaient aujourd’hui sinistrement hanter les habitants de cesrégions. J’ai voulu aller à Samarcande et à Boukhara, cités dont les seuls noms n’ont rien perdu de leur pouvoir d’envoûtement et où l’histoire séculaire revient en force sur le devant de la scène.
De l’Asie centrale, je suis passé aux républiques du Caucase, où la fin du régime répressif soviétique et la liberté retrouvée s’expriment par de nombreuses guerres civiles qui régissent à présent la vie quotidienne de leurs habitants. Pour me faire une idée de la nouvelle situation, j’ai franchi les dangereuses lignes de front qui séparent les Azéris des Arméniens et les barricades moins risquées mais plus théâtrales qui séparent en Géorgie les hommes armés du gouvernement de ceux de l’opposition.
Voyager dans ce pays qu’était jusqu’à hier la très rigide Union soviétique est plutôt facile. Avec quelques dollars en poche et beaucoup de patience, on peut se rendre partout. Durant ces deux mois, j’ai pris des dizaines d’avions – le cœur souvent au bord des lèvres – je me suis déplacé en train, en hélicoptère, en bateau, en voiture. À une époque, il fallait, comme dans tout régime totalitaire, avoir un visa spécial pour chaque localité que l’on voulait visiter. En théorie, c’est toujours le cas, mais aujourd’hui, on peut toujours trouver quelqu’un prêt à griffonner quelque chose sur un morceau de papier et à y apposer un tampon. La corruption est omniprésente et un voyageur peut s’en servir pour atteindre son but. Le mien était de ne pas me laisser arrêter, d’aller de ville en ville, de voir, de parler aux gens, de prendre des notes dans mes carnets et, le soir, de les transférer et les développer sur mon ordinateur.
Souvent, il suffit de trouver un fil conducteur pour comprendre le monde. Au cours des cinq années que j’ai passées au Japon, notre chien Baoli s’est enfui une fois de la maison. Il m’a fallu trois jours pour le trouver dans le labyrinthe efficace de la bureaucratie japonaise responsable de ce genre d’affaire, mais à la fin, j’ai eu le sentiment qu’en cherchant le chien, j’avais compris des aspects de ce pays qui autrement m’auraient échappé. Cette fois, en voyageant à travers l’Union soviétique, je cherchais quelque chose de beaucoup plus insaisissable mais aussi de beaucoup plus substantiel : le cadavre du communisme. Et cette recherche m’a emmené très loin. Il se trouve que, pendant tout ce voyage, j’ai couru après du savon à raser, et cette quête m’a aussi fait comprendre quelque chose. Pour voyager léger, je n’en avais emporté que pour deux semaines, et à la fin de l’expédition sur l’Amour, à Nikolaïevsk, je n’en avais plus. J’ai voulu en racheter, mais : « Niet. Niet », « non, non », m’ont répondu les vendeuses dans tous les magasins de cette petite ville au bord du Pacifique. Eh bien, à partir de ce moment-là et pendant six semaines, j’ai cherché du savon dans tous les villages et capitales qui se trouvaient sur mon chemin. Et la réponse était toujours : « Niet. Niet ». L’explication est simple : à l’été 1991, en raison d’un problème de production, des millions de citoyens soviétiques, et moi avec, n’ont pu se raser correctement. Le savon, cependant, n’était qu’un des nombreux produits qui manquaient dans les magasins à ce moment-là et dont j’ai appris, comme les Soviétiques, à me passer. En Géorgie, par exemple, il n’y avait pas d’ampoules électriques. En Ouzbékistan il était impossible d’acheter des blocs-notes. Partout ailleurs il était extrêmement difficile de trouver de la pellicule en noir et blanc pour les appareils photo.
Au cours de mes précédents voyages en Union soviétique, j’avais été intrigué par les dizaines de statues de Lénine, petites, grandes, moyennes, gigantesques, en bronze, en marbre, en béton, que j’avais vu trôner sur les inévitables places centrales de chaque ville et village de cet immense et, de ce fait, monotone pays. Lénine était toujours là, omniprésent avec sa casquette ou son journal dans une main et l’autre levée pour indiquer l’avenir ou simplement l’horizon dégagé. Le sort de ces statues a marqué mon dernier voyage. À Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, j’étais le seul étranger au milieu de la foule médiévale des paysans et des mollahs qui a abattu, au nom d’Allah, le premier grand bronze de Lénine en Asie centrale ; je suis arrivé à Achgabat le matin où la ville, au réveil, découvrait que les autorités locales, pendant la nuit, sans le dire à personne, sans aucune explication, avaient enlevé la grande statue du père de la Révolution qui ornait la rue principale.
En même temps que ces statues, tout un monde s’écroulait autour de moi. Incroyable ! Bien que de différentes façons, d’un bout à l’autre de cet immense continent, soixante-dix ans de communisme se terminaient ainsi, sous mes yeux, et l’émotion était immense.
J’étais parti vers une Union soviétique en crise, pleine de problèmes, mais où le parti communiste était toujours au pouvoir et où le communisme demeurait le ciment qui maintenait le tout. Je me suis soudain retrouvé à voyager dans un pays où le parti n’existait plus, dans un système qui, le ciment disparu, s’effondrait. Le communisme, mort ? Une pensée, qui jusqu’à tout récemment, était impensable.
Je n’ai jamais été communiste, mais depuis le jour où mon père, qui l’était, a été traqué par les fascistes et que je l’ai vu se sauver par-dessus le mur du jardin de chez nous à Florence pour s’enfuir par les champs, ma vie a été marquée d’une manière ou d’une autre par cette idée et les espoirs qu’elle a suscités. « Un jour, ça s’effondrera », j’entendais dire les amis de mon père quand, frustrés par la pauvreté de l’après-guerre, par les paniers à salade qui réprimaient les grèves, ils attendaient le jour de leur révolution et l’ordre d’aller sortir des murs où ils les avaient cachées, enveloppées dans du papier sulfurisé, les mitraillettes avec lesquelles ils avaient fait la résistance.
Heureusement, cette révolution n’a jamais eu lieu. Heureusement, car les révolutions coûtent extrêmement cher, exigent d’immenses sacrifices et se terminent le plus souvent par de terribles déceptions. J’en ai vécu plusieurs et je les ai toutes vues mal finir : la révolution vietnamienne, la cambodgienne, la chinoise. Toutes menées au nom du communisme, toutes parties en quenouille, en dépit des millions de morts, des souffrances et des sacrifices des survivants, en dépit de la conviction obstinée de ceux, nombreux, qui marchaient vers cet avenir radieux que montrait le bras levé du dernier prophète ayant survécu à la chute de tous les autres mythes du communisme : Lénine.
En entrant dans le mausolée de Lénine, sous les regards sévères des gardes qui scrutent encore chaque visiteur et fouillent ses poches et qui profèrent des « chut, chut » péremptoires, l’index au nez pour que même les pas soient légers et que ce cadavre enveloppé de silence qui lévite dans le noir continue d’inspirer crainte et respect, j’étais heureux parce que j’étais conscient d’assister à quelque chose qui bientôt ne serait plus qu’un souvenir. Là, devant ce cadavre, destiné à disparaître sous peu lui aussi, j’ai songé à cette question absurde qui m’a taraudé tout au long du voyage : comment est-il possible que, pendant des décennies, l’Occident ait eu si peur de ce pays ?
J’ai aussi songé à la colère qui s’était parfois emparée de moi, contre ceux qui m’avaient précédé, qui avaient vécu ici, journalistes ou non. J’avais l’impression qu’ils m’avaient trahi en omettant de me raconter à quel point cette Union soviétique était pauvre, sordide et désorganisée et à quel point son peuple était désespéré et misérable.
Dans le but d’éviter la colère de ceux qui viendront après moi, je vais tenter de tout coucher sur les pages qui suivent : ce que j’ai vu et entendu, les réactions instinctives, les pensées incontrôlables qui traversent l’esprit et aussi les peurs telles que je les ai enregistrées, chemin faisant, dans la mémoire de mon ordinateur.
2
Sur le fleuve Amour
Khabarovsk, 16 août 1991
Je reconnais désormais le socialisme, même les yeux fermés. C’est peut-être l’odeur de l’essence mal raffinée, mais dès que je franchis la porte de l’avion qui m’a amené de Niigata, au nord du Japon, jusqu’ici, à la capitale de l’Extrême-Orient soviétique, je sais que je suis dans un de ces pays où les flics te regardent comme si tu venais de commettre un crime, où il faut faire attention à ce que l’on écrit dans la déclaration en douane, où il faut se dire que les téléphones sont sur écoute, où les dollars, la seule vraie devise au monde et surtout dans le monde non capitaliste, ont une valeur au taux de change officiel et une autre au marché noir… J’ai l’habitude maintenant. Je le sais. Quand je rouvre les yeux, tout ce qui s’ensuit confirme l’odeur du socialisme : la désorganisation, la crasse, les cris, les paquets attachés avec des ficelles, les sempiternels travaux toujours en cours, les tuyaux à même le sol sur lesquels les gens trébuchent, la précaire passerelle en bois sur un fossé ouvert et jamais fermé juste devant la porte de l’aéroport que tous les passagers, aussi bien ceux qui arrivent que ceux en partance, sont obligés de traverser.
De la foule se détache un homme d’une quarantaine d’années avec un petit sac à l’épaule qui s’avance vers moi comme s’il me connaissait. « Bienvenue. Je suis Sacha, l’interprète de l’expédition. » Pâle, un nez mince, des yeux très bleus, des épaules larges, il se déplace avec détermination. Il dit être un journaliste venu de Moscou. J’ai l’impression, le soupçon, que c’est un militaire. La nuit commence à tomber. Il bruine et la ville m’apparaît dans sa misère la plus poignante. Dans les rues, les bus semblent ne pas être passés depuis des heures. À chaque arrêt, des groupes nombreux attendent en silence. Tout le monde semble porter un cabas à la main. Les arbres ajoutent une touche de fraîcheur à l’atmosphère ancienne et romantique de la ville. Khabarovsk n’a guère plus de cent cinquante ans, mais les traces de sa fondation tsariste sont perceptibles partout et embellissent la grise mine des constructions socialistes plus récentes. La ville s’étend sur trois collines et les pentes de ses rues atténuent cette impression de platitude ennuyeuse qui caractérise tant d’autres villes soviétiques.
Khabarovsk se trouve au confluent de deux fleuves : l’Amour et l’Oussouri. C’est la capitale de l’Extrême-Orient soviétique et le siège du plus important commandement militaire de l’URSS, c’est pourquoi c’est aussi la base de notre expédition. Elle a été nommée d’après Khabarov, un chef cosaque qui descendit l’Amour et parvint jusqu’ici vers le milieu du XVIIe siècle. Il n’est pas resté longtemps. Les Chinois, considérant que ces terres leur appartenaient, ont envoyé leurs troupes pour chasser ces « envahisseurs à la barbe rouge », et les Russes ont dû battre en retraite en bon ordre. Du moins, pour cette fois-là.
Notre expédition sur l’Amour est organisée par le Komsomolskaïa Pravda, qui était à l’origine le journal des jeunesses communistes, mais qui est aujourd’hui l’un des journaux les plus libres et sans préjugés de l’Union soviétique. Grâce à cette connexion, nous sommes logés dans « l’hôtellerie du parti » à Khabarovsk.
Ce nom m’avait fait imaginer un lieu réservé à l’élite, mais je me trompais. C’est une pension pour les fonctionnaires communistes des provinces, pour les cadres moyens qui visitent la ville : il y a deux personnes par chambre, les toilettes sont sales, le papier toilette est du genre brillant, le savon c’est de la lessive, les lits sont trop courts, trop mous et incurvés au milieu. Dans chaque pièce on trouve le haut-parleur d’une radio réglée sur une même et unique station. C’est à prendre ou à laisser.
Nous dînons à l’hôtel pour étrangers Intourist afin de fêter le début du voyage et de faire connaissance entre nous. Le chef de l’expédition, celui qui est en charge de toute l’organisation, s’appelle Volodja, c’est le correspondant à Khabarovsk du Komsomolskaïa, un homme d’une cinquantaine d’années, robuste, aguerri, calme. Puis vient Sacha, l’interprète. Le troisième journaliste soviétique s’appelle Nikolaï, c’est le rédacteur en chef d’un journal de Khabarovsk, expert en matière de criminalité. Ce qu’il vient faire dans cette expédition n’est pas bien clair pour moi.
Comme toujours dans ces situations, chacun cherche, parfois de façon peu subtile, à se faire une idée de l’autre, de comprendre où il en est, pour qui il travaille réellement. Journaliste ? Seulement journaliste?
C’est Sacha qui m’intrigue le plus. Au fil de la conversation, j’apprends qu’il a été pendant trois ans le correspondant à Pyongyang de RIA Novosti, l’agence de presse soviétique souvent utilisée par le KGB comme couverture pour ses agents à l’étranger, et qu’il a fini par se faire expulser de Corée du Nord. Il travaille à présent au service des affaires étrangères du Komsomolskaïa Pravda. Il parle anglais, mais lentement et de façon hésitante, comme on le fait quand on n’a pas pratiqué depuis longtemps une langue. Tout comme Sacha m’intrigue, j’intrigue terriblement l’un des trois journalistes chinois, M. Ren, un type d’une quarantaine d’années, grand et sec, dont la belle dentition donne l’impression qu’il sourit en permanence. Assis à côté de moi, il me demande sans cesse pourquoi je parle sa langue, où je l’ai apprise, si je suis déjà allé en Chine, si j’ai des amis à Pékin. Je me garde bien de m’expliquer et m’amuse à rester très vague tout en évoquant de temps à autre des détails que seul quelqu’un qui a vécu longtemps dans son pays peut connaître.
Les trois Chinois travaillent tous pour le Zhongguo Qingnianbao – Quotidien de la Jeunesse chinoise – et ils sont la « délégation » typique d’un pays communiste : Wang, le correspondant à Moscou, qui parle russe et semble le plus sophistiqué, est clairement le « commissaire politique » du groupe ; la dénommée Mlle Liu est la fille d’un général de l’armée populaire de libération et de toute évidence ce voyage est une récompense ; M. Ren est le préposé aux informations : il prend constamment des notes et immortalise avec son appareil photo tout et tous dès le premier instant. L’autre Européen du groupe s’appelle Krzysztof, c’est un jeune correspondant polonais à Pékin.
Volodja porte un toast au succès de l’expédition et promet que, si celle-ci se passe bien, il pourra alors en organiser une autre… pour chasser le tigre. Dans la région de l’Amour, le nombre de ces splendides bêtes habituées des neiges et des glaces a tellement augmenté qu’on doit en abattre un nombre important chaque année.
Nous retournons à pied à la pension. Une voiture, les feux de route allumés, fonce vers moi et s’arrête tout près dans un crissement de freins. Le chauffeur, un jeune blond manifestement ivre, veut me vendre sa jeune compagne.
Une brise d’été caresse la ville. Dans la rue principale, la rue Karl Marx, des dizaines de jeunes filles marchent deux par deux, à la recherche de clients ou d’un compagnon d’un soir. La prostitution occasionnelle semble avoir augmenté notablement depuis ma première visite il y a deux ans. Est-ce possible que chaque fois que l’austérité puritaine d’un système répressif commence à céder, le premier signe de la liberté retrouvée soit toujours et partout celui-ci ? Tous ceux qu’on croise sur notre chemin semblent être à la recherche d’une affaire à conclure. Le vent charrie des bouffées de parfum bon marché et de sueur.
Depuis ma chambre, je vois, dans les fenêtres éclairées de la maison d’en face, les silhouettes des habitants qui se brossent les dents avant d’aller se coucher, je vois les ampoules qui pendent tristement aux plafonds. On est le 15 août, Ferragosto en Italie. Je pense à la propreté, à l’élégance de la nature et des gens chez moi.
Samedi 17 août
Des femmes en chemise de nuit sortent des chambres étouffantes et se dirigent vers les douches communes. Des morpions solitaires rampent sur les planchers en bois huilé. Impossible de prendre une douche, le robinet ne marche pas. Il y a aussi un problème avec le petit déjeuner – la pension n’en propose pas – mais cela est vite résolu. Garé devant la pension, il y a un de ces camions-citernes jaunes remplis du jus amer d’un fruit quelconque. Une femme avec un tablier blanc tout rapiécé, assise sur un petit banc, ouvre et ferme un grand robinet. On fait la queue, on paie, on boit. Les trois ou quatre verres que la femme remplit, donne et reprend, sont toujours les mêmes, jamais rincés.
Une scène me frappe : un homme gare sa voiture et passe un bon moment à essayer de fermer la portière à clé. Il fait preuve de beaucoup de patience, comme s’il y était habitué. Je songe à tous les efforts qu’il a dû fournir, à tout ce qu’il a dû payer pour obtenir cette voiture et à la façon dont il doit composer chaque jour avec le problème de cette serrure défectueuse : un rappel quotidien que, même avec une voiture personnelle, il demeure dans le socialisme.
Le programme du jour c’est de rejoindre la naissance de l’Amour pour embarquer sur un bateau qui nous attend déjà. Armes et bagages, nous partons pour l’aéroport. La même humanité triste, mal habillée, mal lavée, attend le long des trottoirs les mêmes bus qu’hier. Tout le monde a le même cabas en faux cuir. À l’intérieur, je n’imagine que des vieux légumes. Je viens de voir une femme acheter une courge qui m’avait l’air pourrie.
L’aéroport de Khabarovsk est l’un des plus grands de l’Union soviétique. Le long des pistes, sur les parkings, sur les pelouses autour de l’aéroport il y a littéralement des centaines d’avions, les uns derrière les autres : des jets à queue haute mais aussi des avions à hélice, souvent des biplans, comme ceux utilisés entre les deux guerres, encore en service ici pour les destinations de province. Voyager par avion en Union soviétique, c’est comme prendre le car chez nous. Les distances sont immenses et pour de nombreux centres urbains, l’avion est le seul lien avec le reste du pays. Les vols sont très fréquents et relativement bon marché.
L’avion qui nous a été attribué est un très vieil Antonov An-26. C’est en fait l’un de ceux utilisés par les brigades de pompiers qu’on parachute pour éteindre les feux de forêt. C’est pour ça qu’il possède une grande porte à l’arrière et des sièges très rudimentaires le long du fuselage. Volodja est ami avec le chef des pompiers de Khabarovsk et a réussi à louer l’avion pour notre expédition. On vole, très bruyamment, en direction du nord pendant quelques heures jusqu’à la ville de Zeïa. Sur place, dans un petit aérodrome au milieu d’une forêt de bouleaux, un autre véhicule de pompiers nous attend : un hélicoptère dont la peinture orange est entièrement noircie par les échappements des moteurs.
L’hélicoptère est plein de ferraille rouillée, de fatras inutile, d’outils oubliés, d’objets cassés que personne n’a pris la peine de réparer. L’homme qui pompe du combustible d’un vieux camion-citerne vers le ventre de l’hélicoptère fume tranquillement sa cigarette pendant toute l’opération. Le panneau qui, péremptoire, ordonne : « Défense de fumer » est pourtant tout près, délavé par la pluie.
Hier, à cette heure-ci, j’étais encore au Japon, dans l’aéroport aseptisé de Niigata, et la dernière image de là-bas, tout en contraste, me revient à l’esprit : les équipes de Japonaises en uniforme prêtes à bondir pour nettoyer les avions à l’arrivée, les bagagistes, les mécaniciens, les pompistes, chacun avec un uniforme et un casque de couleur différente, selon sa fonction, tous avec des gants très blancs, chacun avec sa propre mission silencieuse à accomplir. Alors qu’ici…
Après les grands tremblements et les secousses du décollage, bientôt la nature dans sa pureté, la taïga dans son immensité, apaisent les esprits. Volodja raconte qu’il est né dans la région. Son père était aussi d’ici. « Race sibérienne. Fort. Fort », dit-il en faisant le geste d’un haltérophile. Plutôt que journaliste, il aurait aimé être chasseur.
Ici et là dans la forêt, on aperçoit d’immenses zones vides : les arbres sont tous morts et les fûts blancs et secs des bouleaux ressemblent à des cure-dents infinis plantés dans le vert émeraude des hautes herbes. Volodja raconte qu’en hiver, la température peut descendre jusqu’à 50 degrés en dessous de zéro et que de nombreux arbres en meurent. Sacha vient nous expliquer que nous survolons une région où se trouvent des installations militaires et que notre groupe a obtenu l’autorisation de la survoler à la seule condition que personne ne prenne de photographies. Nous regardons tous, plus curieux que jamais, à travers les hublots sales de l’hélicoptère, mais on ne voit que des arbres. Sacha insiste sur le fait qu’une fois qu’on aura atterri, il ne faudra pas garder nos appareils photo autour du cou mais les cacher afin de ne pas créer de problèmes avec les militaires que nous rencontrerons. On plaisante à propos de ces militaires soviétiques qui semblent ne pas avoir entendu parler des satellites espions, ne pas avoir lu les rapports de la guerre électronique menée dans le Golfe, bref, qui croient que nos caméras peuvent capturer on ne sait lequel de leurs secrets.
En contrebas, de longs trains serpentent à travers un territoire presque désert : le Transsibérien. Deux locomotives tirent un nombre infini de wagons remplis de bois, de wagons-citernes remplis de pétrole. Les richesses de l’Extrême-Orient soviétique qui prennent la direction des centres industriels de Sibérie. Il s’agit de la voie qui court parallèlement à la frontière avec la Chine, située à vingt ou trente kilomètres de la ligne de démarcation. Comme elle était extrêmement vulnérable – un simple raid aurait pu couper la communication entre Moscou et ces régions – les Soviétiques, il y a plus d’un demi-siècle, ont construit un deuxième Transsibérien, la BAM (MagistraleBaïkal-Amour), une centaine de kilomètres plus à l’intérieur des terres, hors de portée de l’artillerie de toute attaque éventuelle de l’autre côté de la frontière.
Nous volons pendant environ une heure et demie au-dessus d’une forêt qui devient de plus en plus dense, d’un paysage de plus en plus vallonné. Puis, soudain, je le vois, étincelant comme un bijou en argent sous le ciel gris, l’Amour. Des brumes blanchâtres planent au-dessus de l’eau. Sur la rive, une poignée de maisons en bois aux toits noirs de goudron : Djalinda, un repaire de pionniers, une étape importante pour ceux qui voyagent sur le fleuve, car d’ici part une ligne de chemin de fer qui rejoint les deux Transsibériens et relie ainsi Djalinda à tout le réseau de transport soviétique.
Le grand nœud ferroviaire de Skovorodino n’est qu’à 27 kilomètres. Il a été construit en 1909. Les maisons bâties pendant l’été n’ont pas survécu au premier hiver. Le gel fut tel que toutes les fondations se sont déformées, entraînant l’effondrement des murs et des toits.
L’hélicoptère survole le village, puis se pose sur un petit carré de béton à la lisière de la forêt. Une poignée d’enfants sales et vigoureux est à deux doigts de se faire emporter par le vent créé par les pales. Un jeu auquel ils semblent être habitués. Ils ne sont pas habitués, en revanche, à voir des visiteurs étranges comme nous et, lorsque je descends l’échelle, mon Leicadûment caché dans mon sac, les garçons deviennent muets, saisis d’unecuriosité mêlée de crainte.
Drôle d’endroit, Djalinda ! La forêt dans notre dos est dense et sombre. Lorsque l’hélicoptère arrête ses moteurs, nous n’entendons que le bruissement du vent, puis l’approche d’une moto chevauchée par trois soldats. Ils ne sourient pas. Ils ont l’air contrariés. L’un d’entre eux se contente de nous ordonner d’attendre. Ils nous regardent comme si nous étions des Martiens. À leurs yeux, nous le sommes certainement. « Pour eux, les étrangers sont synonymes d’ennuis, explique Volodja. Restez en arrière et ne montrez pas vos appareils, s’il vous plaît. »
J’ai très envie de prendre en photo ces enfants ébahis et transis de froid contre les nuages bas chargés de pluie, mais je me retiens. Il y a deux ans, lors de ma première visite à Sakhaline, un après-midi dans la cour d’un bel immeuble du centre-ville derrière un portail en fer, j’ai vu une scène que je ne pouvais manquer : un corbeau noir perché sur une tête de Lénine recouverte de neige. J’ai fait la mise au point et pris la photo, mais l’instant d’après, un soldat m’arrêtait et confisquait mon Leica, mon passeport et mon permis de voyage. On m’a tout rendu le soir même après l’intervention du gouverneur de l’île que je venais d’interviewer, mais un mois après mon départ, leQuotidien des Forces Armées publiait un entrefilet à propos d’un soldat qui avait reçu une décoration pour avoir « surpris le journaliste-espion Tiziano Terzani en train de photographier des cibles militaires à Sakhaline ». Un ami russe a envoyé la coupure du journal à mon adresse en Thaïlande, mais la lettre ne m’est jamais parvenue. Je n’ai découvert cette histoire que cet hiver, lorsque j’ai traversé Sakhaline en route vers les Kouriles.
Les trois soldats se tiennent immobiles devant nous comme s’ils avaient l’ordre de nous tenir à l’œil. Puis une jeep arrive. Du siège du copilote descend un jeune officier, élégant, grand, gras, portant des bottes boueuses et une casquette démesurée à visière verte : KGB. Volodja va à sa rencontre avec un grand sourire, le salue, nous présente de loin puis commence cette petite danse de main sur l’épaule et de mots à l’oreille, de pas lents en s’éloignant, d’arrêts, encore des mots… Une scène que je connais depuis mon séjour en Chine. C’est une forme classique du théâtre communiste. L’intrigue de la pièce est toujours la même : dans une société socialiste, personne n’a jamais droit à rien, et les autorités – en l’occurrence notre capitaine du KGB – sont chargées de veiller à ce que personne ne demande rien. Celui qui veut vraiment quelque chose – surtout au nom d’un groupe d’étrangers comme c’est notre cas – doit alors expliquer sa position, définir son importance et ensuite justifier le caractère exceptionnel de sa demande. En l’occurrence, il s’agit de nous permettre de traverser le village pour rejoindre la rivière où nous attend le bateau qui nous conduira à la mer, à des milliers de kilomètres d’ici.
La danse-négociation dure un bon quart d’heure. J’entends Volodja répéter : « Komsomolskaïa Pravda », pour donner du poids à sa demande avec le nom de son journal qui est aujourd’hui le plus vendu en Union soviétique, mais l’officier répète : « Niet ». J’entends Volodja dire : « journalistes étrangers », « expédition », comme s’il s’agissait de mots décisifs, magiques, mais l’officier persiste avec son « Niet ». Je sais qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Comme toujours dans tout drame, celui-ci connaîtra aussi son dénouement. Le voilà : au loin, je vois un bus militaire qui approche. L’officier sourit et nous invite à y monter.
Le compromis qu’il a trouvé avec Volodja est simple : nous pouvons entrer dans le village, mais pas à pied. La distance n’est que de quelques centaines de mètres et nous nous retrouvons aussitôt au « centre » de Djalinda.
J’ai l’impression d’entrer dans une gravure du XIXe siècle. Sur la route principale, un chemin en terre, quelques vaches paissent. Devant les maisons, toutes en troncs bruts emboîtés aux angles au moyen d’entailles, est empilé le bois prêt pour l’hiver. Deux mille personnes vivent ici, mais je m’aperçois très vite que ce ne sont pas des habitants normaux et que ce n’est pas un village de province normal. Djalinda est le siège du commandement du Marina Fluvial du Haut Amour et ici il n’y a que des militaires et leurs familles.
À la poignée de gamins sales qui nous ont accueillis à l’hélicoptère se joignent d’autres à vélo qui nous suivent partout. Certains d’entre eux me parlent et me demandent mon adresse, me proposent de vieux timbres et de calendriers de poche pour l’année 1992.
Au bout de la route, j’aperçois l’Amour, gris et lent, qui glisse. Je vais sur la rive, me baigne puis m’assois en silence pour l’écouter, ce fleuve, jusque-là si mythique pour moi et à présent si réel.
Les fleuves m’ont toujours attiré. Leur fascination réside peut-être dans le fait qu’ils passent constamment en demeurant inchangés, qu’ils s’en vont tout en restant, en ce qu’ils sont une sorte de représentation physique de l’histoire, qui n’est que dans la mesure où elle passe. Les fleuves sont l’Histoire. Il y a tant de pays que l’on ne peut comprendre sans parcourir leurs fleuves. L’année dernière, en Birmanie, j’ai su que je ne pouvais atteindre le cœur de ce pays poignant, enchaîné par une dictature militaire terrible et meurtrière, qu’en descendant l’Irrawaddy de Mandalay à Bagan. Ainsi, je suis terriblement frustré de n’avoir jamais réussi à parcourir de longues distances sur le Mékong, malgré mes longues années en Indochine. Et me voici enfin sur l’Amour, extraordinaire frontière historique entre deux civilisations, deux races, deux grands empires !
Pendant des siècles, les Chinois, qui s’étendaient vers le nord, et les Russes, qui se déployaient vers le sud et l’est, se sont croisés et affrontés le long de ce fleuve, se sont battus pour le contrôler. Puis, il y a cent trente ans, Pékin et Moscou sont convenus de considérer l’Amour et son affluent, l’Oussouri, comme la frontière entre leurs deux territoires. L’accord n’étant pas des plus équitables, les Chinois l’ont depuis qualifié de traité « inégal », à l’instar de celui par lequel la Grand Bretagne, à la même période, a obtenu la cession de Hong Kong. L’empire chinois alors affaibli et sous la pression de plusieurs puissances européennes qui réclamaient des concessions, cède soudain à Moscou toutes les terres que les Russes revendiquent, y compris cette immense région entre le Oussouri et l’océan Pacifique, où ces derniers s’empresseront de construire une ville dont le nom est encore aujourd’hui une insulte à la Chine : Vladivostok, « le Conquérant de l’Orient ».
Lorsque l’on voit aujourd’hui que la Chine oblige l’Angleterre à revoir les traités du siècle dernier et à restituer Hong Kong en 1997, il faut garder à l’esprit qu’en 1858 et 1860, avec, respectivement, le traité d’Aigun, puis celui de Pékin, la Russie s’est appropriée quelque 300 000 kilomètres carrés de territoire qui étaient jusque-là chinois, ce que la Russie elle-même avait reconnu en 1689, dans le très formel traité de Nertchinsk.
L’histoire ne s’est certainement pas arrêtée à ce dernier accord, et le conflit territorial entre Russes et Chinois est resté latent et aussi explosif qu’unredoutable volcan. En 1969, c’est la dispute au sujet d’une île insignifiante et inhabitée au milieu du fleuve Oussouri qui a provoqué un affrontement sanglant et qui a amené les deux géants communistes au bord d’une guerre épouvantable qui aurait pu facilement se transformer en guerre atomique. La tension est loin d’être retombée. Elle ne retombera pas de sitôt.
Le fleuve s’écoule en silence. Le courant est doux. Du haut de leurs miradors sur des pylônes métalliques, deux soldats soviétiques scrutent la rive opposée avec leurs jumelles. La Chine semble déserte. Ce n’est qu’en sondant attentivement le feuillage de la forêt en face que j’aperçois les casemates et les soldats de Pékin qui scrutent ce côté-ci avec leurs jumelles. La distance d’une rive à l’autre n’est que d’une centaine de mètres. En hiver, le fleuve devient une surface glacée. Le franchir est alors très facile, mais personne ne s’y risque. L’Amour reste une frontière d’hostilité et de suspicion. Il n’y a aucun contact entre les Chinois et les Soviétiques, aucun commerce, pas d’échange de visiteurs.
Les rivières ont joué un rôle capital dans l’histoire du peuple russe, à l’instar de la mer, des montagnes ou des déserts pour d’autres peuples. Les fleuves ont sorti les Russes de leur isolement, leur ont ouvert l’accès à d’autres cultures et ont rendu possible la conquête d’un empire. Le Don et le Dniepr les ont mis en contact avec le monde grec et, à la fin de celui-ci, avec ce qui restait de la civilisation romaine à Byzance. La Volga leur a ouvert les portes de l’Asie centrale les aidant à atteindre facilement la mer Caspienne, où commençait la section terrestre de la route de la soie. Les fleuves sibériens leur ont permis de progresser vers l’Extrême-Orient et de conquérir cette immense, riche et déserte étendue de « Terre qui dort » : c’est le sens du mot Sibérie.
Les Anglais, les Portugais et les Espagnols ont fondé leurs empires sur la domination de la mer, les Russes ont bâti le leur grâce à leur maîtrise desdéplacements fluviaux. C’est le cours des rivières qui a déterminé la direction de l’expansion russe, tandis que c’est la recherche des fourrures qui a déterminé la logique économique de leurs avancées. Les fourrures sibériennes étaient légères et donc faciles à transporter. Comme elles étaient aussi très prisées, une fois à Moscou elles représentaient une véritable fortune. C’est à la recherche de fourrures que les pionniers russes ont poussé de l’Oural jusqu’au Pacifique, mais une fois sur son rivage, au lieu de prendre le large comme d’autres peuples l’auraient fait, eux, toujours à la recherche de davantage de fourrures, ils ont continué à s’enfoncer vers l’Alaska. L’Alaska ! Il pourraitappartenir aujourd’hui à Moscou, mais ce sont les Russes eux-mêmes qui l’ont vendu en 1867 aux Américains pour quelques centimes le yard carré.
Dans cette course vers l’est, l’Amour était la voie la plus naturelle, la plus évidente. Les Russes savaient qu’il ne fallait pas que d’autres s’en emparent. C’est pourquoi les Cosaques sont venus de Moscou pour fonder des villages et planter des drapeaux sur tout le parcours du fleuve. Ils y ont également planté leurs croix car pour eux, l’Amour n’était pas seulement une extension de la Russie, mais aussi la frontière entre le christianisme et le paganisme.
En haut d’une crête, surplombant un coude de la rivière, j’aperçois les vestiges d’un bâtiment plus grand et plus élégant, plus majestueux que les baraques socialistes dans lesquelles habitent aujourd’hui les gens de Djalinda.
Je montre les ruines et fais le signe de la croix pour voir la réaction des enfants qui sont maintenant autour de moi. « Da… Da. » Oui, oui, c’était l’église, détruite il y a longtemps. « Par les communistes ? » je demande. « Non. Par la Révolution », disent-ils. À côté, abandonnée aussi, une sorte de tour en pierre. Certains disent que c’était le clocher, d’autres, le château d’eau. Probablement les deux selon les époques.
L’Amour n’a pas une véritable source en tant que telle et l’on considère qu’il commence au point où l’Argoun et la Chilka unissent leurs eaux. Cette confluence se trouve à 140 kilomètres en amont de Djalinda. Nous aurions dû partir de là-haut, mais l’eau y est si peu profonde que notre bateau aurait risqué de s’échouer. À ce qu’il paraît, il faut déjà un pilote spécial pour aider le capitaine passer les hauts-fonds.
Notre bateau ! Nous sommes tous très curieux. On va y passer deux semaines et on n’a aucune idée de ce qu’il y a dedans. « Il est là ! Il est là ! » hurle Volodja. Au loin, élancé, tout blanc, nous le voyons approcher. Fraîchement peint sur le côté figure ce nom qui nous fait tous rire : Propagandist. Volodja nous explique que le bateau appartient à la Ligue de la jeunesse communiste et qu’il est habituellement à la disposition des fonctionnaires qui l’utilisent pour accomplir leur travail de propagande dans les villages sur le fleuve, pour se reposer, pour y tenir leurs réunions et leurs fêtes. « Ce bateau connaît tous les secrets du parti », dit Volodja. Certains de ces secrets ne mettront pas longtemps à être révélés. Alors que nous savourons tous, après avoir pris possession de nos minuscules cabines, la première tasse de thé à bord, Sacha trouve une dizaine de cassettes vidéo dans un meuble de la salle à manger. Il en prend une et, juste pour voir si l’appareil fonctionne, la met dans le magnétoscope. Les premières images qui apparaissent à l’écran montrent une blonde nue aux seins énormes très occupée au lit avec un monsieur moustachu et ventripotent, pareillement nu. Nous éclatons tous de rire. La collection embarquée par les jeunes communistes est constituée exclusivement de films pornographiques.
La première étape de notre expédition est Albazino, à seulement 15 kilomètres en aval de Djalinda. Albazino est un nom mythique pour tous les Russes. C’est ici que les pionniers ont construit le premier grand fortd’Extrême-Orient avec des rondins issus des forêts voisines, ici aussi que les Russes ont livré et perdu la première grande bataille contre les armées mandchoues envoyées depuis Pékin pour contrer l’avancée de ces conquérants sur les terres de l’empire céleste.
J’aimais l’idée de rejoindre Albazino en bateau, de voir le fort depuis le fleuve comme le virent les Cosaques venus renforcer ses défenses, mais le camion-citerne qui devait approvisionner la Propagandist en eau n’est pas encore arrivé et le bateau n’est pas prêt pour ce départ tant attendu, Volodja décide donc de nous emmener à Albazino dans un car mis à disposition par la Marine Fluviale. Dommage !
La route de terre, pleine de flaques et de vaches, passe entre deux rangées de bouleaux bas. Nous roulons pendant près d’une heure et, lorsque Volodja annonce que nous sommes arrivés, la question sur toutes les lèvres semble être : Où ? La mythique Albazino est presque inexistante : une douzaine de maisons basses en bois, des lampadaires de guingois sur la rue principale, des silhouettes d’enfants qui jouent dans la boue. Et c’est tout. Qu’est-ce qu’on fait ici ? « Le musée ! » dit Volodja, comme s’il nous réservait une surprise.
« Les musées en URSS sont comme les églises chez vous. Il faut les visiter pour comprendre le pays », m’a dit un jour le directeur de l’extraordinaire musée de la capitale de Sakhaline, en me guidant à travers ses salles. Outre des photos et des documents sur l’histoire de l’île, il y avait d’intéressantes reconstitutions de la vie de ses premiers habitants, les Aïnous, et une exposition des produits de l’industrie locale moderne. La vitrine contenant les boîtes de sardines et de thon, avec leurs belles étiquettes et soigneusement rangées en grandes piles, était l’une des plus populaires d’après le directeur. « Le musée est le seul endroit où les gens d’ici peuvent voir ce genre de produits ! » Depuis ce jour, je visite religieusement tous les musées soviétiques qui se dressent sur mon chemin.
Celui d’Albazino est artisanal et modeste, mais aussi impressionnant car il est construit sur la berge de l’Amour, exactement là où se trouvait autrefois le fort. Comme le fort d’autrefois, le musée d’aujourd’hui est entouré d’une enceinte d’imposants rondins pointus.
En 1650, se trouvait ici le site d’une petite cité sur la rivière, dit une inscription sur le portail d’entrée. En 1857, les lieux étaient habités par des Cosaques, indique un second. Ces deux dates renferment toute l’histoire de la conquête, de l’héroïsme et de l’entêtement qui ont amené ces régions éloignées à faire partie de la Russie. Voici les faits : nous sommes à environ huit mille kilomètres de Moscou, nous sommes au milieu de la taïga sibérienne et pourtant nous sommes toujours en Russie. « J’ai fondé ce musée pour rappeler le passé aux jeunes », explique Agrippina Doroscina, une vieille femme de quatre-vingts ans qui, dans cet endroit reculé, avec ses propres économies, a tenu à construire son monument à la gloire de la Russie.
Le passé, tel qu’il est raconté à Albazino, est évidemment biaisé, mais la ravissante jeune fille d’une vingtaine d’années, convoquée pour être notre guide et qui arrive pimpante et maquillée dans une robe moulante mise pour l’occasion, l’a bien appris par cœur : « En 1632, les Cosaques ont fondé Iakoutsk, puis leur chef, Khabarov, a poursuivi sa descente le long de l’Amour et il a fondé un fort ici même. Il l’a nommé Albazino, d’après un roi local. Khabarov a vécu ici pendant trois ans. En 1685, le fort a été assiégé par les Mandchous. Huit cents Cosaques le défendaient. Au bout d’un an, il n’en restait plus que soixante. Moscou et Pékin ont décidé d’envoyer leurs représentants dans la ville de Nertchinsk pour négocier un accord et signer la paix. Cependant, durant les négociations, la délégation russe était sous la menace constante des troupes chinoises postées à proximité, et à la fin ses membres n’ont eu d’autre choix que de renoncer à leurs positions. Le fort d’Albazino a ainsi été détruit et, en vertu du traité de Nertchinsk, signé en 1689, toutes les terres au nord de l’Amour sont devenues neutres. Ce n’est qu’en 1857 que les Cosaques sont revenus ici, et grâce à eux Albazino a pu renaître. » La jeune fille, fière d’être arrivée sans accroc au bout de sa tirade, déploie son grand sourire plein de dents dorées.
Dans sa version de l’histoire, la partie la plus tendancieuse est celle où elle qualifie de neutres les terres situées de ce côté-ci du fleuve. Neutres ? Drôle de mot pour dire que les Russes, par le traité de Nertchinsk, ont rendu aux Chinois les terres qui leur appartenaient. Jusqu’à l’arrivée des Russes, toutes les terres au nord et au sud de l’Amour appartenaient à la Chine. Les Russes avaient tenté de s’emparer de celles situées sur la rive nord, sans succès. Du moins jusque-là ! Au XIXe siècle, les Cosaques sont repartis à l’attaque et, profitant de la faiblesse de l’Empire céleste, ont réussi à lui arracher 300 000 kilomètres carrés de territoire.
« Mais n’est-il pas vrai que les Chinois s’étaient établis ici des siècles avant les Russes et qu’ils ont descendu l’Amour avant les Russes jusqu’à Sakhaline ? » demandé-je en cherchant à ne pas paraître provocateur à la jolie fille aux hauts talons et hanches à l’avenant. Elle braque son sourire doré sur moi et me fait taire avec une réponse lapidaire : « Je suis patriote ».
En vérité, pour tous les Russes venus de l’intérieur du pays jusqu’ici – aussi bien les Cosaques du passé que les communistes d’aujourd’hui – le fleuve est devenu la frontière sacrée de la Mère Russie, et ce qui existait avant eux n’appartient pas à l’histoire et ils ne s’intéressent ni ne se sentent concernés par ce qui se trouve du côté chinois, sauf dans la mesure où c’est la seule voie d’accès potentielle du seul ennemi possible.
Il y a quelque temps, des archéologues russes sont venus à Albazino pour faire des fouilles, mais ils se sont bien gardés de chercher des traces des anciennes colonies chinoises et n’ont creusé qu’à l’endroit où se trouvait le fort cosaque. « Pour les Russes, l’histoire ne commence qu’il y a trois siècles », me chuchote Mlle Liu, la journaliste chinoise de l’expédition, tandis que nous quittons le musée. Elle n’a pas tort : il y a mille trois cents ans déjà, ses ancêtres sont arrivés sur ces rivages, ont construit leurs forts et y ont installé leurs mandarins pour prélever, au nom de l’empereur Fils du Ciel, les tributs des populations locales.
L’Amour s’écoule avec indifférence. Du haut du mirador métallique qui se dresse à côté du musée, un soldat soviétique contemple la rive opposée : la Chine éternelle, impénétrable, la Chine ici si proche, mais pour les Russes, le long de l’Amour, aussi lointaine que la lune.
Le soir tombe déjà lorsque nous retournons à Djalinda. Des grappes d’enfants nous attendent à l’affût vers l’échelle du bateau. Certains s’essaient aux deux mots d’anglais qu’ils ont appris à l’école, d’autres veulent simplement observer nos visages, nos chaussures, nos ceintures et nos chemises. Nous sommes la chose la plus exotique qu’ils aient jamais vue. « Vous avez déjà été de l’autre côté ? Vous voudriez y aller ? » demandé-je par le truchement de Sacha. Ils me regardent comme si je parlais du diable. L’autre côté est tabou, interdit. Après quelques hésitations, ils me confient un grand secret : l’année dernière pendant l’hiver, alors que le fleuve s’était transformé en glace, un jeune homme du coin, à la suite d’un pari, s’est habillé tout en blanc et a fait cinq allers-retours entre les deux rives jusqu’à ce qu’un garde soviétique, du haut d’une tour, lui tire dessus, le blessant.
Nous passons notre première nuit à bord de la Propagandist amarrée sous la silhouette noire de l’église en ruines. « C’est aussi ton premier voyage par ici ? » je demande à Sacha. « Oui. Oui. C’est la première fois que je viens. » Peut-être que c’est vrai ; peut-être qu’il n’a jamais été ici même, maisKrsysztof, le Polonais, qui avant Pékin était correspondant à Pyeongyang avec lui, vient de me dire que Sacha parle chinois parce qu’il était officier de l’Armée rouge dans la zone de l’Oussouri.
L’une de ses tâches consistait à rédiger des tracts de propagande antichinoise.
Dimanche 18 août
Il ne se passe rien de particulier, mais le simple fait qu’à l’aube le bateau se mette enfin en mouvement sur l’eau gris-vert suscite une grande émotion et tout le monde, réveillé par le bruit des moteurs, est sur le pont. La rive chinoise surgit de la brume avec son premier village. De hautes piles de fûts fraîchement coupés attendent d’être transportées. Sur la berge, on aperçoit les premiers Chinois, des jeunes hommes en uniforme vert. Les trois journalistes de Pékin sont enthousiastes. « Wǒ shì zhōngguó rén ! Nĭhăoma ! », « Je suis chinois, je suis aussi chinois ! Comment allez-vous ? » crient-ils plusieurs fois. Leurs voix se perdent sur l’eau.
Puis, comme au ralenti, des bras se lèvent pour saluer depuis la rive. Le ciel est chargé de pluie. Les nuages, bas et noirs, rendent encore plus blancs les troncs des bouleaux des forêts silencieuses du rivage. Le navire se déplace à 25 kilomètres heure. Par moments, il serpente littéralement dans la rivière, avec de grands virements de bord qui semblent destinés à éviter les bas-fonds. Des poteaux indicateurs, rouges sur la rive chinoise, blancs sur la rive soviétique, indiquent au capitaine les distances et les passages les plus recommandés. Les villages chinois deviennent de plus en plus nombreux, toujours identiques. Les mêmes rangées de cabanes, les mêmes piles de bois sur la rive, les mêmes jeunes en uniforme vert ployant sous le poids d’énormes troncs. « Station forestière numéro 24 », « Station forestière numéro 25 », lis-je au loin. Je m’aperçois vite qu’il ne s’agit pas de villages ordinaires, mais de camps de travail, de prisons où le régime de Pékin envoie ses opposants pour les « rééduquer ». Je pose innocemment cette question à M. Wang, le « commissaire politique » des collègues chinois, mais celui-ci, au lieu de me répondre, me demande comment il est possible que je connaisse le nom chinois de ces institutions spéciales. J’ai vécu en Chine ? En quelles années ? J’éprouve une grande satisfaction à lui répondre par d’autres questions et à ne pas piper mot sur le fait que, il y a sept ans, j’ai eu moi aussi la chance de connaître ce que signifie être « rééduqué », dans mon cas non pas « par le travail », comme les garçons là-bas, le long de la berge, mais par l’écriture et la réécriture de faux aveux et d’interrogatoires qui ont abouti au bout d’un mois à mon expulsion de Chine.
Sous la surface lisse, l’Amour bout et régurgite. La couleur est verdâtre, parfois brune. Les reflets sont noirs. L’eau est fine et ne charrie pas autant de sable et de boue que les autres grands fleuves d’Asie. Nous passons devant la ville soviétique de Tchernaievo : notre capitaine fait retentir sa sirène et depuis la rive répondent celles des vedettes. Encore une fois, il ne s’agit de rien d’autre que d’une installation militaire. Une très haute tour de garde domine la petite étendue de casernes aux toits en ciment.
Plus nous avançons, plus je constate que les peuplements humains normaux sont rares le long de cette rivière mythique. Il n’y a pas de villages de pêcheurs, pas de marchés. Il n’y a pas de traces des différentes tribus mongoles qui ont vécu pendant des siècles dans cette région, payant tribut d’abord à l’empire chinois, ensuite à l’empire des Tsars. Si on se fie à la littérature du XIXe siècle, c’était encore un fleuve sauvage, mais très fréquenté. Il y avait de célèbres bateaux de ligne qui assuraient un service régulier pour les passagers et les marchandises entre la mer et l’intérieur du pays. Il y avait des points de ravitaillement où les gens faisaient halte.
Tchekhov, lorsqu’il partit de Moscou pour se rendre sur l’île de Sakhaline, alors une épouvantable colonie pénitentiaire qu’il voulait décrire par le menu, fit exactement le même trajet que je suis en train de faire sur un bateau qui, avec sa cargaison de bagnards, transportait également des généraux russes et des fonctionnaires tsaristes en voyage d’inspection.
Aujourd’hui, l’Amour semble plus ou moins désert. Aucun service de transport de passagers ne couvre l’ensemble de son parcours et les seules marchandises que l’on voit passer sont des piles de fûts sur d’énormes radeaux de flottage tellement chargés qu’ils semblent toujours sur le point de couler. Le long des berges, il n’y a que des installations militaires. Les seuls êtres humains qu’on voit ce sont des gardes et des prisonniers. Les seules constructions mémorables sur les deux rives sont les hauts miradors : des loges en bois perchées sur de minces pylônes de fer côté soviétique ; des constructions en béton massif côté chinois.
Un hors-bord de la garde fluviale chinoise s’approche de notre bateau. Les deux soldats viennent très près de nous, nous saluent avec de grands gestes du bras puis s’éloignent à toute vitesse. Il y a comme une volonté de faire croire que tout est normal, de faire croire que les relations entre les gens des deux rives sont à présent particulièrement cordiales. Le capitaine précise que cette attitude est nouvelle, que, jusqu’à il y a quelques mois, les relations avec les Chinois étaient encore très tendues et que la navigation sur le fleuve était très problématique. Il n’y avait pas d’accords précis sur le trafic, les bateaux chinois ne cédaient pas le passage aux bateaux soviétiques et vice versa, et il arrivait souvent que deux navires restent bloqués pendant des heures, l’un en face de l’autre, sans qu’aucun ne bouge.
La vérité est que les Soviétiques ont mené une politique de provocation arrogante à l’égard de la Chine. Moscou refusait d’accepter le principe reconnu internationalement selon lequel, lorsqu’une voie d’eau marque la frontière entre deux pays, la véritable frontière ne se trouve pas au milieu du fleuve – ce qui rendrait impossible le passage de tout bateau – mais au niveau du chenal navigable, déterminé par les hauts-fonds et les courants et qui peut être emprunté par les embarcations des deux pays. La Russie, au contraire, depuis déjà le traité de Pékin en 1860, a toujours soutenu que bien que la frontière soit l’Amour, la voie d’eau lui appartenait et la frontière se trouvait à la rive chinoise.
L’arrivée de Gorbatchev au pouvoir a radicalement changé cette situation. D’abord, en juillet 1986, il y a eu le discours de Vladivostok dans lequel le secrétaire du PC soviétique a reconnu le « chenal navigable » comme la véritable frontière. Ensuite, il y a eu la signature en mai 1990, à Pékin, d’un accord spécifique qui établit kilomètre par kilomètre par où passe cette ligne et à qui appartiennent les centaines d’îles, grandes et petites, situées dans ce fleuve et dans l’autre fleuve frontalier, l’Oussouri.
La courte guerre à laquelle Chinois et Soviétiques se sont livrés sur l’Oussouri en 1969 a été provoquée précisément par le fait qu’après une grande crue, un îlot avait changé de position et que l’on ne savait plus à qui il appartenait. Les Chinois appelaient ce morceau de terre Zhenbao ; les Russes, Damanski.
La récente libéralisation de la vie soviétique a permis de clarifier certains détails de cet épisode, dont on ne disposait jusqu’à présent que de la version de propagande de chaque côté. En mars de cette année, par exemple, le magazine Iounost a publié le témoignage – apparemment véridique – de deux officiers soviétiques ayant participé aux opérations sur l’Oussouri.
Le conflit, qui faisait à l’époque craindre le début d’une guerre à grande échelle entre les deux géants communistes, a commencé lorsque des gardes rouges chinois se sont rendus sur l’île contestée pour y installer des bannières de propagande antisoviétique. « À bas le révisionnisme ! » était le slogan maoïste de l’époque.
Les premiers heurts ont eu lieu à coups de poing et de bâtons, puis on est passé aux armes à feu, puis enfin à l’artillerie. Les Soviétiques ont été les premiers à sortir les canons. Ils avaient perdu un char d’assaut qu’ils devaient récupérer à tout prix car c’était le modèle le plus perfectionné et secret dont disposait leur armée. Équipé pour opérer de nuit et d’une radio capable de capter les communications de l’ennemi, le char, unique dans toute la région, servait à recueillir des informations sur les mouvements de l’opposant. Les Soviétiques lui avaient fait traverser la surface gelée du fleuve pour le poster sur l’île, mais les Chinois, en une contre-attaque rapide, l’avaient encerclé, avaient tué son commandant, capturé le reste de l’équipage et cherchaient à le traîner de leur côté avec tout son matériel secret.
Pour le commandement soviétique, la perte de ce char était un désastre, et les soldats de Moscou ont reçu l’ordre de le détruire s’ils ne parvenaient pas à le récupérer. C’est ainsi que pour la première fois, le BM-21 Grad – « tempête de grêle » – le tout nouveau véhicule de combat soviétique d’alors capable de tirer une grêle de sept cents roquettes en un seul coup, a été utilisée au combat. Pékin n’a jamais précisé le nombre de ses tués dans la bataille, mais il est certain que cette « tempête de grêle » a infligé de lourdes pertes aux Chinois. Cela n’a cependant pas permis aux Russes de récupérer leur char.
La bataille pour Damanski a duré environ un mois. Les soldats des deux camps ont combattu dans les pires conditions imaginables de gel et de glace, mais le char restait intact, là où il s’était arrêté. Puis, une nuit, les Soviétiques ont entendu d’étranges bruits métalliques sur l’île, comme des coups de marteau contre l’acier. À l’aube, ils ont vu que les Chinois avaient réussi à amener une énorme grue et qu’ils essayaient de tracter le char avec elle. Sans succès. Dès qu’ils ont posé la grue sur l’Oussouri, la couche de glace s’est effondrée sous le poids de ce mastodonte et le char a fini au fond du fleuve. C’est ainsi que s’est terminée la bataille, et la guerre tant redoutée entre les deux géants communistes n’a pas eu lieu. Pendant les vingt années suivantes, l’île Damanski est restée déserte, comme si c’était un no man’s land. Puis, après le discours de Gorbatchev à Vladivostok, les Chinois l’ont reprise, ont construit un pont pour la relier à leur rive et y ont érigé un monument à leurs soldats tombés au combat.
Notre expédition doit passer à la confluence de l’Oussouri qui se jette dans l’Amour, et ma demande de visite à Damanski a déjà été transmise, par Volodja, aux autorités chinoises. Nous aurons la réponse lorsque nous repasserons par Khabarovsk.