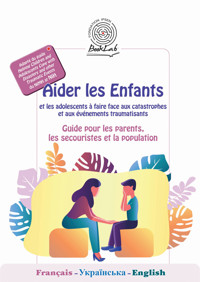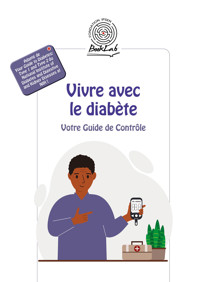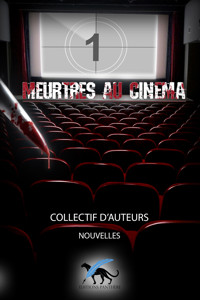Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Connaissances des Pères de l'Église
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Pas toujours très connue, l'Aquitaine, avec son centre de gravité autour de Bordeaux a été une plaque tournante au IVe siècle, avec la christianisation de notables de la région de Bordeaux, qui étaient en lien avec Ambroise, Jérôme, Augustin, Martin de Tours, avec la présencde Sulpice Sévère, l'auteur de la vie de Martin de Tours, de Prosper d'Aquitaine, de Paulin de Nole, de Victorius d'Aquitaine. Une région et des auteurs à découvrir.
la revue CONNAISSANCE DES PERES DE L'EGLISE : plus de 160 numéros CLIQUEZ ICI et TROUVEZ LE VÔTRE
Éditorial
Marie-Anne VANNIERLa christianisation des notables de la région de Bordeaux
Pascal-Grégoire DELAGEPhébade d'Agen
Philippe MOLACPaulin et l'Aquitaine
Janine DESMULLIEZL'Aquitaine de Prosper
Jérémy DELMULLETrois Aquitains remarquables (le Pèlerin de Bordeaux, Sulpice Sévère et Victorius)
Jean-Marc VERCRUYSSEActualité des Pères de l’Église
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Quant à moi, dis-je, il me semble qu’il serait plus juste de demander cela à Gallus, il en sait plus que nous (un disciple peut-il ignorer les actions de son maître ?), et il doit d’abord à Martin, puis à nous, de traiter ce sujet à son tour ; car, pour moi, j’ai écrit un livre ; et toi, Postumianus, tu nous as jusqu’à présent entretenus des miracles des moines d’Orient. Gallus nous doit donc ce récit, et, comme je viens de le dire, c’est à son tour de parler, et, pour l’amour de Martin, il le fera, je crois, avec plaisir.
— Certainement, répondit Gallus, quoique je sois bien faible pour un si grand fardeau ; cependant, excité, par les exemples d’obéissance que vient de rapporter Postumianus, je ne refuserai point la charge que vous m’imposez. Mais, lorsque je pense que moi, Gaulois, je vais parler devant des Aquitains, je crains d’offenser vos oreilles délicates par mon langage peu soigné. Écoutez-moi donc comme un homme grossier, simple et sans fard dans son langage. Car si vous m’accordez d’être disciple de Martin, permettez-moi, à son exemple, de mépriser un style vainement orné et fleuri. »
SULPICE SÉVÈRE, Les Dialogues I, XXVI
Sommaire
Bordeaux et l’Aquitaine
CPE n° 162
Éditorial — Marie-Anne VANNIER
La christianisation des notables de la région de Bordeaux — Pascal-Grégoire DELAGE
Phébade d’Agen — Philippe MOLAC
Paulin et l’Aquitaine — Janine DESMULLIEZ
L’Aquitaine de Prosper — Jérémy DELMULLE
Trois Aquitains remarquables (le Pèlerin de Bordeaux, Sulpice Sévère et Victorius) — Jean-Marc VERCRUYSSE
Actualité des Pères de l’Église
Gaule Aquitaine, du Ier au IIIe siècle, daprès A. Houot
Éditorial
Grâce à Jean-Marc Vercruysse, que nous remercions, nous publions ce beau numéro sur Bordeaux et l’Aquitaine qu’il a organisé et qui prolonge le numéro 54 de notre revue, qui était resté à l’état d’esquisse, en envisageant l’Aquitaine aux débuts du christianisme, ainsi que les courants spirituels dans l’Aquitaine des IVe et Ve siècles.
Ici, c’est une étude de fond qui est menée, en commençant par la christianisation des notables de la région (Pascal-Grégoire Delage). Puis, Philippe Molac présente le premier évêque d’Agen : Phébade, ardent défenseur de la foi de Nicée, proche d’Athanase d’Alexandrie et d’Hilaire de Poitiers qu’il n’a peut-être pas connu personnellement.
Ensuite, Janine Desmulliez, qui est déjà intervenue dans le numéro 123 de CPE, consacré à Paulin de Nole, évoque la vie de celui-ci : son amitié avec Ausone et Sulpice Sévère et sa conversion qui l’amène à s’éloigner d’Ausone qui ne comprend pas son cheminement et à se rapprocher de Sulpice Sévère qui vit une expérience analogue. Ainsi « Nole devient-il un morceau d’Aquitaine en Italie, Primuliacum, un morceau de Campanie en Aquitaine » (p. 35).
Mais si l’on sait que Paulin est né à Bordeaux, il n’en va pas de même pour Prosper qui est désigné comme étant d’Aquitaine, mais qui n’a que des liens lointains avec la région, comme le montre Jérémy Delmulle à partir d’une enquête prosopographique précise.
Finalement, Jean-Marc Vercruysse fait revivre trois Aquitains qui ont marqué le christianisme des premiers siècles : « L’Anonyme de Bordeaux qui inaugure les pèlerinages en Terre sainte, Sulpice Sévère premier hagiographe et historien de la Gaule, et Victorius dont le décompte pascal constitue une étape dans la mise en place du calendrier chrétien » (p. 60), ce qui manifeste le rôle joué, alors, par Bordeaux et l’Aquitaine, qu’il est bon de redécouvrir en l’espace de ce numéro.
Marie-Anne VANNIER
La christianisation des notables de la région de Bordeaux
Depuis son monastère de Bethléem, l’ascète Jérôme s’empressait de répondre en cette année 407 à une nobilis femina d’Aquitaine, la bordelaise Hebydia, dont il loue la foi éprouvée et la glorieuse parenté qui, quoique païenne, s’était illustrée dans le monde des lettres et de la rhétorique. Non sans une pointe d’humaine vanité, Jérôme rappelait à celle qui lui faisait l’honneur d’une lettre qu’elle était la descendante d’une lignée de professeurs que lui-même avait naguère magnifiés dans sa Chronique universelle :
De tes ancêtres, Patera et Delphidius, l’un, avant ma naissance, a professé la rhétorique à Rome ; l’autre, quand j’étais tout jeune encore, a illustré toutes les Gaules par son talent d’écrivain en prose et en vers. Ils sont morts maintenant… Toutefois si je leur accorde une grande éloquence et la science de la littérature profane, j’ai le droit de leur refuser la science de la Loi de Dieu [Ep. 120].
De fait, le petit monde des rhéteurs et grammairiens de Bordeaux s’était découvert au début du IVe siècle une vocation à taille d’Empire, cette promesse d’horizons nouveaux s’étant trouvée confirmée par la suite avec la promotion de leur cité au rang de Praefectura Galliarum peu de temps après la mort de l’empereur Constantin. Les élites locales virent s’ouvrir des perspectives inédites dans les bureaux de l’administration et les tribunaux. Pour les plus chanceux ou les plus méritants d’entre eux, les écoles de Bordeaux allaient devenir une véritable pépinière de gouverneurs et de hauts fonctionnaires. La carrière des lettres – certes étayée par quelques biens fonciers et de puissants réseaux d’amicitas – pouvait faire espérer une carrière prometteuse à l’image de celle du bordelais Aemilius Magnus Arborius. Après avoir exercé ses talents en tant que grammairien et avocat, Arborius parvint à la charge enviée de précepteur auprès de princes impériaux à Constantinople. Un poste de gouverneur était à sa portée quand il fut exécuté lors des massacres de l’été 337 qui suivirent la mort de Constantin[1]. Cette carrière fulgurante annonçait déjà celle de son neveu, Decimius Magnus Ausonius (le poète Ausone, 310-394), qui fut appelé à son tour par l’empereur Valentien Ier à Trèves en 367 pour y devenir le précepteur du prince Gratien[2]. Non seulement les élites urbaines d’Aquitaine accédaient maintenant à des postes à taille d’empire, mais ce mouvement s’accéléra avec l’entrée d’Ausone au Consistoire du Prince. Il atteint son acmé avec la nomination de l’impérial professeur au consulat ordinaire en 379. Ce « moment Ausone », particulièrement bien documenté par nos sources (correspondances, chroniques, codes juridiques…), nous permet à la fois de mieux appréhender l’univers des notables aquitains, mais aussi de saisir quelques aspects du passage d’une partie de cette élite au christianisme. Ce monde des notables était de formation récente à Bordeaux au IVe siècle comme le rappelle Jean-Pierre Bost[3]. Or si son essor fut contemporain des premières mentions d’Églises en Aquitaine, il semble bien que les relations ne furent pas toujours aisées entre élites urbaines en voie de christianisation et ces Ecclesiae qui commençaient à s’implanter localement. Les notables de Bordeaux ou les femmes de leurs clans avaient fâcheusement tendance à chercher bien loin de la Garonne leurs maîtres spirituels.
Un intérêt précoce pour l’Évangile
Bien des notables de l’Aquitaine Seconde sont des gens sans ancêtres encore au milieu du IVe siècle. Ce sont souvent des propriétaires terriens comme la belle-famille d’Ausone, lui-même issu d’un milieu socialement encore plus modeste (son père est un médecin possédant quelques terres du côté de Bazas). Mais l’université offrait maintenant des perspectives inédites et on entrerait alors en rhétorique comme on entre en religion. Les héritiers d’une famille de druides originaire de Bayeux initient une dynastie de professeurs à Bordeaux au début du IVe siècle[4]. Leurs noms (Phoebicus, Delphidius…) témoignent toujours d’un réel intérêt pour les cultes solaires ou apolliniens. Ausone lui-même descend d’un Éduen se piquant d’astrologie et les noms des femmes de la famille (Hilaria, Dryadia…) renvoient encore aux religions traditionnelles.
Les premières traces d’adhésion à la foi chrétienne apparaissent dans ce même milieu dans le deuxième quart du IVe siècle. Si le panégyrique de Constantin délivré à Rome en 321 par le bordelais Nazarius ne comprend aucune référence au christianisme, le moine Jérôme n’en célèbre pas moins son auteur dans sa Chronique (a. 336) et, de façon plus surprenante, cet éloge va s’étendre à sa fille « qui égale son père en éloquence ». Pourquoi une telle mention sous la plume de Jérôme ? C’est le rhéteur Prosper d’Aquitaine qui nous livrera la clé de l’énigme : cette femme – dont Prosper donne le nom, Eunomia –, était une christiana virgo, une célibataire ayant fait le choix de consacrer sa vie au Christ[5]. Eunomia méritait d’être doublement célébrée comme femme lettrée et femme consacrée ! Certes le témoignage est tardif (vers 440), mais Prosper a grandi en Aquitaine et il appartient aux mêmes cercles que Nazarius et Ausone. La présence d’une christiana virgo à Bordeaux vers 330/340 peut apparaître bien précoce pour une Église dont le premier pasteur (Orientalis) n’est mentionné qu’incidemment dans la liste des souscripteurs du concile d’Arles (314). Or, Eunomia n’est pas la seule consacrée d’Aquitaine connue pour cette haute époque. Ausone rappelle qu’une de ses tantes, Aemilia Hilaria, fille de médecin et pratiquant elle-même la médecine, était aussi une virgo devota (Parentalia, 6). La discrétion de Jérôme sur la consécration d’Eunomia est plus étonnante venant de sa part. Il est possible que le mode de vie évangélique choisi par la fille de Nazerius n’ait pas vraiment correspondu à l’idée que le moine de Bethléem s’en faisait… L’histoire d’Eunomia était pourtant bien connue en Gaule et elle reçut l’hommage d’une Laus domna Eunomiae sacrae virginis de la part d’un poète demeuré anonyme pour nous[6].
Au monde des notables appartient encore ce chrétien (ou cette chrétienne) assez fortuné et très motivé qui entreprend en 333 et depuis Bordeaux l’un des tout premiers pèlerinages connus vers Jérusalem, un chrétien suffisamment lettré pour rédiger un itinerarium détaillé à l’intention de ses coreligionnaires. Autre indice de cette acclimatation du christianisme en Aquitaine, la propre sœur d’Ausone, Iulia Dryadia, devenue veuve jeune encore, refusa de se remarier « car la vérité lui était plus chère que la vie. Son unique souci était de connaître Dieu et d’aimer son frère par-dessus tout[7] ». L’engagement religieux de Dryadia se déroula « dans l’austère morale de la vieillesse » alors même que Dryadia n’a pas trente ans et que le remariage était largement encouragé tant pour des raisons sociales qu’économiques[8]. Le choix de Dryadia doit pouvoir s’expliquer par l’adhésion à un christianisme exigeant et rigoureux. Comment l’Évangile est-il parvenu jusqu’aux rives de la Garonne ? Si l’essaimage progressif des Ecclesiae le long des grands axes de communication est bien repérable avec l’apparition des sièges épiscopaux (Bordeaux en 314, Agen en 359, Périgueux en 360…), des cénacles chrétiens ont dû naître aussi de la connexion de ces lettrés d’Aquitaine vivant maintenant à Trèves, Rome ou même Constantinople, et de l’adoption qui s’ensuivit de nouveaux paradigmes religieux et culturels. La virgo Aemilia Hilaria était la sœur d’un homme qui avait fréquenté les cercles palatiaux à Constantinople et le père d’Eunomia avait enseigné à Rome. La proposition chrétienne en Aquitaine put encore être portée par des potentes déjà chrétiens venus participer à la remise en marche de la province après les troubles du IIIe siècle. Ainsi les Pontii Paulini (famille de Paulin, futur évêque de Nole) originaires de Rome ou d’Italie centrale que nous retrouvons tant au nord de Bordeaux qu’à Langon[9]. Or, si un nombre croissant de notables passent au Christ tout au long du IVe siècle, aucun écrit d’Ausone ne fait mention d’un clerc ou d’un évêque alors même que lui-même ne fait pas mystère de son adhésion au christianisme[10].
Tensions familiales et tensions ecclésiales
Delphidius, le beau-père de la correspondante de Jérôme, était resté fidèle aux anciens dieux jusqu’à sa mort. Les conversions s’étaient toutefois multipliées dans son proche entourage. Ausone rappelle que le rhéteur avait essayé – en vain – d’empêcher le mariage de son propre fils Alethius Minervius[11] avec Hebydia, certes riche héritière, mais issue d’une famille chrétienne. L’épouse de Delphidius, Euchrotia, était également chrétienne. Devenue veuve, elle n’hésitera pas à accorder sa protection et un appréciable soutien matériel à l’ascète espagnol Priscillien. Depuis peu évêque d’Avila, Priscillien se trouvait en situation délicate ayant été condamné par un concile tenu à Saragosse en 380. Or, à ce concile réunissant des évêques alarmés par la prédication de l’ascète hispanique avaient pris part Phoebadius d’Agen et Delphinus de Bordeaux. Quand un peu plus tard, Priscillien se rendit en Aquitaine pour y collecter des soutiens politiques, l’évêque Delphinus lui interdit l’entrée de sa cité épiscopale. Cela n’arrêta guère Euchrotia qui l’accueillit dans sa propre villa. Non seulement elle organisa et finança une nouvelle expédition vers Rome, mais elle prit la décision d’accompagner personnellement l’évêque d’Avila en Italie, embarquant dans l’aventure sa propre fille Procula (peut-être une vierge consacrée) et d’autres matrones bordelaises. Manifestement ces femmes liées à l’aristocratie locale n’avaient cure des décisions de leur évêque. Il n’est pas sûr toutefois que la conduite d’Euchrotia et de ses proches ait eu la totale approbation du reste des notables : vingt ans plus tard, Sulpice Sévère rappellera encore l’émoi sans pareil que causa cette conduite jugée scandaleuse[12].
L’engagement d’Euchrotia illustre pourtant bien cet engouement pour un christianisme rigoriste dont Jean-Marie Salamito[13] a montré qu’il devenait un marqueur des élites à la fin du IVe siècle. Magnus Arborius, un neveu d’Ausone et ex-préfet de Rome, le clarissime Meropius Paulinus (Paulin de Nole), ex-gouverneur de Campanie, et l’avocat bordelais Sulpicius Severus fréquentent à la même époque l’ascète Martin devenu évêque de Tours, une figure tout aussi charismatique que controversée au sein de l’épiscopat gaulois. Pourtant c’est à lui et non à l’évêque de Bordeaux que Magnus Arborius demandera de consacrer à Dieu sa propre fille[14]. Sulpice Sévère recueillera dans sa villa de Primuliacum un proche disciple de Martin, Clarus, avant de transformer son domaine en monasterium. Quand le fils d’Ausone devint proconsul à Carthage en 376, son épouse Octavilla se rapprocha des cercles montanistes pourtant considérés comme sectaires en raison de leur intransigeance. Elle s’affichera comme leur protectrice à Rome même, où elle leur obtiendra l’usage de l’église martyriale des saints Martinianus et Processianus au grand dam de l’évêque de Rome qui ne put s’y opposer : l’époux d’Octavilla était alors préfet d’Italie et son propre cousin était préfet de l’Urbs[15].
Un événement inattendu allait toutefois enrayer cette dynamique qui conjuguait conquête du pouvoir par les élites d’Aquitaine et choix d’un christianisme ascétique peu déférent envers les communautés locales. Ayant renversé et assassiné l’empereur Gratien en août 383, le généralissime Maxime rechercha le soutien des évêques gaulois et espagnols. À cette fin, il fit arrêter Priscillien d’Avila dont les partisans et le radicalisme agaçaient nombre de prélats. D’abord déposé lors d’un concile tenu précisément à Bordeaux et très probablement présidé par Delphinus, Priscillien fut ensuite déféré à Trèves et jugé pour sorcellerie. Condamné à mort à la fin de l’année 385, Priscillien fut décapité en même temps que plusieurs de ses fidèles, dont la bordelaise Euchrotia. Il s’ensuivit une véritable chasse aux « visages pâles » et Martin de Tours lui-même fut inquiété. À Bordeaux, une dame de la haute société, Urbica (mère du gendre d’Ausone), fut lynchée par la foule en raison de ses liens avec Priscillien. Les chrétiens rigoristes, tant à Bordeaux que dans le reste de la Gaule, durent faire preuve de la plus grande discrétion. La fille d’Ausone renonça dans ce contexte-là à consacrer à Dieu son fils (le futur Paulin de Pella). La situation bascula à nouveau avec la reprise en main de la Gaule par l’empereur Théodose Ier en 388. Un proche d’Ausone, le bordelais Latinus Pacatus Drepanius, prononça le panégyrique du victorieux Théodose l’année suivante devant le Sénat romain. Toutefois après une courte carrière à la cour de Constantinople, Pacatus revint en Aquitaine vers 395-396 et se consacra par la suite à la poésie religieuse à l’instar d’un illustre contemporain espagnol, Prudence[16]. Au printemps 389, l’ex-consularis Paulin, un proche de Martin, rentrait lui-aussi en Aquitaine et demanda à être baptisé. Détail probablement significatif, ce fut Delphinus de Bordeaux qui le reçut dans l’Église, non Martin de Tours. Peu de temps après, Paulin se retira en Espagne avec son épouse Teresita pour y mener une vie continente et dépouillée, au grand désespoir de son vieux maître Ausone.
La reprise du mouvement ascétique et ses limites
Dans un paysage ecclésial bouleversé par l’exécution de Priscillien et de ses proches, la décision de Paulin et de son épouse (des clarissimes !) apparaît comme symptomatique d’un mouvement de retrait et de rupture avec le monde. Ils sont imités par Sulpice Sévère et son épouse, fille d’un très haut fonctionnaire, le jeune couple disant agir sur les conseils de Martin de Tours. D’Aquitaine, le noble Desiderius et son épouse Serenilla font part à Jérôme de Bethléem de leur conversio opérée en 393. Un ancien gouverneur (iudex), Aper, de concert avec son épouse Amanda, transforme sa villa en petit monastère peu après 396[17]. Non seulement ces couples optent pour une vie radicalement évangélique, mais ce choix impacte l’ensemble de la familia