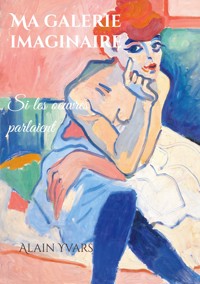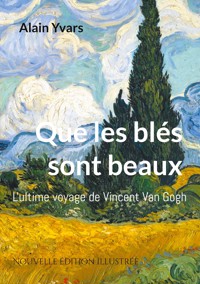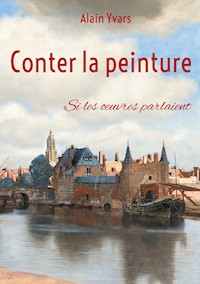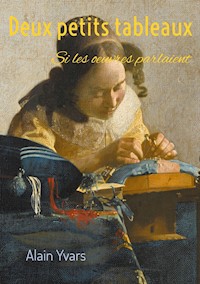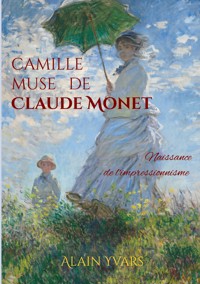
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans son Salon de 1866 pour le journal l'Événement, Émile Zola est enthousiaste : "J'avoue que la toile qui m'a le plus arrêté est la "Camille" de M. Monet. Je venais de parcourir ces salles si froides et si vides, las de ne rencontrer aucun talent nouveau, lorsque j'ai aperçu cette jeune femme traînant sa longue robe et s'enfonçant dans le mur, comme s'il y avait eu un trou... La robe traîne mollement, elle vit, elle dit tout haut qui est cette femme". Le tableau "Camille, La Femme à la robe verte", faisait une entrée remarquée dans la vie et la peinture de Claude Monet. Camille allait devenir sa muse, sa femme. Il ne cessera de croquer sa gracieuse silhouette : changeant de robe comme de personnages dans "Femmes au jardin", flottant dans les hautes herbes d'un champ de "Coquelicots", apparition ascendante dans "La Femme à l'ombrelle". Camille allait se dévouer corps et âme pour que Claude Monet devienne le chef de file des peintres avant-gardistes dont le crédo était la lumière changeante, les sensations fugitives.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au peuple ukrainien qui combat pour la liberté
Monet, ce n'est qu'un œil... mais, bon Dieu, quel œil !
Paul Cézanne
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Elle lui souriait
La rencontre
Un déjeuner sur l‘herbe
Vert… Noir…
Trois femmes pour le prix d‘une
Le spleen
La couleur… Rien que la couleur
Un bel été à Trouville
Une guerre, des voyages
Le bonheur à Argenteuil
Naissance de l’impressionnisme
Au jardin : Camille, un modèle infatigable
Des amis et Camille
La femme à l‘ombrelle
Les dernières années à Argenteuil
Vétheuil
Adieu Camille
Bibliographie
Remerciements
À propos de l‘auteur
Introduction
Elle était si jolie, Camille…
Durant près de quinze années, elle n’a été qu’une silhouette, une passante qui va activer le paysage du couple qu’elle formait avec Claude Monet, le chef de file du groupe des peintres impressionnistes qui avaient la lumière comme unique religion. On retrouve la jeune femme dans de très nombreuses toiles : elle marche, lit, cueille quelques fleurs, sourit à l’homme qu’elle aime, endosse des robes de femmes du monde, parfois des costumes extravagants. Elle est le modèle, la compagne, la mère, la muse…
Que connait-on de Camille Léonie Doncieux née le 15 janvier 1847 à Lyon et qui s’éteindra d’un cancer à 32 ans le 5 septembre 1879 dans une maison longeant les bords de la Seine, à Vétheuil ? Rien, ou presque, de celle dont le visage a marqué l'histoire de la peinture. Peu de choses sur sa famille, « parents assez convenables » note l’état civil, sa personnalité, ses goûts, ses passions, ses désirs. Elle a une petite sœur, Geneviève, de dix années plus jeune. On ne sait ce qu’elle faisait avant de rencontrer Monet. Des hypothèses : modèle, cousette. Se pourrait-il qu’elle ait été en lien avec le monde des comédiens, car elle aimait le théâtre, ce qui expliquerait le naturel de ses poses ?
Étonnamment, tous les documents de l’histoire de sa vie ont été détruits par Monet après sa mort. Il a été rapporté que cette destruction se soit faite à la demande de sa maîtresse Alice Hoschedé qui deviendra sa nouvelle épouse, pathologiquement jalouse de la jeune femme. La certitude sur ce fait est très peu claire… Tout a disparu : plus aucune trace de sa relation avec sa famille originelle, de ses correspondances, photos intimes. Seule, une unique photo de Camille prise en 1871 lors du voyage du couple en Hollande nous est parvenue. Les connaissances sur la jeune femme ne s’appuient donc que sur de rares documents d’époque : courriers des amis peintres du couple et de Claude Monet, des témoignages de critiques et des phrases de Monet lui-même sur sa compagne.
Elle était très belle Camille : petit nez droit, traits fins, visage pâle, presque hautain, moue enfantine. Cette jolie jeune femme brune ne semble nous parler qu'à travers les coups de pinceau de Claude Monet.
Dans plusieurs tableaux des plus importants peintres de cette période, Édouard Manet et Auguste Renoir, des amis de Monet, nous ressentons la sympathie que la femme du peintre, leur amie, leur inspirait et tout l’intérêt qu’ils portaient à la représentation de cet élégant modèle, participante active et enjouée. Le Portrait de madame Monet, daté de 1872, l’un des plus beaux portraits de Camille, peint par Renoir, est celui qui exprime le mieux la personnalité de cette attachante femme que l’artiste a croquée dans les débuts de l’arrivée du couple à Argenteuil. Ils allaient passer leurs plus belles années dans cette ville de la banlieue parisienne.
Tout au long de l’histoire de son couple avec Claude Monet, Camille ne cessera d’être présente dans l’œuvre de son mari. La multitude de tableaux faits de sa compagne intrigue. Il la peignait sous tous les angles, à tout moment, la traquant dans ses moments de solitude rêveuse, assise au soleil dans leur jardin, marchant, élégante, dans les allées. Cette gracieuse figure au regard un peu triste est touchante. Sur les toiles amoureusement peintes par Monet, son apparence, ses sourires, ses poses, figées ou en mouvement, quelques gestes, nous content la femme qu’elle était, plus que de banales correspondances.
Au-delà des documents, le regard pictural de Monet sur sa muse a été le support essentiel de ma réflexion et a donné chair à cette biographie romancée d’un couple indissociable. Camille va y trouver sa place, exister, participer à l’ascension de son génial mari. Ils vont vivre ensemble les moments forts, laborieux, miséreux parfois, de l’avènement de l’impressionnisme, cette vision de l’art qui va révolutionner la peinture académique. La biographie est illustrée par de nombreux tableaux obtenus auprès des grands musées mondiaux qui explicitent le texte.
Nombre des toiles de Claude Monet dans lesquels sa femme est représentée sont des chefs-d’œuvre universellement admirés aujourd’hui. Après sa mort, il ne peindra jamais plus de personnage avec le même intérêt, le même plaisir, le même amour. Plus tard, les personnages insérés dans ses toiles ne sembleront servir que de contrepoint à son travail entièrement tourné vers le paysage. Le sourire de Camille surgira parfois, inattendu, dans une touche de lumière.
Claude Monet – Camille Monet sur son lit de mort, 1879
Crédit: Musee d'Orsay, Paris, FrancePhoto © Photo Josse/Bridgeman Images.
Elle lui souriait
Vétheuil, le vendredi 5 septembre 1879
Un silence glacial a envahi la petite maison encastrée dans la falaise faisant face à la Seine où ils s’étaient installés l’année passée. Les cris habituels des enfants ne résonnent plus.
Il est resté seul à ses côtés. Une lucarne éclaire faiblement la pièce où elle repose sans vie depuis ce matin.
« Camille… Ma chère Camille… Enfin, elle ne souffre plus… »
Claude Monet contemple le fin visage devenu rigide de sa femme. Le regard mouillé, il vient d’accrocher autour de son cou, sous la parure transparente qui recouvre le corps et le lit, le médaillon qu’il avait dégagé du Mont-de-piété. Il l’a ensuite recouvert avec des fleurs.
Une mariée… Le voile en tulle qui enveloppe sa femme lui rend l’apparence de la jeune épouse qui lui souriait, heureuse, le jour de leur union neuf années auparavant.
La tête de la morte a été coiffée d’un bonnet qui lui enserre le front, quelques mèches de cheveux, les joues et le menton. Les yeux clos, elle semble dormir paisiblement dans un au revoir.
Le peintre se surprend à noter machinalement la dégradation des teintes du beau visage rigidifié dans la mort. Un choc de couleurs. Il voit des tonalités de bleu, jaune, gris, mauve. Il estime les ombres, les endroits précis où la lumière se dépose sur le visage, le voile, le lit. Il perçoit la succession des valeurs. La face ravagée de Camille devient une réflexion picturale. C’est plus fort que lui, malgré sa honte, un besoin organique qu’il ne maîtrise pas le submerge.
Il prend une toile vierge suffisamment grande dans le sens de la hauteur ainsi que son équipement de peintre. La toile se couvre de touches immatérielles, de hachures colorées, nerveuses, inhumaines. Des formes estompées, floues, se recréent, rendent une apparence à l’image de ce corps éteint. Monet peint dans une sorte de détachement qui lui donne la sensation inexplicable d’entrevoir un mystère, celui de la vie. Les traits émaciés de la femme qu’il aime envahissent la toile. C’est le plus beau portrait qu’il ait fait d’elle…
La toile fraîche déposée contre le mur, il fixe longuement le portrait de la femme qu’il avait peinte si souvent. Étrangement, il ne l’a jamais sentie aussi près de lui que sur cette toile.
Sous son voile transparent, Camille lui souriait…
Tous les souvenirs des jours heureux lui revenaient en masse… Monet revoyait la gracieuse Camille qui posait inlassablement autrefois : la Femme à la robe verte des débuts de leur rencontre, celle dont l’ombrelle violaçait le visage sur la plage de Trouville, les formes flottantes de sa robe qui foulait les hautes herbes d’une prairie d’Argenteuil piquetée de Coquelicots. Il regrettait aussi de l’avoir transformée en Japonaise grotesque. Quatorze années… Des images de tous ces instants de vie qui leur appartenaient dansaient devant ses yeux.
Il s’assoit face à elle.
C’était hier. Elle existait à nouveau…
La rencontre
Cheveux longs tirés en arrière, visage imberbe, le peintre approche de ses 25 ans en cet été 1865. La chaleur de début d’après-midi est déjà forte.
Claude Monet est installé à l’ombre des feuillages en lisière de la forêt de Fontainebleau, à Chailly non loin du petit village de Barbizon. Un ruban de ciel éclaire le chemin en diagonale, lui donnant une sensation de profondeur. L’artiste étudie le contraste offert par les verts et bruns des arbres que cette coulée de lumière azurée renforce. Il aperçoit la silhouette d’une jeune femme se dessinant à distance. Elle s’avance vers lui sans hésiter et l’aborde d’une voix douce : « Vous êtes monsieur Monet ? Un de vos amis de l’atelier Gleyre m’a fait savoir que vous cherchiez un modèle pour un tableau de plein air. Allez au pavé de Chailly, il y sera, m’a-t-il dit ! »
Le peintre est surpris par cette apparition inattendue. Il apprend que la jeune femme est modèle, arrivée récemment de Lyon avec sa famille. Elle pose souvent pour les peintres. « Mon physique leur plait… Et puis j’aime ça ! », ajoute-t-elle.
La jeune fille se tourne vers la toile : « C’est beau ce que vous faites ! Moins sombre que vos amis. Quelle clarté ! »
Elle parlait d’une petite voie d’adolescente. Pendant qu’elle examinait le tableau, le regard du peintre s’attardait sur elle. Elle était ravissante avec ses cheveux bruns relevés en chignon, la taille bien prise, un nez droit planté dans un visage à l’ovale parfait et une bouche fine qui s’ourlait discrètement de carmin. Charmante, pense-t-il !
Monet explique ce qui le préoccupe actuellement : « Je cherche des figures pour un projet de composition à plusieurs personnages grandeur nature. Ils seront habillés de costumes contemporains, et pique-niqueront dans le sous-bois d’une forêt de hêtres. Un déjeuner. L’esquisse de la toile est bien entamée, mais il me manque des modèles masculins. Mes amis de l’atelier Gleyre, Alfred Sisley, Auguste Renoir et quelques autres m’ont fait faux bond, et j’attends avec impatience Frédéric Bazille. J’ai également besoin d’un personnage féminin. Je souhaite m’inscrire pour le Salon en mars de l’année prochaine. Je crois que j’ai vu trop grand… J’en deviens fou ! »
L’artiste remballe son matériel : « Si vous êtes libre demain matin, venez à l’atelier que je partage avec mon ami peintre Frédéric Bazille, 6 rue de Fürstenberg à Paris. Nous ferons quelques essais de pose. »
Elle lui sourit timidement : « Je viendrai, monsieur Monet. Je serais heureuse d’être votre modèle. Je n’ai que 18 ans, mais je sais poser. Je m’appelle Camille. »
La demoiselle lui parait bien jeune. Monet trouve ses yeux magnifiques. Ceux-ci s’éclairaient de reflets verts dorés lorsque le soleil s’y mirait.
La venue de la jeune femme perturbe Monet. Après son départ, il reste assis sans bouger sur le siège qu’il a utilisé pour peindre. Quel silence pense-t-il en examinant les arbres qui l’entourent. Il aurait bien fait une sieste. La fraicheur de Camille le laisse songeur. Quel joli modèle elle ferait pour ma toile, se dit-il !
Il n’est pas pressé de rentrer. Il se sent bien dans cette forêt. Elle lui rappelle certains lieux de sa Normandie natale où il aimait se promener. Une somnolence mêlée de souvenance s’installe.
Monet n’avait pas vu le temps passer depuis son arrivée à Paris : trois années déjà depuis ses débuts d’apprenti peintre dans l’atelier de Charles Gleyre. Sa vision de la peinture était bien différente de celle du maître dont il supportait mal la tutelle de peintre établi qui lui répétait sans cesse de se « souvenir de l’antique ». Il l’avait quitté assez vite. Il ne souhaitait pas copier les maîtres anciens qui se préoccupaient d’une observation exacte des valeurs, de la justesse du ton, au détriment de la note vibrante, éclatante. Le passage chez Gleyre lui avait permis de sympathiser avec trois camarades de l’atelier : Frédéric Bazille, Auguste Renoir et Alfred Sisley. La même génération tous les trois. Le grand escogriffe de Frédéric Bazille, un Méditerranéen, à peine plus jeune, était le plus proche de lui. Il avait la particularité, pour plaire à ses parents, d’étudier la médecine en même temps que l’art.
Monet avait déjà goûté à la liberté procurée par la peinture en plein air qui lui avait fait découvrir la variation des couleurs en fonction des changements de conditions atmosphériques. Il était tout jeune lorsque Johan Barthold Jongkind et Eugène Boudin l’avaient formé à Honfleur et au Havre. Boudin l’avait entraîné sur la côte normande, chez lui, où ils avaient installé leur chevalet côte à côte. Le maître lui avait dit : « Voilà ton modèle, peint ! » Le gamin avait observé le paysage marin devant eux, puis la toile peinte pas Boudin : il ressentait la clameur du vent et son bruit lorsqu’il se cogne sur les falaises. Il était converti à la peinture de plein air.
Ses nouveaux amis l’avaient suivi dans la forêt de Fontainebleau. Ils s’enivraient de cette liberté, du contact intime avec la nature. Un quatrième mousquetaire, Camille Pissarro, plus âgé, venant de l’académie Suisse, les avait rejoints. Ces cinq-là possédaient le même regard sur un art nouveau : les couleurs bitumineuses, terre de Sienne, noires, ne faisaient pas partie de leur vocabulaire. Une idée les réunissait : une nouvelle conception de la peinture basée sur la prépondérance de la vision. Leur crédo : touche libre, peinture claire, étude en plein air, tons purs appliqués par petites touches d'un jet sur la toile, observation de la lumière changeante modifiant les couleurs, sensations fugitives et éphémères des choses. Cette passion les rendait forts.
Monet avait beaucoup discuté avec Pissarro, l’apôtre du groupe, dont il se sentait très proche. « Regarder le motif plus pour la forme et la couleur que pour le dessin », disait-il. Il insistait : « Il faut peindre généreusement et sans hésitation, car il est préférable de ne pas manquer l’impression première ressentie. Pas de timidité devant la nature, il faut oser au risque de se tromper et de commettre des fautes. Un seul maître : la nature. C’est elle qu’on doit toujours consulter. » Monet comprenait d’autant plus les paroles de Pissarro qu’elles rejoignaient les théories que Boudin lui avait enseignées à Honfleur.
Au printemps de cette année 1865, la petite bande était prête à affronter le jury du Salon annuel parisien. Pour son premier envoi L’Embouchure de la Seine à Honfleur, Monet avait obtenu une excellente critique de « La Gazette des Beaux-Arts ». Il avait gardé précieusement l’imprimé de la gazette : « Le goût des colorations harmonieuses dans le jeu des tons analogues, le sentiment des valeurs, l’aspect saisissant de l’ensemble, une manière hardie de voir les choses et de s’imposer à l’attention du spectateur, ce sont là des qualités de M. Monet qu’il possède déjà à un haut degré ». Le texte final de la critique avait réjoui l’artiste : « Son Embouchure de la Seine nous a brusquement arrêtés au passage et nous ne l’oublierons plus ». L’ami Bazille avait écrit à sa mère : « Monet a eu un succès beaucoup plus grand que ce qu’il espérait. » Même le maître Daubigny l’avait félicité.
Monet est toujours installé sur son siège devant la vision des arbres séculaires de la forêt. « Ce n’était qu’un petit succès, je vais faire mieux », sourit-il, en repensant à ce récent Salon.
Aujourd’hui, seul son Déjeuner compte. Et ce diable de Bazille qui ne répond pas à ses courriers le pressant de venir ! Il n’est jamais là lorsque l’on a besoin de lui celui-là ! Le peintre désire obtenir ses conseils sur la composition du paysage, les personnages à mettre dedans, le lieu de la forêt le plus favorable. La beauté de cette jeune femme venue à lui par hasard pourrait être utilisée dans plusieurs figures féminines : il en a plusieurs en tête, habillées de robes à la mode sous l’Empire qui les mettraient en valeur. Courbet ferait un excellent personnage masculin ?
Le peintre range sa boîte de couleurs, pose son matériel sur son dos, et reprend le chemin menant à la route. La vision des yeux de la jeune fille qu’il venait de quitter l’accompagnait.
Claude Monet – Déjeuner sur l’herbe (fragment central), 1865
Crédit : Musée d'Orsay, Paris, France Luisa Ricciarini/Bridgeman Images
Un déjeuner sur l‘herbe
Que cherche Monet en se lançant dans cette aventure ? La toile définitive appelée Déjeuner sur l’herbe est immense : 27 m2. Un vrai coup d’audace !
Les tableaux qu’il venait d’exposer au récent Salon de 1865, des marines peintes dans sa région du Havre, de modestes formats peints aux côtés de Jongkind et Boudin, l’avaient fait remarquer. « Quelle richesse et quelle simplicité d’aspect », avait commenté un critique. Les encouragements obtenus par le peintre l’étaient moins par ses propres toiles que par le fait que celles-ci étaient coincées de chaque côté de cette Olympia d’Édouard Manet qui avait choqué les critiques : une prostituée de luxe, une courtisane, couchée nue, le regard hautain, un chat noir à ses côtés. Un scandale ! On avait confondu les deux peintres, leurs noms étant proches, au point que cela avait agacé Manet : « Qu’est-ce que ce polisson qui pastiche si indignement ma peinture ? ».
Monet n’a pas de moyens financiers, mais il veut frapper un grand coup. Bazille lui avait expliqué : « Il faut pour être remarqué aux expositions, faire des tableaux un peu grands. » Les formats imposants étaient habituellement réservés aux scènes de l’histoire sainte, de la mythologie ou de l’histoire.