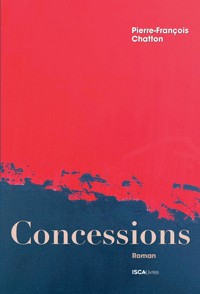
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Dans "Concessions", les héros du roman côtoient au fil des ans des personnages réels, dont des figures de l’Arc jurassien, aimés, admirés ou hais: William Ritter, le chroniqueur excentrique, le romancier talentueux, le dessinateur et photographe provocateur, Le Corbusier, l’architecte génial à la personnalité claire-obscure, George-Alexis Montandon, aventurier, médecin, complice des basses oeuvres du régime de Vichy tombé sous les balles de la Résistance, Marcel Montandon, journaliste et auteur, protégé de William Ritter, arrêté par la Gestapo, les trois frères Loup, pionniers du négoce entre la Suisse et la Chine…
D’une guerre mondiale à l’autre, de Munich à Vladivostok et de Paris à Tientsin, des rencontres improbables, des amitiés indéfectibles, des amours impossibles, des trahisons et des concessions ponctuent ce récit haletant.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste pour la presse écrite et audiovisuelle suisse romande,
Pierre-François Chatton a suivi pendant plus de 30 ans l’actualité internationale. Après "Les Partants", publié en 2021, "Concessions" est son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Avertissement au lecteur
Ce livre est un roman où des personnages de fiction croisent des protagonistes réels.
Leurs dialogues ne sont que pures inventions et servent à faciliter la narration.
Les faits rapportés, comme les dates, s’éloignent parfois de la réalité et relèvent de la seule imagination de l’auteur.
A Elke, ma lectrice préférée
1
1888 * Lausanne
Tout s’était enchaîné si rapidement. Lorsque son patron Jules Favre l’avait convoqué dans un coin du bistrot, Ferdinand craignait le pire. Le chef de cuisine de l’Hôtel de l’Ours à Lausanne avait la réputation de ne pas y aller par quatre chemins. Que pouvait-il lui reprocher ? Après trois ans d’apprentissage, Ferdinand Rosset estimait maîtriser plutôt bien le métier, même s’il reconnaissait avoir encore quelques lacunes dans la cuisson de certains poissons délicats. Il était d’humeur constante. Chaque matin, le sourire aux lèvres, il descendait de sa petite chambre située sous les toits de l’hôtel. Il aimait son travail, appréciait et respectait ce chef qui lui avait sérieusement mis un pied à l’étrier.
– Ferdinand, j’ai une drôle de proposition à te faire. Elle ne m’enchante pas, mais ça serait vraiment bien pour toi.
Anxieux, le jeune cuistot, qui n’avait pas encore vingt ans, croisait ses mains moites. Il ne voyait pas du tout où Jules Favre voulait en venir.
– Je viens de recevoir une lettre d’un ami avec qui j’ai appris mon métier à Genève. Ça remonte à loin, tu vois. Il est chef des cuisines du prince du Monténégro, un pays encore plus petit que la Suisse. Il cherche désespérément un jeune qui pourrait travailler avec lui. Alors j’ai pensé à toi, même si je n’ai vraiment pas envie de te voir partir.
Ferdinand était sidéré. Voilà que son patron, moustaches luisantes et petite bedaine bien enserrée dans sa veste de cuisinier, lui proposait de partir à l’autre bout du monde. Il n’avait jamais entendu parler du Monténégro et se demandait bien comment il pourrait cuisiner pour un prince.
– Vous croyez que je suis capable de faire ça ?
Hochant la tête, le chef sortit la lettre de sa poche et la remit à Ferdinand.
– Tiens, il y a plein de détails sur le travail et sur la vie là-bas. Tu peux également aller à la bibliothèque pour trouver une carte de l’Europe et, peut-être, un livre qui parle du Monténégro. Ou tu peux écrire à mon ami si tu as des questions. Mais réfléchis bien Ferdinand, des occasions comme celle-ci, il n’y en a pas souvent dans la vie. Et comme tu n’as plus personne, rien ne te retient.
La dernière phrase de Favre lui avait fait l’effet d’un méchant coup dans l’estomac. Oui, il était orphelin depuis ses douze ans, depuis que sa mère et son père avaient péri dans l’incendie de la ferme familiale au-dessus d’Aubonne. Brutalement, son horizon s’était assombri. L’enfant unique, espiègle et joueur, le garçon adoré de ses parents, était devenu adulte du jour au lendemain.
Il avait été placé dans une famille protestante, des connaissances de ses parents. Le père était devenu son tuteur. C’est lui qui avait déniché cette place d’apprentissage à l’Hôtel de l’Ours. C’est lui qui l’avait convaincu de se lancer sur cette voie. « Un métier d’avenir, un métier d’équipe aussi, c’est exactement ce qu’il te faut » lui répétait François Golay. Lors de son prochain congé, il irait lui parler de cette surprenante proposition.
François Golay était instituteur. Ferdinand lui avait fait lire la lettre de l’ami de Jules Favre. François avait tiré calmement sur sa pipe, s’était levé comme pour se dégourdir les jambes avant de retrouver son fauteuil aux accoudoirs recouverts de petits napperons.
– Tu peux me croire Ferdinand, ce n’est pas une mauvaise proposition. Tu devrais écrire à ce monsieur pour lui dire que ça pourrait t’intéresser, mais que tu as besoin d’en savoir plus. Où seras-tu logé ? Combien seras-tu payé ? De qui dépendras-tu en dehors de ce chef de cuisine ? De quelle durée sera le contrat et qui paiera ton voyage ? Une fois que tu auras tes réponses, on en reparlera. Et si c’est convenable, je donnerai mon accord en tant que tuteur.
Sans en avoir touché un mot à ses collègues de travail, Ferdinand avait couché par écrit les questions suggérées par son tuteur. Quelques semaines plus tard, il reçut du Monténégro les réponses souhaitées. Il était rassuré et François Golay donna le petit coup de pouce nécessaire pour que le jeune homme ose faire le pas. Et là, tout s’était enchaîné rapidement.
Lors du voyage en train jusqu’à Trieste, Ferdinand avait accumulé plus d’émotions qu’au cours de toute sa vie. Jusque-là, son horizon s’était limité à Aubonne et Lausanne, avec une ou deux excursions au lac de Joux ou dans les Préalpes ainsi qu’une sortie sur le Léman à bord du Bonivard. Maintenant, il traversait une partie de l’Europe afin de rejoindre le port de l’Empire austro-hongrois sur l’Adriatique, pour s’embarquer à bord d’un vapeur de l’Österreichischer Lloyd qui desservait la côte dalmate.
Il était excité à l’idée de cette incroyable aventure dans un pays bien mystérieux, et impressionné par toutes ces choses nouvelles qui le frappaient pratiquement à chaque instant. Par la fenêtre du train, il découvrait une nature qui n’avait rien à voir avec ce qu’il connaissait. La lumière italienne faisait ressembler les paysages à des tableaux pareils à ceux que l’on peut admirer dans des musées. Dans le compartiment, ses voisins parlaient des langues étranges et leurs casse-croutes, déballés d’un panier en osier ou d’une besace, dégageaient des odeurs nouvelles pour le jeune cuisinier. Ferdinand n’en revenait pas.
Son aventure solitaire s’arrêtait à Trieste. Une fois le grand hall de la gare néo-Renaissance traversé, il tendit au cocher un billet avec l’adresse d’une pension. Là, il retrouva deux autres jeunes gens engagés comme lui pour la maison princière – Marcel, un Bourguignon plus âgé – et Rose, une Alsacienne de son âge. Tous trois avaient rendez-vous avec un émissaire du prince, un quinquagénaire qui parlait français avec un accent rocailleux. C’est lui qui allait les accompagner jusqu’à Cetinje, la capitale du Monténégro. Il se présenta : Nicolas, « comme le prince », précisa-t-il immédiatement.
Le bateau appareillait le lendemain à midi, un samedi. Nicolas emmena la petite équipe se restaurer dans une auberge. Le vin aidant, ils surmontèrent leur timidité et commencèrent à faire plus ample connaissance. Rose allait rejoindre l’équipe des gouvernantes. Elle venait d’un petit village près de Colmar et comme Ferdinand, elle découvrait le monde. Marcel avait déjà roulé sa bosse un peu aux quatre coins de la France. Il avait passé près de deux ans dans l’armée et c’est pour ses connaissances militaires qu’il avait été recruté.
Interrogé sur sa maîtrise du français, Nicolas expliqua que c’était la langue de la cour. Il y avait des Suisses et des Français au service du prince et l’homme qui organisait tout ce petit monde venait de Genève.
– Vous allez rapidement faire la connaissance de M. Piguet. Il s’occupe de tout. C’est lui qui m’a appris le français. C’est le professeur attitré de toute la famille. Leur vapeur paraissait bien minable par rapport aux navires qui assuraient la ligne des Indes et du Japon en traversant le canal de Suez, ouvert vingt ans plus tôt. Sur le coup de midi, les amarres étaient lâchées.
– On sait toujours quand on part, mais jamais quand on arrive. Il y a beaucoup d’escales et le voyage n’est pas très confortable. Il faut juste espérer que le temps reste beau et que la bora, ce vent qui vient des montagnes, ne nous secoue pas trop, expliqua Nicolas.
Ferdinand, comme ses compagnons, était impressionné par les manœuvres du navire pour quitter le port. Du large, il pouvait découvrir l’étendue de Trieste, une grande ville entourée de collines avec des immeubles de dimensions impressionnantes d’une blancheur éblouissante.
Contournant l’Istrie puis longeant la côte dalmate, le vapeur mit quatre jours pour atteindre Gravose, le port de Raguse (Dubrovnik). C’est que les escales étaient nombreuses et parfois longues car il fallait débarquer et embarquer, non seulement des passagers, mais également des marchandises ainsi que le courrier. Les ports étaient souvent étriqués et les manœuvres délicates, tout comme la navigation entre les îles qui se succédaient en chapelet. Pas question non plus de naviguer de nuit.
Les trois jeunes recrues avaient tous souffert du mal de mer. Rose avait été la première, Ferdinand l’avait suivie de peu. Peut-être plus solide ou plus vaillant, le Bourguignon avait tenu un peu plus. Finalement, au matin de la dernière journée en mer, ils étaient tous à nouveau sur pied. Le vapeur longea la côte puis bifurqua dans une sorte de défilé étroit. Soudain, la mer ressemblait à un fleuve ourlé par les montagnes avant de se transformer en une sorte de lac encaissé, bordé de quelques maisons dispersées et de petits villages. Deux petites îles, telles des bateaux ancrés, étaient disposées ça et là. Eglises et monastères entourés de cyprès y occupaient la moindre parcelle de terre.
– Nous avons encore une escale à Persato (Perast) mais nous sommes déjà dans les bouches de Cattaro (Kotor). C’est comme ça qu’on appelle ce bras de mer. Là-bas, au fond, c’est Cattaro où nous débarquerons. Le Monténégro, c’est juste derrière ces montagnes. On y sera demain, annonça Nicolas.
En fin d’après-midi, le vapeur avait accosté non loin des imposantes fortifications, souvenir de quatre siècles de domination vénitienne. Le retour sur terre ferme avait désarçonné Ferdinand et ses compagnons. Tout tanguait et leur vue se brouillait. Nicolas leur expliqua que ce mal de terre était tout à fait normal, que cela disparaissait en quelques minutes et qu’il ne fallait pas s’inquiéter.
– On va passer la nuit ici et on va manger dans une auberge que je connais bien. Ce sera bien meilleur que l’infecte nourriture du bateau. Qu’en penses-tu, toi, le cuisinier ? questionna Nicolas.
Ferdinand s’était bien gardé de critiquer la tambouille de l’Österreichischer Lloyd. Il avait pu jeter un coup d’œil aux cuisines et s’était senti pris de pitié pour les marmitons qui devaient jongler dans un espace minuscule, enfumé et sombre. Ceci expliquait cela, pensa-t-il.
Cattaro n’était qu’un gros bourg aux maisons en pierres, serrées les unes contre les autres. Certaines ruelles étaient si étroites que deux personnes ne pouvaient s’y croiser. Malgré sa taille réduite, la petite cité aux confins de l’empire austro-hongrois était un port de commerce très important, d’où une animation permanente. On y parlait allemand, italien, slave et d’autres dialectes balkaniques bien difficiles à identifier. Ce patchwork se retrouvait aussi dans les tenues des uns et des autres. Il y avait du pantalon bouffant, du petit gilet coloré, de la botte et de drôles de couvre-chefs pour les hommes.
Au petit matin, les trois recrues et Nicolas montè-rent à bord d’une diligence surchargée de paquets, de caisses et de malles qui les attendait à proximité du marché monténégrin, juste après le pont-levis. La lente montée commença. Les lacets se succédaient et à chaque virage en épingles à cheveux, la vue sur les bouches de Cattaro s’élargissait. Le spectacle était magique et laissait les jeunes passagers sans voix. Cette route extraordinaire, tracée par la double monarchie, avait déjà plusieurs noms : l’Impériale, la route de l’Empereur, la Serpentine… Elle avait été construite par les Autrichiens pour accéder aux batteries de canons qui devaient défendre Cattaro. Les Monténégrins s’en servaient pour atteindre Cetinje.
Nicolas se lança dans de longues explications, une fois la frontière passée sans aucune difficulté. Qui irait chercher des noises à un convoi « princier »… Il raconta l’importance du Mont Lovtchen où repose Peter Njegos, considéré comme le fondateur du Monténégro. « Vous aurez certainement l’occasion d’y aller. C’est un peu un lieu sacré pour nous ». A Njegusi, un petit village perdu au milieu de la caillasse, Nicolas annonça fièrement que c’est là que le prince régnant était né. Une halte était prévue pour se restaurer et laisser les chevaux se reposer.
Après l’incroyable montée à flanc de coteau, ils s’étaient enfoncés vers l’intérieur des terres et le paysage était devenu presque lunaire. Rares étaient les arpents d’herbe que se disputaient vaches et chèvres. Tout le reste n’était que caillou.
– Vous savez ce qu’on raconte à propos du Monténégro. On dit que lors de la création du monde, Dieu a trébuché, des tas de gros cailloux se sont échappés de son sac et sont arrivés ici. C’est peut-être pourquoi notre pays s’appelle Montagne Noire, Cerna Gora dans notre langue, Monténégro pour vous.
Nicolas rassura aussi ses compagnons. Cetinje se trouve dans une vaste plaine et le paysage y est plus doux. Cetinje qu’ils atteindraient avant la fin de l’après-midi.
Dans la descente vers la capitale, les appréhensions des uns et des autres revenaient. A quoi allait ressembler leur nouvelle vie dans ce pays perdu au milieu des montagnes ? Les villages traversés, la chaussée chaotique, les quelques habitants aperçus ça et là, tout suintait la pauvreté. Rose était la plus prolixe, avouant déjà presque regretter son choix. Marcel essaya de la rassurer, mais paraissait aussi un peu ébranlé. Ferdinand ne s’épanchait pas. C’était le moins loquace des trois.
L’estomac complètement noué, il se demandait pourquoi il avait accepté ce projet. Sans les encouragements de son tuteur, il serait resté sagement à Lausanne. François Golay lui avait tellement répété qu’il devait ouvrir son horizon, découvrir de nouvelles contrées et, pourquoi pas, apprendre d’autres langues, qu’il s’était laissé convaincre. Là, entre deux secousses, il s’en mordait les doigts mais, trop timide, il ne pouvait partager son angoisse avec ses compagnons. Après un virage serré, la plaine de Cetinje se dévoila. On pouvait distinguer la ville, une grosse bourgade plutôt, avec des maisons aux toits plats et quelques bâtisses plus importantes éparpillées. Nicolas désigna l’une d’elle, pas vraiment imposante : « Voilà le palais du prince ! »
2
1888 * Cetinje
La première lettre de Ferdinand était arrivée à Aubonne un peu plus de trois semaines après son départ. Les Golay l’attendaient avec impatience et un peu d’appréhension. Leur jeune protégé avait fait un grand saut dans l’inconnu et ils n’y étaient pas pour rien.
Cetinje, le 20 septembre 1888
Chère Madame Golay, cher Monsieur Golay,
Voici enfin de mes nouvelles. Le voyage a été long, surtout sur le bateau mais c’était beau. J’ai été malade comme les autres, néanmoins ça n’a pas duré. A Trieste, j’ai retrouvé deux Français qui allaient aussi travailler ici et on avait un Monténégrin qui parlait assez bien le français comme guide.
Le pays est perdu dans les montagnes, un peu comme la Suisse, seulement c’est encore pauvre. Il n’y a pas de train et les routes sont affreusement défoncées et poussiéreuses.
Cetinje, la capitale, est une bourgade de la même taille qu’Aubonne, sauf que c’est plat. Le palais du Prince n’est pas un château comme le nôtre. C’est un grand bâtiment, peut-être le plus grand de la ville, pourtant il n’y a même pas une tour ou un donjon. Le prince, il s’appelle Nicolas Ier, je l’ai déjà rencontré. Il parle vraiment bien le français car il a été au collège à Paris. On peut le croiser en ville et, une fois, il est même passé dans les cuisines.
Dans la famille princière, ils sont très nombreux. La princesse a eu douze enfants dont deux sont morts et la plus âgée est déjà mariée. La brigade de cuisine est bien organisée. Elle est dirigée par l’ami de Jules Favre qui s’appelle Marcel Duchemin. Il vient de Genève. On est trois cuisiniers et un pâtissier et on est aidés par des commis et du personnel local. Tout le monde est gentil avec moi.
Je loge dans une maison réservée au personnel du palais. C’est à quelques minutes à pied. J’ai une petite chambre pour moi tout seul. Je me plais bien ici même si j’ai un peu l’impression d’être au bout du monde.
Voilà, je dois retourner au travail pour le repas du soir.
Je vous envoie mes meilleurs messages du Monténégro.
Votre Ferdinand
Ce que Ferdinand n’avait pas encore découvert, c’est l’incroyable animation régnant dans la petite capitale. Les naissances, fiançailles et les mariages rythmaient la vie des Nejgos-Petrovic. Là-dessus venaient se greffer des visites officielles car le Monténégro était reconnu par les principales puissances, des cérémonies diverses sans parler de la célébration de fêtes religieuses, nombreuses chez les orthodoxes. Chaque événement était l’occasion d’organiser un banquet, de servir des mets raffinés et des vins de qualité.
Jules Favre l’avait prévenu : « Marcel Duchemin est une grande gueule, un vrai Genevois mais c’est une bonne pâte ». Effectivement, on entendait parfois le chef lâcher une réprimande sur un ton exaspéré. « Combien de fois faudra-t-il que je le dise ! Il faut vérifier toutes les heures si nous avons suffisamment de glace. Il fait chaud et les aliments doivent être gardés au frais. Evitons de décimer d’un coup toute la famille… ».
Ferdinand n’en revenait pas. On concoctait dans cette cuisine princière des plats dont il n’avait jamais entendu parler, sauf dans les livres. Etonné, il s’en était ouvert à Marcel Duchemin.
– Le prince Nicolas a vécu plusieurs années à Paris dans sa jeunesse. Il a découvert la cuisine française qu’il apprécie et il a décidé de la faire servir à sa table ; c’est pour cela que nous sommes là.
– Mais il n’y a pratiquement pas de magasins ici et on voit bien que les Monténégrins mangent une cuisine très simple. Comment faites-vous ?
– On commande beaucoup de marchandises à l’étranger, en France, en Italie ou en Suisse. Je fais même venir des conserves de Lenzbourg. C’est une très bonne fabrique que tu connais sans doute. Tout vient par bateau – certainement le même que tu as pris – puis par la route. Il y a aussi de bons produits de base ici.
Marcel Duchemin raconta l’histoire d’un laitier, originaire d’un petit village du pied du Jura vaudois, devenu le fromager du prince. Un peu aventurier, ce Charles Crausaz était arrivé un beau jour à Cetinje. Il avait été surpris de ne trouver comme fromage qu’une sorte de tomme un peu sèche et beaucoup trop salée. Sacrément culotté, il avait réussi à interpeller Nicolas, par quelque chose comme : « Ça ne vous dirait pas d’avoir de bons fromages par ici ? ». Le prince s’était vite laissé convaincre par ce drôle de personnage qui s’adressait à lui en français avec un solide accent vaudois. Rapidement, il avait mis des locaux et du matériel à disposition de Charles Crausaz, à condition qu’il forme un ou deux jeunes Monténégrins.
– Il est reparti il y a quelques mois pour ouvrir une école de laiterie au-dessus de Cannes, dans le sud de la France. Les jeunes qu’il a formés travaillent vraiment bien. On a des fromages frais de brebis, de chèvre ou de vache. Ils font aussi une sorte de gruyère. Comme ça, plus besoin de les faire venir de l’autre bout du monde…
Ferdinand s’était mis à cette cuisine raffinée, assez éloignée des plats rustiques qu’il préparait à l’Auberge de l’Ours. Il avait fait de grands progrès dans la cuisson des poissons, surtout des carpes et des truites, celles que l’on pêchait au lac Scutari à la frontière avec l’Empire ottoman. Le travail ne manquait pas, car un repas marquant un événement comportait facilement deux entrées, un plat principal, fromages et desserts. Pour ce qui était de la table familiale, la princesse Milena donnait des instructions très précises. Elle avait des goûts plus simples que Nicolas.
Parfois, en fin d’après-midi, deux jeunes curieuses se glissaient discrètement dans les cuisines. Elena, quinze ans, et Anna, quatorze ans, tournaient autour des cuisiniers, s’enquéraient des plats en préparation et parvenaient à se faire offrir un petit morceau de fromage ou une douceur. Des deux princesses, Ferdinand préférait Anna. Elle dégageait une douceur incroyable alors que son aînée était un peu survoltée.
Au terme d’une journée de travail, Ferdinand était éreinté. Généralement, il regagnait tout de suite sa chambre et s’écroulait sur son lit. De temps à autre, il acceptait de partager un verre d’alcool de prunes avec ses collègues. La discussion tournait autour des petites histoires de la cour.
– La princesse Milena, l’épouse de Nicolas, a eu son premier enfant, Zorka, à dix-sept ans. Et elle était mariée depuis peu avec le prince. On raconte que le mariage avait été arrangé par les parents alors qu’elle n’avait que six ans. Et Zorka, elle, a déjà trois enfants à pas encore vingt-cinq ans. Certains sont même plus âgés que les deux cadets de leur grand-mère, c’est incroyable ! poursuivit Antoine, le pâtissier qui était intarissable sur les potins.
Ces sujets de conversation revenaient lorsqu’il croisait d’autres personnes au service de la famille. Rose, la jeune Alsacienne avec qui il avait fait le voyage, était une vraie pipelette. Elle s’intéressait surtout aux deux garçons, le prince héritier Danilo qui allait avoir dix-sept ans et le petit Mirko, bientôt dix ans. Elle s’occupait du ménage et du rangement de leurs chambres, donc elle était aux premières loges.
Ces histoires ne passionnaient pas beaucoup Ferdinand. Il avait surtout hâte de mieux connaître cette petite ville où de nombreuses maisons imposantes sortaient de terre. Plusieurs pays – la France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Russie – construisaient leur ambassade. Il avait plaisir à parcourir la rue principale bordée d’arbres et aimait s’arrêter pour boire une bière à la taverne Dubravka. Parfois, il allait jusqu’au monastère orthodoxe consacré à la naissance de la Vierge. Il adorait cette ambiance particulière, les magnifiques icônes colorées et ces odeurs d’encens. On était bien loin de l’austérité du protestantisme dans lequel il avait été élevé. Dans ces moments, il se recueillait en souvenir de ses parents.
3
1893 * Triesch
Vienne ou Munich ? Karl pour son père allemand, Karel pour sa mère tchèque, avait dû choisir. Il venait de terminer la Hochschule d’Iglau (Jihlava) et son ambition était d’être architecte. La capitale du Royaume de Bavière et celle du double empire rivalisaient. Dans les deux villes, on investissait dans la pierre, on édifiait des immeubles, perçait des avenues prestigieuses et bâtissait théâtres et opéras. Comment faire son choix ? Les facultés d’architecture de l’une comme de l’autre avaient bonne réputation. Finalement, Karl Sailer opta pour la Bavaroise qui serait, peut-être, un peu moins engoncée dans la bourgeoisie et les fastes impériaux que l’Autrichienne.
En fait, ce qui comptait pour lui, c’était bien sûr d’entamer des études supérieures, mais avant tout de quitter sa petite ville de Triesch (Trest), sur les hautes terres de Bohême-Moravie, à une quinzaine de kilomètres au sud d’Iglau (Jihlava). Il y avait grandi, un pied dans chaque culture.
Il était le fruit d’un mariage mixte, encore rare à l’époque, d’où ce double prénom. A l’école comme à l’église, il était Karl. Mais pour ses camarades allemands, tchèques ou juifs, il était Karel. Le tchèque était la langue de la rue, celle aussi avec laquelle il se confiait à sa mère. Son père était technicien dans une usine textile des environs appartenant à des Allemands. Sa mère était très impliquée dans la paroisse. Elle y côtoyait la baronne Sternbach dont la famille – des Autrichiens d’origine – habitait le château Renaissance qui trônait au milieu de la bourgade.
Pour un jeune homme de dix-neuf ans, Triesch suait l’ennui et Iglau paraissait un peu étriquée. Munich serait sa ville, se promit-il lorsqu’il débarqua du train sous l’immense marquise de la nouvelle gare. Son père lui avait trouvé une chambre dans une famille de lointains cousins installés dans le quartier de Schwabing. Une chance ! L’Académie royale des Beaux-Arts était toute proche.
Pour se donner plus de contenance et parce que sa pilosité s’était finalement développée, Karl – à Munich pas question de s’appeler Karel – se laissa pousser la moustache. Il gommait ainsi ce côté d’adolescent grandi trop vite et suivait la mode du moment. Il osait enfin pénétrer dans un café ou une brasserie et même s’engager dans une conversation animée avec des jeunes de son âge, voire avec des hommes plus âgés. Son corset de provincial cédait petit à petit.
Il se gardait bien de décrire à ses parents la frénésie qui régnait à Schwabing. Dans ses lettres, il évoquait ses études, parlait de ses professeurs et racontait ses balades dans différents quartiers de la capitale bavaroise. Il préférait s’étendre sur les trajets en tramway – ce drôle de wagon tiré par des chevaux qui circule au milieu des routes en pleine ville – plutôt que d’évoquer les débits de boisson où il avait commencé à prendre ses habitudes. Il partageait de manière détaillée ses découvertes musicales.
Karl était devenu un habitué des concerts Kaim, proposés par un célèbre fabricant de piano de Stuttgart. Il y trouvait des places à des prix qui convenaient à sa bourse d’étudiant. Il se familiarisait avec la musique, bien aidé par une voisine de fauteuil dont il allait rapidement tomber amoureux.
– Je suis viennoise et je vis à Munich depuis un peu plus d’un an. J’étudie la musique, le violon, au conservatoire. Et vous ?
Un peu sidéré par le culot de cette jeune femme qui devait être à peine plus âgée que lui, Karl n’eut que quelques secondes pour affiner son profil.
– Karl Sailer – on m’appelle aussi Karel – je viens de Bohême. En fait, nous sommes compatriotes. J’étudie à l’Académie des Arts. J’aimerais être architecte. Mais je n’ai pas bien compris votre prénom…
– Magda…
La musique venait de reprendre, interrompant ce premier échange. Karl était tout chamboulé. Cette jeune femme aux yeux verts, au joli visage saupoudré de minuscules taches de rousseur, dégageait un charme extraordinaire. Elle vivait la musique et les émotions qu’elle percevait l’animaient. Un sourire s’esquissait, un haussement de sourcils se dessinait, un pied marquait la mesure et, parfois, sa respiration s’accélérait. Karl Sailer ne voyait plus qu’elle.
Après un troisième rappel, il fallait quitter la salle. L’envie ne manquait pas à Karl de proposer à Magda de la raccompagner sans avoir la moindre idée de l’endroit où elle habitait. Mais était-ce bien convenable après un si modeste échange ? Magda prit les devants.
– Mercredi prochain, il y aura un autre concert de l’orchestre Kaim. La symphonie numéro 1 de Gustave Mahler. Vous y serez ?
– Mahler, il vient d’Iglau. C’est là que j’ai étudié.
Karl assura qu’il ferait tout pour y être.
Ces sept jours d’attente avaient été un enfer. Karl avait bien échangé quelques baisers avec des filles pas trop farouches de Triesch. Mais sans plus. A Munich, l’idée lui avait traversé l’esprit de fréquenter une maison close, histoire d’être dégourdi. Un peu par manque d’argent et beaucoup par timidité, il y avait renoncé. Voilà que pour la première fois de sa vie, il sentait qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire. Jamais il n’avait vécu un tel bouillonnement intérieur. Même sa logeuse lui fit remarquer que son regard n’était pas le même que d’habitude. Les yeux brillants de Karl lui avaient fait craindre un accès de fièvre. Il l’avait rassurée.
A cette excitation se mêlait l’appréhension. Magda éprouverait-elle aussi des sentiments pour lui ? Il se rassurait en se disant qu’elle ne lui aurait pas proposé de la rejoindre au concert du mercredi si cela n’avait pas été le cas. Que savait-il d’elle ? Pratiquement rien, mais quelle importance !
Ces questions se bousculaient dans sa tête. Il avait bien de la peine à se concentrer sur ses cours et n’avait même plus goût à boire une bière dans une de ses brasseries favorites. Que ce mercredi lui paraissait loin !
4
1893 * Cetinje
Cinq ans ! Cinq ans déjà que Ferdinand passait l’essentiel de sa vie dans les cuisines princières. Malade, Marcel Duchemin s’était résigné à rentrer à Genève à la fin de l’hiver 1891. On pria Ferdinand de le remplacer, le temps de recruter un nouveau chef.
C’est Charles Piguet qui était intervenu. Encore un Genevois, très austère, qui remplissait depuis une douzaine d’années de nombreuses fonctions importantes auprès de la cour. Engagé au départ comme précepteur des petits princes, il avait été promu gouverneur civil des enfants puis secrétaire du prince. Manifestement, Charles Piguet supervisait la vie du palais. Il accueillait des ambassadeurs ou des délégations étrangères pour des banquets qu’il présidait, ce qui l’amenait à être en contact assez étroit avec les cuisines.
Le cheveu très foncé, moustache et barbe soigneusement taillées, redingote impeccable, Charles Piguet dégageait une autorité naturelle. A de nombreuses reprises, Ferdinand l’avait vu lever son index droit en fixant un des petits princes pour être sûr d’être obéi. Pas besoin d’élever la voix.
On savait peu de choses sur lui tant il était discret. On disait qu’il avait fait des études de médecine et on racontait qu’il prenait tous les matins un bain d’eau froide, quitte à briser la glace qui s’était formée sur les seaux d’eau.





























