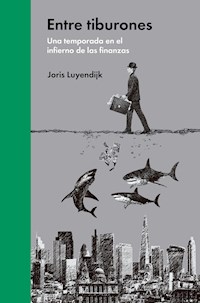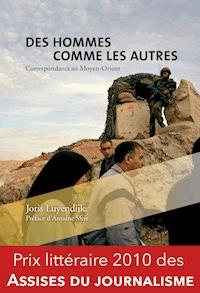
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Un témoignage percutant et pertinent sur le traitement de l'information par les médias. Ancien correspondant au Moyen-Orient, Joris Luyendijk décrypte dans ces pages savoureuses mais sévères le travail des médias lorsqu’ils sont confrontés aux dictatures et aux conflits de cette région du monde. Il nous éclaire sur le fossé énorme qui existe entre ce qu’il observait chaque jour sur le terrain et ce qu’en rapportaient les journaux, la radio et la télévision. Il explique ainsi pourquoi les médias ne parviennent à donner de cette région qu’une image partielle, altérée ou filtrée et par conséquent pourquoi il nous est si difficile de la comprendre. Mais ce livre va plus loin : en révélant le manque cruel de journalisme objectif, il est un appel à la vigilance et à la curiosité des lecteurs, deux vertus cardinales dans un monde saturé d’informations, où certains n’hésitent pas à détourner les mots et les images pour en faire de véritables armes de guerre. Incroyable succès critique et commercial, Des hommes comme les autres a été traduit en neuf langues et a obtenu le Prix des Assises du Journalisme en 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Présentation du livre
Ancien correspondant au Moyen-Orient, Joris Luyendijk décrypte dans ces pages savoureuses mais sévères le travail des médias lorsqu’ils sont confrontés aux dictatures et aux conflits de cette région du monde.
Il nous éclaire sur le fossé énorme qui existe entre ce qu’il observait chaque jour sur le terrain et ce qu’en rapportaient les journaux, la radio et la télévision. Il explique ainsi pourquoi les médias ne parviennent à donner de cette région qu’une image partielle, altérée ou filtrée et par conséquent pourquoi il nous est si difficile de la comprendre.
Mais ce livre va plus loin : en révélant le manque cruel de journalisme objectif, il est un appel à la vigilance et à la curiosité des lecteurs, deux vertus cardinales dans un monde saturé d’informations, où certains n’hésitent pas à détourner les mots et les images pour en faire de véritables armes de guerre.
Incontournable. Merci confrère !
Antoine Sfeir, Les Cahiers de l’Orient
Ce livre a changé la manière dont les gens perçoivent le Moyen-Orient et les médias.
Financial Times
Un révélateur de nos mœurs journalistiques.
NRC Handelsblad
Après des études aux universités d’Amsterdam et du Caire, Joris Luyendijk (1971) a travaillé comme correspondant au Moyen-Orient pour de grands titres de la presse néerlandaise. En 2006, il a été élu « journaliste de l’année » par un panel des plus influents journalistes internationaux.
Pour mon père
« ... Alors je dis : Oui, Dieu, je voudrais quand même savoir, hein, Dieu. La faim, la misère, les maladies, les catastrophes. Pfff..., les enfants maltraités, la pornographie infantile et l’Holocauste. Pourquoi ? Et Il dit : Ben oui, pour ci et pour ça, et ceci et ceci et ceci et ceci et cela. Alors je dis : Ahaa ! Oui, en effet. Ouiouioui, mais oui. Naturellement... Non, à présent je comprends. Au fond, ça va encore, non ? »
— Hans Teeuwen, Trui
« Il y a une guerre entre ceux qui disent qu’il y a la guerre et ceux qui disent qu’il n’y en a pas. »
— Leonard Cohen, There’s a War
Préface
J’ai lu le livre de Joris Luyendijk et j’ai commencé par revêtir mes habits de journaliste, ancien correspondant de guerre, ancien envoyé spécial, ancien homme de terrain...
Au fil des pages, les souvenirs m’assaillaient. Non pas ceux des scoops et des hauts faits d’exploits journalistiques, mais plutôt ceux de la manipulation subie, des mensonges, de la corruption, de la déférence vis-à-vis des « grands de ce monde » et surtout ce goût amer lorsqu’à la fin d’un article, au moment d’y apposer sa signature, on ressent plus qu’on ne comprend qu’on est en train de passer à côté de quelque chose d’important.
Le métier de correspondant est un métier à part dans le monde journalistique, et encore plus celui de correspondant dans le monde arabe. Il ne s’agit pas d’effectuer un simple reportage, résultat d’un bref séjour de quelques jours dans un pays occidental dont on partage au départ la culture et la manière de vivre ; il lui faut pénétrer un monde étrange et étranger.
Étrange, parce que les traditions populaires y sont différentes, la religion — quelle qu’elle soit — omniprésente, parce que les symboles y apparaissent plus importants que le verbe et les actes, parce qu’enfin le regard de l’Autre y est différent de celui auquel nous ont habitués nos compatriotes ou autres Occidentaux : regard chargé à la fois de curiosité et d’envie, de méfiance et de crainte, de suspicion et d’effroi... Il devra le plus vite possible décortiquer les discours chargés de mensonges flagrants, désamorcer les enchevêtrements complexes charriés par les appartenances tribales, claniques ou familiales, rapporter les faits mais en même temps les expliquer avant de les analyser : tout cela nécessite un long travail de préparation dont le premier sans doute aucun est d’apprendre la langue. C’est précisément ce qu’a fait Joris Luyendjik !
La langue est le chemin le plus sûr vers la nébuleuse qu’est la pensée, celle d’un homme ou d’un peuple. Pour un correspondant, c’est la clef pour ouvrir les portiques d’une société et permet de traverser les pièces en constatant leur diversité, leur pluralité et leurs différences. Il en est de même du monde arabe, unique dans ses fantasmes et son imaginaire, mais tellement éclaté dans sa réalité.
Le mérite de notre confrère Joris Luyendijk est d’avoir sans doute voulu éviter l’écueil de l’autosatisfaction : après cinq ans passés au Proche-Orient, ce n’est point un livre sur le Proche-Orient qu’il a écrit — même si cela était son ambition première — accompagné de certitudes péremptoires et de jugements définitifs, mais un merveilleux ouvrage plein de lucidité et d’humilité sur notre sacré métier.
Il nous livre un regard sans complaisance sur la manière dont s’exerce ce métier dans les pays arabes, sans porter de jugement, mais en mettant en exergue la peur du journaliste local et aussi sa dépendance du régime ou du petit chef du régime qui lui-même a peur de son supérieur hiérarchique ; il a ce regard froid sur la réaction des rédactions européennes qui demandent souvent l’impossible à leurs correspondants sur place, prouvant s’il en était besoin qu’elles étaient totalement déconnectées de la réalité du terrain.
Ce regard lucide lui fait montrer du doigt les insuffisances de notre métier, ses lacunes et parfois même son instrumentalisation : sa merveilleuse approche linguistique du conflit israélo-palestinien nous rend affreusement petits. Tout y passe : occupation, libération, dictature, faucons contre extrémistes, colombes contre modérés... Merveilleuse litanie qui nous est directement destinée à nous, journalistes, plus encore qu’à l’opinion publique. Mais le message est clair : nous nous faisons manipuler et nous manipulons à notre tour nos lecteurs, nos auditeurs ou nos téléspectateurs.
Ce livre est rafraîchissant et incontournable. Au fil des pages, mes habits de journaliste ont pris l’allure de haillons ; ceux du Proche-Oriental que je suis également, qui, en dépit de quarante ans de métier, a encore du mal à garder la distanciation vis-à-vis des événements, à ne pas s’impliquer à demeurer neutre, sinon objectif.
Y a-t-il un journalisme (presque) parfait dans ce monde ?
Merci confrère !
Antoine Sfeir
Directeur des Cahiers de l’Orient
PrologueHello everybody !
« Encore un ? »
Le coordinateur de Médecins Sans Frontières sortit du baraquement et examina ses bottes. Je hochai la tête et sentis qu’il fallait que je fasse quelque chose, vite. Sans quoi, au prochain baraquement, je ne pourrais empêcher mes larmes de dégouliner sur mes joues blanches, et ça, je ne le voulais à aucun prix.
C’était un jour pluvieux de septembre et j’errais à Wau, un village du Sud-Soudan, une région qui dans les journaux était décrite depuis vingt ans comme « ravagée par la famine » ou « déchirée par la guerre civile ». Quelque part de l’autre côté de la rivière se trouvaient les rebelles. De notre côté, Médecins Sans Frontières avait aménagé un camp pour les « réfugiés affamés ». Un cessez-le-feu régnait, quoique précaire.
« Tu es sûr que tu veux le voir ? », m’avait demandé un collègue expérimenté, à Khartoum, la capitale. « D’une façon ou d’une autre, les camps de la faim, ça te bouscule le disque dur. »
Un autre m’avait conseillé de me mettre sur « pilote automatique » :
« Demande-toi uniquement : cela peut-il servir ou non à mon reportage ? »
Ce que le coordinateur de Médecins Sans Frontières venait de me montrer dans les deux premiers baraquements était parfait pour mon article. Cela correspondait exactement aux spots de Novib1 au journal télévisé : des petits ventres d’enfants dont je savais depuis mes primaires que c’est la faim qui les fait gonfler, des os saillants sous la peau, comme des piquets sous une toile de tente à moitié couchée par le vent, des bambins si décharnés que leurs mères doivent sans cesse leur soutenir la tête pour que leur nuque ne se brise pas. Excellent pour mon article.
Le coordinateur et moi passâmes près d’un poster. Au-dessus d’un dessin représentant des soldats en train de piller des civils impuissants, on pouvait lire : « Ne vous battez pas contre la population civile ». Le village où se trouvait le camp était fermé. Au café La Pureté Islamique, au lycée Pape Jean-Paul, à l’épicerie Nazareth, au Bureau d’Enregistrement des Paroles d’Honneur et des Promesses, les volets étaient baissés, les portes obstruées de planches clouées et des réfugiés étaient assis dans les vérandas. On trouvait de tout à cet endroit : réfugiés, villageois, croyants au Christ ou en Allah, aux esprits ou aux dieux des arbres.
Nous louvoyâmes entre flaques et détritus vers le troisième baraquement. Là aussi se trouvaient cinquante personnes au regard vide, se protégeant de la pluie, pleurant leurs morts, attendant la prochaine distribution alimentaire. Elles avaient l’air de ne pas me voir, comme si quelqu’un avait éteint la lumière dans leurs yeux. Je notai « éteint » dans mon carnet.
Nous arrivâmes. Dans les premiers baraquements, je m’étais composé un visage sérieux et m’étais légèrement incliné pour me donner une contenance et dominer mes larmes, mais là, dans un réflexe, je levai la main, grimaçai un sourire et lançai : « Hello everybody ! »
Le déclic. La lumière se fit soudain. Des petites filles se mirent à rire, un petit vieux se déplaça et des enfants tentèrent d’attirer l’attention de leur mère, l’air de dire : « Regarde maman ». Un bambin d’un an ou deux ans se libéra de sa sœur, agrippa mes genoux de ses menottes et tomba à la renverse. Les mères portant des gamins faméliques furent prises de fous-rires et saluèrent en agitant leur main libre.
Voilà comment débuta, en 1998, ma carrière de correspondant au Moyen-Orient. Cinq passionnantes années plus tard, c’était terminé. Pendant que mes effets personnels étaient acheminés vers les Pays-Bas dans un conteneur, je fis une petite tournée d’adieu de mes « contacts », ces personnes à qui je devais un visa, un mot d’introduction personnel ou d’autres services. Le dernier sur ma liste était un ambassadeur arabe. Nous prîmes le thé dans son imposante maison à La Haye et je fis une dernière fois mon petit numéro de « je parle arabe, écoutez voir ».
L’ambassadeur se dit surpris du moment choisi pour cesser mes fonctions, à l’heure où les Américains marchaient sur Bagdad. Je lui expliquai que j’avais voulu arrêter plus tôt, mais qu’à cause de la guerre, j’avais prolongé de quelques mois. Un assistant entra dans la pièce, chuchota quelque chose à l’oreille de l’ambassadeur et brancha la télévision sur CNN. Nous vîmes comment, sur la place Fardous (place du Paradis), on abattait la statue colossale de Saddam Hussein. Des Irakiens criaient leur joie devant la caméra et frappaient la statue avec des chaussures. « Thank you mister Bush ! » Solennel, le présentateur parla d’« un moment historique ». C’était la fin de la guerre, le cauchemar Saddam était passé, « Bagdad fête la libération ». L’événement ferait également la une des journaux néerlandais le lendemain.
L’ambassadeur passa sur Al Jazeera. Cette chaîne arabe consacrait également un reportage à la place Fardous, mais au montage, l’accent avait été mis ailleurs. Nous vîmes, sur la même place, des soldats américains jeter triomphalement un drapeau américain sur la statue de Saddam. Nous vîmes ensuite des conciliabules animés puis des soldats américains retirant le drapeau en toute hâte. Al Jazeera montra ensuite les Irakiens en liesse de CNN, mais filmés de loin, de sorte qu’on pouvait voir qu’ils étaient en réalité peu nombreux sur la place et que la plupart observaient la scène à distance.
Je pris congé de l’ambassadeur et, lors des mois qui suivirent, je fis ce que fait tout bon correspondant de retour au pays : je tentai d’écrire un livre sur l’état des choses dans ma zone de couverture.
Je m’enlisai presque immédiatement. Je voyais de temps à autre, dans les journaux ou à la télévision, quelqu’un prétendre que le fondamentalisme est comme-ci ou comme-ça, et que la paix règnerait au Moyen-Orient « si seulement Israël se retirait des territoires occupés », ou « si les Américains cessaient de soutenir les dictateurs ». Je me disais qu’il y avait de bons arguments pour défendre un tel point de vue, mais également pour plaider le contraire. Je n’en sortais pas, et c’est pourquoi le livre ne décollait pas.
Je repensai alors à ma seconde semaine en tant que correspondant. Je venais à peine de rentrer du Soudan et attendais un tampon au ministère de l’Information, au Caire. Le temps passait et j’engageai la conversation avec un collègue qui patientait également. Un vrai vétéran. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées qu’il me racontait, de sa voix de buveur de whisky, la mort de son meilleur ami lors de la guerre Iran-Irak, et « l’Hôtel Commodore pendant la guerre civile au Liban, quelle époque ! Quoi, tu ne connais pas le Commodore ?... ». Enfin, ce genre de personnage. Je lui expliquai que j’étais écrivain et que j’entamais ma carrière de correspondant. Il ricana : « Un livre sur le Moyen-Orient, ça s’écrit lors de la première semaine. Plus tu traines ici, moins tu comprends. »
C’était peu aimable, et probablement dit à dessein. Mais, de retour aux Pays-Bas, je commençai enfin à comprendre ce que ce vétéran avait voulu dire. Avant d’avoir posé le pied au Moyen-Orient, j’avais déjà la tête pleine d’idées et d’images sur la région, largement glanées dans les médias. Sur place, ces idées et ces images avaient petit à petit fait place à la réalité, qui est nettement moins ordonnée et compréhensible que ne le font penser les médias. C’est dans le troisième baraquement de Wau que cela m’avait frappé pour la première fois.
En m’y rendant, j’avais la tête truffée d’images du JT de personnes pitoyables. Dans les deux premiers baraquements, je vis en effet des gens malheureux. Et si dans le troisième baraquement je n’avais pas crié sans réfléchir « Hello everybody ! », je serais sans doute reparti avec cette image de gens malheureux. Bien sûr, ils étaient tristes. Ils mouraient presque de faim. Mais ils n’étaient pas que cela. Les environs de Wau sont aussi fertiles que les Pays-Bas et ces malheureux étaient des paysans qui s’étaient toujours très bien débrouillés seuls, jusqu’à ce qu’une des parties belligérantes les chasse de leurs terres. Les gens de ce camp de famine étaient surtout frappés par une énorme malchance.
En repensant à ces cinq années passées comme correspondant, je retombais sans cesse sur d’autres expériences semblables. Cela devint encore plus intéressant lorsque je cherchai dans mes archives comment Wau était passé dans le journal. J’avais intégré dans mon article la réaction surprenante des gens en apparence tristes et éteints du troisième baraquement, ainsi qu’une conversation avec un médecin, à l’infirmerie du camp. Il s’occupait des cas les plus graves et cochait quotidiennement les listes qui signalaient « quatre-vingts morts par jour à Wau ».
Il expliqua que son plus grand problème étaient les estomacs rétrécis : « Trop de nourriture, et leurs entrailles se déchirent, trop peu, et ils meurent de faim. Alors que la famine les tue, littéralement, nous devons les empêcher d’accéder aux aliments. Selon les manuels médicaux, ces gens-là sont morts depuis longtemps. »
Dans les journaux, on qualifie cette dernière phrase de « superbe citation », et la rédaction en fit un titre. Une immense photo servit d’illustration, avec ce commentaire : « Dans ce camp d’Ajiep, non loin de Wau au Sud-Soudan, une femme accouche. Dans le même baraquement, un membre de sa famille est en train de mourir de faim ». À droite sur la photo, un homme famélique tente vraisemblablement de comprendre d’où viennent les mystérieux déclics de l’appareil, au centre, un garçonnet pleure, et à gauche, deux sages-femmes entourent une mère, tendue, sur le point d’accoucher.
Une image forte. Mais la rédaction aurait aussi bien pu placer une photo des rires du troisième baraquement et mettre une autre citation en exergue dans le titre. Par exemple, celle d’un autre médecin du camp : « La résistance de ces gens est inimaginable. Aucun Occidental n’aurait survécu dans une telle situation, mais eux, ils attendent que la paix revienne et ensuite parcourent des centaines de kilomètres à pied pour retourner dans leur village, planter leurs arachides et reprendre leur vie là où ils l’avaient laissée. »
En tant que correspondant, il m’était donc possible de donner plusieurs lectures d’un même événement. Les médias ne pouvaient en publier qu’une, et souvent prenaient celle qui confirmait l’image existante. Dans le cas de Wau, celle d’êtres tristes qui, selon les manuels de médecine, étaient déjà morts depuis longtemps, et non celle de personnes incroyablement résistantes qui avaient joué de malchance.
Cela se reproduisit souvent pendant ces cinq années et fit de la scène de la place Fardous une conclusion appropriée. Les journalistes américains et néerlandais considéraient la chute de Bagdad comme une évolution allant dans le bon sens. Ils reçurent des images d’Irakiens heureux renversant la statue de leur dictateur. C’était conforme à leurs attentes, et ils se dirent : et voilà, mission accomplie. Sur Al Jazeera, ils virent dans la chute de Bagdad le début d’une occupation. Ils cherchèrent des images symbolisant cela et les trouvèrent dans ces soldats américains triomphants, couvrant spontanément la statue de leurs drapeaux.
Il apparut donc que la réalité et l’image qu’on a d’elle peuvent différer. Lorsque je m’en rendis compte clairement, je sus quel livre je voulais écrire. Non pas un livre expliquant comment le monde arabe pourrait être démocratisé ou sur la tolérance de l’Islam ou sur la question de savoir qui a raison dans le conflit entre Israël et les Palestiniens. Mais le contraire : un livre permettant de comprendre pourquoi au Moyen-Orient il est si difficile de dire des choses sensées à propos de problématiques aussi vastes. Ou, plutôt, tout simplement, un livre sur tous ces moments où je me suis dit : « Hello everybody ! »
1 Novib, ancien nom d’Oxfam.
Sauf mention différente, les notes de bas de page sont toutes de la main du traducteur.
1ère Partie
Chapitre 1Les débuts d’un journaliste
La plupart des journalistes apprennent le métier dans leur pays et sont ensuite envoyés de par le monde. Mon cas est différent. Je n’avais pas étudié le journalisme, mais les sciences sociales et l’arabe. Dans le cadre de ces études, j’avais fait une année de recherches au Caire parmi des gens de ma génération. J’avais tiré un bouquin de cette expérience, ce qui m’avait valu d’être embauché par le Volkskrant1 et le journal de Radio 12.
En arrivant à mon poste au Caire, j’étais donc pratiquement sans expérience, et malgré quelques jours passés dans les rédactions au journal et à la radio, je considérais le journalisme comme un lecteur, auditeur ou téléspectateur moyen : je pensais que les journalistes savent ce qui se passe dans le monde, que les bulletins d’informations en donnent une vue d’ensemble, et que celle-ci peut être objective.
À l’issue des années qui allaient suivre, il ne resterait pas grand-chose de ces idées. Ma foi en la possibilité d’une information impartiale s’évanouit lorsque je « couvris » Israël et les Palestiniens. Pendant ces années — de la première semaine à Wau jusqu’aux suites des attentats du 11 septembre —, j’appris que dans le monde arabe, le journalisme est impossible, qu’on ne peut pas savoir ce qui s’y trame, ni comme journaliste, et encore moins comme téléspectateur, lecteur ou auditeur.
Je fis cette découverte progressivement et ne compris certaines choses qu’après-coup. Mais je fus très rapidement envahi de doutes, lorsque je pris pleinement conscience d’avoir été bombardé correspondant au Moyen-Orient.
J’en étais donc à ma première semaine au Caire, au milieu des caisses de déménagement à vider, lorsque le téléphone sonna. À l’autre bout du fil, quelqu’un de la rédaction me dit : « Faut que tu ailles au Soudan ! » À peine avais-je trouvé un appartement qu’il fallait que je file vers un pays où je n’avais jamais mis les pieds !
Comment m’y prendre ? Devais-je me prémunir contre certaines maladies ? Je sentais mon cœur « se mettre à la course », comme disent les Anglais, et ne savais pas encore que je visiterais un camp de victimes de la famine. Pire : j’ignorais qu’il y eût la famine au Soudan.
Le journal avait en fait appelé parce qu’un certain « Front islamique mondial contre les Juifs et les Croisés » avait fait exploser deux ambassades américaines en Afrique. Là-dessus, Washington avait bombardé des camps d’entraînement de ce Front en Afghanistan et une usine au Soudan. Selon les Américains, l’usine en question produisait des armes chimiques et appartenait au leader du Front, un certain Oussama Ben Laden. Mais Washington ne fournissait aucune preuve et selon le régime de Khartoum, l’usine d’Al-Shifa (la Guérison) ne fabriquait que des médicaments.
Dans la queue à l’ambassade du Soudan au Caire, des collègues m’expliquèrent que, pendant des années, Khartoum avait écarté tant que possible les journalistes occidentaux, prétextant que ceux-ci ne rapporteraient que des récits de mauvaise gouvernance, d’exploitation et de crimes de guerre. Mais à présent, le régime était manifestement convaincu que les journalistes relateraient comment « l’Amérique a détruit la seule usine de médicaments d’un Soudan frappé par la pauvreté ». En moins d’une heure, j’avais mon visa.
Je réservai un vol, me mis sous l’aile de collègues expérimentés et, comme la plupart des Européens, je descendis à l’Acropole, une pension de famille abordable, tenue par des Grecs qui habitaient la ville depuis des générations. Les repas étaient pris en commun, les chambres ne disposaient pas de lignes téléphoniques internationales, et seul le hall central disposait de la télévision. Les Américains optaient, sans exception, pour les cinq étoiles du Hilton, où était également établi le centre de presse temporaire des autorités soudanaises.
Je n’avais aucune idée de ce que je devais faire, et le lendemain, je me contentai de suivre mes collègues. Ils étaient particulièrement chaleureux et je compris rapidement pourquoi la veille, lors du vol de nuit, ils ne s’étaient pas anxieusement demandés ce qu’ils allaient couvrir, ni où et comment ils s’y prendraient. En effet, tout avait été préparé pour nous. Près de l’usine bombardée, les Soudanais avaient exposé les restes des bombes américaines et d’autres détails « visuellement forts » de la destruction : des claviers d’ordinateurs entre des pots de médicaments encore fumants, des téléphones calcinés et des transparents de rétroprojecteurs présentant les objectifs de l’entreprise pour l’automne.
Le ministère de l’Information indiquait le chemin à suivre vers les hôpitaux où se trouvaient les blessés et vers les manifestations en ville. Celles-ci étaient petites, mais filmées en gros plan, elles paraissaient grandes et c’est ainsi qu’elles passèrent sur CNN, avec ce commentaire : « Des foules furieuses manifestent à Khartoum contre les bombardements ». Chaque jour il y avait une conférence de presse, au cours de laquelle rien de neuf n’était dit. Qu’aurait pu annoncer le régime ? « Le pays le plus pauvre d’Afrique menace les États-Unis de sanctions ? » Cependant, on y échangeait des nouvelles et des ragots et l’infatigable directeur des exportations d’Al-Shifa était présent, toujours prêt à répéter aux journalistes fraîchement débarqués que « Le président des États-Unis n’a d’autre choix que de présenter ses excuses ».
C'est ainsi que ça fonctionnait. Le bombardement resta aux actualités pendant trois jours : l’annonce (« Missiles de croisière sur le Soudan »), les réactions au sein de la population (« Clinton ment à propos d’Al-Shifa ») et une analyse (« Khartoum exploite ‘l’agression’ des États-Unis »). Fin de la couverture du bombardement. Le directeur des exportations put se mettre en quête d’un nouvel emploi et la caravane des journalistes se mit en route vers le prochain événement à couvrir.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas, selon mes collègues, de la famine au sud du Soudan, bien qu’on y dénombrât des centaines de morts chaque jour. Mais pour ma part, je voulais voir cette misère, et le journal me dit de tenter ma chance et d’aller aussi loin que possible. Je questionnai mon entourage et découvris que dans le cadre de l’offensive de charme des autorités, le sud était temporairement accessible aux journalistes.
Comme les Pays-Bas accordent une aide relativement importante au développement au Soudan, l’ambassade put m’obtenir un permis pour la zone de guerre. Médecins Sans Frontières désirait donner un peu de publicité à ses activités et mit une petite place à ma disposition dans son avion, en échange de quoi je placerais leur nom dans mon article. Et voilà comment ça fonctionnait !
Aux Pays-Bas, les rédactions dirent que le périple au Soudan était un début retentissant à ma carrière de correspondant. C’était également mon sentiment, et c’est submergé d’impressions confuses et nouvelles que je regagnai le Caire. Je dois dire que j’avais toujours considéré les réfugiés simplement comme des victimes. Mais il apparut que le souci principal de Médecins Sans Frontières était les bagarres et le vol. Les habitants du camp se volaient les uns les autres ainsi que les secouristes, passaient leur temps en règlements de compte et sabotaient la distribution de nourriture à moins d’obtenir un traitement de faveur... Je n’avais jamais imaginé une telle situation auparavant, mais en parlant de cette situation avec le coordinateur, je me dis : « À quoi t’étais-tu attendu ? ». De même avec les fonctionnaires et dirigeants soudanais : j’avais imaginé qu’ils tentaient de trouver une solution à la misère. Mais dans le pays le plus pauvre d’Afrique, il en allait autrement. Les fonctionnaires locaux savaient que les coopérants devaient acheminer les dons de nourriture au bon moment au bon endroit, sans quoi leur carrière individuelle en prendrait un coup. Les fonctionnaires faisaient donc chanter les coopérants : « Mille dollars pour l’autorisation d’envoyer ces aliments vers le sud, sans quoi nous les laissons pourrir au port. »
À mon retour au Caire, je dormis un jour entier et déballai quelques caisses de déménagement. Vint le lundi matin. Je m’assis à mon bureau, y disposai mes cartes de visite de « Correspondant au Moyen-Orient », vérifiai la connexion du fax, du téléphone, de l’ordinateur et d’internet, et fus directement confronté au problème suivant : il était possible qu’un touriste occidental soit enlevé au Yémen, qu’un attentat soit commis sur un religieux au Liban, que le régime à Bagdad organise une manifestation de colère où qu’ici-même, au sud de l’Égypte, un groupe de fondamentalistes soit arrêté... Mais comment étais-je censé l’apprendre ? En suivant les informations, pardi ! Mais là, en l’occurrence, les informations, c’était moi.
Voici le fonctionnement du système tel que je le découvris : toutes les rédactions de journaux sont abonnées aux agences de presse : Reuters, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) et leurs plus petits concurrents. Les agences envoient des reporters couvrir les événements importants et disposent d’informateurs rémunérés jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Lorsqu’un de ces reporters ou informateurs de Reuters, par exemple, apprend quelque chose qui pourrait faire l’actualité, il appelle le coordinateur. Celui-ci se concerte avec ses supérieurs et en cas de feu vert, des reporters et des photographes sont envoyés sur place. Les images et les informations sont transmises vers la capitale locale ou vers Londres, où elles sont transformées en dépêches, lesquelles sont envoyées le plus rapidement possible vers des milliers de rédactions, partout dans le monde. Conférences de presse, enterrements, records du monde, fusillades, résultats d’élections, miracles de la médecine, tremblements de terre, sauvetages providentiels, chutes de neige imprévues, incidents de frontière... tout cela vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Les agences de presse sont les yeux et les oreilles du monde, et dans ma profession, on appelle le flot de dépêches qu’elles déversent « les fils » ou plus simplement « les agences ». « Allo, ici Hilversum3. On voit sur les agences que des fondamentalistes ont été arrêtés dans ton pays. Tu en sais plus ? » Dans les premiers temps, il m’arrivait de m’exclamer : « Comment voulez-vous que j’en sache davantage alors qu’ici les journaux passent l’information sous silence parfois pendant plusieurs jours ? ». Bien sûr, il ne s’agissait de leur part que d’une question standard, mais ce qu’elle impliquait était presque humiliant : si à Hilversum ils étaient informés avant moi et mieux que moi de ce qui se passait dans ma région, quel était alors mon rôle ?
La présentation. Voilà la première tâche de tout correspondant, comme je le découvris un mois et demi plus tard, lorsque le Moyen-Orient domina réellement, pendant quelque temps, l’actualité internationale. Saddam Hussein était encore le maître de l’Irak et avait expulsé de son pays les inspecteurs en armement de l’Onu. L’Amérique exigeait qu’il autorise leur retour et menaçait de bombarder. Il y eut un ultimatum et les journalistes coururent en Jordanie, où se trouvait l’unique ambassade irakienne encore ouverte. Ce fut l’occasion de retrouver des collègues que j’avais rencontrés au Soudan, mais les retrouvailles ne furent pas intimes : trop de nouveaux visages. En effet, les bombardements américains en Irak s’avéraient plus médiatiques que ceux au Soudan, et des quatre coins du monde affluaient des reporters, revenant d’un foyer d’insurrection en Asie, avant de poursuivre en direction de l’Afrique.
Cela donna lieu à quelques scènes passionnantes dans les cinq étoiles d’Amman. Il y avait là les diplomates et les hommes d’affaires occidentaux qui travaillaient en Irak et qui avaient poussé leur 4 x 4 à toute vitesse de Bagdad à Amman. Et il y avait les journalistes qui étaient arrivés ventre à terre à Amman pour pouvoir, justement, filer vers Bagdad en 4 x 4. On murmurait que des agents secrets irakiens étaient également dans les palaces, et tentaient de repérer avec qui parlaient les expatriés. L’ambiance entre correspondants de guerre était très chaleureuse et les problèmes pratiques qui se posaient à nous dominaient nos conversations. Nous nous vantions de nos contacts, avions de mystérieuses conversations au téléphone, tentions — après avoir ingurgité de grandes quantités de bière — de deviner les ficelles de nos confrères, ou implorions l’aide de la BBC qui, telle était la rumeur, employait un fonctionnaire du ministère irakien de l’Information qui pouvait obtenir des visas.
Car tout dépendait d’un visa, dans mon cas également. Humiliant fléau. Il fallait remplir ses coordonnées sur un formulaire et se rendre deux fois par jour à l’ambassade d’Irak pour entendre le consul, monsieur Sadun, déclamer sous un grand poster de Saddam Hussein, le Béni, le Glorieux, les noms des heureux élus. Nous nous pressions autour de Sadun comme les enfants autour du Joueur de flûte de Hamelin et je vis de grands gaillards pleurer près des portes de l’ambassade en constatant que jusqu’à la dernière nuit avant l’ultimatum, ils avaient fait chou blanc. Ils se consolèrent peut-être en apprenant qu’un peu plus tard, sous la pression, monsieur Sadun avait eu une attaque cardiaque. Certains médias lui envoyèrent une corbeille de fruits. De retour à l’hôtel, chacun se mit à boire.
« Arafat ! Ha oui, Arafat. La fois où Clinton est venu à Gaza.
— Ah, avec ce gars qui avait un super whisky distillé lui-même.
— Je l’ai encore interviewé.
— Qui ? Arafat ?!
— Oui, mais je ne te dirai pas comment j’y suis parvenu. » Muet d’étonnement, je buvais avec les autres, ne fut-ce que parce que l’alcool m’aidait à oublier que, dans mon passeport également, manquait le visa et que j’allais devoir « couvrir » la guerre depuis ma chambre d’hôtel à Amman.
Les bombardements commencèrent et une vague de soulagement se répandit parmi les correspondants, et particulièrement parmi les freelance : Saddam aurait pu, à la dernière minute, céder. Dans ce cas, pas de bombardements, donc pas de commandes, alors que les frais pour se rendre à Amman étaient déjà engagés.
Les agences de presse rapportèrent les premières déflagrations et le journal de Radio 1 se transforma en émission permanente. Mais qu’y avait-il à signaler ? Impossible de savoir si toutes les cibles avaient été touchées. Que les auteurs des bombardements prétendent que tout se déroulait bien et que les bombardés aient été furieux allait de soi. Je pouvais bien le répéter quelques fois, mais après ? Je ne pouvais pas quitter ma chambre : c’était le milieu de la nuit et la couverture de l’opérateur de téléphonie mobile jordanien n’offrait pas la qualité indispensable pour une intervention sur les ondes à partir d’un téléphone portable.
Je me revois, assis dans ma chambre de l’Intercontinental d’Amman. Je crains que mon apport ne se soit limité à demander au garçon assurant le service de chambre ce qu’il pensait de tous ces bombardements. « C’est ma chance », se dit celui-ci, me donnant une réponse dans la veine de : « Par Allah, ça ne fera qu’accroître la rage contre l’Amérique ».
Dix minutes plus tard, j’étais à l’antenne, avec pour commencer une question à laquelle je devais réagir et dont la réponse se trouvait dans une dépêche d’agence faxée depuis Hilversum. Venait ensuite quelque chose sur Al Jazeera, également captée aux Pays-Bas, et enfin une question sur ce que l’Arabe moyen pensait des événements. Sur quoi je pris ma voix d’expert et déclarai : « C’est difficile à évaluer, mais ce qui se dit ici est que cela jouera en faveur des fondamentalistes. C’est en tous les cas eux qui profitent le plus de la colère contre l’Amérique, et les gens pensent que cette colère grandira. »
La Maison Blanche avait appelé la campagne de bombardements Operation Desert Fox4 et je compris petit à petit pourquoi. L’information c’est également du show-business. La raison pour laquelle je devais, depuis Amman, résumer des dépêches d’agence évoquant les bombardements à Bagdad, plutôt que de demander à quelqu’un de le faire depuis Hilversum, où ces dépêches arrivaient, c’est que « à Amman » sonnait mieux. Ce fut l’occasion d’apprendre un nouveau terme journalistique, le dateline5, c’est-à-dire l’endroit où est réalisé un article ou un billet pour la radio : « Notre correspondant est arrivé dans la capitale jordanienne Amman. Joris, pouvez-vous décrire l’atmosphère ? ». Et dans le journal :
Mille fois meilleurs vœux de bonne santé à notre roi bienaimé !
De notre correspondant
AMMAN — Pour la dernière fois peut-être les Jordaniens ont fêté cette semaine...6
Les rédacteurs en chef semblaient jauger leurs correspondants et reporters dans une large mesure sur le critère du dateline. Avaient-ils « l’info » et « y » étaient-ils ? Autrement dit : n’avaient-ils rien loupé des infos importantes rapportées par les agences de presse, et étaient-ils présents sur les lieux de l’actualité ? « Belle analyse, mais dommage pour le dateline », disait-on. Voilà pourquoi ces grands gaillards avaient fondu en larmes aux portes de l’ambassade d’Irak à Amman. À Bagdad, ils auraient vraisemblablement été enfermés directement et condamnés aux mêmes agences de presse que moi à Amman, pour autant que leurs fax eussent fonctionné, mais à Bagdad, ils auraient « marqué des points ».
Cette première nuit, l’émission de la radio s’était prolongée pendant des heures, avec une intervention de ma part pratiquement toutes les heures (« la colère ne cesse de grandir »). Plus tard, un ami me demanda comment j’avais pu fournir, chaque heure, lors de mes interventions, toutes les réponses exactes sans la moindre hésitation. Je répondis que toutes ces questions sont préparées à l’avance, comme c’est le cas au journal télévisé. Cela me valut un courriel de malédictions de l’ami en question, qui venait de comprendre ce que j’avais compris plus tôt moi-même : depuis des décennies, il regardait et entendait au journal des scénettes de théâtre.
J’avais été surpris et flatté lorsque le Volkskrant et la radio m’avaient proposé d’être leur correspondant. Je m’étais persuadé qu’ils avaient, tout simplement, une énorme confiance en moi, malgré mon manque d’expérience journalistique et de connaissances de la politique régionale. Mais la véritable raison de leur audace en me choisissant était moins flatteuse : le travail de base d’un correspondant n’est pas très compliqué. La rédaction aux Pays-Bas appelait pour signaler que quelque chose s’était produit, ils faxaient ou envoyaient les dépêches par courriel, je les reproduisais dans mes propres termes à la radio ou les transformais en article pour le journal. Voilà pourquoi ma présence sur place était plus importante pour les rédactions que mes informations personnelles. Et d’autre part, les agences diffusaient suffisamment d’informations pour pouvoir tenir à la radio ou dans le journal un discours cohérent sur n’importe quelle crise ou rencontre au sommet.
Ce fut dur à avaler. En pratiquant le métier de correspondant, l’idée que je me faisais du journalisme, des informations et des médias prit un premier coup. J’avais imaginé le correspondant comme une sorte d’historien du moment présent. Se passait-il quelque chose, il se rendait sur place, menait son enquête et faisait son compte-rendu. Mais je ne me rendais pas sur place pour constater ce qui se passait. Je ne me rendais sur place que pour y être le présentateur de l’information à transmettre. Je ne m’en étais pas douté avant. C’était pourtant logique : il y a quotidiennement des milliers de conférences de presse, sommets, enterrements, manifestations, attentats et bagarres. Comment une rédaction pourrait-elle se pencher sur tout ? De plus, il y a bien dix mille rédactions à travers le monde. Imaginez qu’elles se rendent toutes à chaque conférence de presse, à chaque enterrement...
Peu de temps après, je fus, pour la première fois, brièvement de retour aux Pays-Bas pour une réunion avec la rédaction. Je compris alors pourquoi mes supérieurs suivaient aveuglément les agences de presse, et attachaient tant d’importance à « être sur place » et à « avoir l’info ». J’avais imaginé le service « étranger » de la rédaction composé d’hommes et de femmes sensés, analysant le monde et décidant après mûre réflexion ce qui ferait l’actualité. Or les hommes et les femmes de la rédaction étaient en effet sensés, mais ils n’analysaient pas le monde. Ils passaient les agences de presse au crible, et le chef du service faisait une sélection. Ou plus exactement, il faisait une sélection dans la sélection des agences, qui indiquent dans une case spéciale de leurs dépêches l’importance de celles-ci : bulletin, urgent, actualisation... Là aussi je ne m’en serais jamais douté, mais lorsque je le vis, je compris qu’il ne pouvait en être autrement. Le chef n’avait pas d’expérience du monde arabe, il était pressé par le temps, devait suivre l’actualité partout dans le monde et sentait dans son dos le regard pressant du rédacteur en chef. Celui-ci, encore moins au courant du monde arabe, devait assumer un nombre grandissant de « tâches de direction » et contrôler également l’ensemble des services : intérieur, La Haye7, sport, économie, art... Le chef du service et le rédacteur en chef pouvaient-ils faire autre chose que tenir à l’œil les agences et la concurrence directe et demander : « Pourquoi n’avons-nous pas ça ? » Voilà pourquoi, en feuilletant les journaux et en zappant à la télévision, ce sont souvent les mêmes images et reportages qui apparaissent. Toutes ces rédactions puisent leurs informations et images à la même source. C’est la raison pour laquelle les gens qui traduisent et retravaillent les dépêches d’agence ne sont généralement pas appelés « journalistes » mais « rédacteurs »8. Ceux-ci ne partent pas en reportage, mais restent à la rédaction et transmettent des dépêches ou demandent à un correspondant de les retravailler.
Heureusement, un correspondant fait davantage que présenter l’information : les analyses et reportages font également partie de ses tâches. Comment faire dans mon cas pour ne pas me contenter de l’opinion d’un garçon d’étage ? Des collègues m’indiquaient des revues spécialisées, des sites web sur le Moyen-Orient, des publications des Nations unies, du Fond Monétaire International et des think tanks9. Il y avait en outre, dans chaque pays arabe, des diplomates onusiens, des scientifiques locaux et des militants des droits de l’homme qui recevaient les journalistes occidentaux. On leur soumettait un sujet et on intégrait un commentaire dans un article. « On semble ne pas comprendre que beaucoup d’Arabes ne sont pas contre l’Amérique, mais contre une certaine politique américaine, selon Ra’s Mutakallim, professeur en sciences politiques de l’Université du Caire. » Ce genre de personnes est appelé talking head10 et mes collègues disposaient de listes avec leurs noms et numéros de téléphone. On pouvait également faire appel à un « fixeur », un « local »11 qui, pour cent à deux cent dollars par jour, arrangeait des rendez-vous et servait d’interprète le cas échéant.
C’est ainsi que mes collègues m’aidèrent à réaliser mes premières analyses. Je calquais également mes premiers reportages sur les leurs. Le plus commode, c’étaient leurs listes d’articles prêt à l’usage. « As-tu quelque chose sur l’abus de drogues au Yémen/les crimes d’honneur en Jordanie/le culte de la personnalité du président syrien/la prévention du sida en Égypte ?
— Rappelle-moi demain. J’ai quelques numéros pour toi. »
Il y avait également Lexis Nexis, une banque de données où il était possible d’acheter des articles d’à-peu-près tous les grands journaux des années passées. C’était une mine d’idées et d'informations. Dans la pratique, cela fonctionnait ainsi : je lisais chez Reuters ou dans le New York Times un article sur un rapport de l’Onu à propos des enfants orphelins qui collectent les détritus des quelque 22 millions de Cairotes. Ensuite, je me faisais envoyer par courriel vingt articles puisés chez Lexis Nexis sur ces chiffonniers et les passais au tamis pour en garder les chiffres et les faits saillants — nombre d’enfants, malades et morts à cause des émanations nocives, évaluation des coûts d’une alternative pour la collecte des déchets. Je notais ensuite les noms des fonctionnaires onusiens cités et autres porte-paroles, trouvais leurs numéros sur internet ou grâce à des collègues, et les appelais. Lorsque je laissais passer quelques jours, je réalisais que de nombreux correspondants travaillaient de cette manière, car les fonctionnaires que je contactais avaient déjà répété tant de fois leurs beaux petits textes qu’ils en rêvaient la nuit. Enfin, je me rendais moi-même à la décharge pour l’aspect humain de l’article : un gosse qui dit qu’il préfèrerait jouer mais qu’il faut bien manger, un gamin fier de gagner de l’argent et de ne pas devoir être assis la journée entière dans une classe bondée et surchauffée, où l’instituteur le frappe et où de toute façon les demi-analphabètes de son espèce ne peuvent pas suivre.
Avant de partir pour le Caire, j’avais servi à des amis un tranche d’humour noir : si la devise des militaires est « See the world, meet interesting people and kill them »12, celle des correspondants serait sans conteste « See the world, meet interesting people and report about them »13. Mais à mesure que les semaines devinrent des mois et que je compris le véritable contenu du métier, la boutade disparut de mon répertoire. « See the world... » Du hublot de l’avion ou du taxi, peut-être. Mais ce que je voyais, moi, c’étaient surtout les ambassades, les halls de départ, les chambres d’hôtel et des bureaux. Attendre, souvent : le départ de l’avion retardé, l’arrivée du bus, le coup de fil promis. Ou était-ce à moi de réessayer ? N’était-ce pas impoli ? Ou était-ce naïf de la part d’un journaliste d’un pays qu’on ne situait même pas sur la carte d’espérer un appel téléphonique ? Attendre qu’il plaise au consul de me voir, ou était-il déjà rentré à la maison sans prévenir ?