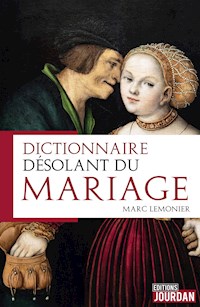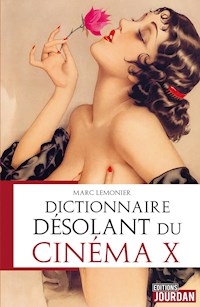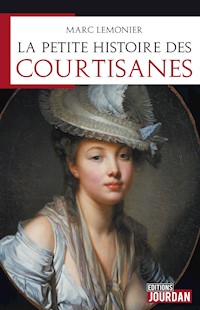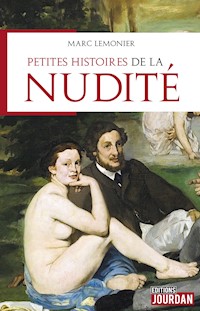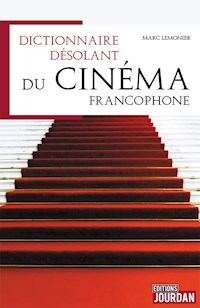
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les dessous du cinéma du samedi soir, de Bebel à de Funès, de Fernandel aux Bronzés ou à Taxi 4, sont parfois peu reluisants, ridicules ou simplement étonnants.
Saviez-vous que…
… l’un des tout premiers films de l’Histoire fut une œuvre érotique signée Méliès ?
… le plus épouvantable drame de la « Belle Époque » fut causé par le cinéma ?
… un personnage historique rendit fous tous ceux qui l’interprétèrent ?
… les stars du cinéma comique ou musical dînaient à la table de la Gestapo ?
… des intégristes catholiques firent exploser un cinéma ?
… De Gaulle adorait Bourvil, mais pas la Grande Vadrouille ?
Dans cet ouvrage, nous croiserons des acteurs qui se détestent, des actrices qui mentaient sur leur âge, des réalisateurs de films comiques reconvertis dans le porno, des voleurs de scénarios et des vedettes reconverties dans le business…
L’ensemble ne constitue pas une contre-histoire du cinéma, ni même une découverte de la face cachée de l’industrie cinématographique, mais bien une promenade dans un univers pas toujours aussi glamour qu’on le prétend.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Animateur de radio puis journaliste,
Marc Lemonier est l’auteur d’une soixantaine de livres consacrés à l’Histoire de la ville de Paris, au langage populaire, au cinéma des années 1950 et 1960 et à l’Histoire de l’érotisme. Dans ce dernier domaine, il a publié
Secrets de maisons closes,
Guide du Paris Libertin aux Éditions La Musardine, ainsi que
Histoires de seins, Petites histoires de courtisanes, Petites histoires de nudité et le
Dictionnaire désolant du cinéma X aux Éditions Jourdan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Éditions Jourdan
Paris
http://www.editionsjourdan.com
Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-499-9 – EAN : 9782390094999
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Marc Lemonier
Dictionnaire désolant du cinéma francophone
À Luis Rego, parce qu’il est drôle…
Du même auteur aux éditions Jourdan
Histoires de seins, 2017
La petite histoire des courtisanes, 2018
Petites histoires de la nudité, 2018
Dictionnaire désolant du cinéma X, 2018
Livres consacrés au cinéma chez d’autres éditeurs…
Guide des lieux cultes du cinéma en France, Horay, 2005
Sur la piste de Fantômas, Hors Collection, 2005
Jean Gabin dans le siècle, City, 2006
Paris des films cultes, Bonneton, 2008
L’Intégrale Louis de Funès, Hors Collection, 2010
Petite encyclopédie James Bond, City, 2012
Le Monde des Tontons flingueurs, City, 2012
Petit dictionnaire Woody Allen, City, 2012
L’Intégrale Michel Audiard, Hors Collection, 2012
Louis de Funès Vie de légende, Hors Collection, 2013
Peut-on rire de tout ? Peut-on rire alors du cinéma populaire ?
Mais oui, pourquoi pas.
Le cinéma populaire français a produit des chefs-d’œuvre, des films « cultes », des comédies irrésistibles, des films d’action trépidants…
Ils ont été pour la plupart ignorés de la critique sérieuse à leur sortie, malgré le talent de grands acteurs : Bourvil, Louis de Funès, Brigitte Bardot, Daniel Auteuil, Michel Galabru, Michel Serrault, Jean Yanne… qui furent le principal attrait de films n’ayant d’autres ambitions que le plaisir du public. Ces succès du cinéma familial, de Bebel à De Funès, de Fernandel aux Bronzés ou à Taxi 4, vus et revus à la télévision, ne sont pas forcément de grands films, mais souvent de bons films, jamais indignes. Nous en rirons donc sans mépris.
Car il y a bien pire : des films sans idées, sans scénario, prenant les spectateurs pour des imbéciles, et donc souvent pas drôles, ce qui est grave pour des films comiques. Nous essaierons de débusquer les plus insignifiants d’entre eux et leurs réalisateurs. Les américains ayant décrété qu’Ed Wood était le plus mauvais réalisateur de tous les temps, il faudrait tout de même démontrer, exemples à l’appui, que le vieux continent est capable de produire des films aussi navrants que les siens.
Mais nous ne nous contenterons évidemment pas de cette forme de dénonciation assez facile de la médiocrité. Nous explorerons, pour nous en désoler, d’autres aspects de l’univers du cinéma populaire francophone pour y dénicher quelques histoires amusantes, des anecdotes, parfois des révélations, sur les évènements les moins reluisants de cette grande aventure.
Quelques exemples :
L’un des tout premiers films de l’histoire fut une œuvre érotique signée Méliès.
Le plus épouvantable drame de la « Belle époque » fut causé par le cinéma.
Un personnage historique rendit fous tous ceux qui l’interprétèrent.
Les stars du cinéma comique ou musical dinaient à la table de la Gestapo.
Des intégristes catholiques firent exploser un cinéma.
De Gaulle adorait Bourvil, mais pas la Grande Vadrouille…
Nous croiserons des acteurs qui se détestent, des actrices qui mentaient sur leur âge, des réalisateurs de films comiques reconvertis dans le porno, des voleurs de scénario et des vedettes reconverties dans le business…
L’ensemble ne constitue pas une contre-histoire du cinéma, ni même une découverte de la face cachée de l’industrie cinématographique, mais une promenade dans un univers pas toujours aussi glamour qu’il le prétend.
Juste pour rire.
A
Accidents de voiture
… Manière assez fréquente de mourir pour les stars en 1967
Françoise Dorléac, la sœur de Catherine Deneuve, et Jane Mansfield sont mortes à quelques jours d’intervalle dans un accident de voiture, en 1967, tout comme les actrices Junie Astor et Nicole Berger décédées cette même année et dans les mêmes circonstances. Le 26 juin 1967, Françoise Dorléac était pressée de se rendre à l’aéroport de Nice pour y prendre l’avion de Londres où on l’attendait pour une projection des Demoiselles de Rochefort. Sa Renault 10 s’écrase contre un poteau de béton sur la route de Villeneuve-Loubet. Entre avril et août de cette année, ce sont trois vedettes du cinéma français qui disparaissaient dans un fracas de tôle brisée.
Quelques mois plus tôt, une autre comédienne connaissait ce sort funeste, directement sous le feu des projecteurs. L’accident eut lieu durant un tournage, comme le raconta Johnny Hallyday dans ses mémoires. « La première fille avec laquelle j’ai vécu s’appelait Patricia Viterbo. C’était une belle fausse blonde que j’ai eu le temps de voir brune. Une actrice qui a joué dans les adaptations cinématographiques des romans de Frédéric Dard. Elle m’impressionnait. Un soir, elle était en tournage au bord de la Seine (pour le film Le Judoka agent secret, un navet de Pierre Zimmer). On la filmait dans une voiture. Le frein à main n’était pas serré. La voiture a percuté le pont et l’a défoncé, elle est tombée à l’eau. Patricia ne savait pas nager, elle est morte noyée. »
Patricia Viterbo, née le 21 mars 1939 au Vésinet, décédée le 10 novembre 1966 à Paris.
Nicole Berger, née le 12 juin 1934 à Paris, décédée le 13 avril 1967 à Rouen.
Françoise Dorléac, née le 21 mars 1942 à Paris, décédée le 26 juin 1967 à Villeneuve-Loubet.
Junie Astor, née le 21 décembre 1911 à Marseille, décédée le 25 août 1967 à Sainte-Magnance.
Isabelle Adjani
… Actrice française, née en 1955, vraisemblablement décédée en 1987 selon les amateurs de rumeurs et de complots
Voilà, personne n’a osé vous le dire, Isabelle Adjani est morte du sida en 1987. En tout cas, elle a été très malade, et tous ses efforts pour prouver le contraire sont restés vains, donc elle doit bel et bien être morte.
La jeune actrice avait été révélée à la Comédie française pour son émouvante manière de prononcer cette phrase à double ou triple sens qui fait la renommée de l’École des femmes de Molière : « Lepetit chat est mort ! » Ah ! que de frissons parcoururent ce jour-là le dos moite des amateurs de lolitas perverses ! D’autant qu’elle récidiva quelques mois plus tard, en recevant au cinéma la plus belle baffe qu’on ait jamais entendue claquer sur la figure d’une adolescente frondeuse, de mémoire d’amateur d’éducation rigide. La gifle, qui donnait son titre au film de Claude Pinoteau, lui avait été administrée pour de vrai par Lino Ventura. Il avait fait un faux mouvement. Et bing ! Isabelle Adjani faillit mourir une première fois.
Quelques années plus tard, après un début de carrière bien rempli, Quartet, Mortelle randonnée, Subway, Isabelle est quasiment considérée comme mourante, voire morte, par toutes les personnes bien informées du monde du spectacle, et bientôt par la France entière. Morte du sida, évidemment. Il s’agit d’une rumeur qu’elle vient démentir en personne sur le plateau du journal télévisé de TF1 le 18 janvier 1987. Face au journaliste Bruno Masure, elle assène une vérité assez facilement démontrable : « Je suis bien vivante, regardez-moi… » Cela ne suffit pas à calmer les rumeurs, car elle apparaît fatiguée, reposant son visage sur sa main gauche, « ce qui cache quelque chose » selon les complotistes. Le sociologue Jean-Noël Kapferer, spécialiste du développement de la rumeur, fit l’analyse de celle-ci. Quelque trente ans plus tard, dans une interview au magazine Grazia, Isabelle Adjani rapporta ses conclusions :« Un foyer FN me considérait métaphoriquement comme un corps français infecté par un corps étranger. Mes racines algériennes, du côté de mon père, devenaient unvirus, à partir de cette interview où je parlais de lui... On était sans doute dans l’archéologie de ce que l’on appelle aujourd’hui la fachosphère, le spectre de la haine que l’on retrouve sur Internet. »
Le démenti public ne changea rien à l’affaire, il permit au contraire d’apprendre l’existence de la rumeur à ceux qui l’ignoraient. Il se trouve sans doute encore des amateurs de mystères, persuadés qu’Isabelle Adjani est vraiment morte du sida en 1987.
Isabelle Adjani, née le 27 juin 1955 à Paris.
Woody Allen
… Acteur et réalisateur américain, qui fit ses débuts en France, quasiment payé à ne rien faire
Un soir de 1964, au Blue Angel, un cabaret new-yorkais où il donne son spectacle de stand-up, Woody Allen fait la connaissance de Warren Beatty et du producteur Charles K. Feldman accompagnés de l’actrice Shirley MacLaine. Ces derniers lui proposent d’écrire le scénario d’un film dont ils n’ont quasiment que le titre What’s New Pussycat ? — expression avec laquelle Beatty, terrible Don Juan, saluait ses conquêtes, quand il ne se souvenait plus de leurs prénoms. La commande est assez précise tout de même : « Faites-nous un scénario qui nous permette de nous rendre tous à Paris pour aller courir les filles… »
Woody écrit donc l’histoire de Michael James (Peter O’Toole), rédacteur en chef d’une revue féminine à Paris, qui, justement, ne peut pas s’empêcher de courir les filles. Il s’en ouvre à son psychiatre, le docteur Fritz Fassbender (Peter Sellers), le premier psy de l’œuvre de Woody Allen. Michael est entouré de filles énamourées, Liz (Paula Prentiss) et Renée (Capucine), ainsi que la belle Carole (Romy Schneider), dont est amoureux leur ami, Victor Shakapopulis (Woody Allen).
Le scénario de What’s New Pussycat? n’a, apparemment, ni queue ni tête. Certains thèmes devenus chers à Woody dans la suite de son œuvre apparaissent déjà, comme la psychanalyse évidemment, mais aussi la difficulté de conquérir les filles... Son personnage d’obsédé sexuel maladroit annonce l’Allan Felix de Tombe les filles. Malheureusement, le producteur n’en fit qu’à sa tête et imposa à Woody l’adjonction de scènes absurdes, comme une course de karting. Rien que pour voir Romy Schneider, Peter Sellers et Woody Allen s’adonner à ce sport, ce film mérite son statut de film culte. D’autant qu’on y rencontre également Jacques Balutin et Françoise Hardy. Tout se déroule à Paris ou dans sa proche banlieue.
Bien plus tard, Woody déclara :« J’ai souffert le martyre. C’était ma première expérience hollywoodienne, personne ne m’écoutait, mais l’argent coulait à flots et les producteurs changeaient d’avis tous les jours. J’ai pu rester huit mois à rêvasser dans une chambre du George V, à jouer des airs de Sidney Bechet, à explorer la ville et à imaginer la vie que je pourrais y mener. »
À sa sortie, le film fut traité de « combinaison hurlante de gags pornographiques », mais il remplit les salles — sans doute pour cette raison. Ce fut également le premier contact de Woody Allen avec Paris et son premier rôle au cinéma.
Sa mère ne le trouva pas drôle…
Allen Stewart Konigsberg, dit Woody Allen, né le 1er décembre 1935 à New York.
What’s New Pussycat ? film de Clive Donner, en 1965.
Mathieu Amalric
… Un méchant très inspiré.
Mathieu Amalric, le comédien délicat découvert grâce aux films des frères Podalydès, d’Arnaud Despleschin ou d’Olivier Assayas, fait partie des quelques Français qui eurent l’honneur d’incarner l’un des « méchants » de la saga James Bond. Dans Quantum of Solace en 2008, il est Dominic Greene, un homme d’affaires sadique, appartenant à une organisation criminelle et terroriste. Le comédien affirma que, pour jouer son rôle, il s’était inspiré de Nicolas Sarkozy et de Tony Blair, l’ancien Premier ministre anglais.
Mathieu Amalric, né le 25 octobre 1965 à Neuilly-sur-Seine.
Angélique, Marquise des Anges
… Angélique Sancé de Monteloup, marquise des Anges, première héroïne sexy contre son gré
En 1964, le cinéaste Bernard Borderie réalise Angélique, Marquise des anges, film très librement adapté d’un roman rose d’Anne et Serge Golon… qui détestèrent cette adaptation et l’image de leur héroïne portée à l’écran. Les deux auteurs reprochent surtout d’avoir transformé leur personnage en petite grue. En 2013, à la sortie d’une nouvelle version cinématographique du roman, Anne Golon affirma « [les scénaristes du film] voyaient Angélique comme une petite putain qui veut se farcir tous les hommes. Il y a vraiment eu rupture entre nous, et j’ai compris, dès ce moment, que le film ne serait pas fidèle au livre… »Pourtant les cinq épisodes de la saga eurent un certain succès, en grande partie, parce que les spectateurs s’attendaient à y trouver quelques scènes affriolantes. Le choix de l’actrice principale devenait donc essentiel pour le réalisateur et le producteur qui, comme le craignait Anne Golon, avaient bel et bien une idée derrière la tête, celle de faire des films un peu sexy.
Plusieurs actrices furent pressenties pour le rôle, dont Annette Stroyberg, Marina Vlady, Jane Fonda, Catherine Deneuve, et peut-être Brigitte Bardot. Michèle Mercier, qui faisait carrière en Italie, fut choisie après une séance de casting orageuse, au cours de laquelle elle envoya réalisateur et producteur sur les roses, affirmant en avoir assez de leurs questions et de leurs exigences idiotes.
À l’écran, la brune Michèle Mercier devient blond vénitien et partage la vedette avec Robert Hossein, balafré et violent. Dès le premier épisode de la saga qui comptera cinq films, les spectateurs — masculins principalement — plébiscitent l’ambiance trouble qui règne autour de Michèle Mercier. Pourtant, elle a fait rajouter une clause dans son contrat pour ne pas apparaître nue à l’écran. Loupé ! Lors d’une scène de bain, elle entre dans l’eau, les mamelons recouverts de sparadrap et le pubis dissimulé par un triangle de plastique qui se décolle aussitôt. Au cours d’une scène de viol, elle est frappée au sein et meurtrie par un figurant trop enthousiaste.
Angélique est violée, mariée de force, réduite à l’esclavage, fouettée, marquée au fer rouge… Ses aventures semblent avoir été réécrites par un émule du marquis de Sade. La comédienne a beau vouloir interdire qu’on la filme nue, elle n’en devient pas moins une héroïne sexy. Pendant des années, lorsque les films de la série sont diffusés à la télévision française, environ une fois par an, au moins, ils sont réservés aux adultes.
Angélique, Marquise des anges, film de Bernard Borderie, en 1964.
Arletty
… Actrice peu résistante dont l’atmosphère réussit à défendre le factice contre le réel
Arletty, l’incarnation de la Parisienne d’avant-guerre, gouailleuse et sophistiquée, volontiers vulgaire, mais élégante, pourrait être encore aujourd’hui considérée comme la plus grande actrice du siècle dernier, surpassant en charme, en élégance et en inventions toutes celles qui — trop blondes, trop sophistiquées — tentèrent de la supplanter à partir des années soixante.
Il y a juste un petit détail gênant qui l’empêche d’accéder à ce panthéon artistique. La grande actrice n’a pas été parfaite en tout point durant la Seconde Guerre mondiale — elle ne fut pas la seule, nous allons dans cet ouvrage rencontrer quelques-uns de ses compagnons de beuveries à la Kommandantur. Au sens le plus littéral de l’expression, « elle coucha avec les Allemands », ou du moins avec un membre de l’armée du Reich, le dénommé Hans Soehring, qu’elle surnommait « Faune ». Elle fait sa connaissance le 25 mars 1941, chez son amie Josée de Chambrun, la propre fille de Pierre Laval, l’inspirateur de la collaboration avec l’Allemagne nazi. En 1944, alors que Paris est libérée, Arletty y reste, passant d’un appartement à l’autre, et finit par s’installer dans une chambre de l’Hôtel Lancaster où se trouvent déjà quelques membres du gouvernement provisoire.
Elle est évidemment interrogée par la police du nouveau pouvoir. Crânement, elle déclare : « Je n’ignore pas les bruits qui courent sur mon compte. On me reproche d’avoir eu comme ami un officier allemand pendant l’Occupation, mais, comme je n’ai rien fait de répréhensible envers mon pays,j’attends le résultat de l’enquête du comité d’épuration du cinéma avec confiance. » Ce qui n’est ni tout à fait faux ni tout à fait vrai. Elle est arrêtée le 20 octobre 1944. Au cours de ses interrogatoires, elle affirme avoir systématiquement refusé de tourner dans tous les films que lui proposa la société de production allemande Continental Films, ou dans des projets émanant du propre beau-fils du maréchal Pétain… Elle n’aurait donc pas grand-chose à se reprocher, et d’ailleurs elle est rapidement libérée, tout en restant ostracisée par le monde du spectacle pendant quelques années. Le plus grave n’est peut-être pas là. À la lecture de ses mémoires, intitulés La Défense, Arletty ne semble avoir aucune compassion pour les victimes de la guerre, ne faire preuve d’aucun soutien à l’égard de la France résistante, n’éprouver aucun regret d’avoir fréquenté l’infréquentable et d’avoir été l’incarnation de la collaboration décomplexée.
Il n’en reste pas moins qu’Arletty a marqué l’histoire du cinéma français, au point d’avoir eu une influence sur le cours du monde. En 1938, elle tourne dans un film de Marcel Carné, Hôtel du Nord, où elle prononce quelques phrases qui restent dans l’histoire du cinéma français. À son souteneur, interprété par Louis Jouvet, qui affirme vouloir changer d’atmosphère, elle réplique : « C’est la première fois qu’on me traite d’atmosphère ! Si je suis une atmosphère, tu es un drôle de bled ! Les types qui sortent du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu’ils ont été, on devrait les vider ! Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? Puisque c’est ça, vas-ytout seul à La Varenne ! Bonne pêche et bonne atmosphère ! » Aussitôt, l’Hôtel du Nord, au bord du canal Saint-Martin à Paris, devint un des lieux saints de l’histoire du cinéma. À tel point que, lorsqu’en 1989 un promoteur voulut le raser, les amoureux du vieux Paris se révoltèrent et vinrent demander le soutien d’Arletty, qui s’indigna : « Autant démolir la tour Eiffel ! » L’hôtel fut sauvé et classé monument historique.
Oui, mais voilà, le film avait été réalisé en studio, à Billancourt. L’hôtel où jamais rien ne fut tourné fut sauvé, les studios de Boulogne-Billancourt furent rasés…
Léonie Bathiat, dite Arletty, née le 15 mai 1898 à Courbevoie, décédée le 23 juillet 1992 à Paris.
The Artist
… Un film français silencieux — une hérésie ! — qui valut un Oscar à un cabot
Le cinéma français doit sa notoriété — entre autres — à la qualité de ses dialogues. Michel Audiard, Henri Jeanson, Marcel Pagnol, Sacha Guitry et, plus tard, la troupe des Bronzés, Jamel Debbouze et bien d’autres, ont donné de la voix… Le mot d’auteur, la bonne réplique, puis la bonne vanne font partie intégrante de l’histoire du cinéma populaire. Depuis « les cons, ça ose tout, c’est à ça qu’on lesreconnaît » dans LesTontons flingueurs, jusqu’à « ça dépend, ça dépasse » dans Le Père Noël est une ordure… Alors, par quelle aberration mentale des producteurs de films populaires français en sont-ils arrivés à désirer faire un film muet ?
Comme souvent, tout est de la faute de Fantômas !
Le producteur Thomas Langmann avait contacté le réalisateur français Michel Hazanavicius, l’auteur des deux épisodes de la saga OSS 117 avec Jean Dujardin, pour créer une version contemporaine des aventures du maître du crime. Le réalisateur lui proposa alors de les tourner sous la forme d’un film muet en noir et blanc, à la manière des séries du réalisateur Louis Feuillade en 1912. Faute d’avoir réuni le budget nécessaire, les deux hommes renoncent à leur projet, mais l’idée du muet en noir et blanc fait son chemin. Michel Hazanavicius revient avec un scénario qui justifie l’usage de ces deux techniques oubliées, en racontant justement le passage du muet au parlant, de la pantomime au film musical.
On connaît la suite, le succès et la reconnaissance quasiment planétaires que rencontra le film, mais également l’accès au vedettariat et aux plus hautes récompense de celui qui n’était alors qu’un acteur, certes reconnu pour son talent, mais n’ayant jamais rencontré pareille notoriété… Nous voulons évidemment parler de l’interprète du rôle de Jack, le chien Uggie. Plus tard, dans un ouvrage sobrement intitulé Uggie, The Artist, ma vie, mon œuvre, publié en France chez Jean-Claude Lattès, il raconta la manière dont sa carrière connut cette accélération fulgurante. Uggie, un jack terrier, est à ce jour le seul chien ayant eu l’honneur de laisser l’empreinte de ses papattes sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard à Los Angeles, et d’y avoir son étoile. À l’occasion de la sortie de The Artist à Cannes, il reçut l’une des plus hautes distinctions que puisse espérer un chien acteur, la Palm Dog.
Quant au reste, toutes ces distinctions inouïes, le sacre de Jean Dujardin, tout cela est inexplicable. À moins de considérer l’avis du comique belge Marc Herman.
« The Artist, deux César, deux Oscar… pour un film muet.
Comme quoi, les Français sont appréciés quand ils la ferment ! »
The Artist, film de Michel Hazanavicius, en 2011.
L’As des as
… Quand un succès annoncé devient l’objet de polémiques, disons… surprenantes
Peut-on se disputer à propos d’un film de Gérard Oury ? Eh bien ! oui, évidemment, il y a de multiples raisons à cela. On peut débattre à l’infini de la nécessité de détruire une 2CV au début du Corniaud, de la taille un peu étriquée du casque de SS porté par Bourvil dans La Grande Vadrouille, de la familiarité d’un aviateur anglais avec une bonne sœur dans ce même film, ou de l’opportunité d’une publicité clandestine pour Levi’s dans Rabbi Jacob, mais il semblerait que ce n’est pas de cela qu’il s’agit…
L’As des as raconte l’histoire rocambolesque de Jo Cavalier, un ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale qui, après une carrière de boxeur, est devenu entraîneur de l’équipe de France se rendant aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. En chemin, il croise un jeune garçon de 10 ans, Simon Rosenblum, dont la famille juive est persécutée en Allemagne. Le chevaleresque aviateur français se lance alors dans un combat inégal contre la Gestapo. Il décide de mettre ses nouveaux amis à l’abri, et s’empare au passage de la superbe voiture de son ami, le général antinazi von Beckman… voiture qu’il partage avec un ourson.
Bons sentiments, reconstitution historique soignée, humour, flirt du héros avec la ravissante Marie-France Pisier, « cascades » à la Belmondo, tout était en place pour que le public soit au rendez-vous. Il le fut, avec plus de cinq millions de spectateurs. Ce qui ulcéra une partie de la critique cinématographique.
Soyons clairs : il n’y a qu’en France qu’on peut imaginer le déclenchement d’une polémique de la nature de celle qui allait suivre. Le 10 novembre 1982, vingt-trois critiques de cinéma signent dans les quotidiens Libération et L’Humanité ainsi que dans l’hebdomadaire Télérama une tribune intitulée « Urgent, chambre en ville à louer ». Ils ne critiquent pas spécialement le film de Gérard Oury, mais considèrent que sa sortie a écrasé celle du film de Jacques Demy, Une chambre en ville. Ils déplorent « l’écrasement informatif et publicitaire des films préconçus pour le succès ». Quelque temps plus tard, Belmondo prend à son tour la plume pour écrire une « lettre ouverte aux coupeurs de têtes » : « Lorsqu’en 1974, j’ai produit Stavisky d’Alain Resnais et que le film n’a fait que 375 000 entrées, je n’ai pas pleurniché en accusant James Bond de m’avoir volé des spectateurs. »
La carrière de L’As desas connut encore une dernière mésaventure. À la naissance de Canal +, la chaîne de télévision cryptée à péage qui tentait d’attirer ses premiers abonnés en leur proposant des films très récents, il fut le premier à être diffusé, le jour même de l’ouverture d’antenne, le 4 novembre 1984. Mais le système de cryptage était tellement performant que personne ne réussit à le voir ! La chaîne dut continuer à le diffuser « en clair »… Ce qui conforta les critiques, qui pensaient alors que le principe même d’une chaîne à péage comme Canal + « ne marcherait jamais ».
L’As des as, film de Gérard Oury, en 1982.
Astérix et Obélix
… Des acteurs au régime
Christian Clavier, Clovis Cornillac, Édouard Baer, trois acteurs se sont succédé pour jouer le rôle d’Astérix. Le rôle de César a été interprété par Alain Chabat ou Fabrice Luchini, mais il restera à jamais associé à la seule scène comique de toute la carrière d’Alain Delon — César parle de lui à la troisième personne, comme Alain Delon. C’était également la seule scène drôle du film adapté d’Astérix aux Jeux olympiques. Par deux fois, on retrouva le maigrelet Sim dans le rôle d’Agecanonix avec, pour épouse, Arielle Dombasle, puis Adriana Karembeu.
Seul Gérard Depardieu resta fidèle au rôle d’Obélix dans les quatre adaptations successives de l’œuvre d’Albert Uderzo et René Goscinny. Dans l’une de ses nombreuses interviews alcoolisées, Gégé affirme avoir un point commun avec le livreur de menhirs, à savoir son goût pour le sanglier. « C’est très bon le sanglier ! Je le préfère en sauce plutôt que rôti. La gibelotte de marcassin, c’est exquis ! »
Astérix et Obélix contre César, film de Claude Zidi, en 1999.
Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, film d’Alain Chabat, en 2002.
Astérix aux Jeux olympiques, film de Thomas Langmann et Frédéric Forestier, en 2008.
Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, film de Laurent Tirard, en 2012.
L’Auberge espagnole
… Un film qui nous apprend les règles de la vie en collectivité
Lorsque les sociologues des siècles futurs se pencheront sur le phénomène de la colocation chez les jeunes urbains des sociétés occidentales au début du XXIe siècle, ils ne manqueront pas d’images pour illustrer leurs propos : starlettes de la télé-réalité batifolant dans des piscines, vedettes de séries américaines bavardant sur leur canapé et, évidemment, L’Auberge espagnole, qui décrit l’ambiance au sein d’un groupe « d’étudiants Erasmus ».
Pour 180 000 pesetas, un peu plus de 1 000 euros, ils se partagent un vaste appartement délabré, au premier étage d’un immeuble ouvrant sur une grande place du quartier d’El Raval, dans le Barrio Gotico. Les règles de leur cohabitation sont assez souples et concernent principalement le rangement du frigo, où des étiquettes essaient tant bien que mal de rappeler à chacun où doivent se trouver yaourts et bouteilles de jus d’orange… ainsi que les lunettes d’Alessandro, le colocataire italien. Le ménage est rarement fait, seule l’Anglaise Wendy semble s’y intéresser.
Quant au reste, c’est le bazar ! En particulier dans le domaine de la vie sentimentale des colocataires. Voilà ce que les films pour la jeunesse apprennent à leurs spectateurs. L’Auberge espagnole a plus fait pour le programme Erasmus que des milliers de pages de communication institutionnelle.
L’Auberge espagnole, film de Cédric Klapisch, en 2002.
Michel Audiard
… Dialoguiste de talent et journaliste dans une revue antisémite
Le dialoguiste Michel Audiard incarne l’esprit français. Depuis qu’il les a rassemblées lui-même en 1968 dans un livre intitulé Mon petit livre rouge, les phrases-chocs et les vannes dont il a parsemé des dizaines de films sont considérées comme de véritables proverbes, exprimant une forme de sagesse populaire. « Quand on mettra les cons sur orbite, tu n’as pas fini de tourner »,« lesconneries, c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer », « c’est le sort des familles désunies de se retrouver uniquement aux enterrements », et on en passe.
Il se trouve quelques milliers de cinéphiles qui prétendent, parfois à juste titre, connaître par cœur la « scène de la cuisine » des Tontons flingueurs. Rien à dire à cela. Pourtant la critique et une partie des spectateurs de Carambolage, le film de Marcel Bluwal en 1963, s’offusquèrent à cause des réparties du commissaire Boudu, interprété par Michel Serrault. Michel Audiard en fit un nostalgique de la Gestapo française, ce qui constituait une provocation à l’égard de la pensée dominante du moment, les Français faisant mine de croire que la collaboration n’avait jamais existé. On voit Boudu se désoler de la disparition du supplice de la baignoire, ou promouvoir les bienfaits de la peine de mort. « Quand il s’agit de faire tomber une tête, rien n’est prématuré. Ce qui prouve la solidité de la peine de mort, ce sont les erreurs auxquelles elle a survécu », affirme-t-il.
On pourrait dire qu’il s’agit d’humour noir. Malheureusement, l’historien Pascal Ory, dans un ouvrage intitulé Les Collaborateurs, rapporta en 1980, cinq ans avant la mort du dialoguiste, quelques informations pour le moins gênantes. Dès 1942, Michel Audiard aurait participé à la rédaction de la revue collaborationniste L’Appel. Il affirma, en 1944, qu’il y avait tout au plus « passé quelques contes et nouvelles. » Le monde du cinéma feignit alors de l’ignorer — l’auteur de ces lignes, qui a écrit deux livres sur Audiard, se compte parmi les aveugles qui firent semblant de n’avoir rien vu. Il fallut la publication d’une enquête poussée, menée par la revue Temps Noir