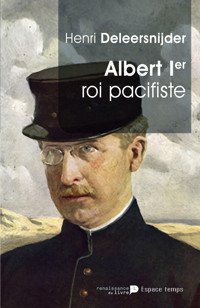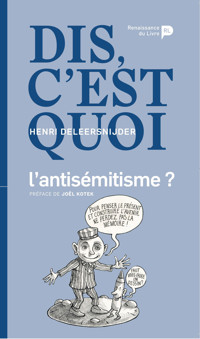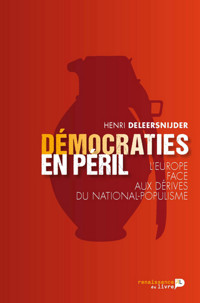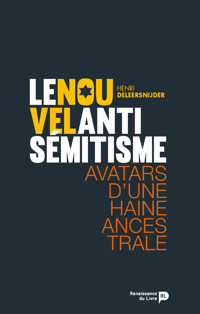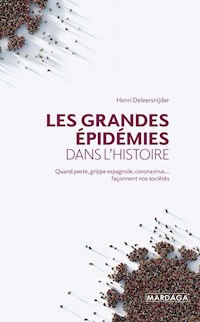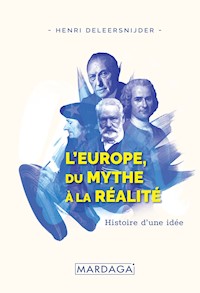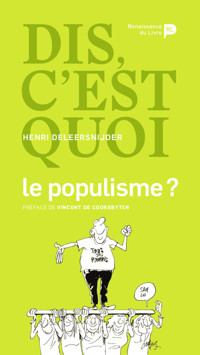
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Toute connaissance est une réponse à une question. Telle est la démarche qui prévaut dans ce livre conçu comme un dialogue entre un père et son fils. Il a trait au populisme, concept ambigu par excellence, tiré à hue et à dia au gré des positionnements politiques. Le mot est aussi le signe d'un vocabulaire idéologique en mal de précision, voire une arme de combat pour clouer au pilori un opposant ou réduire au silence une constestation sociale.Il n’empêche que la rhétorique populiste, associée à du nationalisme, constitue une périlleuse tentation démagogique lorsque des leaders ambitieux s’en emparent pour se hisser à tout prix sur le pavois du pouvoir. Au mépris des fondamentaux démocratiques.D’où l’urgence de décrypter ce phénomène qui pourrait à terme se révéler liberticide. Il y va de l’intérêt des jeunes générations et du grand public soucieux du bien commun. Henri Deleersnijder est professeur d’histoire et essayiste. Licencié-agrégé en Arts et Sciences de la communication de l’Université de Liège, il est collaborateur au département des relations extérieures et communication de la même institution. Ses deux derniers ouvrages portent les titres de Le nouvel antisémitisme, Avatars d’une haine ancestrale et Les mots de l’espoir. Vincent de Coorebyter est professeur à l’ULB, titulaire de la chaire de philosophie sociale et politique contemporaine, et président du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dis,
c’est
quoi
le populisme ?
Henri Deleersnijder
Dis, c’est quoi le populisme ?
Renaissance du Livre
Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo
www.renaissancedulivre.be
Renaissance du Livre
@editionsrl
directrice de collection : nadia geerts
maquette de la couverture : aplanos
isbn : 978-2-507-05561-5
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.
Préface
En Europe de l’Ouest, le populisme, jamais éradiqué, reprend son expansion dans les années 1980 en exploitant les craintes suscitées par l’immigration extra-européenne. Le phénomène, dès lors, prend une dimension nationaliste, ce qui ne facilite pas sa compréhension et sa définition. L’expression de « national-populisme », en vogue dans les années 1990 et reprise dans ces pages, tient compte de ce trait marquant de nombreuses formations populistes, qui suscite différentes questions. Le populisme est-il une forme de nationalisme, ou le nationalisme une forme de populisme ? Que conclure des accents xénophobes, voire racistes, de certaines formations politiques dites populistes ? Faut-il, comme on l’a fait et comme on le fait encore aujourd’hui, rattacher le populisme à l’extrême droite, y voir une forme atténuée de ce courant antidémocratique ?
C’est un des mérites de ce petit livre que de ne pas ignorer cette proximité entre le populisme et d’autres courants de pensée, sans l’assimiler pour autant à ses cousins plus ou moins proches. Alors que tous les populismes de droite sont nationalistes, tous les nationalismes ne sont pas populistes. Il existe un nationalisme conservateur, à teneur plus ou moins religieuse, qui dénonce le monde extérieur et qui exalte l’ordre et le peuple sans pour autant user des pratiques politiques et démagogiques propres au populisme : on peut penser par exemple à la Turquie d’Erdogan. De même, et c’est un autre point essentiel bien souligné par Henri Deleersnijder, le populisme n’est pas l’extrême droite, et encore moins le fascisme. On le verra tout au long de ces pages, le populisme n’est pas antidémocratique à proprement parler : c’est une perversion de la démocratie, une maladie grave mais interne à la démocratie, et qui n’a pas pour ambition de la renverser même si le populisme cherche bien à la bousculer. Il s’agit, en fait, d’un risque de recul de la démocratie né d’un excès de démocratisme, d’une compréhension simpliste de la démocratie.
Les deux termes ont d’ailleurs une signification commune. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple (souvent par l’intermédiaire d’élections) et pour le peuple ; le populisme est l’exaltation d’un peuple souverain auquel il faut rendre la plénitude de ses droits. Le populisme se réclame de la démocratie : il prétend parler au nom du peuple et faire triompher sa volonté, que le « système » étoufferait et bafouerait ; il se présente non comme la négation mais comme la restauration d’une authentique démocratie. Mais il pervertit la démocratie en ce qu’il sélectionne les segments de population qui constituent le « vrai peuple », le seul peuple légitime à ses yeux. Il en écarte ainsi les étrangers, sauf lorsqu’ils sont parfaitement assimilés. Il tend à en écarter les marginaux de toute sorte, tous ceux qui font peur ou qui suscitent l’hostilité de l’honnête citoyen (délinquants, drogués, SDF, « assistés sociaux »…). Il rêve en outre – et c’est propre à ce mouvement de pensée – de retrancher du peuple les « élites » politiques, médiatiques, technocratiques, judiciaires, intellectuelles… qu’il accuse de trahir le peuple en travaillant à leur propre profit ou à celui des étrangers et des marginaux. Le populisme, qui exalte le peuple, commence par l’amputer de plusieurs de ses composantes. Ou, plus exactement, il distingue en son sein les bons et les mauvais, les vraies gens et les élites corrompues, les nationaux et les étrangers, ceux qui méritent leur statut par leur travail et leur honnêteté et ceux qui profitent des méritants.
À cet égard, le populisme n’a rien inventé. Il a toujours existé une méfiance, une rancœur ou une colère populaire à l’encontre des étrangers, des marginaux et des élites, et cette attitude a toujours pris une vigueur particulière en temps de crise et de difficultés, en période de chômage, de mutations incontrôlées ou de menaces sur le cadre habituel de vie. L’originalité du populisme est de donner une forme politique à cette détresse en usant de démagogie et d’outrances verbales pour exprimer tout haut ce que chacun est censé penser tout bas, et en prônant un mode de gouvernement destiné à traduire en actes les aspirations populaires que ce discours tonitruant s’emploie à flatter.
Le lien entre populisme et démagogie étant bien connu, je voudrais insister plutôt sur la seconde facette – le mode de gouvernement –, car c’est ici que l’on perçoit le mieux en quoi le populisme est une maladie interne à la démocratie, une caricature de sa logique.
Le populisme entend arriver au pouvoir par les urnes, en respecter le verdict. Mais, une fois installé au gouvernement grâce à un succès électoral, il interprète celui-ci de façon très discutable. Il y voit un plébiscite en faveur de ses leaders, il le considère comme l’expression de la volonté du « vrai peuple », il ignore (ou tente d’ignorer) qu’il a des opposants politiques qui représentent d’autres parties de la population et qui possèdent également une légitimité. Il tient ces opposants pour des ennemis du peuple et non pour des concurrents, il n’admet pas que chaque élu ne détient qu’une partie de la légitimité démocratique. Et, surtout, le populisme fait du moment précis de l’élection un chèque en blanc pour l’avenir, la preuve que le peuple a voulu le porter au pouvoir et que ses leaders restent pleinement légitimes tout au long de leur mandat. « J’ai été élu par les Américains », ne cesse de rappeler Donald Trump, ignorant superbement que sa cote de confiance a lourdement chuté depuis son élection et que, s’il devait se représenter devant l’électorat aujourd’hui, il serait sévèrement désavoué. Le populisme réduit la légitimité démocratique au moment électoral qui l’a porté ou qui le portera au pouvoir, en tenant pour quantité négligeable toutes les oppositions qui se manifestent contre sa politique : il n’y voit pas une mise en cause de sa légitimité mais la preuve qu’il a raison, que le « vrai peuple » a des ennemis en la personne des courants idéologiques qui ne partagent pas ses vues.
De même qu’il réinterprète le sens de l’élection, le populisme tord le sens de la souveraineté populaire. Il s’empare de cette notion pour gouverner de manière brutale, simpliste, rapide, à coup de décisions mal préparées. En campagne électorale, il ne cesse de critiquer les procédures et les solutions trop complexes des élites, des technocrates, des intellectuels : il leur oppose le « bon sens », la nécessité de prendre des mesures fortes et efficaces, immédiates et unilatérales. Sur fond de crise et de détresse, il promet de gouverner en n’écoutant que la voix du peuple, en ignorant les critiques et les appels à la raison. Prétendant traduire dans les faits ce que le peuple attend, il écarte ici encore toute opposition – notamment celle qui est fondée sur le droit, la Constitution ou les cours et tribunaux – en la réduisant à du sabotage, à des menées malveillantes inspirées par les élites ou par l’étranger. Le populisme prétend respecter la démocratie, mais il la réduit à une partie bien précise des aspirations populaires, et il en néglige d’autres piliers : l’État de droit, le respect du pluralisme, la liberté d’expression et d’opposition, l’usage de la négociation et de la raison. Il transforme la volonté du peuple en impatience, ses désirs en ukases, sa demande de mesures efficaces en résolutions abruptes. Il prétend soigner les maux de la démocratie – la lenteur de ses procédures de consultation et de délibération, la complexité de décisions tenant compte d’une multiplicité d’intérêts et de situations – en revenant aux fondements du système, à la prééminence du peuple en toutes choses : il place la volonté et l’action avant la réflexion. C’est pourquoi il est toujours susceptible de séduire et constitue une tentation permanente en démocratie.
Vincent de Coorebyter
C’était au début d’une série de cours d’histoire. Après le rappel de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 et de la nuit du 4 août qui mit fin aux droits féodaux, je m’attardai à la lecture et au commentaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 du même mois. Comme chaque année, j’attirai particulièrement l’attention sur ce texte fondateur de notre modernité. Et je demandai à mes élèves de rhéto de compléter par un seul mot son article III, lequel proclamait : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la… ». En leur recommandant de réfléchir, comme il se doit, le temps nécessaire avant de répondre.
Quelle ne fut pas ma surprise d’entendre la réponse de l’un d’entre eux ! Avec un élan d’une touchante spontanéité, il lança dans la classe le terme « … popularité ». Dans son esprit, celle-ci – la popularité donc – avait remplacé la « nation » dont je m’empressai de lui rappeler qu’elle est le fondement de tout régime démocratique, au contraire de la monarchie absolue de droit divin qui était de tradition jusque-là en France.
Ainsi donc, donnant a posteriori raison au poète René Char pour qui « les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux », le jeune homme laissait entendre par son choix que la visibilité d’un leader, connu et admiré du plus grand nombre, devait automatiquement légitimer son pouvoir. Cette tentation d’abandonner à la consigne son autonomie politique au profit d’un sauveur providentiel est au cœur même de ce qu’il est convenu d’appeler le « populisme ».
Quand un malaise s’installe et dure, que la peur d’un avenir incertain bride les volontés, la recherche d’un « père », voire d’un homme fort, se fait