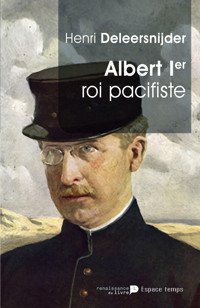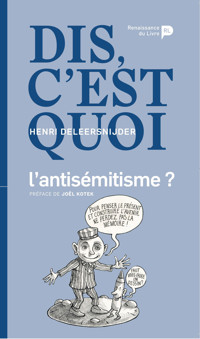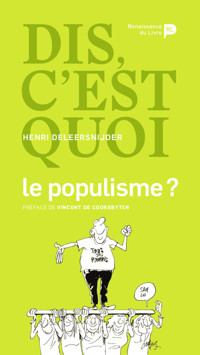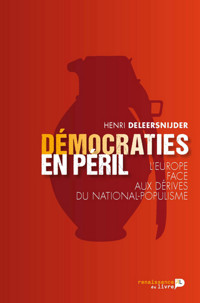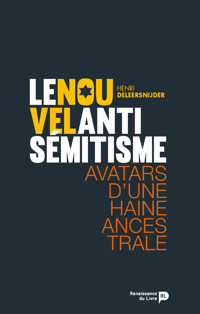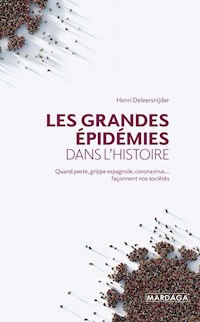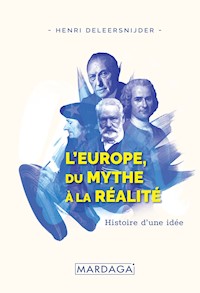
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La volonté de rassembler les peuples du Vieux Continent n'est aujourd'hui plus un mythe et donne lieu à une construction hors du commun.
De la jeune Europè de Phénicie à l’Union européenne des Vingt-Sept de Bruxelles, du mythe des origines à la réalité d’aujourd’hui, que de chemin parcouru ! Paraphrasant Victor Hugo, fervent partisan de l’unification de l’Europe, on pourrait parler, à propos de cette construction hors du commun, d’une « idée qui va ». La volonté de rassembler les peuples du Vieux Continent, si souvent pris autrefois dans l’engrenage de conflits meurtriers, de nombreux philosophes, écrivains, poètes et hommes politiques l’ont partagée au cours des siècles. Jusqu’à ce que, le 9 mais 1950, le plan Schuman inspiré par Jean Monnet propose la création de la CECA. Et donne l’impulsion qui aboutira à l’actuelle Union. Ce livre suit un axe chronologique rigoureux et fait la part belle aux propos de tant de pionniers du projet européen. Il se positionne résolument en faveur d’une Europe garante de la paix face aux replis identitaires et autres dérives nationalistes, tout en promouvant une économie au service de l’être humain, soucieuse par conséquent du bien-être social.
Ce livre d'histoire consacré à l'Europe suit un axe chronologique rigoureux et transmet les propos des pionniers du projet européen.
EXTRAIT
Oui, l’Europe doit à nouveau faire rêver, à condition qu’elle ait une vision d’avenir. Elle en a un urgent besoin, face à tous les défis auxquels elle est confrontée, celui d’achever son unité en priorité. L’histoire, si souvent délaissée à l’heure du présentisme ambiant, peut y contribuer. Surtout si l’on adhère à l’une de ses définitions les plus judicieuses : « art de se souvenir de ce dont les hommes sont capables ». Les philosophes, écrivains, poètes et hommes politiques de l’idée d’Europe l’ont été du meilleur.
Si les pages suivantes retentissent de leurs voix, c’est grâce aux historiens et chercheurs qui les ont auparavant recueillies et qui y sont abondamment cités. On retrouvera les noms des principaux d’entre eux, avec les titres de leurs ouvrages, dans l’orientation bibliographique figurant à la fin de ce livre. Vive reconnaissance à eux !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Licencié en arts et sciences de la communication,
Henri Deleersnijder est professeur d’histoire et collaborateur au service « relations extérieures et communication » de l’université de Liège. Soucieux de mettre en évidence les courants politiques profonds et durables que l’actualité immédiate empêche trop souvent de déceler, il s’implique surtout dans des recherches à l’intersection de l’histoire des idées, de la science politique et des médias, intérêts qui se retrouvent dans ses ouvrages.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
« Il faut, dans nos temps modernes, avoir l’esprit européen. »
Germaine de Staël
Prologue
On connaît la boutade prêtée à Henry Kissinger : « Quand on veut parler à l’Europe, à quel numéro de téléphone faut-il appeler ? » Avec sa surprenante justesse, cette question résume à elle seule toute la problématique abordée dans le parcours historique de l’idée d’Europe que propose cet essai.
Depuis sa lointaine origine, le Vieux Continent, selon une appellation du langage courant, est resté divisé, périodiquement entraîné dans des affrontements sanglants qui laisseraient entendre que la guerre est son lot naturel et ses rares périodes de paix des bouffées d’air passagères. Rien qu’au cours du terrible XXe siècle, deux guerres devenues mondiales s’y étaient déclenchées. Constat qui, après 1945, amena plusieurs grands témoins des heures sombres de leur existence à jeter les bases d’une Union européenne : Jean Monnet et Robert Schuman furent les principaux pionniers de ce projet.
Aujourd’hui, cet édifice, patiemment construit durant de longues décennies, risque de se lézarder, sinon de s’effondrer, miné par les effets délétères d’un désamour qui prend parfois la forme d’un rejet pur et simple. Défiance et hostilité mettent à mal la concrétisation d’une idée qui s’est forgé un chemin, tout au long des siècles et malgré les embûches, grâce aux écrits de penseurs désireux d’unifier l’Europe pour y instaurer la paix, tels l’abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, Victor Hugo au XIXe et Aristide Briand au XXe pour n’en citer que trois parmi les plus connus.
Examiner leurs desseins – en leur laissant largement la parole – est l’objet principal de ces pages. C’est aussi une façon de rendre justice à ces pourvoyeurs d’espoir qui ne font que rarement la « une » des livres ou manuels d’histoire, alors que les fauteurs de guerre y occupent tant de place. Le lecteur pourra ainsi entendre leurs voix, tout en se replongeant dans l’époque où elles se sont exprimées.
Les générations nouvelles, et pas seulement elles du reste, manquent de héros positifs, passeurs d’entente entre les peuples. Ne fût-ce que pour damer le pion aux chantres du repli identitaire qui ont de plus en plus l’honneur des tribunes politiques et des médias, apprentis sorciers cultivant souvent la démagogie et la virulence verbale comme uniques ressorts rhétoriques.
Car le parcours mémoriel de ce livre est traversé par une nette conviction : peut-être même autant que l’ultralibéralisme qui prévaut aujourd’hui en Europe, le nationalisme, à distinguer du patriotisme sans haine, est l’insidieux ennemi de la construction de l’Union. En 1934, dans un de ses Appels aux Européens, Stefan Zweig en dénonçait déjà les funestes dérives : « L’égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l’altruisme sacré du sentiment européen, parce qu’il est toujours plus aisé de reconnaître ce qui vous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et désintéressement1. » Puisse le sombre présage du suicidé du Brésil, auteur du poignant Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen qui avait fui le nazisme, avoir en l’occurrence eu tort ! Et qu’ainsi puisse se poursuivre aujourd’hui, loin des enfermements nocifs mais avec l’appui de politiques sociales, l’œuvre d’unification européenne dont tant de prédécesseurs visionnaires avaient semé les jalons.
Oui, l’Europe doit à nouveau faire rêver, à condition qu’elle ait une vision d’avenir. Elle en a un urgent besoin, face à tous les défis auxquels elle est confrontée, celui d’achever son unité en priorité. L’histoire, si souvent délaissée à l’heure du présentisme ambiant, peut y contribuer. Surtout si l’on adhère à l’une de ses définitions les plus judicieuses : « art de se souvenir de ce dont les hommes sont capables2 ». Les philosophes, écrivains, poètes et hommes politiques de l’idée d’Europe l’ont été du meilleur.
Si les pages suivantes retentissent de leurs voix, c’est grâce aux historiens et chercheurs qui les ont auparavant recueillies et qui y sont abondamment cités. On retrouvera les noms des principaux d’entre eux, avec les titres de leurs ouvrages, dans l’orientation bibliographique figurant à la fin de ce livre. Vive reconnaissance à eux !
1 Stefan Zweig, « L’unification de l’Europe », dans Appels aux Européens, Paris, Bartillat, 2014, p. 111.
2 Patrick Boucheron et François Hortog, L’histoire à venir, Toulouse, Anacharsis, 2018, p. 20.
À l’origine était le mythe
Un jour que la princesse phénicienne de Tyr, fille du roi Agénor et de Téléphassa, batifolait comme de coutume sur la plage, jouant avec ses servantes ou s’occupant à cueillir des fleurs, elle fut séduite par un taureau blanc, qui n’était autre que Zeus lui-même. C’est que le dieu des dieux, cavaleur plus souvent qu’à son tour, avait été émoustillé par le portrait qu’Hermès, le messager de l’Olympe, lui avait fait de la charmante personne. Il prit dès lors forme taurine pour se mêler au troupeau royal qui, des montagnes, se dirigeait vers le rivage.
L’élue fut bientôt mise en confiance par ce visiteur pour le moins inhabituel, à la beauté aguichante cependant et qui sentait bon l’odeur de safran. Et de lui mettre des guirlandes de fleurs à ses cornes, entre autres mignardises… jusqu’à ce que, montée sur son échine, elle se fit brusquement emporter par lui vers les flots tout proches. L’insolite duo parvint ainsi à Gortyne, en Crète, et Zeus, ayant recouvré sa forme première, s’unit à elle sous des platanes enchanteurs. De cet hymen consommé vraisemblablement à la hussarde naquirent trois garçons, Sarpédon, Rhadamanthe et Minos, le futur roi de Cnossos.
Le père, Agénor, eut beau envoyer ses fils à la recherche de leur sœur, avec interdiction de revenir bredouille à Tyr, rien n’y fit. Durant leur périple, l’un d’entre eux, Cadmos, sur la recommandation de l’oracle de Delphes, fonda la cité de Thèbes en Béotie. Mais de la bien-aimée, qui avait été ravie – à tous les sens du terme – par le dieu du ciel et de la foudre qui la maria au roi de Crète Astérion, il ne subsista nulle trace.
Europe, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, avait bel et bien disparu. Pas tout à fait, à vrai dire. Car, dans l’Antiquité et jusqu’à aujourd’hui, ce mythe de l’enlèvement d’une princesse (ou d’une nymphe, selon les versions de la légende) inspira quantité d’artistes. Dès le VIe siècle avant notre ère, vers 550, un panneau sculpté d’un des temples de Sélinonte, sur la côte méridionale de la Sicile, représente de profil la jeune fille juchée sur le taureau : montée en amazone et l’air serein, elle tient d’une main une de ses cornes tandis que, de l’autre, posée sur son dos, elle veille à ne pas tomber ; en bas, les poissons nageant entre les pattes de l’animal montrent bien que cette chevauchée étonnante se déroule dans la mer. Bon nombre de vases grecs, entre autres supports, telles des mosaïques et des gravures, figureront aussi cette scène et, rien qu’à Pompéi, elle sera reproduite sur les fresques murales de dix-sept maisons antiques.
Par la suite, de nombreux peintres emprunteront le sujet pour des tableaux où le rapt sera traité de différentes manières. Sur celui du Titien par exemple, appelé L’Enlèvement d’Europe (1560-1562), l’atmosphère se fait très lourde : servantes effrayées sur la plage, tempête battant la falaise, ténébreux nuages surplombant l’étrange tandem en partance pour le large. Trois quarts de siècle plus tôt, soit en 1475, le tableau de Liberale da Verona, une huile sur toile illustrant le même sujet, déclinait l’enlèvement en plusieurs phases : à droite, on voit la jeune Europe en train de quitter ses compagnes de jeux puis de monter sur le dos de Zeus-taureau accroupi ; vers la gauche, on la revoit franchissant la mer sur sa monture ; enfin, à l’extrême gauche, le premier ayant troqué sa forme animale pour une figure humaine, on les retrouve tous deux, accolés quasi comme deux amants.
Par ailleurs, de nombreux poètes, jusqu’à André Chénier, Victor Hugo et Leconte de Lisle notamment, déclineront au cours des siècles cette étonnante aventure. Pour nous limiter à la seule littérature gréco-latine, ce sera d’abord le cas, au IIe siècle avant notre ère, de Moschos, de Syracuse : dans un poème alexandrin de cent soixante-six vers, l’Europè, il nous en a donné une version très complète. Elle est évoquée également dans les Métamorphoses (8 ap. J.-C.) d’Ovide. En 23 avant notre ère, Horace (65-83) donne à ce kidnapping une finalité historique par le truchement de Vénus. Celle-ci, s’adressant à une Europe éplorée, lui fait cette exhortation : « Tu ne le sais pas, mais tu es l’épouse de Jupiter [Zeus] invincible. Arrête de sangloter ! Apprends à supporter de bon cœur ta grande fortune. Une partie de la terre prendra ton nom3. »
Ainsi donc, selon une interprétation du mythe qui pêcherait par trop de précipitation, l’Europe serait fille d’Asie, puisque c’est de la côte de l’actuel Liban qu’est parti le périple de la princesse ayant légué son matronyme à notre continent. Ce nom, d’après une étymologie largement admise, porte en lui la trace du mot grec Europè dont il vient : l’adjectif eurus signifie « large » et le nom ops « œil ». Zeus europè, d’ailleurs, c’est Zeus « aux grands yeux » ou « aux larges vues », et Europè aurait le sens de « vaste terre ». Une autre hypothèse, moins retenue aujourd’hui par les hellénistes, évoque une origine sémitique : hereb, c’est le « soir », le « soleil couchant » ou l’« Occident », ce qui s’oppose à « pays du Levant », c’est-à-dire l’Asie. Ex oriente lux, n’est-ce pas.
Quant à Louis de Jaucourt (1704-1779), auteur d’une grande quantité d’articles dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751), il écrit ceci au début de l’entrée « Europe », qualifiée de « grande contrée du monde habitée » : « L’étymologie qui est peut-être la plus vraisemblable dérive le mot Europe du phénicien urrapa, qui, dans cette langue, signifie visage blanc ; épithète qu’on pourrait avoir donné à la fille d’Agénor, sœur de Cadmus, mais du moins qui convient aux Européens, lesquels ne sont ni basanés comme les Asiatiques méridionaux, ni noirs comme les Africains4. » On le voit, différentes interprétations ont été émises au sujet de l’origine d’un mot qui a fini par désigner un continent, mais pas avant la Renaissance.
« Continent incertain »5, au demeurant. Évoquant les frontières de celui-ci, le même de Jaucourt écrit que l’Europe « s’étend dans sa plus grande longueur depuis le cap de Saint-Vincent en Portugal & dans l’Algarve, sur la côte de l’[o]céan [A]tlantique, jusqu’à l’embouchure de l’Obi dans l’Océan septentrional, par l’espace de 1 200 lieues françoises de 20 au degré, ou de 900 milles d’Allemagne. Sa plus grande largeur, prise depuis le cap de Matapan au midi de la Morée jusqu’au Nord-Cap, dans la partie la plus septentrionale de Norwege, est d’environ 733 lieues de France de 20 au degré pareillement, ou de 550 milles d’Allemagne. Elle est bornée à l’Orient par l’Asie ; au midi par l’Afrique, dont elle est séparée par la mer Méditerranée ; à l’occident par l’[o]céan [A]tlantique, ou occidental & au septentrion par la mer Glaciale6 ». Quant à la Russie, à l’entrée qui lui est consacrée dans l’Encyclopédie, l’auteur lui reconnaît une place au sein de l’Europe chrétienne, résultat selon toute vraisemblance de la politique d’européanisation menée par le tsar Pierre le Grand.
Quoi qu’il en soit, pour en revenir à l’Antiquité, le premier à avoir écrit le terme « Europe » est le poète grec Hésiode (VIIIe-VIIe s.), vers 700 avant Jésus-Christ, dans son imposante Théogonie. Il le mentionne de manière extrêmement fugace pour désigner l’une des trois mille Océanines « aux fines chevilles, qui, partout disséminées sur la terre et dans les profondeurs de l’onde, exercent en tous lieux même surveillance, enfants splendides entre toutes les déesses7 ». Daté de 590 avant Jésus-Christ, l’Hymne homérique à Apollon, lui, est beaucoup plus explicite : le mot ne s’y applique plus à une figure mythologique, mais à un territoire. Allusion y est faite, en effet, « à ceux qui vivent dans le riche Péloponnèse, et ceux de l’Europe et tous ceux des îles baignées par les vagues ». C’est qu’à partir du VIe siècle avant notre ère, les Grecs ont pris l’habitude de considérer que la Terre comporte trois continents : l’Asie, l’Europe et la Libye (autrement dit, l’Afrique).
Qu’est-ce à dire ? Eh bien, c’est que l’Europe se limite à l’Hellade, soit les régions centrales de la Grèce antique. Tout cela rendra perplexe, un siècle plus tard, l’historien Hérodote (484-425), dont le moins qu’on puisse dire est qu’il a pris ses distances à l’égard des mythes. Écoutons-le à ce propos : « Pour l’Europe, on ne sait si elle est entourée par la mer, ni d’où lui vient son nom, ni qui le lui a donné, à moins d’admettre qu’elle ait pris celui de la Tyrienne Europe – ce qui voudrait donc dire qu’auparavant elle n’avait pas de nom, comme les deux autres. Cependant on sait bien que cette femme, Europe, était une Asiatique, et qu’elle n’est jamais venue dans le pays que les Grecs appellent aujourd’hui Europe ; elle passa seulement de Phénicie en Crète et de Crète en Lycie [sud-ouest de la Turquie actuelle]. Mais nous n’en dirons pas plus là-dessus – et nous donnerons à ces pays leurs noms habituels8. »
Hérodote s’est donc rallié aux « noms établis par la coutume ». À ceci près que, chez lui, le mot « Europe » acquiert une signification nettement plus large : il y voit certes une des trois parties constituant la Terre, mais la perçoit très étendue. À l’ouest, il la voit s’étendre jusqu’à l’embouchure du Pô et même jusqu’aux îles Hébrides, situées au sud de la mer d’Écosse, au nord bien au-delà du Danube jusqu’au rivage de la mer du Nord, à l’est, enfin, jusqu’au fleuve Tanaïs, l’actuel Don se jetant dans la mer d’Azov.
Tout cela reste un peu flou, on en conviendra, au point que, pour le « père de l’histoire » et ses contemporains, l’Europe serait plus vaste que l’Asie. Alors que, selon Paul Valéry (1871-1945) – qui reprenait là une observation faite bien avant lui par les géographes des siècles antérieurs –, l’Europe n’est qu’un « petit cap du continent asiatique9 ». Mais il y aurait beaucoup à dire aussi, en ce qui concerne notre actualité, sur les limites du Vieux Continent : la Turquie, par exemple, est-elle européenne ou non ? Et qu’en est-il de l’immense Russie et des pays du Caucase ? Quoi qu’il en soit, pour s’en tenir à la seule Antiquité, ce sont les Grecs qui ont forgé la notion d’« Europe ». Et, si l’on s’en tient aux géographes Strabon (v. 60 av. J.-C.-v. 20 ap. J.-C.) et Ptolémée (v. 90-v. 168), il s’agit d’une des trois parties connues de l’époque, avant les grandes découvertes donc.
Faut-il en déduire que, chez eux, il y avait coïncidence à ce sujet entre expression géographique et conception « morale10 » ? Tant s’en faut. On sait que tous ceux qui ne parlaient pas la langue hellénique et ne partageaient pas un minimum de la culture qu’elle véhiculait étaient taxés de « Barbares », même si, physiquement parlant, ils vivaient sur un territoire conçu comme faisant partie de ladite Europe. Les seuls qui échappaient à la péjoration inhérente au terme « barbarie » étaient ceux qui, outre la Grèce elle-même, vivaient en Italie et, d’une façon générale, sur les côtes méditerranéennes de la Gaule et de l’Espagne, soit là où des colons grecs s’étaient installés de longue date. Et, cela va de soi, sur le rivage ionien de l’Asie mineure.
Cette Europe politico-culturelle se différenciait fondamentalement de l’Asie, prisonnière du despotisme pour les Anciens. Dans Les Suppliantes, en 422 avant Jésus-Christ, le poète tragique grec Euripide (480-406) nous le rappelle par la voix de Thésée : « Pour un peuple il n’est rien de pire qu’un tyran. Sous ce régime, pas de lois faites pour tous. Un seul homme gouverne, et la loi, c’est sa chose. Donc, plus d’égalité, tandis que, sous l’emprise de lois écrites, pauvre et riche ont mêmes droits. […] De plus, dans les pays où le peuple gouverne, il se plaît à voir croître une ardente jeunesse. Un tyran hait cela : les meilleurs citoyens, ceux dont il croit qu’ils pensent, il les abat, craignant sans cesse pour son trône. Que peut-il donc rester de force à la patrie, lorsque, comme un champ que le printemps fleurit, on y vient moissonner l’épi de la vaillance11 ? » Ces paroles du principal héros attique résonnent toujours d’un souvenir aigu : celui des combats de résistance menés par les cités de Sparte et d’Athènes, au cours des guerres médiques, contre l’envahisseur perse.
Les Occidentaux, si tant est qu’on puisse utiliser ce mot très contemporain pour les habitants des régions situées à l’ouest de la Grèce, ne s’en sortent pas mieux que les Asiatiques. Pour d’autres raisons, à vrai dire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans un passage de sa Politique, Aristote (384-322) considère que « les peuples qui habitent les climats froids, les peuples d’Europe, sont en général pleins de courage ; mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie ; et s’ils conservent leur liberté, ils sont politiquement indisciplinables, et n’ont jamais pu conquérir leurs voisins12 ». Et il poursuit : « En Asie au contraire, les peuples ont plus d’intelligence, d’aptitude pour les arts ; mais ils manquent de cœur, et ils restent sous le joug d’un esclavage perpétuel13. »
Quel est donc pour le philosophe le pays idéal qui offre les qualités de l’une et l’autre contrées ? La Grèce, bien sûr : « La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit toutes les qualités des deux autres. Elle possède à la fois l’intelligence et le courage. Elle sait en même temps garder son indépendance et former de bons gouvernements, capable, si elle était réunie en un seul État, de conquérir l’univers. Dans le sein même de la Grèce, les divers peuples présentent entre eux des dissemblances analogues à celles dont nous venons de parler : ici, c’est une seule qualité naturelle qui prédomine, là elles s’harmonisent toutes dans un heureux mélange. On peut dire sans craindre de se tromper qu’un peuple doit posséder à la fois intelligence et courage pour que le législateur puisse le guider aisément à la vertu14. »
Un siècle auparavant, au Ve, Hippocrate (v. 460-v. 377) avait déjà fait œuvre d’anthropologue lorsque, dans le traité Airs, eaux, lieux, il insistait sur l’impact de l’environnement sur les caractéristiques physiques et psychologiques d’une population déterminée, et, d’une façon générale, sur le rôle joué par les conditions de vie naturelles sur les mœurs des différents peuples connus, tant de l’Asie que ceux de l’Europe, désignés par lui avec l’appellation Europaioi. Et de conclure sa démonstration par une exhortation à l’adresse de ses collègues : « Partez de ces données dans votre estimation pour considérer le reste, et vous ne commettrez pas d’erreur15. » Même si elle rencontre aujourd’hui moins de succès, la théorie des climats a connu une fortune durable depuis l’Antiquité grecque. Jusque dans De l’Esprit des lois (1748) de Montesquieu (1689-1755), fin observateur des sociétés humaines : l’appliquant à la matière politique, il écrit que « ce sont les différents besoins dans les différents climats, qui ont formé les différentes manières de vivre ; et ces différentes manières de vivre ont formé les diverses sortes de lois16 ».
L’opposition Orient-Occident aura, elle aussi, la vie dure, et ce bien avant que ne s’énonce, sous la plume de Samuel Huntington dans son article « The clash of civilizations » (1993), le concept de « choc des civilisations ». La Grèce, qui s’est vue comme le bouclier de la liberté face à l’ogre asiatique, a eu d’abord vis-à-vis de lui – successivement incarné par Xerxès et Darius –, une politique défensive. Avec le roi Philippe de Macédoine, dans la seconde moitié du IVe siècle, son action prend une dimension offensive. Et, avec son fils Alexandre le Grand, elle se concrétisera non seulement par un désir de revanche face à un Empire perse qui avait failli faire perdre leur autonomie aux cités grecques, mais aussi par une politique de conquête qui portera le jeune et brillant général jusqu’aux confins de l’Indus. S’ensuivit, promue par le glorieux vainqueur, une volonté de rapprochement, sinon de fusion, entre les cultures orientale et hellénique, elle-même encouragée par des mariages entre soldats grecs et femmes perses.
Mais l’Empire d’Alexandre ne survécut pas à la disparition prématurée, en 323 avant Jésus-Christ, de celui qui l’avait forgé par son génie militaire. La civilisation hellénistique bien, par contre, qui vit progressivement s’avancer en son sein la puissance militaire de Rome. Un peu après le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, l’affaire était entendue : l’hégémonie romaine allait bientôt s’étendre sur la Grèce et sur tout le pourtour de la Méditerranée, cette Mare nostrum au nom particulièrement évocateur. Même s’il s’appliquait à sa portion géographique occidentale, le vocable d’Europe n’avait plus cours dans ce vaste ensemble géopolitique allant à l’ouest jusqu’au limes du Danube et du Rhin – avec le mur d’Hadrien entre la Bretagne et l’Écosse –, à l’est jusqu’à la lisière de l’Euphrate et de l’Arabie, au sud du Maghreb à l’Égypte. Seul comptait l’Empire, et rien que lui, avec des contrées orientales nettement plus prospères et rayonnantes, comme le prouvera l’éclat de Constantinople – l’ancienne Byzance – à partir de 330 après Jésus-Christ.
En 416 de notre ère, soit six ans après le sac de Rome par Alaric Ier et en un siècle où la puissance romaine allait à terme succomber définitivement sous les coups de boutoir des invasions dites « barbares », le poète latin d’origine gauloise Rutilius Namatianus (v. 370-ap. 417) écrivait, s’adressant à la ville de Rome : « Tu as formé pour les nations les plus distantes une même patrie ; aux peuples sans loi que tu as conquis tu as fait du bien en régnant sur eux. En offrant aux vaincus le partage de tes propres lois, tu as fait une cité de ce qui jadis était l’univers17. » Ce qui fera dire, au XIXe siècle, à l’historien suisse Jacob Burckhardt (1818-1897) : « Rome sauva toutes les cultures du monde ancien pour autant qu’elles existaient encore et pouvaient être sauvées. […] Sans la monarchie universelle de Rome, il n’y aurait pas eu de continuité dans la vie intellectuelle. Il est très significatif que l’Empire, même morcelé, ait ainsi tendu sans cesse à l’unité18. »
Du coup, ceux qui, comme les Germains, n’avaient pas voulu se ranger sous la bannière législative romaine étaient affublés, puisque non-Romains, de l’infamante qualification de « barbares ». Y compris, quand l’Empire devint chrétien après la conversion de Constantin (312, selon la tradition chrétienne), chez un apologiste du rang de Paul Orose (v. 380-ap. 417), auteur de l’ouvrage Histoires contre les païens (v. 417-418). Pour ce prêtre originaire de Braga, en Galice (actuellement au nord du Portugal), « les Goths ne pouvaient en aucune façon obéir aux lois à cause de leur barbarie effrénée19 », et ce, en dépit des efforts fournis par le roi des Wisigoths Athaulf, qui régna de 410 à 416. Peut-être aussi parce qu’ils ne s’étaient pas encore convertis à la foi chrétienne… ?
3 Horace, Odes, III, 27.
4 Cité par Rotraud von Kulessa et Catriona Seth (éd.), L’idée de l’Europe au Siècle des Lumières, Cambridge, Royaume-Uni : Open Book Publishers, 2017, p. 26.
5 Voir à ce propos Axelle Chassagnette, « Continent européen, continent incertain », dans Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), L’Europe. Encyclopédie historique, Arles, Actes Sud, 2018, pp. 116-122.
6 Cité par Axelle Chassagnette, dans Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), op. cit., p. 120.
7 Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 364-366, coll. « Rivages poche. Petite Bibliothèque », Paris, Payot & Rivages, p. 89.
8 Hérodote, L’Enquête, IV, 45, dans Hérodote et Thucydide, Œuvres complètes, coll. « La Pléiade », Paris, Gallimard, 1964, p. 303.
9 Cité par Denis de Rougemont, dans Vingt-huit siècles d’Europe. La conscience européenne à travers les textes d’Hésiode à nos jours, Paris, Payot, 1961, p. 33.
10 Terme plusieurs fois employé dans ce contexte par Federico Chabod dans le chapitre I de son ouvrage Histoire de l’idée d’Europe, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014. Lequel a particulièrement inspiré ces lignes relatives à l’interprétation par les Grecs du mot « Europe ».
11 Euripide, Les Suppliantes, entre les vers 399 et 451, Paris, Les Belles Lettres, 1976.
12 Aristote, Politique.
13Ibid.
14Ibid.
15 Hippocrate, Airs, eaux et lieux, XXIV, Paris, Les Belles Lettres, 1996, dans Yves Hersant et Fabienne Durand-Bogaert, Europes. De l’Antiquité au XXesiècle. Anthologie critique et commentée, Paris, Robert Laffont, 2000, p. 25.
16 Montesquieu, De l’Esprit des lois, 3e partie, liv. XIV, chap. X.
17 Rutilius Namatianus, Sur son retour, livre premier, Paris, Les Belles Lettres, 2017, p. 5.
18 Cité par Carlo Ossola, Fables d’identité. Pour retrouver l’Europe, Paris, Presses universitaires de France / Humensis, 2018, p. 16.
19 Cité par Federico Chabod,op. cit., p. 55, note 41.
La Respublica christianadu Moyen Âge
Après la cassure Est-Ouest et Nord-Sud, consécutive à la disparition de l’Empire romain d’Occident en 476 et à la conquête arabe du VIIe siècle, le mot « Europe », dépourvu de tout contenu politique aux yeux des Anciens, a sensiblement servi à désigner l’aire géographique occidentale du Vieux Continent. Mais, l’expansion du christianisme aidant, le concept qu’il véhiculait cahin-caha s’est bientôt chargé d’une signification inconnue dans l’Antiquité païenne. Autrement dit, la Respublica romana de l’Antiquité s’est petit à petit muée en Respublica christiana20 de l’âge médiéval.
La mutation du monde païen en monde chrétien, car c’est bien de cela qu’il s’agit, ne s’est pas opérée du jour au lendemain, comme on s’en doute. « Il a fallu de nombreux siècles pour que s’impose le terme de “chrétienté” (christianitas), appliqué à une région21. » Elle se fit, grosso modo, du Ve au XIe siècle. Durant le Haut Moyen Âge, par exemple, dans un manuscrit d’Isidore de Séville figurant l’orbis christianus, la Terre, entourée d’un cercle, est divisée en trois parties : Asia, Europa, Africa ; à chacun de ces trois continents sont respectivement attribués les noms de Sem (pour l’Asie), de Japhet (pour l’Europe) et de Cham (pour l’Afrique), tous trois fils de Noé selon la Bible. Un plus grand cercle, englobant le premier, figure l’Océan. Mais le mot « Europe » ne désigne chez l’évêque auteur de cette représentation qu’une réalité géographique, confirmée du reste dans son Traité de la nature (v. 620). Réalité géographique qui comportait cependant déjà une « valeur ajoutée » : ce Japhet étant plus ou moins assimilé à Japet, le père de Prométhée, le continent européen s’en trouvera ipso facto