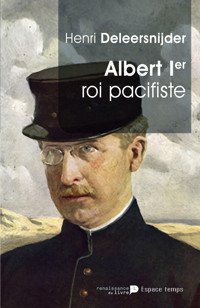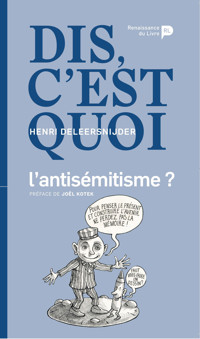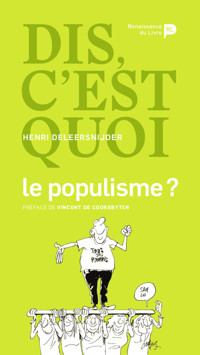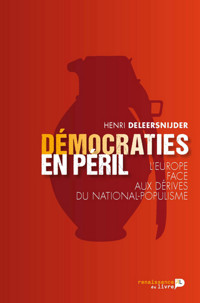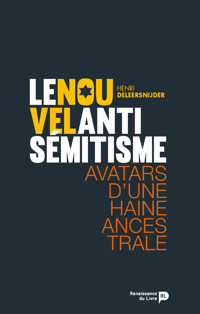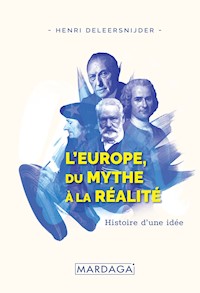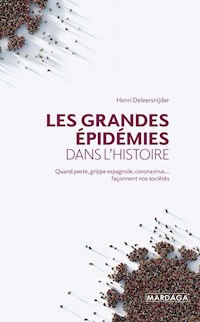
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Découvrez les grandes épidémies qui ont façonné notre histoire afin de mieux comprendre notre société actuelle et la crise d'aujourd'hui.
Peste, lèpre, variole, syphilis, typhus, choléra, tuberculose, grippe espagnole, polio, sida... Les épidémies ont jalonné l'histoire de l'Occident et marqué des tournants dans l'évolution de ses sociétés. Aujourd'hui encore, nous n'en sommes pas épargnés : personne n'avait anticipé la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et certains annoncent déjà un « monde d'après », changé par le coronavirus.
Dans cet ouvrage, Henri Deleersnijder retrace l'histoire de ces grandes épidémies, en mettant en lumière leurs divers impacts. De la peste à la Covid-19, il décortique les mécanismes de chacune d'entre elles et décrit les bouleversements socio-politiques qu'elles ont produits. De plus, l'auteur s'attache à faire des parallèles entre les crises sanitaires du passé et l'actuelle, nous invitant ainsi à prendre du recul et à mieux appréhender celle-ci.
Une compréhension historique des grandes épidémies et de leur fonctionnement, pour mieux aborder les jours à venir
Dans cette frise chronologique, Henri Deleersnijder retrace les différentes épidémies qui ont influencé nos vies et en dégage les parallèles à faire entre elles afin que nous ne fassions plus les mêmes erreurs qu'hier.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Henri Deleersnijder, professeur à l’ULiège, a d’ailleurs profité du confinement pour réfléchir aux aspects sociaux des différentes crises sanitaires que l’Humanité a connues."
- RTBF
"Henri Deleersnijder ajoute un nouvel élément qui démontre toute l’importance des sur l’évolution de nos sociétés et de leur histoire."
- Dimanche
"Henri Deleersnijder remonte le cours de l'histoire et raconte les grandes épidémies qui ont ébranlé l'Occident, qui ont marqué l'histoire des peuples, jusqu'à infléchir leur destinée."
- Le Quinzième Jour
À PROPOS DE L'AUTEUR
Licencié en arts et sciences de la communication,
Henri Deleersnijder est professeur d’histoire et collaborateur scientifique à l’université de Liège. Soucieux de mettre en évidence les mouvements historiques du temps long, ces courants politiques profonds et durables que l’actualité immédiate empêche trop souvent de déceler, il s’implique surtout dans des recherches à l’intersection de l’histoire des idées, de la science politique et des médias, intérêts qui se retrouvent dans ses ouvrages.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les grandes épidémies dans l’histoire
Henri Deleersnijder
Les grandes épidémies dans l’histoire
Quand peste, grippe espagnole, coronavirus… façonnent nos sociétés
C’est à l’échelle du monde que se joue désormais le destin pathologique des hommes.
FERNAND BRAUDEL
L’homme n’est rien d’autre qu’une résistance absolue, inentamable, à l’anéantissement.
ROBERT ANTELME
Les épidémies ont une façon bien à elles de perdre leur élan.
PHILIP ROTH
PROLOGUE Des effets de sidération uniques
Dans l’Apocalypse de Jean, il est question de deux Bêtes complices de Satan. L’une est dite de la mer : « Je vis alors monter de la mer une Bête à dix cornes et sept têtes ; elle portait sur les cornes dix diadèmes et, sur les têtes, des titres blasphématoires1. » ; l’autre est issue de la terre : « Je vis ensuite une autre Bête monter de la terre ; elle avait deux cornes, comme un agneau, mais elle parlait à la dragonne2. » Ces monstres, symbolisant selon toute vraisemblance l’Empire romain idolâtre, trônent au cœur même d’une certaine eschatologie chrétienne, celle-là même qui – en-dehors de la Résurrection et du Jugement dernier – traite de la fin du monde.
À une époque comme la nôtre qui bruit d’une angoisse millénariste, où la collapsologie a le vent en poupe et où l’effondrement planétaire paraît même imminent, il n’est pas sûr que les preppers, ces survivalistes les plus avertis, aient prévu que la catastrophe surgirait d’une minuscule « entité », en forme de couronne qui plus est, d’où son nom de coronavirus. Cet organisme non vivant, qu’on pourrait tout juste qualifier d’« intervie », est tout au plus une molécule de protéine (ARN, acide ribonucléique très proche chimiquement de l’ADN), protégée par une fine couche de graisse extérieure. Mais si cette bête à picots n’a évidemment rien à voir avec les mastodontes évoqués dans le dernier livre du Nouveau Testament, elle possède par contre une dangerosité qui ébranle depuis peu les fondements de nos sociétés mondialisées, hyper-technicisées et super-connectées, sans parler de la santé de leurs populations mises en coupe réglée par elle.
Fameux coup de semonce pour notre humanité ! Et pour un monde développé qui se croyait à jamais à l’abri de crises sanitaires d’une ampleur aussi stupéfiante. C’est peu dire qu’il a senti passer le souffle de l’apocalypse. Il n’est pas inintéressant, à cet égard, de se souvenir que ce mot signifie « révélation ». Car la pandémie du Covid-193, ce SARS-CoV-2 dont l’appellation est formée de« co »pour« corona », de« vi » pour « virus », de « d » pour disease (« maladie », en anglais) et de « 19 » pour l’année 2019 où il est apparu, nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, ainsi que sur nos modes de vie, même si ce virus n’est évidemment porteur d’aucun sens. Indépendamment des morts qu’il a provoquées – et rien ne prouve que l’hécatombe soit définitivement arrêtée –, son impact sur nos existences quotidiennes est d’ores et déjà énorme, comme l’ont montré l’état de confinement du printemps 2020 et celui de l’automne. Au point qu’il est désormais question d’un « monde d’avant » et d’un « monde d’après ». Ce qui rejoindrait, d’une certaine façon,une interprétation ancienne des temps dits« apocalyptiques », annonciateurs de malheurs certes mais aussi de jours meilleurs, une fois vaincues les forces du Mal.
C’est à tenter de décrypter, à ce jour, plusieurs effets durables de la pandémie de Covid-19 que le présent essai s’emploie. Mais il entend surtout faire un retour sur d’autres grandes épidémies qui ont marqué l’histoire des peuples, jusqu’à infléchir leur destinée : de la « peste » d’Athènes au Vesiècle avant notre ère jusqu’à la grippe dite « espagnole » de 1918-1919, en passant par la Peste noire du milieu du XIVesiècle – meurtrière entre toutes – et les explosions de choléra en Europe, au cours du XIXe siècle.
Que serait cependant une froide évocation de ces fléaux sans les témoignages de ceux qui les ont vécus ou les œuvres de ceux qui y ont puisé un matériau littéraire ? Raison pour laquelle il sera fait fréquemment appel à celles-ci et à ceux-là. Plonger dans le passé offre toujours plus d’attrait lorsque cette exploration s’enrichit d’une densité humaine, et rien de tel à cette fin que de s’abreuver des vertus de la narration offertes par la littérature. Sans remonter au début de l’Iliade où Zeus envoie une épidémie aux mortels, il en sera ainsi de Thucydide (v. 460-v. 400) dans sa Guerre du Péloponnèse et d’Albert Camus (1913-1960) dans La Peste, pour ne citer que ces deux exemples. Appel fréquent sera fait également aux spécialistes d’un champ d’études où, jusqu’à une date relativement récente, il y avait assez peu d’arpenteurs.
Puisque les crises sanitaires contribuent à façonner nos sociétés, on peut être convaincu que la pandémie de coronavirus donnera l’occasion aux chercheurs (historiens, sociologues, journalistes, etc.) de récolter des récits de vie induits par l’événement historique qu’elle a enclenché. Il est certain que ce travail d’archivage a déjà commencé et qu’il se poursuit. Ce sera là une masse de documents dans laquelle pourront puiser les disciples de Clio, persuadés de l’utilité de l’histoire conçue dans sa dimension de longue durée. Ainsi seront prises en compte les traces qu’aura laissées le Covid-19. Cette grande épidémie à propos de laquelle Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l’Institut Pasteur et professeur au Collège de France, dira : « Jamais je n’aurais cru voir cela de mon vivant4. »
Avant de se lancer dans le parcours de quelques-unes des plus grandes crises sanitaires de l’histoire des sociétés occidentales, un distinguo lexicographique s’impose, même s’il va de soi : le mot « épidémie », formé de l’élément « épi » (« entourage ») et du grec « démos » (« peuple »), concerne une population d’une zone géographique délimitée ; celui de « pandémie », constitué de l’élément « pan » (« tout ») et également du grec « démos » (« peuple »), suppose un mal touchant la quasi-totalité d’une population, voire l’ensemble des êtres humains de la planète. En dépit de la différence de sens qu’ils comportent, ces noms relatifs à des maladies infectieuses et transmissibles seront, à l’occasion, employés l’un pour l’autre dans les pages qui suivent.
1. La Sainte Bible, Braine-le-Comte, Ėditions de Maredsous, 1950, chapitre 13, 1, p. 1395.
2. Ibid., chapitre 13, 11, p. 1396.
3. « Covid »étant l’acronyme deCorona virus diseaseet le noyaudisease (« maladie », en anglais) étant du féminin en français, l’Académie française a recommandé, le 7 mai 2020, l’emploi de ce genre, et donc de dire et d’écrire « la Covid-19 ». Mais comme ce choix de l’illustre institution est loin de faire l’unanimité, nous avons cru bon de garder le masculin, à l’image d’un usage majoritaire en vigueur à ce jour, tant à l’oral qu’à l’écrit, en particulier dans les médias. À chaque occurrence du terme, on lira donc « le Covid-19 ».
4. Libération, 16 octobre 2020.
La peste d’Athènes, une première
Dans l’Antiquité, le premier à décrire par le menu une épidémie est l’historien grec Thucydide. Nous sommes alors à l’été 430 avant notre ère, au cours de la deuxième guerre du Péloponnèse opposant Athènes et Sparte, et l’Attique vient d’être à nouveau envahie par les Lacédémoniens : « Ils installèrent leur camp dans le pays et se mirent à saccager les campagnes. Quelques jours seulement après leur arrivée, la peste fit sa première apparition parmi les Athéniens. Précédemment déjà, plusieurs pays, dans la région de Lemnos [île grecque au nord-est de la mer Égée] et ailleurs, avaient été, dit-on, atteints par le même mal, mais on ne gardait nulle part le souvenir d’une épidémie aussi violente et aussi meurtrière que celle-ci. Les médecins, soignant pour la première fois une maladie qu’ils ne connaissaient pas, étaient impuissants. C’est même parmi eux que la mortalité fut le plus élevée, car ils avaient avec les malades des contacts plus fréquents. Tous les moyens d’action humains restaient inefficaces. Quant aux prières qu’on faisait dans les temples, aux consultations d’oracles et autres moyens de ce genre, tout cela n’était d’aucun secours et, comme le mal se montrait le plus fort, on cessa finalement d’y avoir recours5. »
Thucydide rappelle alors le périple qu’a suivi le fléau : né en Éthiopie, il passa ensuite en Égypte et en Libye, ainsi que dans une grande partie de l’Empire perse, avant de finir par atteindre Athènes, et d’abord le port du Pirée. De là, il se répand dans la cité même. Voici une description clinique de la maladie, dont la précision ne manque pas de surprendre : « On s’accordait généralement pour constater que cette année-là, les autres maladies avaient été exceptionnellement rares et ceux qui, antérieurement, avaient pu se trouver souffrants, furent tous atteints finalement par le nouveau mal. Quant aux autres, sans aucune cause apparente et alors qu’ils étaient en pleine santé, ils commençaient par ressentir brusquement à la tête une chaleur brûlante, accompagnée de rougeur et d’inflammation des yeux. Les parties internes, c’est-à-dire la gorge et la langue, devenaient aussitôt sanguinolentes ;la respiration était irrégulière et l’haleine fétide. C’étaient ensuite des éternuements avec enrouement de la voix. Bientôt le mal descendait dans la poitrine, provoquant une toux violente. Lorsqu’il atteignait le cœur, des troubles graves s’y produisaient et le patient évacuait avec de vives souffrances toutes les espèces d’humeurs bilieuses que les médecins ont distinguées. Puis, dans la plupart des cas, on était pris de spasmes entraînant non plus des vomissements, mais de violentes convulsions. Cette crise survenait tantôt après que les nausées se fussent calmées, tantôt beaucoup plus tard. Extérieurement, le corps ne semblait pas tellement brûlant quand on le touchait et la couleur n’en était pas bilieuse ; il était rougeâtre, livide, parsemé de petits phlyctènes et d’ulcères. Pourtant, les malades ressentaient intérieurement une fièvre si dévorante que les vêtements les plus légers et les plus fines étoffes de lin leur étaient insupportables ; ils tenaient à rester nus et leur plus grand désir était de se jeter dans l’eau froide. C’est du reste ce qu’ils firent souvent, quand ils n’avaient personne pour les garder : en proie à une soif inextinguible, ils allaient se jeter dans les citernes. On pouvait les faire boire plus ou moins, cela ne changeait rien à leur état. Ils étaient continuellement torturés par une agitation impossible à calmer et par le manque de sommeil6. »
Les malades qui avaient survécu à l’issue fatale, « soit le septième soit le neuvième jour7 », n’échappaient pas pour autant à d’atroces souffrances supplémentaires – faites d’« une forte ulcération et de violentes diarrhées8» dans les intestins – avant de succomber à leur tour. Et ceux qui avaient la chance de survivre à ce fléau « se voyaient atteints aux extrémités. Leurs organes génitaux, leurs doigts, leurs orteils étaient attaqués et beaucoup ne se rétablirent qu’après les avoir perdus. Certains devinrent aussi aveugles. Quelques-uns se trouvèrent frappés d’amnésie complète dans les jours qui suivirent leur guérison. Ils ne savaient plus qui ils étaient et ne reconnaissaient pas leurs amis9 ».
Thucydide a beau écrire que « les mots sont impuissants à [en] décrire les caractéristiques10 », il n’empêche qu’il en a laissé un tableau tellement parlant que son modèle archétypal ne s’est jamais démenti depuis. Le poète latin Lucrèce (v. 98-55), en particulier, s’en inspire directement à la fin de son épopée philosophique De Natura Rerum (54), dans les vers 1138-1285, pour évoquer à son tour la terrible calamité sanitaire qui a frappé Athènes dans la seconde moitié du Vesiècle avant notre ère, soit par vagues de 430 à 426. C’est notamment le cas quand il parle des cadavres sans sépulture : « [Ils] avaient beau s’entasser les uns sur les autres, les oiseaux et les bêtes sauvages passaient au large pour fuir l’infection ; ou bien si quelques téméraires venaient goûter à la proie, aussitôt ils tombaient en langueur sous la menace de la mort. Les oiseaux ne se hasardaient pas à se montrer durant ces terribles jours et pendant la nuit les bêtes féroces, abattues, ne quittaient point leurs forêts ; la plupart, atteintes par la contagion, languissaient et mouraient ; les chiens surtout, les chiens fidèles, gisant au milieu des rues, exhalaient douloureusement la vie que leur arrachait la violence du mal. C’étaient partout des funérailles sans cortège, lugubres, qu’on hâtait. Et nul moyen sûr d’assurer le salut commun ; car tel remède qui avait conservé à l’un la jouissance des souffles vivifiants de l’air et la contemplation des espaces célestes, apportait aux autres le péril et la mort11. »
Mais il y a plus, évoqué par le grand historien grec : « On n’était plus retenu ni par la crainte des dieux ni par les lois humaines. Voyant autour de soi la mort abattre indistinctement les uns et les autres, on ne faisait plus aucune différence entre la piété et l’impiété. Et quant aux délits que l’on pouvait commettre, nul ne s’attendait à vivre assez longtemps pour subir le châtiment. Chacun redoutait bien davantage l’arrêt déjà prononcé contre lui et suspendu sur sa tête et l’on trouvait tout naturel de tirer quelque plaisir de la vie avant d’en être frappé12. » On peut difficilement imaginer plus grande anomie, cette absence de loi frappant un groupe humain.
Par ailleurs, la peste d’Athènes eut, comme on s’en doute, de profondes répercussions démographiques. Thucydide parle de la perte de plus de cinq mille hoplites au cours des deux importantes vagues de la maladie et de trois centaines de cavaliers dans le courant de la seconde. La population civile, elle, dut payer un lourd tribut à l’hécatombe : peut-être entre 70 000 et 80 000 morts sur environ 200 000 habitants, ce qui laisserait entendre que plus d’un tiers d’entre eux succombèrent sous les accès répétés du mal.
Les sans-abri furent particulièrement touchés : « La situation des Athéniens, déjà accablés par l’épidémie, était encore aggravée par l’entassement des campagnards dans la ville. Les réfugiés furent particulièrement éprouvés. Faute de logements pour les accueillir, ils vivaient dans des baraquements où l’atmosphère, en cette saison de l’année, était irrespirable. Les morts et les moribonds gisaient pêle-mêle. On voyait des agonisants tituber dans les rues. Des malades à demi morts et dévorés par la soif assiégeaient les fontaines. On mourait dans les sanctuaires, où campaient les réfugiés et dont le sol était jonché de cadavres. Les gens, dépassés par l’ampleur du fléau et ne sachant ce qu’ils allaient devenir, en vinrent à ne plus se soucier des lois divines ou humaines. On ne respectait plus aucun des usages qu’on observait avant dans les funérailles. Les familles que la mort avait frappées à plusieurs reprises manquaient des objets nécessaires aux obsèques et beaucoup eurent alors recours à des pratiques indécentes. Trouvant des bûchers dressés par d’autres, ils y déposaient avant eux les cadavres des leurs et y mettaient le feu. Ou bien, sur les bûchers où des corps étaient déjà en train de brûler, ils jetaient les cadavres qu’ils avaient apportés et prenaient la fuite13. »
On mesure, à la lecture de ces débordements, le traumatisme social qu’a provoqué cette peste dont Thucydide lui-même fut atteint mais qui n’épargna pas le stratège Périclès en 429. Tout comme elle dut porter un coup fatal à la prospérité d’Athènes et à sa démocratie, face à la montée en puissance d’une cité de Sparte autoritaire et militarisée au plus haut point. On peut même y voir, en forçant un peu le trait, un sinistre présage du gouvernement des Trente Tyrans (404-403) que la cité de l’Attique connut, une fois livrée à l’hégémonie de sa rivale du Péloponnèse (404-371).
Mais, justement, s’agissait-il d’une peste ? Aujourd’hui, tous les experts s’accordent pour dire qu’elle n’en fut pas une :elle n’a rien à voir avec la peste véritable. Rappelons à ce propos que le mot latin « pestis », signifiant « maladie contagieuse, épidémie » et en général « fléau », s’est longtemps appliqué à toute grande catastrophe sanitaire, entraînant en tout cas une très forte mortalité. Ce qui fait que les hypothèses relatives à la peste d’Athènes sont allées bon train depuis des lustres. La variole a été retenue, frappant une population non immunisée, ainsi qu’une rougeole maligne s’attaquant à un groupe humain n’ayant jamais été mis en contact avec cette affection. C’est néanmoins la fièvre typhoïde – le typhus exanthémateux, plus exactement – qui récolte de nos jours la plus grande adhésion du monde des médecins et des historiens.
5. Thucydide, « Histoire de la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens », II, 47, dans Hérodote et Thucydide, Œuvres complètes, coll. « La Pléiade », Paris, Gallimard, 1964, p. 819.
6. Ibid., II, 49, p. 820.
7. Ibid.
8. Ibid., p. 821.
9. Ibid.
10. Ibid., II, 50, p. 821.
11. Lucrèce, De la Nature, livre VI, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 229-230.
12. Thucydide, op. cit., II, 53, p. 823.
13. Thucydide, op. cit., II, 52, p. 822-823.
La peste antonine et la peste de Cyprien, ou l’Empire romain ébranlé
Pour la peste dite « antonine », c’est plutôt la variole qui est retenue (bien que certaines autorités en la matière évoquent une fièvre hémorragique). Ce qui est certain, c’est que la maladie en question a fait l’objet d’une grande épidémie à partir de fin 165 - début 166 dans l’Empire romain. Rome vivait alors sous la dynastie des Antonins (96-192) – d’où l’appellation « antonine » –, et plus précisément sous le règne de l’empereur philosophe Marc Aurèle (121-180).
En Orient, à la suite des acquisitions territoriales de Pompée (107-48), le limes avait été fixé sur l’Euphrate. Mais Trajan (53-117) avait franchi cette frontière assignée par Auguste (63 av. J.-C.-14 ap. J.-C.), bousculant de la sorte l’équilibre géopolitique de la région : à sa conquête de la Dacie (Roumanie contemporaine), il avait ajouté les provinces d’Arménie et de Mésopotamie, ce qui réveilla l’hostilité des Parthes. Ce n’est pas la première fois que ce peuple nomade originaire du Turkestan donnait du fil à retordre aux velléités expansionnistes des Romains. Du coup, le co-empereur Lucius Verus (130-169) fut envoyé sur le terrain des opérations, laissant à son général Avidius Cassius (130-175) la responsabilité de l’offensive : celle-ci se solda en 164 par la prise de la ville de Séleucie du Tigre, située dans l’actuel Irak, puis de Ctésiphon toute proche en 165.
Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus ( ? - 272 av. J.-C.). Car les troupes romaines, battant en retraite, abandonnèrent les lieux ravagés par le pillage sacrilège de Séleucie, atteintes de surcroît qu’elles étaient par la peste. Telle est en tout cas la version officielle laissée de l’événement par plusieurs sources antiques. Des recherches historiques récentes ont, par contre, abouti à « l’existence de la maladie dans l’Empire au moins un an avant la fin de la campagne parthe14 » et accréditent l’hypothèse des « progrès de la maladie dans l’Empire avant le retour des armées romaines15 ». Sur leur chemin de retour, les légionnaires ne firent vraisemblablement que la semer de plus belle (Syrie et Asie Mineure), jusqu’à la répandre dans Rome elle-même. Et là résidait à l’époque le médecin Galien (entre 129 et 131- entre 201 et 216) :il allait, de cette épidémie considérée comme étant originaired’Orient, donner une description d’une redoutable précision, en particulier en ce qui regarde l’exanthème, c’est-à-dire l’éruption cutanée très étendue, tout en avouant plusieurs années plus tard que, s’il avait à l’époque précipitamment quitté la capitale de l’Empire, c’est parce qu’y était arrivée ladite épidémie…
Il est vrai que les symptômes du mal avaient de quoi effrayer. Voici ce qu’en dit aujourd’hui l’Académie nationale de médecine : « L’exanthème que décrit Galien est caractéristique de la variole par sa topographie au corps entier, par sa morphologie vésiculo-pustuleuse puis croûteuse et par son évolution. Il insiste à plusieurs reprises sur la couleur noirâtre des éléments cutanés qui est bien due, comme il le supposait, à des extravasations sanguines intralésionnelles. Les autres signes qu’il décrit :fièvre, diarrhée, inconfort gastrique, vomissements, fétidité de l’haleine, etc. se retrouvent dans les descriptions classiques de la maladie. “Tous ceux qui avaient des selles très noires sont morts”, écrit Galien. On connaît, en effet, le pronostic particulièrement péjoratif des varioles hémorragiques16. »
On a beaucoup épilogué sur les effets de cette pandémie sur la destinée de l’Empire romain. Alors que le IIe siècle a constitué pour lui un « siècle d’or », celui de la pax romana, l’événement catastrophique qu’elle a représenté par son ampleur serait vu plus tard comme une entame de son déclin, une sorte de tocsin annonçant le fatal affaiblissement du Bas-Empire. Même s’il convient de ne jamais oublier que « la connaissance [d’un] fait est difficilement dissociable de sa perception et des narrations qu’organisent [ses] sources17 », il est fort possible que les ravages de la maladie aient contribué, par le choc psychologique produit sur les populations tétanisées, à l’émergence des religions orientales, dont le christianisme. Tout cela s’ajoutant au péril de la frontière du Danube, menacée par les Germains. C’est d’ailleurs sur cette frontière qu’il avait été amené à défendre que Marc Aurèle perdît la vie le 17 mars 180, peut-être à la suite d’une attaque de la peste antonine.
Celle-ci, comme bon nombre d’épidémies, fit des retours meurtriers, sous le règne de son fils Commode (161-192). Elle provoqua un important choc démographique : un tiers de la population de Rome a peut-être alors disparu sous les coups de cette peste antonine. Les campagnes ont certainement perdu aussi pas mal de main-d’œuvre. Et l’armée, pour compenser la perte d’effectifs, fit de plus en plus appel à des auxiliaires germaniques et autres populations vivant en dehors de l’Empire. Mais ce sang neuf ne parvint cependant pas à rendre la santé à une société qui le perdit à nouveau avec profusion à partir de 249 environ jusqu’en 262, du fait de la peste de Cyprien, dont les effets se prolongèrent jusque vers 270.
Cyprien (v. 200-258), évêque de Carthage hanté par la fin des temps, décrit cette pandémie, venue d’Égypte pour se répandre dans toute l’Afrique romaine, et au-delà dans l’Empire, avec force détails dans son ouvrage De Mortalitate(La Condition mortelle de l’homme) : « Ces grandes évacuations qui nous abattent, ces cruelles inflammations de gorge qui nous altèrent, ces fréquents vomissements, ces yeux étincelants et pleins de feu, ces membres pourris qu’il faut couper, ce venin froid de la maladie qui nous fait perdre l’usage des jambes, de l’ouïe ou de la vue, tout cela ne sert qu’à exercer notre foi18. » Son diacre Pontius, lui, s’attache plus aux aspects anthropologiques de la peur que cette pestilence provoque : « Tous tremblaient, fuyaient, évitaient la contagion, abandonnant de façon impie leurs propres amis, comme si, en excluant la personne qui était sûre de mourir de la peste, on pouvait exclure la mort elle aussi. »
Il est évidemment difficile d’évaluer avec précision le nombre de décès causés par ces deux pandémies (variole pour la première et peut-être fièvre hémorragique virale pour la seconde) qui frappèrent, quasi coup sur coup, un Empire de plus en plus mis à mal par la pression des peuples barbares à ses frontières. Si l’on retient le chiffre de 65 millions pour l’année 165, peut-être arrive-t-on à celui de 55 ou 45 millions un siècle plus tard, ce qui constitue sans conteste une saignée énorme. Est vraisemblablement plus certain, en revanche, le fait que ces catastrophes sanitaires répétées ont contribué à accélérer la désagrégation de la puissance romaine.
Mais elles n’ont pas été les seules. Il y a eu aussi le rôle joué par les crises climatiques. « Les recherches contemporaines ont pu faire coïncider avec l’année 536 une baisse brutale des températures, causée par une exceptionnelle activité volcanique dans l’hémisphère nord. La décennie 536-545, la plus froide des derniers deux mille ans, subit l’influence de ces éruptions majeures, mais aussi d’une diminution des émissions solaires qui marqua le “petit âge glaciaire de l’Antiquité tardive”19 », observe Claire Sotinel, professeure à l’université Paris-Est-Créteil. Elle rejoint en ce domaine la conviction de l’historien Kyle Harper pour qui « le climat est le premier grand acteur de l’histoire ».« Et les hommes alors ? », pourrait-on à juste titre se demander. Peut-être qu’ils seraient, beaucoup plus qu’on ne le pense communément, soumis aux contingences météorologiques et virales.
14. Kyle Harper, Comment l’Empire romain s’est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, Paris, La Découverte, 2019, p. 157.
15. Ibid.
16. Charles Haas, sur http://www.academie-medecine.fr/la-peste-antonine-2/
17. Benoît Rossignol, « La peste antonine (166 ap. J.-C.) », Hypothèses, 2000/1 (3), p. 34.
18. Cité dans Kyle Harper, op. cit., p. 210.
19. Claire Sotinel, « 536, l’année sans soleil », L’Histoire, n° 471, mai 2020, p. 21.
La peste de Justinien, l’effondrement du monde antique
La peste de Justinien (v. 482-565), elle, mérite sans conteste son nom. Une fouille menée dans une nécropole de Bavière en 2012 a confirmé, grâce à l’examen de squelettes qui y étaient ensevelis depuis la seconde moitié du VIe siècle, que la maladie infectieuse – qui se transformera en pandémie – était d’origine bactérienne. Elle a bien été causée par le germe Yersinia pestis, nom qui provient de celui qui l’a identifié à Hongkong en 1894 : le médecin pasteurien franco-suisse Alexandre Yersin (1863-1943). L’origine de ce bacille, c’est-à-dire une bactérie en forme de bâtonnet, était asiatique. Quant à son génome, il a été analysé en l’an 2000, ce qui a permis de le détecter dans des ossements.
Alors que l’Éthiopie a le plus souvent été considérée comme étant le foyer originel de cette gigantesque épidémie, Procope de Césarée (v. 500-v. 565), son témoin essentiel, affirme qu’elle apparaît en 541 dans le port de Péluse, au nord-est du delta du Nil. Toujours selon cet historien grec très cultivé, elle a remonté la mer Rouge, pour se répandre ensuite le long des routes maritimes dans deux directions différentes : d’abord, vers la Palestine et la Syrie ; puis, d’Alexandrie, via la Méditerranée orientale,vers l’Asie Mineure, la Grèce et Constantinople qu’elle atteint en juin 542.
Comme évoqué plus haut, on estime aujourd’hui qu’un accident climatique d’envergure, provoqué par une éruption volcanique, a créé un « voile de poussière » devant le Soleil en 535-536. Dix-huit mois sans de réels rayons solaires et la Terre rejetant des nuages de sulfate expliqueraient, en plus d’une grave crise frumentaire et l’affaiblissement des corps, la migration vers le nord du continent africain de populations nomades, contraintes de quitter avec le bétail leur environnement habituel, situé plus au sud. Mais des rongeurs auraient accompagné ce déplacement comme passagers clandestins. D’où l’irruption de l’agent épidémique dans les comptoirs de l’Empire romain d’Orient.
Signalons immédiatement que, selon une théorie dominante, ce n’est pas le rat qui transmet la peste à l’homme, mais la puce qui, s’échappant de cet animal ne lui fournissant plus assez de ressources – parce que malade ou mort – s’en va piquer au petit bonheur la malchance un être humain, au niveau du cou par exemple : la redoutable bactérie lui est ainsi inoculée. Les dégâts que celle-ci a commis pour la période en question dépassent l’entendement. Pas moins de dix-huit vagues de peste, en l’espace d’un peu plus de deux siècles – soit de 541 à 767 – ont été recensées, les unes des autres séparées de dix ou douze mois, et ce tant dans l’Empire qu’au-delà, mais principalement dans le pourtour méditerranéen traversé de voies commerciales. À Byzance même, le terrible mal aurait tué entre 40 % et 65 % d’une population évaluée à 500 000 habitants, si l’on en croit Procope du moins. Dans son article sur la peste d’Orient figurant dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Louis de Jaucourt (1704-1779) reconnaît néanmoins la pertinence de ses propos : « Procope nous a donné la description de cette maladie, avec autant d’art que d’exactitude, et aussi bien que s’il avait été médecin de profession. » En plus des fortes fièvres, du délire ou de la prostration, des vomissements et des hémorragies digestives, les contaminés« étaient emportés par un bubon qui se formait, tantôt plus tôt, tantôt plus tard, ou à l’aine ou à l’aisselle, ou sous l’oreille, ou en d’autres parties du corps ».
Évocation analogue chez Grégoire de Tours (538-594) qui, dans son Histoire des Francs (584), parle de l’arrivée de la peste en Gaule, remontant depuis Marseille la vallée du Rhône pour atteindre même la lointaine Trèves. En fait, elle passa d’abord de l’ancienne cité phocéenne jusqu’à Arles en 549, puis atteignit l’Auvergne : « Quand survint le fléau lui-même, l’hécatombe de la population fut telle dans toute la région qu’on ne peut dénombrer toutes les légions qui y tombèrent. Comme les sarcophages et les cercueils faisaient défaut, on mettait en terre dix corps ou même plus que dans une même fosse. On dénombra un certain dimanche dans la seule basilique du bienheureux Pierre [à Clermont-Ferrand] trois cents cadavres. La mort elle-même était subite, car il se produisait à l’aine ou à l’aisselle une blessure à la manière d’une morsure de serpent et on était frappé à mort par ce poison en sorte qu’on rendait l’âme le lendemain ou le troisième jour20. » La description de cet évêque historien ne fait que confirmer les symptômes propres à la peste bubonique : « bubons douloureux à l’aisselle et à l’aine, taches noires autour des piqûres de puces, s’ulcérant et se gangrenant, mort rapide21. »
Le désarroi provoqué par une telle affection, à l’issue fatale foudroyante, aussi bien en dehors de l’État du basileus qu’en celui-ci même, avait des allures apocalyptiques. Ainsi, une épitaphe retrouvée au sud de la mer Morte, datant de 592, révèle que c’était « l’année où les hommes crièrent famine et où il mourut le tiers de l’humanité22