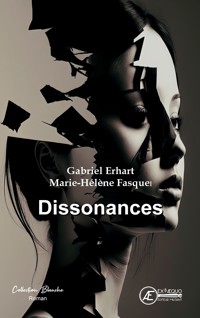
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
À travers quelques portraits de musiciens, ce recueil de nouvelles raconte des histoires singulières où la musique entraîne des réactions imprévisibles, dues à des accoutumances, des addictions, des perturbations mentales, des névroses, façonnant un destin qui avance comme la mécanique bien huilée d’une symphonie. Rien n’est jamais simple dans l’univers des rythmes et des fréquences qui font parfois chavirer des personnages banals vers une dramaturgie cruelle…
À PROPOS DES AUTEURS
Marie-Hélène Fasquel - Professeure agrégée d’anglais, chroniqueuse, jurée de prix littéraires (jurée du Grand Prix des Lectrices Elle 2020, Prix des Lecteurs du Livre de Poche 2022…), conférencière (TEDxRennes), elle est auteure et co-auteure de divers ouvrages. L. Delahousse lui a consacré une émission sur France 2.
Gabriel Erhart - Auteur, saxophoniste et flûtiste professionnel, ex-enseignant en Conservatoire, il s’est produit dans différents festivals de jazz (Tourcoing, Thiers, Côte d’opale, Malterie, Club de jazz de Dunkerque, Petit faucheux…) et pour des ciné-concerts en Égypte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Erhart
Marie-Hélène Fasquel
Dissonances
Nouvelles
ISBN : 97910388-0754-9
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : octobre 2023
© couverture Ex Æquo
© 2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières Les Bains
www.editions-exaequo.com植
Les personnages et les situations de ces récits sont purement fictifs.
Aux géants
Charlie Parker
Stan Getz
John Coltrane
Préface
Saint Augustin disait : chanter est le propre de celui qui aime, et, depuis la nuit des temps, tous les philosophes s’accordent pour dire avec Aristote que la musique adoucit les mœurs…
Depuis, la science a confirmé ces intuitions et prouvé que certaines musiques réduisent l’anxiété, la douleur, voire augmentent les performances sportives.
Et pourtant, ne faut-il pas se méfier d’un tel consensus ?
Pour Emmanuel Bigand, neuroscientifique à l’université de Bourgogne, la musique agit comme une technologie qui transforme l’esprit.
On connaît l’effet destructeur des décibels. Cette destruction affecte-t-elle seulement l’oreille interne ? Ne perturbe-t-elle pas l’ensemble de la chaîne auditive et, au bout du compte, le cerveau lui-même ?
Le psychanalyste Carl Gustav Jung a démontré à quel point est ténue la lisière entre la raison et le noir marais de l’inconscient…
Les auteurs
ANOUK
Stan Getz, surnommé The Sound :
Voyage, Black Hawk.
Je tiens fermement la rampe et je ne peux pas, comme j’en ai l’habitude, plaquer les mains sur mes oreilles alors que les freins de la rame émettent comme un cri de douleur. Enfin le sifflement strident s’arrête. J’appuie sur le bouton fiché devant moi, ce qui provoque une décompression pénible de la porte, et je sors, ajoutant le claquement de mes chaussures à ceux de milliers d’autres sur ce quai de la gare du Nord.
17 h 45. Une voix détimbrée annonce une demi-heure de retard, indifférente, comme si personne n’était censé l’écouter. Je m’engouffre dans la bouche de métro. La réverbération de la galerie souterraine amplifie le cliquetis des talons qui frappent le sol dans une désynchronisation qui me met les nerfs à vif.
Direction Porte d’Orléans. J’arrive avec deux jours d’avance. Je ne sais pas si j’ai bien fait. Pas moyen de joindre Anouk. Je lui ai bien laissé un message sur son portable, mais elle ne m’a pas rappelé. Heureusement, elle m’a envoyé les clefs de son appartement. Un hurlement retentit dans le lointain. Tout ce que j’en comprends, c’est le mot un.
Mécaniquement, je presse le pas. Par chance, personne ne parle ou ne téléphone, quoique mille bruits diffus suintent de la foule qui s’écoule avec moi. J’approche de la zone du cri. Je le sais parce qu’un autre mot vient de s’en échapper. Le mot trois. C’est plus fort que moi, je me faufile parmi les marcheurs et parviens à gagner quelques places dans le cortège. Le cri résonne à nouveau. À mon grand dam, un type en planche à roulettes déchire le magma sonore et m’empêche de le déchiffrer. Mais le type s’éloigne et je jubile, car je viens d’identifier la phrase : « TROIS avocats pour UN euro ! » Le camelot (qui n’est pas encore entré dans mon champ de vision) débite cette phrase sur le même ton que l’employée de la SNCF, quoique subsiste entre ses mots l’espoir que la foule bigarrée lui profite. En réalité, peu de gens se détournent, aspirés par une force à laquelle ils ont depuis longtemps cessé de réfléchir. Sur le quai, le vrombissement de la loco retentit. Les marcheurs s’agglutinent, s’immobilisent au bord du quai, et les chaussures cessent leur concert débridé. Puis la marée s’engouffre dans les wagons et les portes claquent.
Adossé à une barre d’acier, je pense aux trains de mon enfance, triste que soit révolu le temps où les rails tressautaient au rythme de leurs jointures. Désormais, on traque toute imperfection. Montparnasse. Des halls de béton bruyants. Et puis, de temps en temps, en dénivelé, des échoppes en forme de bulles. À l’intérieur, un coiffeur, un boulanger s’y affairent, isolés par des cloisons de plexiglas. En passant, je réussis à saisir quelques mots de la bouche du coiffeur. Il faudrait que je m’arrête et peut-être parviendrais-je à en deviner d’autres ? Mais je n’ai pas le temps. Au débouché d’un escalator, un piano trône, martelé par un inconnu. Enfin, je sors et me dirige vers l’avenue du Maine pour retrouver l’appartement d’Anouk, rue Daguerre. À cette heure le brouhaha de la place Dautry est au plus fort, et je reste sur mes gardes, car des sons violents peuvent surgir à tout moment, pénétrants comme des lames. Rassuré par l’espace extérieur, je commence à réentendre sur mon épaule le chuintement du mousqueton de mon étui de saxophone. Puis, c’est l’avenue du Maine. Depuis combien de temps n’y suis-je pas revenu ?
Marchant sous des platanes droits comme les colonnes de Buren, je dépasse la rue Froidevaux et m’engage dans la rue Daguerre, en partie piétonnière, commerçante, toujours vibrante. J’arrive devant la porte cochère de l’immeuble. Une averse commence à cingler les pare-brise. Je sonne. Pas de réponse. J’insiste. Rien. Il me reste le portable. La messagerie s’enclenche. Je compose le digicode. La porte s’ouvre dans un grincement de gonds. J’entre dans un hall au goût bourgeois, avec moulures en plâtre et lustre en faux cristal, puis je monte par l’escalier de service. Anouk habite dans un duplex, constitué d’anciennes chambres de bonnes, aménagé dans les soupentes. J’arrive devant la porte et sonne. Rien. Où peut bien être passée mon amie ? Il est vrai que je ne l’ai pas revue depuis dix ans, alors, que reste-t-il exactement de notre amitié ?
Si je ne suis pas là, va voir Michel… Tu te rappelles ? La Vieille Tour, rue Losserand…
Je descends. La Vieille Tour est à cinq minutes. Une pluie dense s’acharne sur l’asphalte. J’arrive devant le bistrot d’où s’échappent des bribes de jazz. Michel, qui m’a repéré à travers la baie vitrée crasseuse, me fait signe d’entrer. Je l’embrasse comme au bon vieux temps. Les musiciens ont les uns pour les autres une affection corporatiste. Michel a une moustache à la Edwy Plenel et je remarque que ses cheveux ont jauni.
— Anouk est là ?
— Non. T’es passé chez elle ?
— J’en viens.
— Elle m’a parlé de ton arrivée. Je pensais que c’était jeudi…
— C’est vrai. J’ai décidé de venir un peu plus tôt.
— Tant mieux. Ça lui fera plaisir. Dis-moi, comment ça va la vie lilloise ?
— Très bien, je te remercie, mais j’ai toujours la nostalgie de Paname, tu me connais !
— Tu prends un verre ?
— Merci, Michel, mais je crois que je vais retourner à l’appart attendre Anouk. Tu as mon numéro de portable ?
— Ouais, t’inquiète pas, je t’appelle si je la vois.
— Merci, mon vieux.
— Y’a pas de quoi. Mais je vois que tu as ton flight. Tu nous rejoins demain ? Y’a un bœuf avec les copains. Comme ça tu pourras revoir un peu tout le monde !
— OK ! Alors, à demain.
***
Remontant le col de mon pardessus, je coupe par la rue du Château et regagne l’appartement, qui n’a, semble-t-il, pas changé d’un iota depuis toutes ces années. Les meubles sont toujours aussi moches et les murs vides, à part quelques affiches de concerts défraîchies. Je me sèche les cheveux avec une serviette, enlève mes chaussures et déambule dans le quarante mètres carrés qu’Anouk a acheté avec son avance sur héritage. La rue est bruyante, mais les fenêtres ont du triple vitrage. Le frigo est plein. Peut-être à mon intention ?
Désinvolte, j’entre dans la chambre. Le lit est défait. Il pleut des cordes, la nuit s’annonce précoce. Je grignote une pizza.
Pas de coup de fil de Michel.
***
Le lendemain, j’émerge, sursautant à l’aiguille qui accroche le huit du réveil, sans doute l’heure à laquelle Anouk a l’habitude de se lever. Comme je traverse le salon pour me diriger vers la cuisine, je remarque que le plancher gémit comme le vieillard qu’il était déjà bien avant ma naissance. Posé sur une crédence, je découvre un cadre dans lequel on voit Anouk au temps de la fac. Si ça se trouve, c’est moi qui ai pris cette photo ? En soulevant le coin d’un rideau, je plonge le regard dans la rue au bitume délavé. Dans un placard, je trouve du café soluble. Ça fera l’affaire ! Je passe un nouveau coup de fil à Anouk. Le motif de So What de Miles Davis retentit dans la chambre. Le téléphone repose sur le rebord de la fenêtre.
J’enfile mon pardessus et traîne toute la journée dans le quartier, évitant le plus longtemps possible la Vieille Tour. Je n’ai pas envie de parler du passé.
***
Michel sourit à mon entrée. Non, je n’ai pas de nouvelles d’Anouk. Je descends dans le sous-sol de la boîte. Ici, rien n’a changé non plus.
Les musicos sont déjà là. Inutile de parler. On est heureux d’être ensemble. Un standard sert à s’accorder, puis le public arrive. Michel a trouvé un bassiste pour remplacer Anouk. Je ne le connais pas, mais il assure.
À minuit, je quitte les lieux. Paris, la nuit, c’est quelque chose. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Des pigeons picorent sous un banc sur lequel un SDF est allongé. Une ambulance hurle un peu plus loin. Anouk n’est pas revenue et je m’affale sur son lit, vidé. La nuit passe vite. Je décide de partir et laisse un mot sur la crédence.
Le TGV, cette fois-ci, est dans les clous : 10 h 35 tapantes à la gare de Lille-Europe. Sur les étroits trottoirs, je file à grandes enjambées pour fuir les vents coulis du Nord, m’écartant parfois pour laisser passer des gamins en poussette. À deux pas de la cathédrale de la Treille, j’entre dans un estaminet et, après avoir salué d’un clin d’œil le patron, je me fais servir un potjevleesch et écoute d’une oreille distraite le journal de France 3 Régions : le carnaval de Dunkerque, cette année, affiche un bilan modeste, un mort. Puis l’info revient vers la capitale des Flandres :
« La série continue dans ce que l’on est bien obligé d’appeler désormais l’affaire de la Deûle. S’ajoutant à la disparition de Lloyd Andrieu, de Thomas Ducroo et de Jean Mériadoc, un nouveau corps vient d’être repêché hier juste en face du jardin Vauban. Il s’agit de celui d’une jeune femme domiciliée à Paris : Anouk Brunneghem... »
Je bondis et les regards des clients se tournent un bref instant vers moi.
« Le procureur essaie d’établir une corrélation entre ces différentes noyades. Toutefois, la thèse du suicide ou celle de l’accident paraissent à ce jour les plus probables. En effet, tous les cadavres avaient de fortes quantités d’alcool ou d’héroïne dans le sang, en particulier la jeune femme chez qui l’on a retrouvé une dose létale de méthadone… »
Le patron s’approche :
— Tu veux autre chose ?
— Non, je te remercie.
***
Courbé en deux, je quitte l’estaminet. La rue Sainte-Catherine est à deux pas. Je pousse la porte d’entrée. Pas de minuterie. Tout en montant l’escalier où filtrent les disputes quotidiennes de ménages à bout de souffle, je revois Anouk m’observant au cours des répètes.
Pourquoi est-elle venue à Lille ?
J’allume mon portable pour éclairer le palier et j’aperçois une lettre glissée sous la porte. Je déchire l’enveloppe et reconnais aussitôt l’écriture d’Anouk. Je n’ai pas besoin de lire ce qu’un seul mot pourrait résumer, le mot solitude.
Pour certains, le passé est encore tout proche et les sentiments ne sont qu’endormis. Le temps est comme arrêté. Moi, je ressens l’absence d’Anouk comme un immense vide alors que plus rien n’existait vraiment entre nous. Mais au fond de moi, du plus loin que je me souvienne, je sais que je n’aurais pas pu vivre quelque chose de durable avec Anouk, parce que jamais, non jamais, je n’ai aimé le SON de sa voix.
DIES IRAE
Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem,
Christopher Hogwood, L’oiseau-Lyre.
Lundi 21 décembre.
Maggie remonta le col de sa robe de chambre et franchit la porte vitrée du balcon, son arrosoir à la main. Au loin, la surface irisée du lac se perdait dans la brume d’hiver.
Avant de verser l’eau, elle tâta la terre de chaque pot accroché à la balustrade, émue à l’idée qu’en toute saison les plantes sont si dépendantes de nous. Puis, elle regagna sa chambre, introduisit le Requiem de Mozart dans le lecteur-CD et afficha le numéro deux : Dies Irae.
8 h 45 : l’heure de la musique, comme 7 h 45 était celle du petit-déjeuner, 9 h 15 de la gymnastique douce, 11 h des cartes, quand elle trouvait des partenaires pour une belote, le seul jeu qui la distrayait encore.
Se glissant par l’entrebâillement de la porte, le visage d’une aide-soignante recouvrit soudain la fiche jaunie du règlement intérieur, punaisée sur le mur.
— Vous avez du linge ?
Irritée, Maggie arrêta l’appareil, se leva, ouvrit le dernier tiroir de la commode et tendit quelques chemisiers à la jeune fille qui avait pénétré dans la chambre.
— Y sont bien étiquetés ?
— Oh, oui, répondit Maggie, mais heureusement que je vérifie à chaque fois, parce qu’avec ces nouvelles étiquettes autocollantes, ça ne tient jamais !
— Je vous les rapporte jeudi.
Maggie haussa les épaules : le retour de la lessive avait lieu tous les jeudis.
Après avoir réenclenché le lecteur, elle s’installa dans son fauteuil orthopédique, alors que, comme au jour du jugement dernier, retentissait le roulement des timbales et que le chœur scandait Dies Irae. Cette pièce, entendue mille fois, la subjuguait toujours par la splendeur de son introduction chromatique sitôt suivie par le dialogue apaisé des chanteurs. À côté d’elle, sur le guéridon hérité de sa mère, reposait, dans un boîtier matelassé, un alto de Mirecourt, le dernier compagnon de sa vie, aujourd’hui muet.





























