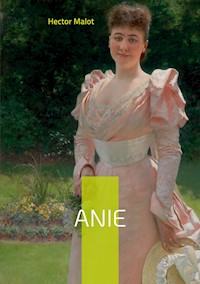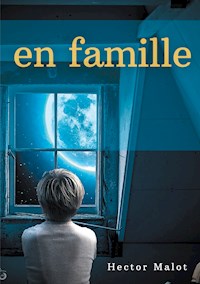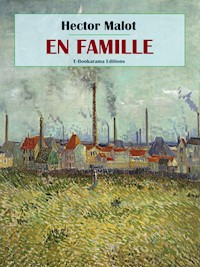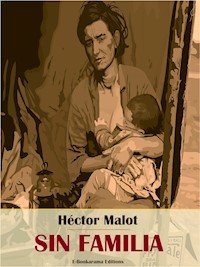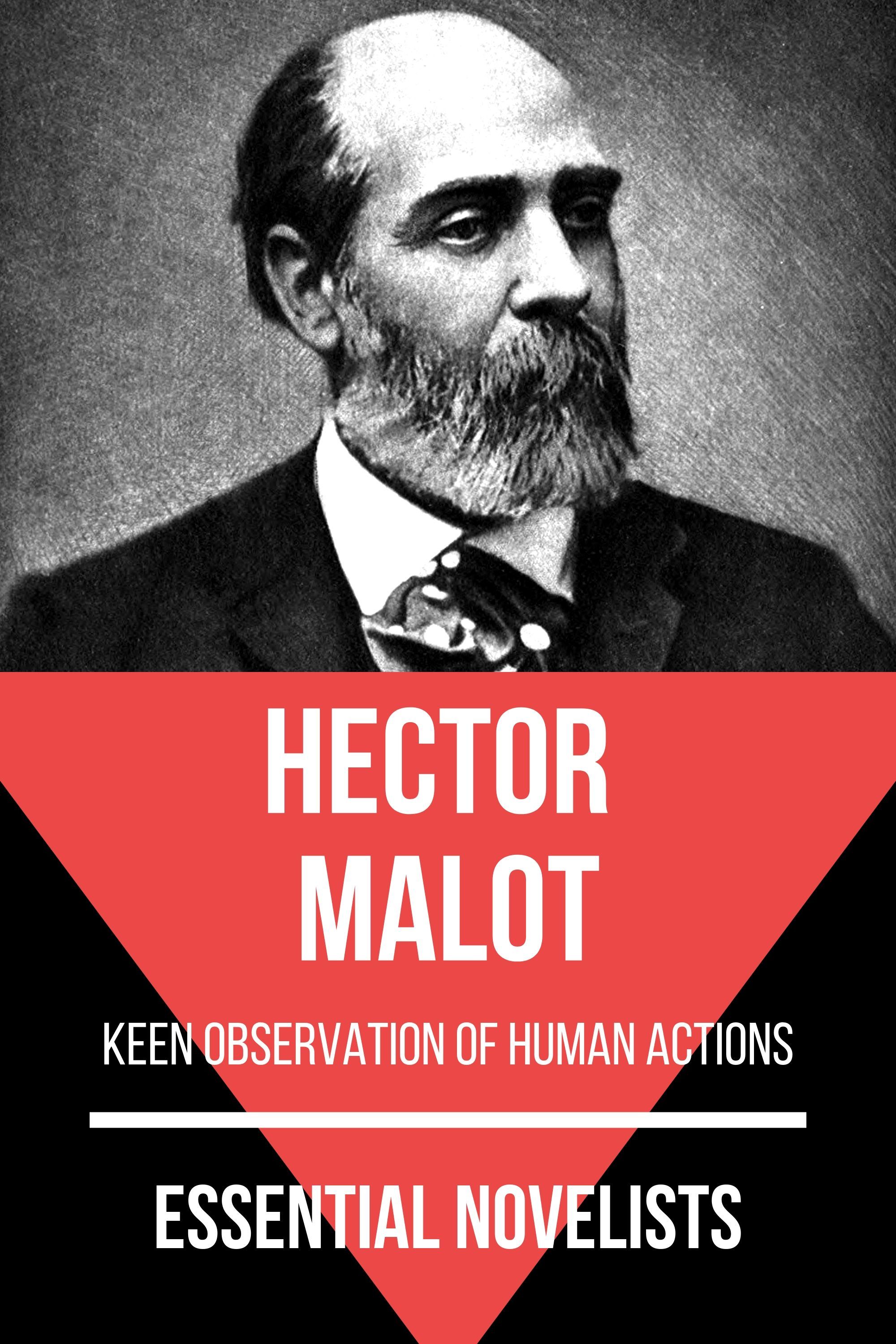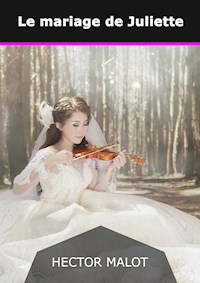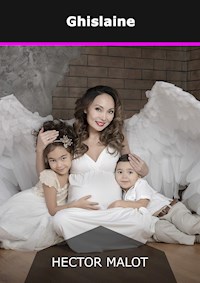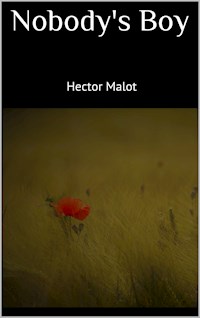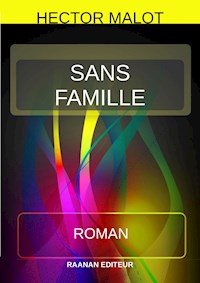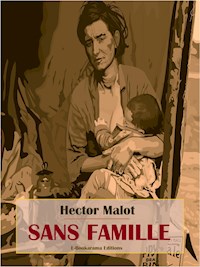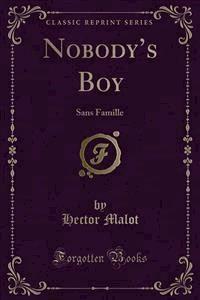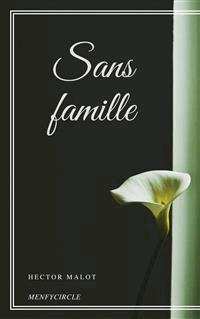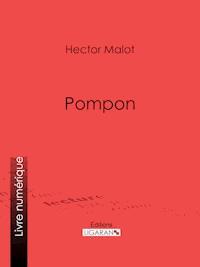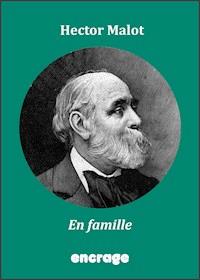
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Encrage Romans
- Sprache: Französisch
A travers le destin d’une jeune orpheline, la vie et l’évolution des usines Saint Frères dans la Somme, grand complexe industriel de la fin du XIXe siècle
Roman « populaire » dans la tradition des récits d’enfant à la recherche de leur origine,
En famille est aussi un roman sur la question sociale qui intéressait beaucoup d’écrivains de l’époque. Car, à travers un récit dans lequel l’auteur fait, une fois de plus, la preuve de ses talents de conteur, ce sont la condition ouvrière et le patronage industriel qui sont au cœur de l’œuvre.
Découvrez les oeuvres d'Hector Malot, publiées par Encrage Edition. Des romans réalistes et sociaux pour plonger au coeur du 19e siècle
EXTRAIT
Comme cela arrive souvent le samedi vers trois heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai, en quatre files, les voitures s’entassaient à la queue leu leu : haquets chargés de fûts, tombereaux de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, sous un clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l’octroi, pressés d’entrer dans Paris à la veille du dimanche.
Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait une d’aspect bizarre avec quelque chose de misérablement comique, sorte de roulotte de forains mais plus simple encore, formée d’un léger châssis tendu d’une grosse toile ; avec un toit en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues basses.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Hector Malot, né à la Bouille (près de Rouen), le 20 mai 1830, mort à Fontenay-sous-Bois, le 17 juillet 1907, devint, après des études de droit et des emplois de clerc de notaire puis de journaliste, l’auteur d’environ soixante-dix romans de veine réaliste, dans lesquels il offre un panorama fidèle de tous les milieux de la société de son siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Œuvres d’Hector Malot - 1
collection dirigée par Francis Marcoin
Hector Malot
En famille
1872
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-933-3
En famille, roman social, roman familial
par Francis Marcoin
Rien ne disposait Hector Malot à se faire connaître comme auteur pour la jeunesse. Ecrivain d’abord classé chez les Réalistes, il est salué à ses débuts par Taine comme un nouveau Flaubert. Né en 1830, près de Rouen, à La Bouille, lieu où Maupassant situera Le Horla, il est donc lui-aussi un Normand et c’est dans cette province qu’il trouvera le cadre d’un feuilleton paru en 1867 dans le Courrier français : Le Roman d’un enfant. Celui-ci, repris en 1869 par Hetzel sous le titre de Romain Kalbris, était une sorte de tour du Cotentin qui appelait en quelque sorte une suite ou une amplification, venue dix ans plus tard sous la forme de Sans famille, succès immense et particulièrement durable non seulement en France mais dans le monde entier. Ces deux romans ont un point commun, l’errance d’un enfant sur les routes, errance pourtant devenue improbable dans une France qui n’aime pas le vagabondage et qui entend protéger la jeunesse quand bien même elle n’hésite pas à la mettre au travail précocement.
Cette errance n’est pas voulue par le héros, qui ne se définit pas comme un aventurier ; elle se fait sous la pression de la nécessité, comme dans les romans picaresques espagnols du XVIe siècle. Hector Malot dira avoir particulièrement aimé le prototype de ce genre :La Vie de Lazarillo de Tormès,un récit truculent où le jeune narrateur ne survit qu’à coup de mensonges et de tromperies. Si les scrupules n’embarrassaient jamais Lazarillo, Romain et Rémi sont dotés d’une honnêteté poussée jusqu’à l’exagération : ils mourraient de faim plutôt que de dérober la moindre miette de pain. Sur ce point, Hector Malot ne rejoint pas l’indulgence de Victor Hugo qui, dansLes Misérables, montrait jusqu’où allait la société pour punir le vol d’un seul pain. Ce moralisme improbable conduit les personnages aux limites extrêmes du dénuement, Hector Malot se plaisant à explorer ces limites, sans jamais toucher à l’ordre social et au respect de la propriété, dans une société qui se tourne vers l’abondance malgré des poches d’immenses pauvretés.
Ces qualités vaudront à l’auteur, jusqu’alors mal vu de l’Académie française, de recevoir en 1879 un prix Montyon récompensant lesbons livres : « En dédiant ce livre à sa fille, disait le rapporteur, M. Hector Malot a tout de suite indiqué qu’il ne s’agissait pas, cette fois, d’un de ces romans de mœurs vulgaires ou d’élégante immoralité que les pères cachent à leurs enfants et que les auteurs se gardent bien d’adresser à l’Académie ». Ce sont sans doute d’autres attraits qui ont séduit le grand public et qui le séduisent encore aujourd’hui. « De tous mes romans, écrira l’auteur dansLe Roman de mes romans,celui qui a été le plus souvent pris pour type du roman à recommencer, ç’a étéSans famille. Pendant quinze ans, si j’avais voulu, j’aurais pu indéfiniment raconter les aventures d’un enfant, ou ce qui valait encore mieux, de deux enfants, de beaucoup d’enfants. Ce pouvait être rémunérateur… » 1Malgré lui, Hector Malot est happé par la librairie de jeunesse. Son éditeur habituel, Flammarion, qui ne peut pas encore profiter du succès deSans famillepublié chez Dentu, édite pour les étrennes de 1885 une « édition spéciale pour la jeunesse » deLa Petite sœur,un roman qui ne s’adressait pas aux jeunes enfants. L’avertissement de l’auteur témoigne d’une certaine réticence : « On a pensé qu’avec quelques changements ce livre pourrait être mis entre les mains de ceux dont on choisit les lectures. Je dois trop au public qui a fait le succès deSans famillepour ne pas chercher à leur être agréable et à prouver ma reconnaissance à ceux qui m’ayant lu enfants voudraient me lire encore, ayant grandi. J’ai donc accepté ces changements. Ce n’est pas seulement à l’enfance que la plus grande révérence est due, c’est aussi à la jeunesse, — de là cette édition spéciale ».
Entre août et octobre 1893, il publieEn familledans lePetit Journal. Ce titre reprend celui du dernier chapitre deSans familleet joue sur un effet de symétrie un peu appuyé : sans famille, en famille, le lecteur étant invité à retrouver quelque chose de connu. L’Académie accordera au livre un nouveau prix Montyon, et 35 000 exemplaires en seront vendus entre 1894 et 1911. L’auteur, cette fois-ci, abandonne le récit à la première personne pour adopter la position d’un narrateur balzacien soucieux de décrire les gens, les objets et les lieux qui vont avec. Les pages initiales nous montrent une sorte de roulotte foraine qui attend de passer l’octroi de la porte de Bercy, et ces scènes de la vie parisienne se déroulent dans le quartier des barrières, du chemin de fer de ceinture, des fortifications, une zone plutôt miséreuse, mal bâtie et mal fréquentée. Zone d’un roman « naturaliste » à la Goncourt auquel se refuse pourtant Hector Malot, qui se plaît pourtant à peindre des figures populaires et à restituer la gouaille parisienne, avec des traces de langue orale, « Ousque vous allez ? », « C’est donc des moules ceux d’Auxerre… », et avec des surnoms pittoresques, Gras Double, Grain de Sel, La Marquise.
Ce n’est pas la première fois qu’il évoque une roulotte : dansZyte, paru en 1886, celle du « Grand théâtre Lachapelle » est quelquefois transformée en atelier de photographie. Précisément, cette « maison roulante » qui a tant nourri l’imagination romanesque du XIXe siècle, est ici une « voiture photographique » hors d’état, celle des parents de Perrine, qui va être remisée au Champ Guillot, une sorte de terrain d’accueil dans un Paris dur aux pauvres, où tout se paie très cher. Ce Paris, nous le verrons très peu, et le Champ Guillot est une sorte d’île au milieu d’une ville qui « mugit comme la mer ». Hector Malot reprend ici la métaphore hugolienne de la ville-océan, mais la plaine de Saint-Denis où Perrine va bientôt errer est également une immensité où elle se retrouve « comme une noyée ». Cette métaphore s’accorde avec une autre de ses inspirations, qui vient deRobinson Crusoepuisque l’étrange maison de Grain de Sel, le propriétaire du Champ Guillot, fait « penser qu’un Robinson en avait été l’architecte » avec ses murs faits de plâtre, de carton et de fer-blanc. Comme Robinson encore, Grain de Sel, qui est un chiffonnier, pratique l’art de la récupération, et Perrine elle-même fera quelque cueillette, profitant de tout ce qui traîne ou pousse tout seul. Nous retrouvons ici un des motifs favoris de l’Académie, cette économie domestique que l’on entend inculquer au peuple : car si ce dernier est pauvre, c’est bien entendu parce qu’il gère mal ses affaires ! L’argent est donc rare, on compte en sous, et à un certain moment il ne restera même plus rien.
Rien ne se perd, verre cassé, os, ferraille. En même temps, ces détritus participent d’un monde pittoresque qui fascine l’auteur. Un monde presque étranger survit autour de la grande ville, avec sa langue, l’argot : chiffonnier se dit « biffin » et trier « triquer ».Acet argot répondront des mots de l’Ile de France et de la Picardie, le peuple ayant son langage à lui qui n’est pas sans poésie. Dans ce monde on croise un ivrogne qui fait boire un âne, une maraîchère qui fume la pipe. Les premiers chapitres relèvent donc de ce qu’il est convenu d’appeler une littérature « populaire », terme très vague qui prétend désigner le lectorat mais qui se rapporte plutôt aux personnages. Populaire aussi parce que sont convoqués les archétypes du roman : Perrine est très vite une orpheline. Mais les termes deSans famillesont inversés puisqu’elle a connu ses parents. Quand débute le roman, son père est déjà mort, et sa mère ne va pas tarder à mourir au Champ Guillot. La petite fille n’a donc pas à s’interroger sur ses origines, et elle sait même qu’elle a de la famille du côté d’Amiens, famille qu’elle part rejoindre à pied. L’auteur y met un peu de mystère car le nom du village familial, Maraucourt, revient plusieurs fois, inscrit sur des bâches de charrettes, accompagné d’un autre nom qui prend une dimension impressionnante, Vulfran Paindavoine.
Durant quelques chapitres, nous repartons donc sur les routes au rythme lent deRomain Kalbriset deSans famille ; le lecteur retrouve des impressions connues, et tout pourrait s’arrêter dès l’arrivée à Maraucourt et les retrouvailles avec ce Vulfran Paindavoine, le grand-père paternel de Perrine. Mais ce puissant industriel, qui dirige un véritable empire dans une vallée de la Somme, n’a jamais accepté le mariage de son fils avec une jeune femme hindoue, et Perrine doit se faire aimer avant de se faire reconnaître de ce grand-père devenu aveugle dans tous les sens du terme. Là est l’originalité du roman, qui renverse le scénario habituel : il ne s’agit pas de retrouver ses origines mais de se mettre en accord avec elles, tout en convertissant un ancêtre égaré. A l’errance succède donc l’installation dans un petit pays minutieusement décrit dont Perrine fera la conquête. Ce pays retrouvé est double, faisant coexister la nature des marais et des tourbières avec les constructions industrielles et ouvrières qui ont profondément modifié le paysage. L’opposition entre nature et culture n’est cependant pas tranchée puisque Perrine règne sur les deux terrains. Sur le premier, d’abord, car elle a l’air d’une gitane et elle a une sorte de beauté sauvage. Son type est singulier, nous dit l’auteur : « d’une certaine incohérence mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race ». Un chevelure pâle, une carnation ambrée, un œil noir et long, un corps gracieux et nerveux, des épaules souples et menues, des yeux de « gazelle »… Ces yeux qui distinguaient déjà la belle actrice Zyte dans le roman du même nom. Issu d’un monde de notaires, Hector Malot laisse percer une attirance pour la beauté exotique et pour une vie moins rangée, certes affreuse par moments mais chargée d’émotions : pour aller de Paris à Maraucourt, Perrine a vécu la vie des bêtes et montré ses capacités de résistance. Arrivée comme une « bohémienne » à Maraucourt, elle se fait embaucher dans la filature de son grand-père mais refuse la promiscuité des chambrées d’ouvrières et aménage une hutte de chasseurs dans une île au milieu des marais, tirant parti de ce qui est à sa disposition tout en goûtant la beauté de cette nature « sauvage » : avant Kipling et avant la littérature scoute, elle est déjà dans le « Grand Jeu », ressentant les impressions d’une vie primitive où la préoccupation majeure est de se nourrir, de se vêtir, de se protéger des intempéries. Cette deuxième expérience insulaire, après celle du Champ Guillot, illustre donc encore plus clairement le genre de la robinsonnade, et du reste tout ce passage sera publié chez Hachette en 1897 comme livre de lecture courante sous le titreL’Ile déserte.
Mais ce grand jeu est celui d’une « civilisée » qui obéit avant tout à des règles d’hygiène et qui se comporte comme un individu moderne soucieux de protéger son intégrité. Cette hutte de chasseurs dans les tourbières, Hector Malot la nomme « aumuche ». Il a sans doute mal entendu car en picard on parle de « muche » pour désigner une cachette, notamment un refuge taillé dans le calcaire, et l’on « se muche » ou « se camuche ». Dans un fabliau du Moyen-Age intituléDu provost à l’aumuche, « aumuche » a le sens de capuchon, et certains dictionnaires proposent « anmuche » pour désigner un cabane à lapins. « Cho muche » veut dire « la muche », c’est sans doute cette formule qui est arrivée à ses oreilles peu habituées à ce parler. Reste le sens : il s’agit bien de s’isoler, et cette aumuche est une sorte de petit fortin où Perrine se retrouve pleinement, maîtresse d’elle-même et des lieux. Quand elle n’est pas en retrait, elle se place volontiers en hauteur, en un point d’où elle domine le village. Car à l’enchantement des tourbières répond l’agitation industrielle qui n’est pas sans beauté. Et l’ignorance de Perrine permet à l’auteur de décrire un des hauts-lieux du textile, procédant à la manière de Zola puisque Perrine découvre Maraucourt comme Lantier découvrait les mines d’Anzin dansGerminal.
Le roman change donc également de régime : la misère des chiffonniers ou des chanteurs de rue ne posait pas la question sociale comme le fait celle de la condition ouvrière, abondamment traitée dans les bibliothèques juvéniles du XIXe siècle. S’il ne fait guère preuve d’originalité en traitant cette question, Hector Malot l’évoque avec honnêteté et se fait littéralement le Zola de la jeunesse : il enquête, il se documente assez longuement sur l’industrie textile, mais sans trouver son amorce. Selon ses propres dires, le livre aurait vraiment démarré à la vue des tourbières de la vallée de la Somme, lors d’un voyage en train, et à l’idée d’installer son héroïne dans une de ses îles. Les tourbières, qui renvoient à des formes d’exploitation déjà anciennes, lui offrent d’abord un cadre « naturel » et « sauvage », un pays d’eau et de végétation contrastant avec les usines nouvelles de M. Vulfran Paindavoine, dont le modèle lui est donné par un des industriels les plus prospères du moment, le directeur de l’entreprise Saint Frères, installée dans la vallée de la Nièvre, un affluent de la Somme, et notamment à Flixecourt, devenu Maraucourt dans le roman. Ces paysages entraperçus de la fenêtre d’un wagon, Malot les découvrira de plus près, marchant à travers les prairies, prenant des notes 2et rêvant, comme si une géographie précise, bien que reconstituée dans le livre, était nécessaire au démarrage de l’écriture.
En 1882, les frères Saint employaient 6.400 ouvriers et toute la vallée, à Flixecourt, Saint-Ouen, Harondel et l’Etoile, vivait de l’activité du jute. Pour loger ce personnel venu de toute la région, la famille Saint fera construire à partir de 1894 des cités proches des fabriques. Le livre d’Hector Malot accompagne donc cette initiative. Une maternité, des écoles, des crèches, des magasins coopératifs accompagneront l’existence de ces familles, selon un mode paternaliste que l’on dénoncera plus tard mais qui était alors apprécié des ouvriers. Cette question sociale intéresse Hector Malot comme Emile Zola, mais aussi comme les auteurs de la bibliothèque catholique de Lefort à Lille, ou comme la comtesse de Ségur, dontLa Fortune de Gaspardse terminait déjà sur tout un plan d’aménagements en faveur des ouvriers. La différence avec elle, c’est qu’Hector Malot se prend d’amour pour cette vallée de la Nièvre : certaines pages vibrent de sa rencontre avec les marais, avec leurs oiseaux, avec leurs lumières. Et il se passionne pour la condition de ces ouvriers picards encore proches de la ruralité. Il s’emploie notamment à restituer leur patois, et il évoque les légendes du pays,La Fée des tourbières,L’Enlisage des Anglais,Le Leuwarou d’Hangest. Le nom même de Vulfran Paindavoine n’est pas choisi au hasard : la très belle collégiale d’Abbeville, qui sera peinte en 1894 par Eugène Boudin, s’appelle Saint-Vulfran et ce prénom se rencontre dans la région, de même que le patronyme Paindavoine. On notera qu’une entreprise en constructions métalliques et matériel de levage avait été fondée à Lille en 1860 et qu’elle s’était rendue célèbre avec ses ponts à platelage métallique, les ponts Paindavoine, nombreux outre-mer.
Ce qui rapproche cependant Hector Malot et la comtesse de Ségur, c’est que tous deux voient l’usine comme un lieu de production mais aussi de pouvoir, où des intrigues se développent comme dans une cour royale. C’est par la flatterie et en suivant un plan bien arrêté que Gaspard s’attirait les faveurs de M. Féréor. On trouve les mêmes situations ici, car la question est de savoir qui héritera et de la fortune et du pouvoir, M. Paindavoine n’ayant plus d’enfant. Ou du moins le croit-on. Perrine elle-même, en toute honnêteté, établit « un plan de vie » et si elle n’espionne pas à proprement parler, elle tend à l’oreille à propos pour surprendre des conversations qui ne lui sont pas destinées. Il lui faut faire preuve d’habileté et elle est se retrouve dans la position d’un personnage de conte parti à la conquête de la fortune. C’est le paradoxe de cet ouvrage ancré dans une réalité fort précise, géographique, sociale, économique, et qui en même temps offre des éléments de merveilleux. La plus petite, la plus faible, ici doublement paria, — en France et aux Indes, — triomphera. Il se trouve que cette fortune est sienne en quelque sorte, mais l’itinéraire est bien celui d’un conte, semé d’embûches et clos par le triomphe. Perrine surmonte l’épreuve décisive qui lui permet d’entrer dans l’intimité de M. Vulfran Paindavoine, « plus riche qu’un roi », et même d’habiter le « palais enchanté » interdit à tous les autres.
Ainsi aura-t-elle mérité sa fortune. Manière habile de justifier l’héritage, qui à certains égards est une injustice. Mais le souci des hommes qui ont réussi n’est-il pas de transmettre l’œuvre qu’ils ont édifiée, et n’ont-ils pas plaisir à se reconnaître dans leurs descendants ? Lorsqu’il retrouve la vue et découvre donc le visage de Perrine, M. Paindavoine est frappé par son air de famille. Le lecteur avait déjà pu observer que la petite fille était dotée de la volonté et des qualités exceptionnelles de son grand-père. Mieux, Hector Malot lui prête son propre talent d’écrivain puisqu’elle décrit à merveille, comme lui, les tourbières et la campagne environnante. Comme si, derrière la question sociale, se profilait un « roman familial ». Sur certaines illustrations de Lanos, M. Paindavoine ressemble étrangement à l’auteur, dont l’unique petite-fille, Perrine Mesple, née en octobre 1893 au moment où s’achevait la parution en feuilleton du roman, porte le nom de l’héroïne. On peut penser que celle-ci doit son existence à cette naissance annoncée et que le grand-père fait vivre à sa propre petite-fille une aventure prodigieuse au cours de laquelle elle doit faire la conquête de son grand-père. Comme si l’écrivain proposait son autoportrait en manufacturier et le portrait de ses enfants, réels ou imaginaires, en petits vagabonds, à la façon de la comtesse de Ségur représentant ses petits-enfants en fils de pauvres.
Le roman familial est une expression créée par Freud pour rendre compte des fantasmes par lesquels le sujet modifie imaginairement ses liens avec ses parents, rêvant qu’il a été abandonné et qu’il vient d’une famille supérieure. On ne saurait trouver mieux que la phrase initiale deSans famille,« Je suis un enfant trouvé », pour illustrer cette construction dont le modèle est donné par le mythe d’Œdipe. Précisément, Hector Malot évoque Œdipe à la fin de notre livre : Perrine conduisant cet homme aveugle n’est-elle pas son Antigone ? Ni Perrine ni M. Paindavoine ne savent qui est cette Antigone dont ils vont lire l’histoire dans l’Œdipe à Colonede Sophocle, histoire dans laquelle ils se reconnaissent.
Quelles questions intimes Hector Malot se posait-il donc alors qu’il prétend se situer sur le terrain social ? Nous ne risquerons aucune réponse, nous n’avons même pas idée de ce qu’elle pourrait être, mais ce lien direct du grand-père et de la petite-fille semble exclure tout le reste de la famille. M. Vulfran Paindavoine est un homme qui s’est fait tout seul, qui est parti de « rien », se plaçant au rang de tous ces enfants qui échappent à leur généalogie, au rang même du Christ. Car dans ce roman où la morale ne s’encombre pas de considérations religieuses, il a un moment de désespoir qui le fait s’écrier : « Mon dieu, mon dieu, vous vous êtes retiré de moi ! » Plainte étrange, que la suite fera oublier, quand cet homme découvrira qu’il n’est pas seul, qu’il a une petite-fille, et même une famille, une immense famille puisque ses œuvres sociales lui valent la reconnaissance de ses ouvriers qui fêtent en grande pompe son anniversaire.
Dans son genre, Hector Malot était aussi un industriel. Il est l’écrivain le mieux rétribué de son temps, il gère sa carrière d’écrivain comme d’autres dirigent une entreprise. Dans une note manuscrite, il se flatte d’avoir été particulièrement bien payé parLe Petit Journalet d’avoir excité la jalousie de ses confrères alors qu’il n’a fait aucune concession, donnant « une histoire simple, sans romanesque et sans péripétie 3. Mais en 1895 le n°37 de laRevue Mamereproduira une lettre qu’il a adressée à la rédaction, déjà publiée parLe Tempsdu 25 mai 4. « M. Hector Malot se retire du roman après fortune faite et nous fait part de sa résolution dans une lettre peut-être un peu longue mais intéressante et instructive : “J’aurais pu, dit-il à ses clients, continuer comme tant d’autres à exploiter un nom auquel les années ont donné une valeur commerciale”, mais il a craint d’être accusé “d’obstination sénile et sait qu’il ne peut plus rien apporter d’inattendu malgré une dizaine de romans en préparation” ». Ce départ à la retraite reste surprenant et fait penser à quelque blessure secrète, bien cachée par un écrivain qui a toujours protégé son intimité et qui en dévoile peut-être quelque chose dansEn famille, un de ses derniers romans. Il lui restera à faire le bilan de sa carrière, dans ceRoman de mes romansqui sera dédié à Perrine Mesple, devenue en quelque sorte son exécutrice testamentaire.
1Le Roman de mes romans, Flammarion, 1896, réédition dans lesCahiers Robinsonn°13, Arras, université d’Artois, 2003.
2Il a laissé un carnet, actuellement en cours de dépouillement par Anne-Marie Cojez, dans le cadre d’une thèse sur l’espace chez H. Malot. Voir son site :Dans les pas de Perrine : de Paris à Flixecourt. Au fil du roman d’Hector Malot(http://home.nordnet.fr/~acojez/Perrine/index. html).
3VoirCahiers Robinsonn°13, pp. 275-276.
4Reproduite dansLe Roman de mes romans.
1.
Comme cela arrive souvent le samedi vers trois heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai, en quatre files, les voitures s’entassaient à la queue leu leu : haquets chargés de fûts, tombereaux de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, sous un clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l’octroi, pressés d’entrer dans Paris à la veille du dimanche.
Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait une d’aspect bizarre avec quelque chose de misérablement comique, sorte de roulotte de forains mais plus simple encore, formée d’un léger châssis tendu d’une grosse toile ; avec un toit en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues basses.
Autrefois la toile avait dû être bleue, mais elle était si déteinte, salie, usée, qu’on ne pouvait s’en tenir qu’à des probabilités à cet égard, de même qu’il fallait se contenter d’à peu près si l’on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui couvraient ses quatre faces : l’une, en caractères grecs, ne laissait plus deviner qu’un commencement de mot : fvtog ; celle au-dessous semblait être de l’allemand : graphie ; une autre de l’italien : fia ; enfin la plus fraîche et française, celle-là : photographie, était évidemment la traduction de toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route, les divers pays par lesquels la pauvre guimbarde avait roulé avant d’entrer en France et d’arriver enfin aux portes de Paris.
Etait-il possible que l’âne qui y était attelé l’eût amenée de si loin jusque-là ?
Au premier coup d’œil on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vidé ; mais, à le regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n’était que le résultat des fatigues longuement endurées dans la misère. En réalité, c’était un animal robuste, d’assez grande taille, plus haute que celle de notre âne d’Europe, élancé, au poil gris cendré avec le ventre clair malgré les poussières des routes qui le salissaient ; des lignes noires transversales marquaient ses jambes fines aux pieds rayés, et, si fatigué qu’il fût, il n’en tenait pas moins sa tête haute d’un air volontaire, résolu et coquin. Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites, au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin, dont on l’avait couvert pour le défendre du soleil et des mouches.
Près de lui, assise sur la bordure du trottoir, se tenait une petite fille de onze à douze ans qui le surveillait.
Son type était singulier : d’une certaine incohérence, mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race. Au contraire de l’inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu’accentuait l’œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse. Dans l’affaissement du repos le corps s’était abandonné ; il avait les mêmes grâces que la tête, à la fois délicates et nerveuses ; les épaules étaient souples d’une ligne menue et fuyante dans une pauvre veste carrée de couleur indéfinissable, noire autrefois probablement ; les jambes volontaires et fermes dans une pauvre jupe large en loques ; mais la misère de l’existence n’enlevait cependant rien à la fierté de l’attitude de celle qui la portait.
Comme l’âne se trouvait placé derrière une haute et large voilure de foin, la surveillance en eût été facile si de temps en temps il ne s’était pas amusé à happer une goulée d’herbe, qu’il tirait discrètement avec précaution, en animal intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.
— Palikare, veux-tu finir !
Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant, mais dès qu’il avait mangé son foin en clignant de l’œil et en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa faim.
A un certain moment, comme elle venait de le gronder pour la quatrième ou cinquième fois, une voix sortit de la voiture, appelant :
— Perrine !
Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra dans la voiture, où une femme était couchée sur un matelas si mince qu’il semblait collé au plancher.
— As-tu besoin de moi, maman ?
— Que fait donc Palikare ?
— Il mange le foin de la voiture qui nous précède.
— Il faut l’en empêcher.
— Il a faim.
— La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas ; que répondrais-tu au charretier de cette voiture s’il se fâchait ?
— Je vais le tenir de plus près.
— Est-ce que nous n’entrons pas bientôt dans Paris ?
— Il faut attendre pour l’octroi.
— Longtemps encore ?
— Tu souffres davantage ?
— Ne t’inquiète pas ; l’étouffement du renfermé ; ce n’est rien, dit-elle d’une voix haletante, sifflée plutôt qu’articulée.
C’étaient là les paroles d’une mère qui veut rassurer sa fille ; en réalité elle se trouvait dans un état pitoyable, sans respiration, sans force, sans vie, et, bien que n’ayant pas dépassé vingt-six ou vingt-sept ans, au dernier degré de la cachexie ; avec cela des restes de beauté admirables, la tête d’un pur ovale, des yeux doux et profonds, ceux même de sa fille, mais avivés par le souffle de la maladie.
— Veux-tu que je te donne quelque chose ? demanda Perrine.
— Quoi ?
— Il y a des boutiques, je peux t’acheter un citron ; je reviendrais tout de suite.
— Non. Gardons notre argent ; nous en avons si peu ! Retourne près de Palikare et fais en sorte de l’empêcher de voler ce foin.
— Cela n’est pas facile.
— Enfin veille sur lui.
Elle revint à la tête de l’âne, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon qu’il restât assez éloigné de la voiture de foin pour ne pas pouvoir l’atteindre.
Tout d’abord il se révolta, et voulut avancer quand même, mais elle lui parla doucement, le flatta, l’embrassa sur le nez ; alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction manifeste et voulut bien se tenir tranquille.
N’ayant plus à s’occuper de lui, elle put s’amuser à regarder ce qui se passait autour d’elle : le va-et-vient des bateaux-mouches et des remorqueurs sur la rivière ; le déchargement des péniches au moyen des grues tournantes qui allongeaient leurs grands bras de fer au-dessus d’elles et prenaient, comme à la main, leur cargaison pour la verser dans des wagons quand c’étaient des pierres, du sable ou du charbon, ou les aligner le long du quai quand c’étaient des barriques ; le mouvement des trains sur le pont du chemin de fer de ceinture dont les arches barraient la vue de Paris qu’on devinait dans une brume noire plutôt qu’on ne le voyait ; enfin près d’elle, sous ses yeux, le travail des employés de l’octroi qui passaient de longues lances à travers les voitures de paille, ou escaladaient les fûts chargés sur les haquets, les perçaient d’un fort coup de foret, recueillaient dans une petite tasse d’argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu’ils crachaient aussitôt.
Comme tout cela était curieux, nouveau ; elle s’y intéressait si bien que le temps passait sans qu’elle en eût conscience.
Déjà un gamin d’une douzaine d’années qui avait tout l’air d’un clown, et appartenait sûrement à une caravane de forains dont les roulottes avaient pris la queue, tournait autour d’elle depuis dix longues minutes, sans qu’elle eût fait attention à lui, lorsqu’il se décida à l’interpeller :
— V’là un bel âne !
Elle ne dit rien.
— Est-ce que c’est un âne de notre pays ? Ça m’étonnerait joliment.
Elle l’avait regardé, et voyant qu’après tout il avait l’air bon garçon, elle voulut bien répondre :
— Il vient de Grèce.
— De Grèce !
— C’est pour cela qu’il s’appelle Palikare.
— Ah ! c’est pour cela !
Mais malgré son sourire entendu, il n’était pas du tout certain qu’il eût très bien compris pourquoi un âne qui venait de Grèce pouvait s’appeler Palikare.
— C’est loin, la Grèce ? demanda-t-il.
— Très loin.
— Plus loin que… la Chine ?
— Non, mais loin, loin.
— Alors vous venez de la Grèce ?
— De plus loin encore.
— De la Chine ?
— Non ; c’est Palikare qui vient de la Grèce.
— Est-ce que vous allez à la fête des Invalides ?
— Non.
— Ousque vous allez ?
— A Paris.
— Ousque vous remiserez votre roulotte ?
— On nous a dit à Auxerre qu’il y avait des places libres sur les boulevards des fortifications ?
Il se donna deux fortes claques sur les cuisses en plongeant de la tête.
— Les boulevards des fortifications, oh là là là !
— Il n’y a pas de places ?
— Si.
— Eh bien ?
— Pas pour vous. C’est voyou les fortifications. Avez-vous des hommes dans votre roulotte, des hommes solides qui n’aient pas peur d’un coup de couteau ? J’entends d’en donner et d’en recevoir.
— Nous ne sommes que ma mère et moi, et ma mère est malade.
— Vous tenez à votre âne ?
— Bien sûr.
— Eh bien, demain votre âne vous sera volé ; v’là pour commencer, vous verrez le reste ; et ça ne sera pas beau ; c’est Gras Double qui vous le dit.
— C’est vrai cela ?
— Pardi, si c’est vrai ; vous n’êtes jamais venue à Paris ?
— Jamais.
— Ça se voit ; c’est donc des moules ceux d’Auxerre qui vous ont dit que vous pouviez remiser là ? pourquoi que vous n’allez pas chez Grain de Sel ?
— Je ne connais pas Grain de Sel.
— Le propriétaire du Champ Guillot, quoi ! c’est clos de palissades fermées la nuit ; vous n’auriez rien à craindre, on sait que Grain de Sel aurait vite fichu un coup de fusil a ceux qui voudraient entrer la nuit.
— C’est cher ?
— L’hiver oui, quand tout le monde rapplique à Paris, mais en ce moment je suis sûr qu’il ne vous ferait pas payer plus de quarante sous la semaine, et votre âne trouverait sa nourriture dans le clos, surtout s’il aime les chardons.
— Je crois bien qu’il les aime !
— Il sera à son affaire ; et puis Grain de Sel n’est pas un mauvais homme.
— C’est son nom, Grain de Sel ?
— On l’appelle comme ça parce qu’il a toujours soif. C’est un ancien biffin qui a gagné gros dans le chiffon, qu’il n’a quitté que quand il s’est fait écraser un bras, parce qu’un seul bras n’est pas commode pour courir les poubelles ; alors il s’est mis à louer son terrain, l’hiver pour remiser les roulottes, l’été à qui il trouve ; avec ça, il a d’autres commerces : il vend des petits chiens de lait.
— C’est loin d’ici le Champ Guillot ?
— Non, à Charonne ; mais je parie que vous ne connaissez seulement pas Charonne ?
— Je ne suis jamais venue à Paris.
— Eh bien, c’est là.
Il étendit le bras devant lui dans la direction du nord.
— Une fois que vous avez passé la barrière, vous tournez, tout de suite à droite, et vous suivez le boulevard le long des fortifications pendant une petite demi-heure ; quand vous avez traversé le cours de Vincennes, qui est une large avenue, vous prenez sur la gauche et vous demandez ; tout le monde connaît le Champ Guillot.
— Je vous remercie ; je vais en parler à maman ; et même, si vous vouliez rester auprès de Palikare deux minutes, je lui en parlerais tout de suite.
— Je veux bien ; je vas lui demander de m’apprendre le grec.
— Empêchez-le, je vous prie, de prendre du foin.
Perrine entra dans la voiture et répéta à sa mère ce que le jeune clown venait de lui dire.
— S’il en est ainsi, il n’y a pas à hésiter, il faut aller à Charonne ; mais trouveras-tu ton chemin ? Pense que nous serons dans Paris.
— Il paraît que c’est très facile.
Au moment de sortir elle revint près de sa mère et se pencha vers elle :
— Il y a plusieurs voitures qui ont des bâches, on lit dessus : — Usines de Maraucourt, et au-dessous le nom : Vulfran Paindavoine ; sur les toiles qui couvrent les pièces de vin alignées le long du quai on lit aussi la même inscription.
— Cela n’a rien d’étonnant.
— Ce qui est étonnant c’est de voir ces noms si souvent répétés.
2.
Quand Perrine revint prendre sa place auprès de son âne, il s’était enfoncé le nez dans la voiture de foin, et il mangeait tranquillement comme s’il avait été devant un râtelier.
— Vous le laissez manger ? s’écria-t-elle.
— J’vous crois.
— Et si le charretier se fâche ?
— Faudrait pas avec moi.
Il se mit en posture d’invectiver un adversaire, les poings sur les hanches, la tête renversée.
— Ohé, croquant !
Mais son concours ne fut pas nécessaire pour défendre Palikare ; c’était au tour de la voiture de foin d’être sondée à coups de lance par les employés de l’octroi, et elle allait passer la barrière.
— Maintenant ça va être à vous ; je vous quitte. Au revoir, mam’zelle ; si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles, demandez Gras Double, tout le monde vous répondra.
Les employés qui gardent les barrières de Paris sont habitués à voir bien des choses bizarres, cependant celui qui monta dans la voiture photographique eut un mouvement de surprise en trouvant cette jeune femme couchée ; et surtout en jetant les yeux çà et là d’un rapide coup d’œil qui ne rencontrait partout que la misère.
— Vous n’avez rien à déclarer ? demanda-t-il en continuant son examen.
— Rien.
— Pas de vin, pas de provisions ?
— Rien.
Ce mot deux fois répété était d’une exactitude rigoureuse : en dehors du matelas, de deux chaises de paille, d’une petite table, d’un fourneau en terre, d’un appareil et de quelques ustensiles photographiques, il n’y avait rien dans cette voiture : ni malles, ni paniers, ni vêtements.
— C’est bien, vous pouvez entrer.
La barrière passée, Perrine tourna tout de suite à droite, comme Gras Double lui avait recommandé, conduisant Palikare par la bride. Le boulevard qu’elle suivait longeait le talus des fortifications, et dans l’herbe roussie, poussiéreuse, usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur le dos ou sur le ventre, selon qu’ils étaient plus ou moins aguerris contre le soleil, tandis que d’autres s’étiraient les bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre. Ce qu’elle vit de la physionomie de ceux-là, de leurs têtes ravagées, culottées, hirsutes, de leurs guenilles, et de la façon dont ils les portaient, lui fit comprendre que cette population des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante la nuit, et que les coups de couteau devaient s’échanger là facilement.
Elle ne s’arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt pour elle, puisqu’elle ne se trouverait pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l’autre côté, c’est-à-dire vers Paris.
Hé quoi ! ces vilaines maisons, ces hangars, ces cours sales, ces terrains vagues où s’élevaient des tas d’immondices, c’était Paris, le Paris dont elle avait si souvent entendu parler par son père, dont elle rêvait depuis longtemps, et avec des imaginations enfantines, d’autant plus féeriques que le chiffre des kilomètres diminuait à mesure qu’elle s’en rapprochait ; de même, de l’autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés dans l’herbe comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes, aux faces patibulaires, étaient des Parisiens.
Elle reconnut le cours de Vincennes à sa largeur et, après l’avoir dépassé, tournant à gauche, elle demanda le Champ Guillot. Si tout le monde le connaissait, tout le monde n’était pas d’accord sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle se perdit plus d’une fois dans les noms de rues qu’elle devait suivre. A la fin cependant, elle se trouva devant une palissade formée de planches, les unes en sapin, les unes en bois non écorcé, celles-ci peintes, celles-là goudronnées, et quand, par la barrière ouverte à deux battants, elle aperçut dans le terrain un vieil omnibus sans roues et un wagon de chemin de fer sans roues aussi, posés sur le sol, elle comprit, bien que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur état, que c’était là le Champ Guillot. Eût-elle eu besoin d’une confirmation de cette impression, qu’une douzaine de petits chiens tout ronds, qui boulaient dans l’herbe, la lui eût donnée.
Laissant Palikare dans la rue, elle entra, et aussitôt les chiens se jetèrent sur ses jambes, les mordillant avec de petits aboiements.
— Qu’est-ce qu’il y a ? cria une voix.
Elle regarda d’où venait cet appel, et, sur sa gauche, elle aperçut un long bâtiment qui était peut-être une maison, mais qui pouvait bien être aussi tout autre chose ; les murs étaient en carreaux de plâtre, en pavés de grès et de bois, en boîtes de fer-blanc, le toit en carton et en toile goudronnée, les fenêtres garnies de vitres en papier, en bois, en feuilles de zinc et même en verre, mais le tout construit et disposé avec un art naïf qui faisait penser qu’un Robinson en avait été l’architecte, avec des Vendredis pour ouvriers. Sous un appentis, un homme à la barbe broussailleuse était occupé à trier des chiffons qu’il jetait dans des paniers disposés autour de lui.
— N’écrasez pas mes chiens, cria-t-il, approchez.
Elle fit ce qu’il commandait.
— Qu’est-ce que vous voulez ? demanda-t-il lorsqu’elle fut près de lui.
— C’est vous qui êtes le propriétaire du Champ Guillot ?
— On le dit.
Elle expliqua en quelques mots ce qu’elle voulait, tandis que, pour ne pas perdre son temps en l’écoutant, il se versait, d’un litre qu’il avait à sa portée, un verre de vin à rouges bords et l’avalait d’un trait.
— C’est possible, si l’on paye d’avance, dit-il en l’examinant.
— Combien ?
— Quarante-deux sous par semaine pour la voiture, vingt et un sous pour l’âne.
— C’est bien cher.
— C’est mon prix.
— Votre prix d’été ?
— Mon prix d’été.
— Il pourra manger les chardons ?
— Et l’herbe aussi, s’il a les dents assez solides.
— Nous ne pouvons pas payer à la semaine, puisque nous ne resterons pas une semaine, mais un jour seulement ; nous passons par Paris pour aller à Amiens, et nous voulons nous reposer.
— Alors, ça va tout de même ; six sous par jour pour la roulotte, trois sous pour l’âne.
Elle fouilla dans sa jupe, et, un à un, elle en tira neuf sous :
— Voila la première journée.
— Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien sont-ils ? Si c’est une troupe, c’est deux sous en plus par personne.
— Je n’ai que ma mère.
— Bon. Mais pourquoi ta mère n’est-elle pas venue faire sa location ?
— Elle est malade, dans la voiture.
— Malade. Ce n’est pas un hôpital ici.
Elle eut peur qu’on ne voulût pas recevoir une malade.
— C’est-à-dire qu’elle est fatiguée. Vous comprenez, nous venons de loin.
— Je ne demande jamais aux gens d’où ils viennent.
Il étendit le bras vers un coin de son champ ;
— Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu attacheras ton âne ; s’il m’écrase un chien, tu me le payeras cent sous.
Comme elle allait s’éloigner, il l’appela :
— Prends un verre de vin.
— Je vous remercie, je ne bois pas de vin.
— Bon, je vas le boire pour toi.
Il se jeta dans le gosier le verre qu’il avait versé, et se remit au tri de ses chiffons, autrement dit à son « triquage ».
Aussitôt qu’elle eut installé Palikare à la place qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas sans certaines secousses, malgré le soin qu’elle prenait de les éviter, elle monta dans la roulotte :
— A la fin, pauvre maman, nous voilà arrivées.
— Ne plus remuer, ne plus rouler ! Tant et tant de kilomètres ! Mon Dieu, que la terre est grande !
— Maintenant que nous avons le repos, je vais te faire à dîner. Qu’est-ce que tu veux ?
— Avant tout, dételle ce pauvre Palikare, qui, lui aussi, doit être bien las ; donne-lui à manger, à boire ; soigne-le.
— Justement, je n’ai jamais vu autant de chardons ; de plus, il y a un puits. Je reviens tout de suite.
En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit à chercher çà et là dans la voiture, d’où elle sortit le fourneau en terre, quelques morceaux de charbon et une vieille casserole, puis elle alluma le feu avec des brindilles et le souffla, en s’agenouillant devant, à pleins poumons.
Quand il commença à prendre, elle remonta dans la voiture :
— C’est du riz que tu veux, n’est-ce pas ?
— J’ai si peu faim.
— Aurais-tu faim pour autre chose ? J’irai chercher ce que tu voudras. Veux-tu ?…
— Je veux bien du riz.
Elle versa une poignée de riz dans la casserole où elle avait mis un peu d’eau, et, quand l’ébullition commença, elle remua le riz avec deux baguettes blanches dépouillées de leur écorce, ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment se trouvait Palikare et lui dire quelques mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’étaient pas indispensables, car il mangeait ses chardons avec une satisfaction dont ses oreilles traduisaient l’intensité.
Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et non réduit en bouillie, comme le servent bien souvent les cuisinières parisiennes, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide à large base, et le posa dans la voiture.
Déjà elle avait été emplir une petite cruche au puits et l’avait placée auprès du lit de sa mère avec deux verres, deux assiettes, deux fourchettes ; elle posa son écuelle de riz à côté et s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe étalée.
— Maintenant, dit-elle, comme une petite fille qui joue à la poupée, nous allons faire la dînette, je vais te servir.
Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était d’un regard inquiet qu’elle examinait sa mère, assise sur son matelas, enveloppée d’un mauvais fichu de laine qui avait dû être autrefois une étoffe de prix, mais qui maintenant n’était plus qu’une guenille, usée, décolorée.
— Tu as faim, toi ? demanda la mère.
— Je crois bien, il y a longtemps.
— Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de pain ?
— J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une belle faim : tu vas voir ; si ça met en appétit de regarder manger les autres, la platée sera trop petite.
La mère avait porté une fourchette de riz à sa bouche, mais elle la tourna et retourna longuement sans pouvoir l’avaler.
— Ça ne passe pas très bien, dit-elle en réponse au regard de sa fille.
— Il faut te forcer : la seconde bouchée passera mieux, la troisième mieux encore.
Mais elle n’alla pas jusque-là, et après la seconde elle reposa sa fourchette sur son assiette :
— Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas persister.
— Oh ! maman !
— Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien ; on vit très bien sans manger quand on n’a pas d’efforts à faire ; avec le repos l’appétit reviendra.
Elle défit son fichu et s’allongea sur son matelas haletante, mais si faible qu’elle fût elle ne perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant les yeux gonflés de larmes elle s’efforça de la distraire :
— Ton riz est très bon, mange-le ; puisque tu travailles tu dois te soutenir ; il faut que tu sois forte pour me soigner ; mange, ma chérie, mange.
— Oui, maman, je mange ; tu vois, je mange.
A la vérité elle devait faire effort pour avaler, mais peu à peu, sous l’impression des douces paroles de sa mère, sa gorge se desserra, et elle se mit à manger réellement ; alors l’écuelle de riz disparut vite, tandis que sa mère la regardait avec un tendre et triste sourire :
— Tu vois qu’il faut se forcer.
— Si j’osais, maman !
— Tu peux oser.
— Je te répondrais que ce que tu me dis, c’était cela même que je te disais.
— Moi, je suis malade.
— C’est pour cela que si tu voulais j’irais chercher un médecin ; nous sommes à Paris, et à Paris il y a de bons médecins.
— Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu’on les paye.
— Nous le payerions.
— Avec quoi ?
— Avec notre argent ; tu dois avoir sept francs dans ta robe et en plus un florin que nous pouvons changer ici ; moi j’ai dix-sept sous. Regarde dans ta robe.
Cette robe noire, aussi misérable que la jupe de Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait été battue, était posée sur le matelas et servait de couverture ; sa poche explorée donna bien les sept francs annoncés et le florin d’Autriche.
— Combien cela fait-il en tout ? demanda Perrine, je connais si mal l’argent français.
— Je ne le connais guère mieux que toi.
Elles firent le compte, et en estimant le florin à deux francs elles trouvèrent neuf francs quatre-vingt-cinq centimes.
— Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut pour le médecin, continua Perrine.
— Il ne me guérirait pas par des paroles, il ordonnerait des médicaments, comment les payer ?
— J’ai mon idée. Tu penses bien que quand je marche à côté de Palikare, je ne passe pas tout mon temps à lui parler, quoiqu’il aimerait cela ; je réfléchis aussi à toi, à nous, surtout à toi, pauvre maman, depuis que tu es malade, à notre voyage, à notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que tu crois que nous pouvons nous y montrer dans notre roulotte qui, si souvent, sur notre passage a fait rire ? Cela nous vaudrait-il un bon accueil ?
— Il est certain que même pour des parents qui n’auraient pas de fierté, cette entrée serait humiliante.
— Il vaut donc mieux qu’elle n’ait pas lieu ; et puisque nous n’avons plus besoin de la roulotte nous pouvons la vendre. D’ailleurs à quoi nous sert-elle maintenant ? Depuis que tu es malade, personne n’a voulu se laisser photographier par moi ; et quand même je trouverais des gens assez braves pour se fier à moi, nous n’avons plus de produits. Ce n’est pas avec ce qui nous reste d’argent que nous pouvons dépenser trois francs pour un paquet de développement, trois francs pour un virage d’or et d’acétate, deux francs pour une douzaine de glaces. Il faut la vendre.
— Et combien la vendrons-nous ?
— Nous la vendrons toujours quelque chose : l’objectif est en bon état ; et puis il y a le matelas…
— Tout, alors ?
— Cela te fait de la peine ?
— Il y a plus d’un an que nous vivons dans cette roulotte, ton père y est mort, cela fait que si misérable qu’elle soit, la pensée de m’en séparer m’est douloureuse ; de lui c’est tout ce qui nous reste, et il n’est pas une seule de ces pauvres choses à laquelle son souvenir ne soit attaché.
Sa parole haletante s’arrêta tout à fait, et sur son visage décharné des larmes coulèrent sans qu’elle pût les retenir.
— Oh ! maman, s’écria Perrine, pardonne-moi de t’avoir parlé de cela.
— Je n’ai rien à te pardonner, ma chérie ; c’est le malheur de notre situation que nous ne puissions, ni toi ni moi, aborder certains sujets sans nous attrister réciproquement, comme c’est la fatalité de mon état que je n’aie aucune force pour résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant que tu ne l’es toi-même. N’est-ce pas moi qui aurais dû te parler comme tu viens de le faire, prévoir ce que tu as prévu, que nous ne pouvions pas arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni nous montrer dans ces guenilles, cette jupe pour toi, cette robe pour moi ? Mais en même temps qu’il fallait prévoir cela, il fallait aussi combiner des moyens pour trouver des ressources, et ma tête si faible ne m’offrait que des chimères, surtout l’attente du lendemain, comme si ce lendemain devait accomplir des miracles pour nous : je serais guérie, nous ferions une grosse recette ; les illusions des désespérés qui ne vivent plus que de leurs rêves. C’était folie, la raison a parlé par ta bouche : je ne serai pas guérie demain, nous ne ferons pas une grosse, ni une petite recette, il faut donc vendre la voiture et ce qu’elle contient. Mais ce n’est pas tout encore ; il faut aussi que nous nous décidions à vendre…
Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible.
— Palikare, dit Perrine.
— Tu y avais pensé ?
— Si j’y avais pensé ! Mais je n’osais pas le dire, et depuis que l’idée me tourmentait que nous serions forcées un jour ou l’autre de le vendre, je n’osais même pas le regarder, de peur qu’il ne devine que nous pouvions nous séparer de lui, au lieu de le conduire à Maraucourt où il aurait été si heureux, après tant de fatigues.
— Savons-nous seulement si nous-mêmes nous serons reçues à Maraucourt ! Mais enfin, comme nous n’avons que cela à espérer et que, si nous sommes repoussées, il ne nous restera plus qu’à mourir dans un fossé de la route, il faut coûte que coûte que nous allions à Maraucourt, et que nous nous y présentions de façon à ne pas faire fermer les portes devant nous…
— Est-ce que c’est possible, cela maman ? Est-ce que le souvenir de papa ne nous protégerait pas ? lui qui était si bon ! Est-ce qu’on reste fâché contre les morts ?
— Je te parle d’après les idées de ton père, auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons donc et la voiture et Palikare. Avec l’argent que nous en tirerons, nous appellerons un médecin ; qu’il me rende des forces pour quelques jours, c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent, nous achèterons une robe décente pour toi, une pour moi, et nous prendrons le chemin de fer pour Maraucourt, si nous avons assez d’argent pour aller jusque-là ; sinon nous irons jusqu’où nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin à pied.
— Palikare est un bel âne ; le garçon qui m’a parlé à la barrière me le disait tantôt. Il est dans un cirque, il s’y connaît ; et c’est parce qu’il trouvait Palikare beau, qu’il m’a parlé.
— Nous ne savons pas la valeur des ânes à Paris, et encore moins celle que peut avoir un âne d’Orient. Enfin, nous verrons, et puisque notre parti est arrêté, ne parlons plus de cela : c’est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée.
En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une fois elle avait dû faire de longues pauses pour arriver à bout de ce qu’elle voulait dire.
— As-tu besoin de dormir ?
— J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir dans la tranquillité du parti pris et l’espoir d’un lendemain.
— Alors, je vais te laisser pour ne pas te déranger, et comme il y a encore deux heures de jour, je vais en profiter pour laver notre linge. Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d’avoir demain une chemise fraîche ?
— Ne te fatigue pas.
— Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée.
Après avoir embrassé sa mère, elle alla de-ci de-là dans la roulotte, vivement, légèrement ; prit un paquet de linge dans un petit coffre où il était enfermé, le plaça dans une terrine ; atteignit sur une planche un petit morceau de savon tout usé, et sortit emportant le tout. Comme après que le riz avait été cuit, elle avait empli d’eau sa casserole, elle trouva cette eau chaude et put la verser sur son linge. Alors, s’agenouillant dons l’herbe, après avoir ôté sa veste, elle commença a savonner, à frotter, et sa lessive ne se composant en réalité que de deux chemises, de trois mouchoirs, de deux paires de bas, il ne lui fallait pas deux heures pour que fût tout lavé, rincé et étendu sur des ficelles entre la roulotte et la palissade.
Pendant qu’elle travaillait, Palikare attaché, à une courte distance d’elle, l’avait plusieurs fois regardée comme pour la surveiller, mais sans rien de plus. Quand il vit qu’elle avait fini, il allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six braiments qui étaient des appels impérieux.
— Crois-tu que je t’oublie ? dit-elle.
Elle alla à lui, le changea de place et lui apporta à boire dans sa terrine qu’elle avait soigneusement rincée, car s’il se contentait de toutes les nourritures qu’on lui donnait ou qu’il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour sa boisson, et n’acceptait que de l’eau pure dans des vases propres ou le bon vin qu’il aimait par-dessus tout.
Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit à le flatter de la main en lui disant des paroles de tendresse comme une nourrice à son enfant, et l’âne, qui tout de suite s’était jeté sur l’herbe nouvelle, s’arrêta de manger pour poser sa tête contre l’épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux caresser : de temps en temps il inclinait vers elle ses longues oreilles et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béatitude.
Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant fermé, ainsi que dans les rues désertes du quartier, et on n’entendait plus, au loin, qu’un sourd mugissement sans bruits distincts, profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la respiration et la vie de Paris qui continuaient actives et fiévreuses malgré la nuit tombante.
Alors, dans la mélancolie du soir, l’impression de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus fort, et, appuyant sa tête à celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui depuis si longtemps l’étouffaient, tandis qu’il lui léchait les mains.
3.
La nuit de la malade fut mauvaise : plusieurs fois, Perrine couchée prés d’elle, tout habillée sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait d’oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau qu’elle allait chercher au puits afin de l’avoir plus fraîche : elle étouffait et souffrait de la chaleur. Au contraire, à l’aube, le froid du matin, toujours vif sous le climat de Paris, la fit grelotter et Perrine dut l’envelopper dans son fichu, la seule couverture un peu chaude qui leur restât.
Malgré son désir d’aller chercher le médecin aussitôt que possible, elle dut attendre que Grain de Sel fût levé, car à qui demander le nom et l’adresse d’un bon médecin, si ce n’était a lui ?
Bien sûr qu’il connaissait un bon médecin, et un fameux qui faisait ses visites en voiture, non à pied comme les médecins de rien du tout : M. Cendrier, rue Riblette, près de l’église ; pour trouver la rue Riblette il n’y avait qu’à suivre le chemin de fer jusqu’à la gare.
En entendant parler d’un médecin fameux qui faisait les visites en voiture, elle eut peur de n’avoir pas assez d’argent pour le payer, et timidement, avec confusion, elle questionna Grain de Sel en tournant autour de ce qu’elle n’osait pas dire. A la fin il comprit :
— Ce que tu auras à payer ? dit-il. Dame, c’est cher. Pas moins de quarante sous. Et pour être sûre qu’il vienne, tu feras bien de les lui remettre d’avance.
En suivant les indications qui lui avaient été données, elle trouva assez facilement la rue Riblette, mais le médecin n’était point encore levé, elle dut attendre, assise sur une borne dans la rue, à la porte d’une remise derrière laquelle on était en train d’atteler un cheval : comme cela elle le saisirait au passage, et en lui remettant ses quarante sous, elle le déciderait à venir, ce qu’il ne ferait pas, elle en avait le pressentiment, si on lui demandait simplement une visite pour un des habitants du Champ Guillot.
Le temps fut éternel à passer, son angoisse se doublant de celle de sa mère qui ne devait rien comprendre à son retard ; s’il ne la guérissait point instantanément, au moins allait-il l’empêcher de souffrir. Déjà elle avait vu un médecin entrer dans leur roulotte, lorsque son père avait été malade. Mais c’était en pleine montagne, dans un pays sauvage, et le médecin que sa mère avait appelé sans avoir le temps de gagner une ville, était plutôt un barbier avec une tournure de sorcier qu’un vrai médecin comme on en trouve à Paris, savant, maître de la maladie et de la mort, comme devait l’être celui-là, puisqu’on le disait fameux.
Enfin la porte de la remise s’ouvrit, et un cabriolet de forme ancienne, à caisse jaune, auquel était attelé un gros cheval de labour, vint se ranger devant la maison et presque aussitôt le médecin parut, grand, gros, gras, le visage rougeaud encadré d’une barbe grise qui lui donnait l’air d’un patriarche campagnard.