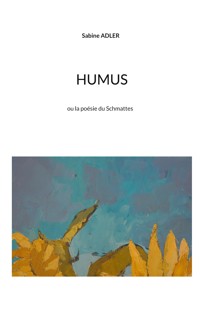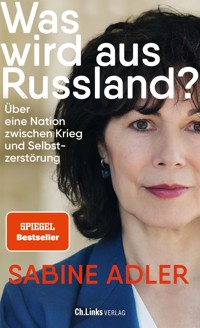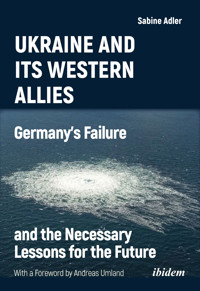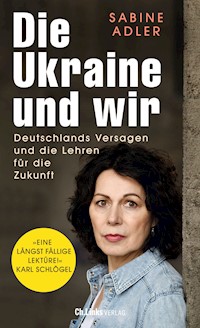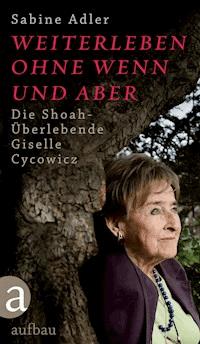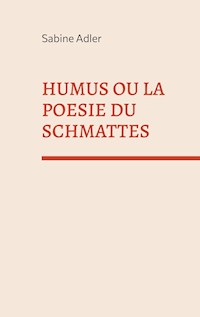
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
C'est un récit personnel qui retisse des destinées simples et proches de l'impensable. La narratrice, née de l'union d'une "sale boche" et d'un "sale juif", parcourt des épisodes familiaux où l'expérience de l'humilité croise celle de l'humiliation. Devenue enseignante, elle explique comment la fabrique des préjugés conduit souvent au lynchage et à l'extermination.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Partie I
Partie II
Partie I
Lorsqu’on a deux ou trois personnes, que dis-je, lorsqu’on a une seule personne avec laquelle on peut se montrer faible, misérable, rabougri qui, pour autant ne vous fera pas souffrir, alors on est riche. L’indulgence, on ne peut l’exiger que de celui ou celle qui vous aime, mais jamais d’autres gens et surtout jamais de soi-même.
Milena Jesenka
Il m’a semblé très vite que tout cela n’était qu’une imposture , un bout de texte cousu de fil blanc qui s’apparentait à ce que mon père, comme tous les juifs du Sentier, appelait un « schmattes », un bout de chiffon . Mais c’est avec les bouts de chiffon que l’on confectionne les patchworks, qu’on recycle et redonne vie au vêtement défraichi. La trame de ce récit mêle nécessairement le vécu à l’imaginaire, la réalité au songe, mais ne saurait trahir l’expérience de la souffrance.
Car c’est bien le vécu qui m’habite, celui des humbles, des modestes, ces laboureurs qui retournent la terre dans le silence et s’étonnent de la clarté soudaine dans laquelle on veut les exposer. C’est aussi le vécu des humiliés, ceux qu’on a voulu écraser, mettre six pieds sous terre, ceux sur qui on a essuyé une main crottée comme marque d’un pouvoir usurpé, marque évidente et navrante d’ inhumanité, ceux dont la silhouette s’est perdue dans les forêts de bouleaux .Et puis, il y a l’imagination, cette imagination paradoxalement étriquée et sans limites. J’étais enfant, de cet âge où on ose encore poser les questions avec ingénuité sans en mesurer l’onde de choc possible. De mon père à qui je demandais ce qu’on avait fait à ses parents et à sa sœur, je reçus cette réponse aussi directe que sans appel : « Ton imagination est trop petite pour concevoir ce qu’on leur a fait. » J’étais restée, bien sûr, sans voix, comprenant que j’avais touché là les frontières de possibles explications, comprenant aussi que l’indicible était synonyme d’insupportable : ne pas pouvoir nommer, c’est être condamné à garder une part d’éternelle souffrance. René Char, le lombric poétique, en ces temps de résistance où, pour vivre, il fallait tuer, livra cet aphorisme dans Les feuillets d’Hypnos : « L’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer ». C’était bien cela, une vérité lumineuse éclairant tragiquement la part abstruse de notre être. Evidemment, depuis ce jour, mon imagination n’a cessé d’imaginer.
*
Il est des mots qui nous intriguent, et le premier qui retint mon attention fut le verbe « humer ». J’étais toujours à cet âge où on pose en toute innocence les questions les plus graves, et lisais la série des « Heidi », que ma mère m’avait rapportée des magasins Gibert Jeune, commerce équitable de l’époque pour les affamés de lecture. Avant les bombardements qui rasèrent Berlin, ma mère avait connu des moments heureux dans la campagne est – allemande, suivant une scolarité et une vie familiale quelque peu chaotiques. Elle gardait un souvenir sensible de l’histoire de cette petite fille des alpages, et j’eus moi-même une lecture émue en découvrant les chevrettes qui humaient l’herbe tendre. Je pense sincèrement que ce verbe « humer » fut mon sésame littéraire : avec lui, c’était la perspective de nouveaux mondes qui se révéleraient à moi, sans que j’en saisisse nécessairement les contours ou le sens ; mais ces mondes étaient à ma portée et je pourrais m’y arrimer. L’institutrice me gratifia d’une note plus qu’honorable pour ce qui fut ma première composition et qui devait ressembler à ce qu’on appelle communément une fiche de lecture : racontez un livre qui vous a plu. L’histoire des biquettes fouinant une herbe plus verte que verte me permit de clore honorablement une année médiocre, dans le sens premier du terme, c’est-à-dire moyenne. J’étais confortée dans mon goût pour les livres et passai dans la classe supérieure, où j’allais découvrir les termes dérivés de l’humus : l’humilité et l’humiliation.
*
Mes deux branches parentales étaient d’origine plus que modeste, et l’un des frères de mon père aimait à répéter : « On était plus pauvre que pauvre », et lorsqu’il décrivait ce que furent leurs conditions de vie durant et après la guerre, il agrémentait volontiers ses explications d’un « Même à ton chien, tu ne l’aurais pas donné à manger ! ». Il parlait bien sûr des cantines de fortune que lui et ses frères, orphelins, furent contraints de fréquenter, dans cette période où les Trente Glorieuses n’étaient que l’embryon d’une réalité prometteuse mais en chantier. Comme beaucoup, je ne peux imaginer ce qu’est la douleur d’avoir faim. Demi-pensionnaire dès la maternelle, j’entendais pourtant les rengaines admonestées par les surveillantes, comme elles l’étaient par mes parents. La guerre et ses privations planaient comme un mauvais nuage sur nos repas. Ma mère me raconta comment, dans la capitale en ruines, elle partait glaner des patates pourries parmi les gravats des maisons bombardées. Le film d’Helma Sanders- Brahms, Les années de plomb, et, plus tard, le Journal anonyme d’une Berlinoise, s’ajoutèrent aux souvenirs de son enfance massacrée. Chaque alerte annonçant l’imminence d’une bombe qui allait s’écraser, puis le bruit de cette même bombe déclenchaient inexorablement la peur, qui prenait la forme et l’odeur d’un mince filet jaune coulant le long de ses jambes fluettes. Le premier jour de l’été 45, un escadron soviétique fit irruption dans la cave où elle et sa famille se cachaient. Ma mère, sans qu’elle en comprît la raison, reçut une baffe magistrale d’une femme militaire. Celle-ci se vengeait-elle d’un enfant perdu durant la bataille de Stalingrad ? Qu’importe ! La bestialité s’était véritablement incarnée dans cette femme capable de faire ce que sa propre imagination n’avait jamais sans doute conçu. Ce jour-là, ma mère aurait dû fêter ses dix ans.
Quelques mois auparavant, mon père se trouvait encore dans l’Isère, caché dans une famille de paysans. Comme beaucoup d’autres, c’était des gens simples, ignorant tout du judaïsme et résolument humains et « justes ». Moyennant une somme versée par l’O.S.E, ils donnèrent l’abri à mon père, le nourrirent, le firent travailler, comme leurs enfants, dans les champs, le sauvèrent d’une déportation programmée. Mon père avait d’ailleurs réchappé à trois reprises. La première fois, c’était au commissariat du XVIII ème arrondissement de Paris. Alors qu’il attendait que ses papiers soient contrôlés, il saisit dans les yeux du policier qui le gardait qu’il lui fallait au plus vite déguerpir, ce qu’il fit promptement. La deuxième fois, il commit l’impair de répondre en allemand ( en fait, en yiddisch) à un officier qui lui avait donné une barre de chocolat. Devant l’air interrogatif du soldat, il bredouilla qu’il avait appris l’allemand sur les bancs de l’école. Il reconnait aujourd’hui qu’il eut beaucoup de chance. La troisième fois aurait pu lui être fatale et il en garde encore les traces. La milice active dans la région de Grenoble l’arrêta, persuadé que mon père connaissait un réseau de résistants. Mutique, il reçut, non une gifle, mais des coups de poing qui dévièrent à jamais sa cloison nasale. Il ne dut sa survie qu’à une femme présente, Boule de suif locale, qui plaida la clémence et obtint que mon père fût relâché.
Pour mon père comme pour ma mère, à quoi tenait leur vie respective ? Les expériences d’humiliation et d’humilité se croisèrent, comme les fils d’un métier à tisser. La « sale Boche » arriva à Paris à l’automne 45, au gré d’un remariage de ma grand-mère avec un STO. Le « sale juif » était remonté dans la capitale un an auparavant, Paris venait d’être libérée, son père, sa mère et Rosa, sa sœur, avaient été exterminés à Auschwitz, non loin de leur Hongrie natale.
*
Mes parents, dont la rencontre était plus qu’improbable, avaient cependant quelques funestes points en commun : le père de ma mère mourut durant l’opération « Barbarossa », probablement entre la fin 41 et le début de l’année 42 ; le père de mon père fut arrêté en août 41, interné à Drancy, puis à Compiègne, déporté dans le convoi n°1 , le 23 mars 1942 , tatoué du numéro 28241. Son décès porte la date du 23 avril. Il ne survécut que trois semaines dans l’enfer concentrationnaire. On estime la durée moyenne de survie des déportés à trois mois. Après une année passée dans les camps d’internement français, en l’occurrence celui de Compiègne, mon grand-père, malgré son jeune âge, 41 ans, devait être étique et moralement épuisé. Une lettre reçue par la famille atteste de ses inquiétudes malheureusement fondées : aller en « camp de travail », puisque telle était la destination officiellement affichée, était synonyme d’une mort certaine. « Je n’y survivrai pas » furent ses derniers mots. L’arrestation et la déportation le 15 décembre 1943 de ma grand-mère et de Rosa ne figurent plus que dans les archives du Mémorial, rue Goeffroy-Lasnier. Ma quête fut vaine, mais j’ai longtemps espéré qu’un miracle se produirait. Le plus jeune frère de mon père confia que, à leur retour dans la capitale, durant une année ou plus, « il rêvait qu’il ne rêvait plus ». Chaque nuit, cet enfant alors âgé de onze ans a imaginé le retour de ses parents et de sa sœur, a pensé que le cocon familial se recréerait, a cru que tout cela n’était qu’un mauvais rêve. Mon autre oncle m’a confié qu’il avait beaucoup pleuré quand son grand frère leur avait dit, sans ménagement mais avec un courage et une lucidité remarquables : « Papa, Maman , Rosa, c’est fini ! ». Ces mots, implacables, accompagnés d’un geste de la main, ont sans doute permis la résilience mais n’ont pas enlevé la douleur et l’incompréhension. Pire, celles-ci sont aujourd’hui une partie de notre héritage. Mon oncle pleura donc abondamment, puis, il ne pleura plus. Jamais. Quant à mon père, je n’ai