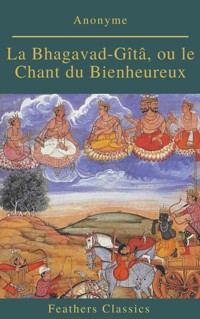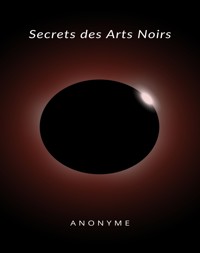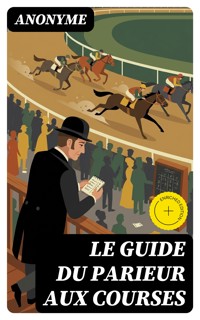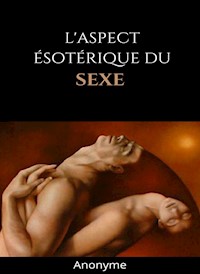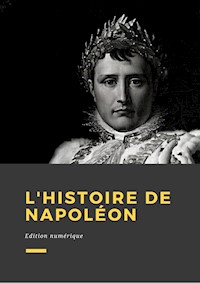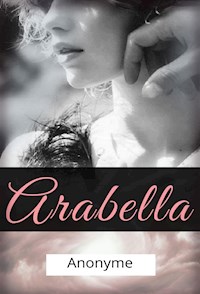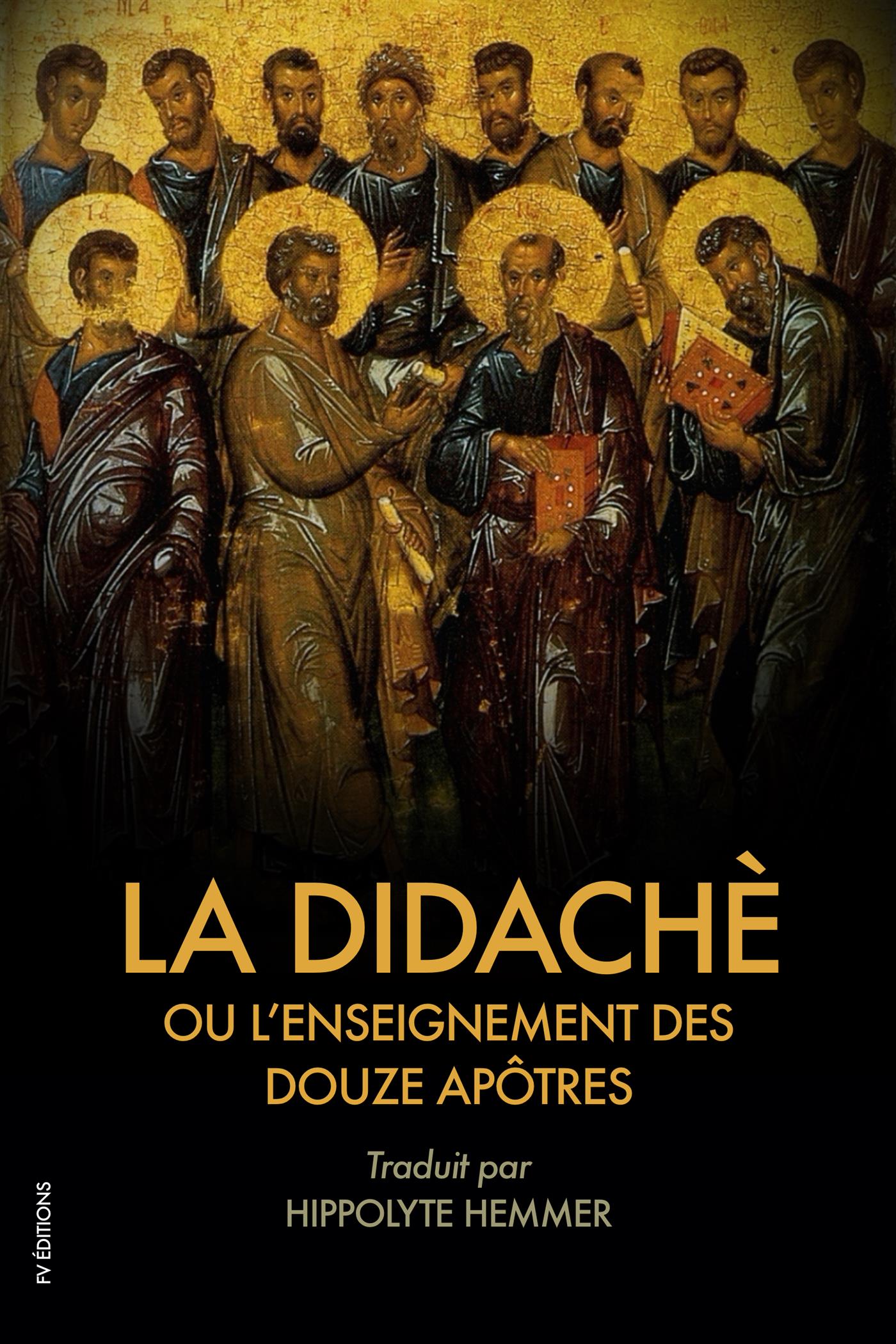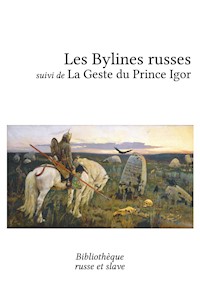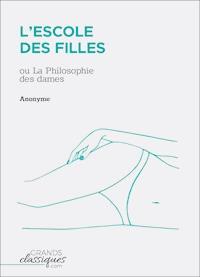Extrait : "Le 19 mars 1871. Le Journal officiel, encore aux mains du gouvernement régulier, publie les pièces suivantes dans sa partie officielle : "Gardes nationaux de Paris, Un comité prenant le nom de comité central, après s'être emparé d'un certain nombre de canon, a couvert Paris de barricades, et a pris possession pendant la nuit du ministère de la justice."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097818
©Ligaran 2015
L’ouvrage que nous publions a pour but de mettre sous les yeux du lecteur un résumé de la presse quotidienne pendant la Commune. Nous reproduisons, sous la date de chaque jour, d’abord tout ce que le Journal officiel de Paris contient d’intéressant, soit dans sa partie officielle, soit dans sa partie non officielle : lois, décrets, arrêtés, avis, ordres, etc., dépêches et rapports militaires, procès-verbaux des séances de la Commune.
À la suite de cette reproduction presque complète du Journal officiel de Paris, nous donnons quelques extraits des divers journaux qui soutenaient la Commune. Enfin, nous empruntons au Journal officiel du gouvernement ce qui explique, contredit, réfute les assertions de la presse insurgée, ce qui en fait ressortir les erreurs et les mensonges. On a ainsi un tableau plus authentique, plus irréfragable que l’histoire, et qui est à celle-ci, sous le rapport de la fidélité, ce qu’est la photographie comparée à la peinture.
Nous suppléons, pour le public, aux collections du double Journal officiel et des journaux que Paris insurgé vit naître, collections qu’il est difficile de se procurer et qui sont d’un prix très élevé. Nous répondons, croyons-nous, à la curiosité générale, et nous faisons une œuvre utile et salutaire. Quel meilleur moyen, en effet, d’éclairer l’opinion sur les doctrines et sur les hommes qui ont laissé parmi nous des traces si lugubres de leur domination passagère, que de mettre chacun à même de voir ce que ces doctrines ont enfanté, ce que ces hommes ont fait, dit et écrit pendant leur pouvoir de trois mois ?
Il n’est pas nécessaire, à ce qu’il nous semble, de déterminer ici le point de départ des évènements : le lecteur est censé le connaître. Mais il est à propos de donner quelques renseignements sur la matière dont nous nous servons, sur les différentes feuilles qu’on verra défiler dans ces deux volumes, et d’abord sur le Journal officiel de Paris, qui en fournit le principal élément.
Les bureaux et l’imprimerie du Journal officiel furent envahis le 19 mars par quelques citoyens à la tête de trois compagnies de la garde nationale fédérée. Les citoyens qui prirent ainsi possession du journal du gouvernement se nommaient Lebeau, Vésinier, Barberet, Floriss Piraux. Le premier numéro qu’ils publièrent, celui du 20 mars, conservait une partie de la rédaction que le gouvernement avait abandonnée dans sa retraite, notamment l’article Variétés signé Mérinos, lequel article parut le même jour dans le Journal officiel de Versailles sous la signature Eugène Mouton. C’était l’œuvre d’un honorable magistrat, qui était ainsi publiée des deux parts sous des noms équivalents, dont le dernier, bien entendu, est seul réel. Lebeau et Vésinier paraissent d’abord s’être partagé la direction. Vésinier prouve son autorité en publiant la liste incomplète (et pour cause) de ses ouvrages dans les annonces (21 et 22 mars). Mais il semble avoir été bientôt éclipsé par Lebeau. L’annonce des ouvrages de Vésinier ne se trouve plus dans le numéro du 23. Les « délégués au Journal officiel » signaient des proclamations dans le numéro du 20 mars ; il n’y a plus que « le délégué » dans le numéro du 22 ; et le 24, Lebeau affirme ouvertement sa qualité. Un avis placé en tête de la partie officielle est signé : « Pour le comité central, E. Lebeau, délégué au Journal officiel. »
Le citoyen Lebeau sentit à son tour sa situation ébranlée. En vain il fit insérer dans le Rappel (28 mars) l’histoire d’une tentative de corruption dont il avait été l’objet :
« Le mercredi soir, le citoyen Lebeau, délégué du comité central à l’Officiel, voit entrer un individu qui lui demande un moment d’entretien pour affaire grave.
Cet individu, après des tas de circonlocutions et de périphrases (on n’était pas sévère pour le style sous la Commune), finit par lui proposer une grosse somme pour mettre dans le Journal officiel une déclaration en faveur du comte de Paris, qui éclaterait tout à coup et qui déciderait un mouvement.
Le citoyen Lebeau fit immédiatement arrêter ce drôle, qui attend à la préfecture de police le procès qui va lui être fait pour tentative de corruption sur un fonctionnaire public.
Il a été constaté que cet individu était d’un bataillon de la garde nationale commandé par un comte, ami d’enfance des princes d’Orléans. »
Le trait, évidemment communiqué par le citoyen Lebeau lui-même, était sans doute magnanime. Il n’empêcha pas l’incorruptible Lebeau d’être remplacé par le citoyen Longuet. Cette révolution intérieure n’eut pas lieu sans quelques scènes scandaleuses. Lebeau, soutenu par Vésinier, fit une énergique résistance. Longuet fut mis une première fois à la porte, mais il revint avec deux délégués de la délégation de l’intérieur, les citoyens Demay et Arnaud, et il fallut bien céder. Le numéro du 28 mars publiait un article du citoyen Éd. Vaillant sur le régicide, annoncé par quatre lignes de Ch. Longuet, « le délégué, rédacteur en chef du Journal officiel ». Lebeau a retracé cette page d’histoire burlesque dans une lettre qu’il écrivit au journal la Cloche, et qui fut alors reproduite dans toute la presse :
« Paris, 29 mars 1871.
Monsieur le directeur,
Vous traitez de conte l’impudente proposition qui m’a été faite dans les bureaux de l’Officiel (relativement à la restauration du comte de Paris), votre doute ne me paraît guère honorable pour le journalisme.
Vous continuez en disant que le délégué au Journal officiel, sortant de l’anonyme, signe aujourd’hui Longuet. Cette assertion exige quelques explications.
Lors de la prise de l’hôtel de ville, mon ami Lullier me fit appeler et me demanda à quel poste je voulais être délégué. Je réfléchis un moment, et ensuite je lui demandai l’Officiel, en lui déclarant qu’avec ce journal et mes profondes études sur les diverses révolutions, je pourrais soulever la province contre le gouvernement Thiers.
Il mit aussitôt trois compagnies à ma disposition pour aller prendre possession du Journal officiel.
Pendant deux jours, j’eus pour collaborateurs les citoyens Barberet et Vésinier, surtout ce dernier. Le citoyen Longuet m’engagea à les renvoyer, en me disant que Vésinier avait écrit les Nuits de Saint-Cloud.
Eux partis, il devait immédiatement venir.
Il n’en fit rien, et, pendant trois jours, je fus seul à l’Officiel.
Vendredi soir, le citoyen Longuet vint avec une délégation le nommant rédacteur en chef. Lui, rédacteur en chef ! Je ne vous souhaite pas, monsieur le directeur, d’en avoir un pareil ; car, pour écrire deux phrases, il met un temps incroyable ; et encore, après les avoir écrites, ne les donne-t-il pas toujours au journal.
Mardi matin, j’ai eu une altercation très vive avec lui, à la suite de laquelle je l’ai forcé à quitter l’Officiel.
Plus tard, j’exposerai tout, en écrivant un petit opuscule : De l’art d’avoir une certaine réputation, tout en étant un parfait imbécile.
Je termine, monsieur le directeur, en vous déclarant que c’est moi, inconnu dans le journalisme, qui ai imprimé au Journal officiel son allure révolutionnaire, et qui ai fait, avec l’assentiment du comité central, tous les décrets qui ont donné au mouvement du 18 mars sa véritable signification.
Le directeur,
ÉMILE LEBEAU. »
Le même journal a reçu communication de la pièce suivante :
« Cette nuit, pendant l’absence du citoyen Lebeau, directeur de l’Officiel, les fédéralistes Demay et Arnaud, délégués à l’intérieur, se sont rendus, à la sollicitation du citoyen Longuet, dans les bureaux du Journal officiel, et, de leur propre autorité, ils ont fait disparaître l’en-tête suivant :
“C’est par surprise que le nom du citoyen Longuet a paru hier dans le Journal officiel. ”
Nous approuvons complètement l’article du citoyen Vaillant, et nous n’hésitons pas à déclarer que nous avions préparé sur le régicide un article plus radical que, vu les circonstances, nous n’avons pas voulu insérer.
M. de Laroche-Thulon, représentant à l’Assemblée de Versailles, a déclaré qu’il provoquait tous les républicains.
Eh bien, les citoyens Lebeau, Lullier et Dardelles, commandant des Tuileries, relèvent tous les défis des défenseurs du principe monarchique.
Le directeur de l’Officiel,
ÉMILE LEBEAU. »
C’est à cette lettre de l’ex-délégué que répondit le délégué nouveau par la note publiée dans le numéro du 31 mars (V.t. I, p 164), où il se borne à constater l’état mental de son prédécesseur.
Cependant la Commune avait été constituée par les élections du 26 mars, et le 29 mars le comité central lui avait remis ses pouvoirs.
Le 30 mars, le Journal officiel, qui a jusqu’alors continué à s’appeler le Journal officiel de la république française, et qui a publié le 29 mars le 88e numéro de sa troisième année, commence une nouvelle ère : il porte le titre de Journal officiel de la Commune de Paris, première année, numéro 1er. Le 31 mars, il reprend son ancien titre, et publie le n° 90 de sa troisième année. Le Journal officiel de la Commune n’avait vécu qu’un jour, et pourtant il est clair que c’était le seul titre qui convînt à l’organe de l’assemblée se prétendant exclusivement communale.
La direction du citoyen Charles Longuet dura jusqu’au 13 mai, non sans quelques tribulations. La question de l’Officiel revient dans un grand nombre de séances de la Commune. Signalons la séance du 21 avril, celle du 24, celle du 29 du même mois, à propos des canons Krupp, qui avaient été, au dire de l’Officiel du 28 avril, livrés aux Versaillais par les Prussiens. La séance du 30 avril continue la suite de l’incident. On verra, du reste, en parcourant les procès-verbaux des séances, que le Journal officiel était une des préoccupations les plus constantes de cette tumultueuse assemblée.
Le rapport des frères May en l’honneur de l’intendance, que publiait l’Officiel du 1er mai, à la veille du jour où ces intendants étaient révoqués de leurs fonctions, fut une nouvelle erreur de Longuet ; le 3 mai, il était obligé de faire l’aveu de son incurie en insérant la déclaration du citoyen G. Tridon, chargé du contrôle de la manutention.
Une note rectificative qu’on trouve dans l’Officiel du 10 mai a besoin de quelques mots d’explication. Dans l’état présenté par la délégation des finances et résumant les mouvements de fonds du 20 mars au 30 avril (V. l’Officiel du 4 mai), on lisait, parmi les payements faits à diverses administrations publiques : « À la Bibliothèque nationale, 30 000 fr. » Mais l’administrateur délégué Vincent n’avait pas versé à la caisse la somme entière : il avait retenu 10 000 fr. pour ses quarante jours d’appointements. De là la rectification du comptable P. Boizard et la révocation de l’administrateur Vincent.
Le numéro du 13 mai fait connaître la nomination du citoyen Vésinier, « délégué au Journal officiel pour les fonctions de rédacteur en chef ».
En tête du numéro du 14, le comité de salut public donne l’ordre de vendre le Journal officiel cinq centimes.
Le 16, le Journal officiel porte pour la première fois la date du calendrier républicain, 26 floréal an 79, plus la devise : liberté, égalité, fraternité, et la mention du nouveau prix : cinq centimes le numéro.
Le numéro du 23 mai, le dernier imprimé au quai Voltaire, ne l’est que sur une seule page : il ne contient pas de partie officielle. Le délégué Vésinier avait égaré la copie destinée à l’impression de la première partie du journal. L’armée était, dès lors, maîtresse des Invalides et du Corps législatif. Elle était trop proche de l’imprimerie de l’Officiel pour que celle-ci continuât à fonctionner. Le tirage fut arrêté vers cinq heures du matin ; deux ou trois cents exemplaires seulement avaient été tirés. Ces exemplaires ne furent pas distribués. Ils furent mis sous séquestre dans la matinée du mardi.
On transporta, pendant la journée, des formes, des caractères, du papier, à l’imprimerie nationale, rue Vieille-du-Temple, avec l’intention sans doute d’y composer le numéro du jour suivant. Mais on ne s’y trouva pas encore assez éloigné des troupes qui s’avançaient dans Paris. On reprit du papier, des caractères, des formes, cette fois dans le matériel de l’imprimerie nationale, et on les transporta au passage Kussner, à Belleville. Ce fut au n° 17 de ce passage que fut imprimé le dernier numéro du Journal officiel de la Commune, portant les dates du 4 prairial an 79 et mercredi 24 mai 1871. L’imprimerie, l’abonnement, la direction, la rédaction sont indiqués rue Vieille-du-Temple, 87.
Donnons maintenant quelques renseignements sur les personnages que nous avons vus se succéder dans la direction du Journal officiel. Laissons de côté Lebeau, dont la carrière n’a duré que trois ou quatre jours. Longuet, qui expulsa Lebeau, est originaire de Caen ; il a environ trente-deux ans. Il était venu depuis une dizaine d’années habiter le quartier latin, où il fonda le journal les Écoles de France, puis la Rive gauche. Ces deux publications furent supprimées. Il assista au congrès de Liège, 1865, en qualité d’étudiant ; il assista à celui de Lausanne, 1867, en qualité de délégué de l’Internationale pour les sections de Caen et de Condé-sur-Noireau. Pendant le siège, il fut commandant du 248e bataillon de la garde nationale, qui n’était pas armé. Au 18 mars, il construisit, avec les hommes de ce bataillon, des barricades rue Soufflot et place du Panthéon, et s’empara du Luxembourg. Il échoua aux élections du 26 mars dans le 5e arrondissement, et fut nommé membre de la Commune aux élections supplémentaires du 16 avril par 1 058 voix du 16e arrondissement. Il vota contre le comité de salut public, signa la déclaration de la minorité, et passa pour modéré en comparaison de ses collègues.
Pierre Vésinier a environ quarante-cinq ans. Il est petit et difforme. C’est un bohème littéraire de la dernière catégorie. Il a commencé par être secrétaire d’Eugène Sue. Après la mort de son patron, il donna aux Mystères du peuple, que celui-ci avait publiés, une suite qu’il intitula les Mystères du monde. Il donna aussi les Travailleurs de l’abîme pour un roman inachevé d’Eugène Sue. Il publia des livres graveleux entremêlés de pamphlets politiques. Obligé de se sauver de France, il se réfugia en Suisse, d’où il fut bientôt expulsé. Il se rendit en Belgique ; il en fut chassé et s’enfuit à Londres, où il continua à mélanger à égale dose la politique (si cela peut s’appeler la politique) et la gravelure ; il y publia dans ce genre mixte un roman intitulé le Mariage d’une Espagnole, où il traçait une biographie à sa façon de Mlle de Montijo, devenue l’impératrice Eugénie. Il signa même ce roman des initiales M. de S., cherchant à le faire attribuer à Marie de Solms (Mme Ratazzi). C’étaient là de ses procédés.
Rentré en France, il fut, après le 4 septembre et pendant le siège, un des orateurs les plus violents des clubs et un des écrivains les plus enfiellés des journaux socialistes. Il fut arrêté à la suite du 31 octobre, fit quatre mois de prison préventive, puis fut acquitté.
La cause de Vésinier triompha au 18 mars. Il fut véritablement l’homme de plume, le littérateur de la Commune. Nul du moins ne prodigua sa prose autant que lui. Non seulement il rédige, comme nous l’avons dit, le Journal officiel pendant les premiers jours de l’insurrection, puis le dirige à partir du 13 mai jusqu’à la fin ; mais on le trouve partout. Dans Paris libre, qui est son œuvre spéciale, il fait paraître en même temps les Proscrits du dix-neuvième siècle (non encore publiés), par P. Vésinier, ex-secrétaire d’Eugène Sue, et le Mariage d’une Espagnole (Mlle de Montijo), par P. Vésinier, avec cette note : « condamné à deux ans de prison pour ce volume, » répétée à chaque feuilleton. Dans l’Affranchi, il fait quotidiennement une revue de la presse sous ce titre : Le venin réactionnaire. C’est lui qui accueille la suppression des journaux dissidents par la note que nous avons reproduite (page 43 du second volume). Il y réimprime aussi en feuilletons : le Mariage d’une Espagnole (Mlle de Montijo), par P. Vésinier, avec la même note : « condamné à deux ans de prison pour ce volume, » répétée également à chaque feuilleton. Non élu aux élections du 26 mars, il parvint enfin à être nommé membre de la Commune aux élections supplémentaires du 16 avril. Il obtint dans le 1er arrondissement 2 626 voix. Il fut nommé secrétaire de l’assemblée avec le citoyen Amouroux, puis, comme on l’a vu, délégué au Journal officiel, sans perdre toutefois ses fonctions de secrétaire, ni celles de membre de la commission des services publics. On voit que cet étrange réformateur de la société devenait un personnage important, et que Vésinier pouvait aspirer, si la Commune eût vécu, à gouverner la France.
À côté du Journal officiel de la république française, publié par la Commune, se rangent un certain nombre de feuilles, les unes nées avant elle, les autres enfantées par elle, qui la soutiennent. En voici quelques-unes :
Le Mot d’ordre, dont M. Henri Rochefort était rédacteur en chef, mis au jour le 3 février 1871, suspendu par le général Vinoy le 11 mars, repris après le 18, disparut le 20 mai, après la fuite de ses rédacteurs.
Le Vengeur, dont M. Félix Pyat était rédacteur en chef, mis au jour le 3 février, suspendu par le général Vinoy le 11 mars, repris après le 18.
La Nouvelle République, dont M. Paschal Grousset était rédacteur en chef, née le 19 mars, à laquelle succéda, le 2 avril,
L’Affranchi, journal des hommes libres, par le même, disparu le 25 avril.
La Commune, rédigée par MM. George Duchêne, Odilon Delimal, etc., à laquelle collabora le député de Paris Millière, parut le 20 mars et fut supprimée le 19 mai par arrêté du comité de salut public.
L’Ordre, dont M. Vermorel était rédacteur en chef, parut le 20 mars, et n’eut que quatre numéros.
L’Ami du peuple, par le même, parut le 25 avril, et n’eut également que quatre numéros.
Le Réveil du peuple, rédigé par les anciens rédacteurs du Réveil. Delescluze n’y figura que pour une lettre publiée en guise de programme dans le premier numéro, du 18 avril 1871.
Le Tribun du peuple, dont le rédacteur en chef était M. Lissagaray, parut le 17 mai et finit le 24.
L’Homme, dont le rédacteur en chef se nommait L. Maretheux, commença sa publication le 8 mars, devint l’Homme libre à partir du 18 mars, et mourut le 9 avril.
Ces journaux étaient à dix centimes le numéro. En voici qui ne coûtaient que cinq centimes :
Le Cri du peuple, dont M. Jules Vallès était le rédacteur en chef, né le 22 février 1871, suspendu par le général Vinoy le 11 mars, repris après le 18, finit le 23 mai.
La Sociale, née le 31 mars et morte le 17 mai, dont le principal rédacteur fut Mme André Léo.
Paris libre, fondé par Vésinier le 12 avril, qui, outre les romans dudit Vésinier, publia le Pilori des mouchards, c’est-à-dire les noms des individus ayant demandé un emploi de police sous l’empire.
La Montagne, journal de la révolution sociale, dont le rédacteur en chef fut Gustave Maroteau. Elle parut le 2 avril, eut vingt-deux numéros, et fut remplacée plus tard par
Le Salut public, du même Maroteau, né le 16 mai, disparu le 24.
Le Bonnet rouge, né le 10 avril, dont le rédacteur en chef se nommait Achille Baubeau de Secondigné, signant Secondigné tout court. Il fit place à
L’Estafette, publiée par le même à partir du 23 avril.
Le Prolétaire, organe des revendications sociales, signé par les citoyens Dubourg, Jacqueline, etc., né un peu tardivement, – le 20 mai.
Le Père Duchêne, né le 16 ventôse, an 79 (7 mars 1871), suspendu par le général Vinoy le 11 mars, repris après le 18, dura jusqu’à la fin de la Commune ; deux petites feuilles in-octavo sur papier grossier, avec une vignette de tête représentant un sans-culotte coiffé du bonnet rouge, qui de la main droite tient un niveau et dont le bras gauche entoure un canon ; un pastiche de l’ancien Père Duchêne, mêmes fureurs, même cynisme et plus de jurons. Il avait pour rédacteurs les citoyens Vermesch, A. Humbert et Maxime Vuillaume.
Tenons-nous-en là. Nous venons de citer ce qu’il y eut de plus coloré parmi les feuilles communeuses. Nous avons fait des emprunts à beaucoup de ces feuilles, dans la mesure restreinte que nous imposaient les limites de notre cadre, mais assez cependant pour qu’on puisse juger ce journalisme et, pour montrer ce que de tels instituteurs étaient capables de faire de la population parisienne et de la population française.
La confrontation de ces feuilles entre elles est fort instructive. Donnons quelques exemples des révélations qu’on peut en tirer.
Ainsi, en ce qui concerne le premier engagement entre les troupes régulières et les troupes insurgées, quelle discussion pourrait valoir le rapprochement des articles que nous reproduisons pages 189 et 192 du premier volume et de la fameuse proclamation du lendemain ? Le journal la Sociale publiait le 1er avril au soir, sous la date du 2 avril, cette invitation furieuse à marcher contre Versailles, et annonçait les évènements qui se préparaient pour le lendemain. On sait ce qui se passa, en effet, le 2 avril ; et, le 3, paraissait en tête du Journal officiel la proclamation : « Les conspirateurs royalistes ont attaqué. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué, etc. »
On sait le grand rôle que jouèrent dans les proclamations et dans les journaux de la Commune les zouaves pontificaux, les soldats de Charette et de Cathelineau. Dans cette proclamation du 3 avril que nous venons de rappeler, la commission exécutive disait que les conspirateurs royalistes, « ne pouvant compter sur l’armée française, avaient attaqué avec les zouaves pontificaux,… avec les chouans de Charette, avec les Vendéens de Cathelineau, etc. »
« Le 2 avril, les bandes du royaliste Charette, les zouaves pontificaux portaient un drapeau blanc et criaient Vive le roi ! Aucun doute n’est possible à cet égard. » (V.p 244 du premier volume.)
« Les troupes de Charette ont combattu hier sous le drapeau blanc. Chaque soldat avait sur sa poitrine un cœur de Jésus en drap blanc sur lequel on lit ces mots : Arrête, le cœur de Jésus est là ! » (Cri du peuple, 5 avril.)
Bien mieux, on leur prenait des drapeaux, on leur prenait même des drapeaux du saint-empire romain !
Il n’est besoin, pour démentir ces ridicules histoires, que de s’adresser aux mêmes feuilles qui les ont propagées. Jusqu’à la fin de la Commune, on les voit annoncer que les zouaves pontificaux sont décidément entrés en ligne. Dans le rapport du délégué à la guerre, daté du 16 avril (V.p 404 du premier volume), on lit : « Les zouaves pontificaux sont décidément entrés en ligne avec les gendarmes et les sergents de ville. » Le Mot d’ordre du 12 mai dit : « Les hommes de Charette sont entrés en ligne. » On n’avait donc pu leur prendre des drapeaux au commencement d’avril, et ils n’avaient pu, comme ce même Mot d’ordre les en avait accusés alors (n° du 7 avril), fusiller tous leurs prisonniers.
Qu’a-t-on besoin de chercher à démontrer que les incendies des derniers jours de la Commune étaient prémédités et préparés ? L’aveu en est formel dans les journaux que publiaient quelques hommes de la Commune. Il suffit, par exemple, de voir les avertissements et les menaces du journal de Jules Vallès, le Cri du peuple, dans les numéros du 16 et du 20 mai. Rien de plus clair. Les enfants terribles de la bande ne savaient point retenir leur plume et trahissaient les abominables secrets dont ils étaient dépositaires.
Les fausses nouvelles ont atteint, dans la presse communeuse, des proportions qui seraient risibles, si rien pouvait être risible dans ces désolantes et déshonorantes saturnales. Citons les deux mille gendarmes cernés le 14 avril dans l’île de la Grande-Jatte, dont le journal la Commune avait l’indiscrétion de demander des nouvelles quelques jours après (V.p 376 et 433 du premier volume), les régiments de l’armée régulière se laissant tranquillement décimer par des sergents de ville (V.t. I, p 261), les quarante mille hommes gardés à vue au Pecq (V.t. II, p 472), et mille autres inventions que les séides de la Commune étaient seuls capables de digérer.
Les bulletins militaires que la délégation à la guerre faisait publier méritent de passer en proverbe entre tous les bulletins qui maltraitèrent audacieusement la vérité. Ils épuisèrent une crédulité presque inépuisable. Des protestations s’élevèrent au nom du sens commun, jusque dans les feuilles dévouées à l’insurrection (V.p. 88 du second volume). Nous nous sommes contentés généralement de donner les rapports du Journal officiel. Si nous avions donné les informations militaires que publiaient les feuilles simplement officieuses, nous serions tombés dans le fantastique et dans le ridicule.
Le Journal officiel lui-même était bien aventureux. Nous avons dit précédemment un mot des canons Krupp et des mitrailleuses qu’il faisait livrer par les Prussiens aux troupes de Versailles (V.t. II.p 181). Ce fut une lourde bévue. Emporté par le désir de rendre les Versaillais odieux, le rédacteur avait oublié que la Commune tenait beaucoup à persuader au public la stricte neutralité de la Prusse. Aussi fut-il blâmé dans la séance de la Commune et l’assemblée exprima-t-elle pour cette fois son regret que les nouvelles même officielles ne fussent pas plus sévèrement contrôlées.
Il est de ces bulletins dont on ne peut s’empêcher de sourire. Tels sont ceux des gouverneurs des forts d’Issy et de Vanves. On peut les comparer, au moins pour la naïve émulation qui s’y donne carrière, aux chants alternés des bergers de Virgile (V.p 426, 425 du premier volume). Le commandant du fort de Vanves fait savoir que son artillerie démonte les batteries ennemies, que les attaques sont repoussées avec le plus grand succès : « Pas de morts, un seul blessé dans l’attaque de la nuit dernière. Chacun est impatient d’en finir avec les hordes versaillaises. » Mais le commandant du fort d’Issy touche son rival à l’endroit faible. Le délégué à la guerre avait reproché à celui-ci l’effroyable gaspillage de munitions qu’il faisait. Le gouverneur du fort d’Issy constate aussi la justesse du tir et le sang-froid de ses artilleurs « qui démontent constamment les batteries ennemies du matin au soir », mais « tout en ménageant les munitions, car ils ne tirent qu’à coup sûr ».
Lorsque le fort d’Issy fut enfin occupé par l’armée, le secrétaire de la Commune, Vésinier, écrivit aux journaux une lettre, que la plupart, trouvant l’impudence trop forte, s’abstinrent de reproduire, ou qu’ils ne reproduisirent qu’avec des commentaires plus ou moins embarrassés. Celui dont l’Estafette du 12 mai fait suivre cette lettre est un bon modèle de ces explications difficiles (V.t. II, p 477.)
Ils s’efforcèrent de tromper jusqu’au bout la malheureuse population qu’ils voulaient dominer. Quelques heures après l’entrée de l’armée dans Paris, le dictateur militaire de la Commune démentait encore le fait dans une affiche que nous avons reproduite. (V.t. II, p 606).
La principale pâture de cette presse, c’étaient les accusations calomnieuses contre les troupes régulières, les récits d’atrocités, qui, presque toujours, se démentent eux-mêmes par leur exagération et par leur invraisemblance.
En veut-on un seul trait ? on peut lire dans la Montagne du 7 avril :
« À Neuilly, les sergents de ville ont fusillé leurs prisonniers avec des raffinements de cruauté inouïs. Ils ont commencé par les dépouiller de tous leurs vêtements ; puis ils les ont attachés dos à dos. Puis ils les fusillaient ainsi réunis pour que la même balle perçât à la fois les deux hommes. »
Les auteurs de ces récits y trouvaient l’avantage d’exciter la fureur de leurs propres soldats qui leur paraissaient sans doute trop débonnaires, de réclamer les mesures terroristes qu’ils rêvaient tous, de justifier par avance les cruautés qu’ils pourraient commettre en les présentant comme des représailles.
Ces calomnies remplissent chaque jour les feuilles de la Commune. C’est à celle qui enchérira sur les autres. Nous avons dû en reproduire çà et là quelques spécimens. Les inventeurs et les propagateurs de ces calomnies ne dissimulent pas, du reste, le but qu’ils poursuivent. Voyez, par exemple, l’article de l’Affranchi, intitulé Pas de pitié ! (page 244 du premier volume). Si la feuille du citoyen Paschal Grousset avait de ces accents dès la première heure de la lutte, on peut deviner à quelles fureurs durent se livrer les Maroteau, les Bouis, à mesure que la lutte s’exaspéra et que la défaite fut prochaine.
Quelques-unes de ces inventions calomnieuses eurent un retentissement exceptionnel et servirent de préliminaires aux mesures extrêmes. Telle fut l’histoire du viol et de l’assassinat d’une infirmière, dont le citoyen Urbain prit prétexte, dans la séance de la Commune du 17 mai, pour demander l’exécution de dix otages. Cette accusation, qui se produit alors sous la garantie du lieutenant Butin, de la 3e compagnie du 105e bataillon (voyez le rapport dans l’Officiel du 19 mai, t. II, p 563), cette accusation était, pour ainsi dire, à l’ordre du jour dans les journaux de la Commune. Quatre jours auparavant, dans le Cri du peuple du 13 mai, un fait du même genre est attesté par le citoyen Noron, chef du 22e bataillon : une jeune femme, infirmière à ce bataillon, aurait été assassinée tandis qu’elle donnait des soins à un blessé. Pour Noron, le fait s’est accompli dans une reconnaissance « où un guide plus brave qu’expérimenté avait conduit le bataillon au milieu des postes versaillais ; » il ne dit pas où. Pour Butin, le fait est attesté par un commandant innomé, qui l’a vu s’accomplir à quelque distance du fort de Vanves. Voilà sur quelles allégations plus que suspectes l’on s’appuyait pour demander la mort de dix hommes de bien, incarcérés à titre d’otages.
L’explosion de la cartoucherie Rapp fut exploitée à outrance dans le même but. Le comité de salut public n’hésita pas à déclarer que c’étaient des agents du gouvernement de Versailles qui y avaient mis le feu. Toutes les feuilles communeuses réclamèrent à l’envi du sang et des vengeances. Paris libre du citoyen Vésinier s’écriait :
« Les sauvages qui peuplent les forêts avoisinant Versailles ne paraissent pas avoir la moindre notion d’humanité ; nous devons les détruire par tous les moyens possibles pour ne pas être nous-mêmes victimes de leurs atrocités. »
Le Cri du peuple (20 mai) déclarait que, pour tirer vengeance de cette explosion (étrange logique !), la Commune ferait sauter tout Paris : « Le gouvernement de Versailles peut faire sauter un coin de Paris… Paris héroïque et désespéré pourra sauter peut-être, mais s’il saute, ce sera pour engloutir le gouvernement de Versailles et son armée. » C’est, en effet, à la faveur de ces imputations odieuses, que la Commune préparait les massacres et les incendies de la dernière heure.
Il est une autre sorte de calomnies et de provocations dont la presse communeuse n’abusa pas moins. On n’a pas oublié le parti qu’elle s’efforça de tirer des ossements qu’on trouva dans les caveaux des églises. On se souvient peut-être de l’article romantique publié par Jules Vallès dans le Cri du peuple du 9 mai, sur les cadavres de l’église Saint-Laurent : « C’est ici l’autel de la Vierge, etc. » (V.t. II, p 455.) Cet article fut imprimé en placard avec un « dessin d’après nature », vendu à grand nombre et crié dans les rues.
Les pièces qui ont été recueillies depuis lors, après la délivrance de Paris, ont mis en pleine lumière la bonne foi de ceux qui jetaient ces infamies dans le public. Le 13 mai, un rapport du docteur Piorry, commis officiellement pour donner son opinion sur les cadavres de Saint-Laurent, mettait à néant les atroces suppositions auxquelles ils avaient donné lieu. Mais les membres de la Commune ne jugèrent pas à propos de publier ce rapport, ils laissèrent le mensonge circuler et cachèrent le démenti. Ceux de ces membres qui étaient en même temps rédacteurs de journaux n’en continuèrent pas moins à exploiter ce mensonge pour les plus odieuses excitations. Bien plus, le Journal officiel du 21 mai contient un « deuxième rapport sur la recherche des crimes commis à l’église Saint-Laurent » par le citoyen Leroudier, qui signe « pour la municipalité ». Dans ce rapport, Leroudier ose dire : « Après avoir vidé l’ossuaire, après avoir dégagé l’humus enveloppant ces restes terrifiants, la science calme et froide est venue constater que ces débris appartenaient tous à des infortunées enterrées depuis moins de dix ans. Or le règne du dernier curé en a duré dix-sept ! » Et toujours la même conclusion : « Faites-vous justiciers ! » Nous n’avons pas jugé que ce rapport, qui n’est d’ailleurs remarquable que par une emphase burlesque, valût la peine d’être reproduit ici.
Les caveaux de Saint-Laurent prêtèrent, jusqu’au dernier jour de la Commune, aux plus absurdes et aux plus révoltantes déclamations. Il en fut de même des caveaux funéraires de l’église des Petits-Pères, de ceux de l’église de Notre-Dame-des-Victoires, etc., qui furent également violés et où les gardes nationaux de Paris s’étonnèrent également de trouver des squelettes et des ossements humains.
La monomanie sanguinaire de quelques feuilles de la première révolution sembla revivre dans certains journaux de la Commune, tels que la Montagne et le Salut public. Nous leur avons fait de très sobres emprunts.
Pour faire comprendre où en est la notion de justice chez ces hommes, il suffit de dire que le Salut public réclamait le huis clos pour les jugements des cours martiales. Nous lisons dans une sorte de manifeste signé par la rédaction (n° du 19 mai) : Il nous paraît urgent de fermer les portes de la cour martiale au public. La publicité des séances occasionne des faits très graves qui empêchent presque toujours à la vérité de ressortir, au juge de juger avec connaissance de cause.
« La cour martiale perd son caractère révolutionnaire, qui consiste dans la rapidité et la sévérité des jugements.
Devenant un tribunal ordinaire, – en perdant le côté saisissant du secret, – elle ne pourra jamais produire les résultats immédiats que produirait un tribunal révolutionnaire.
La cour martiale d’aujourd’hui se trouve obligée de rendre des arrêts contre l’auditoire, qui la gêne et entrave son travail. Nous demandons au comité de salut public que la cour martiale siège à portes fermées. »
Ainsi, ils craignent la présence de ce peuple, au nom duquel, ils prétendent agir. Sa voix, ses sentiments, ses impressions dérangent leurs tribunaux dans leur travail. Il faut l’écarter ; il faut opérer dans le secret et dans le silence.
Que peuvent-ils donc trouver à redire aux procédés de l’ancienne inquisition ?
On lira les provocations que cette feuille publiait le 21 mai au soir, en même temps qu’elle annonçait une grande victoire de Dombrowski (V.t. II, p 618). À cette heure-là précisément, l’armée entrait dans Paris.
D’autres de ces journaux se contentaient d’exciter aux démolitions ou aux confiscations. Le Mot d’ordre se distingua sous ce rapport ; il conseillait la démolition de l’hôtel de M. Thiers et des maisons des autres membres du gouvernement dès le 6 avril ; il appelait l’attention de ses amis sur le trésor de Notre-Dame (V.t. I, p 296.) Il demandait qu’on rasât le château de Versailles (ibid., p 355), etc.
On voit ce que contient d’enseignements un recueil comme celui-ci, en dehors même de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, de ce pouvoir qui ne prétendait à rien moins qu’à « illuminer » le monde. On prendra là, dans son œuvre même, la triste opinion qu’il faut en avoir. On ne saurait, en effet, être trop sévère pour lui ni pour le mouvement dont il est sorti. L’insurrection du 18 mars aggrava nos désastres, prolongea et redoubla toutes nos souffrances, et fit courir au pays un immense danger. Elle exposait la France à être plus complètement écrasée sous le joug étranger. Elle fut accablante pour notre renommée nationale. Cette sédition éclatant en présence de l’ennemi fut partout condamnée avec mépris ; les journaux de toutes les nations rappelèrent que les peuples les plus accusés de décadence politique et morale, que l’Espagne, le Mexique, avaient su rester unis devant l’invasion étrangère, et ne pas se déchirer sous les yeux d’un vainqueur. La défaite de nos armées avait sans doute diminué notre prestige, mais l’insurrection parisienne fit bien plus encore pour nous déconsidérer. Pour racheter cette grande faute et les crimes contre la société et la civilisation dont elle fut suivie, il faut que nous la flétrissions et que nous la détestions de toute notre énergie. Si les ruines qu’elle a laissées dans Paris finissent par se réparer ou par disparaître avec les années, il faut que l’histoire, en maintenant devant l’esprit les actes et les paroles de la Commune de 1871, entretienne et ravive la réprobation dont elle doit rester à jamais frappée.
L.M.
Le Journal officiel, encore aux mains du gouvernement régulier, publie les pièces suivantes dans sa partie officielle :
GARDES NATIONAUX DE PARIS,
Un comité prenant le nom de comité central, après s’être emparé d’un certain nombre de canons, a couvert Paris de barricades, et a pris possession pendant la nuit du ministère de la justice.
Il a tiré sur les défenseurs de l’ordre ; il a fait des prisonniers, il a assassiné de sang-froid le général Clément Thomas et un général de l’armée française, le général Lecomte.
Quels sont les membres de ce comité ?
Personne à Paris ne les connaît ; leurs noms sont nouveaux pour tout le monde. Nul ne saurait même dire à quel parti ils appartiennent. Sont-ils communistes, ou bonapartistes, ou prussiens ? Sont-ils les agents d’une triple coalition ? Quels qu’ils soient, ce sont les ennemis de Paris qu’ils livrent au pillage, de la France qu’ils livrent aux Prussiens, de la république qu’ils livreront au despotisme. Les crimes abominables qu’ils ont commis ôtent toute excuse à ceux qui oseraient ou les suivre ou les subir.
Voulez-vous prendre la responsabilité de leurs assassinats et des ruines qu’ils vont accumuler ? Alors, demeurez chez vous ! Mais si vous avez souci de l’honneur et de vos intérêts les plus sacrés, ralliez-vous au gouvernement de la république et à l’Assemblée nationale.
Paris, le 19 mars 1871.
Les ministres présents à Paris,
DUFAURE, JULES FAVRE, ERNEST PICARD, JULES SIMON, AMIRAL POTHUAU, GÉNÉRAL LE FLO.
Le gouvernement, voulant éviter une collision, a usé de patience et de temporisation envers des hommes qu’il espérait par là ramener au bon sens et au devoir. Ces hommes, se plaçant en révolte ouverte contre la loi, s’étaient constitués en comité insurrectionnel, ordonnant à la garde nationale de désobéir à ses chefs légitimes. C’est à leur action qu’a été due la résistance opposée à la reprise des canons que l’autorité militaire voulait replacer dans leurs arsenaux, sous la garde de la garde nationale et de l’armée. La ville entière s’était émue de l’établissement de redoutes sur les hauteurs de Montmartre et des buttes Chaumont, et tout homme d’un peu de bon sens comprenait combien il était à la fois ridicule et criminel de déployer contre Paris cet attirail menaçant.
Tant qu’un pareil état de choses se prolongeait, la reprise du travail était impossible, la province s’éloignait de la capitale, et toute espérance de crédit et de prospérité était indéfiniment ajournée. Après avoir épuisé toutes les voies de conciliation, le gouvernement a senti qu’il était de son devoir de faire respecter la loi et de rendre à la garde nationale son autorité légale. Ce matin à la pointe du jour, les hauteurs ont été enlevées, les canons allaient être reconduits aux arsenaux sous l’escorte de la troupe, lorsque des gardes nationaux armés et d’autres sans armes, excitant et entraînant la foule, se sont jetés sur nos soldats et leur ont arraché leurs armes. Plusieurs bataillons ont été cernés, d’autres forcés de se replier. À partir de ce moment, l’émeute a été maîtresse du terrain. Nous racontons plus bas comment ces criminels artisans ont mis en arrestation le général Lecomte et le général Clément Thomas qui se trouvaient dans la mêlée, et comment ces deux captifs ont été lâchement assassinés.
La journée s’est terminée dans le désordre, sans que la garde nationale, convoquée cependant dès le matin, par le rappel, parût en nombre suffisant pour le réprimer sur le théâtre où il se développait. Ce soir, l’insurrection a envahi l’état-major de la garde nationale et le ministère de la justice. On se demande avec une douloureuse stupeur quel peut être le but de ce coupable attentat ; des malveillants n’ont pas craint de répandre le bruit que le gouvernement préparait un coup d’État, que plusieurs républicains étaient arrêtés. Ce sont d’odieuses calomnies. Le gouvernement, issu d’une Assemblée nommée par le suffrage universel, a plusieurs fois déclaré qu’il voulait fonder la république. Ceux qui veulent la renverser sont les hommes de désordre, les assassins qui ne craignent bas de semer l’épouvante et la mort dans une cité qui ne peut se sauver que par le calme, le travail, le respect des lois. Ces hommes ne peuvent être que les stipendiés de l’ennemi ou du despotisme. Leurs crimes, nous l’espérons, soulèveront la juste indignation de la population de Paris, qui sera debout pour leur infliger le châtiment qu’ils méritent.
Ce matin, vers midi, le général Lecomte, séparé de ses troupes, a été amené par une bande de forcenés rue des Rosiers, à Montmartre, devant quelques individus prenant le titre de comité central. Des cris « À mort ! » se faisaient entendre. Le général Clément Thomas, survenu peu de temps après, en habit de ville, a été reconnu. Un des assistants s’est écrié : « C’est le général Clément Thomas, son affaire est faite ! » Le général Lecomte et le général Clément Thomas ont été poussés dans un jardin, suivis par une centaine d’hommes. Ils ont été attachés et fusillés. Leurs cadavres ont été mutilés à coups de baïonnette.
Ce crime épouvantable, accompli sous les yeux du comité central, donne la mesure des horreurs dont Paris est menacé, si les sauvages agitateurs qui troublent la cité et déshonorent la France pouvaient triompher.
Les deux aides de camp du général Lecomte allaient subir le même tort que leur général, quand ils ont été sauvés par l’intervention d’un jeune homme de dix-sept ans, qui s’est écrié que ce qui se passait était horrible ; qu’après tout on ne connaissait pas ceux qui prononçaient ces condamnations à mort. Il a réussi à faire épargner les deux jeunes officiers menacés d’une mort affreuse.
Que la population de Paris, si indulgente jusqu’ici pour les fauteurs de désordres, comprenne enfin qu’elle doit se montrer énergique contre de pareils forfaits, sous peine d’en être complice !
Les proclamations suivantes avaient été adressées aux habitants et aux gardes nationaux de Paris :
HABITANTS DE PARIS,
Nous nous adressons encore à vous, à votre raison et à votre patriotisme, et nous espérons que nous serons écoutés.
Votre grande cité, qui ne peut vivre que par l’ordre, est profondément troublée dans quelques quartiers ; et le trouble de ces quartiers, sans se propager dans les autres, suffit cependant pour y empêcher le retour du travail et de l’aisance.
Depuis quelque temps des hommes malintentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, qui ne sont plus dans vos murs, se sont constitués les maîtres d’une partie de la ville, y ont élevé des retranchements, y montent la garde, vous forcent à la monter avec eux, par ordre d’un comité occulte qui prétend commander seul à une partie de la garde nationale, méconnaît ainsi l’autorité du général d’Aurelles si digne d’être à votre tête, et veut former un gouvernement en opposition au gouvernement légal, institué par le suffrage universel.
Ces hommes qui vous ont causé déjà tant de mal, que vous avez dispersés vous-mêmes au 31 octobre, affichent la prétention de vous défendre contre les Prussiens, qui n’ont fait que paraître dans vos murs, et dont ces désordres retardent le départ définitif, braquent des canons qui, s’ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-mêmes ; enfin, compromettent la république au lieu de la défendre, car, s’il s’établissait dans l’opinion de la France que la république est la compagne nécessaire du désordre, la république serait perdue. Ne le croyez pas, et écoutez la vérité que nous vous disons en toute sincérité !
Le gouvernement, institué par la nation tout entière, aurait déjà pu reprendre ces canons dérobés à l’État, et qui, en ce moment, ne menacent que vous, enlever ces retranchements ridicules qui n’arrêtent que le commerce, et mettre sous la main de la justice les criminels qui ne craindraient pas de faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère ; mais il a voulu donner aux hommes trompés le temps de se séparer de ceux qui les trompent.
Cependant le temps qu’on a accordé aux hommes de bonne foi pour se séparer des hommes de mauvaise foi est pris sur votre repos, sur votre bien-être, sur le bien-être de la France tout entière. Il faut donc ne pas le prolonger indéfiniment. Tant que dure cet état de choses, le commerce est arrêté, vos boutiques sont désertes, les commandes qui viendraient de toutes parts sont suspendues, vos bras sont oisifs, le crédit ne renaît pas, les capitaux dont le gouvernement a besoin pour délivrer le territoire de la présence de l’ennemi hésitent à se présenter. Dans votre intérêt même, dans celui de votre cité, comme dans celui de la France, le gouvernement est résolu à agir. Les coupables qui ont prétendu instituer un gouvernement à eux vont être livrés à la justice régulière. Les canons dérobés à l’État vont être rétablis dans les arsenaux, et, pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais ; qu’ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Ils hâteront ainsi le retour de l’aisance dans la cité, et rendront service à la république elle-même, que le désordre ruinerait dans l’opinion de la France.
Parisiens, nous vous tenons ce langage parce que nous estimons votre bon sens, votre sagesse, votre patriotisme ; mais, cet avertissement donné, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix, et sans un jour de retard, que l’ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable.
Paris, le 17 mars 1871.
THIERS,
Président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la république.
DUFAURE, ministre de la justice.
E. PICARD, ministre de l’intérieur.
POUYER-QUERTIER, ministre des finances.
JULES FAVRE, ministre des affaires étrangères.
Général LE FLO, ministre de la guerre.
Amiral POTHUAU, ministre de la marine.
JULES SIMON, ministre de l’instruction publique.
DE LARCY, ministre des travaux publics.
LAMBRECHT, ministre du commerce.
À LA GARDE NATIONALE DE LA SEINE.
Le gouvernement vous appelle à défendre votre cité, vos foyers, vos familles, vos propriétés.
Quelques hommes égarés, se mettant au-dessus des lois, n’obéissant qu’à des chefs occultes, dirigent contre Paris les canons qui avaient été soustraits aux Prussiens.
Ils résistent par la force à la garde nationale et à l’armée.
Voulez-vous le souffrir ?
Voulez-vous sous les yeux de l’étranger, prêt à profiter de nos discordes, abandonner Paris à la sédition ?
Si vous ne l’étouffez pas dans son germe, c’en est fait de la république et peut-être de la France !
Vous avez leur sort entre vos mains.
Le gouvernement a voulu que vos armes vous fussent laissées.
Saisissez-les avec résolution pour rétablir le régime des lois, sauver la république de l’anarchie, qui serait sa perte ; groupez-vous autour de vos chefs : c’est le seul moyen d’échapper à la ruine et à la domination de l’étranger.
Paris, le 18 mars 1871.
Le ministre de l’intérieur,
ERNEST PICARD.
Le général commandant en chef les gardes nationales de la Seine,
D’AURELLE.
GARDES NATIONALES DE PARIS,
On répand le bruit absurde que le gouvernement prépare un coup d’État.
Le gouvernement de la république n’a et ne peut avoir d’autre but que le salut de la république. Les mesures qu’il a prises étaient indispensables au maintien de l’ordre ; il a voulu et il veut en finir avec un comité insurrectionnel, dont les membres, presque tous inconnus à la population, ne représentent que les doctrines communistes, et mettraient Paris au pillage et la France au tombeau, si la garde nationale et l’armée ne se levaient pour défendre, d’un commun, accord, la patrie et la république.
Paris, le 18 mars 1871.
THIERS, DUFAURE, ERNEST PICARD, JULES FAVRE, JULES SIMON, POUYER-QUERTIER, GÉNÉRAL LE FLO, AMIRAL POTHUAU, LAMBRECHT, DE LARCY.
DÉPÊCHE OFFICIELLE ADRESSÉE À LA MAIRIE DE ROUEN.
Versailles, 19 mars 1871, 8 h. 25 m. matin.
Le président du conseil du gouvernement, chef du pouvoir exécutif, aux préfets, sous-préfets, généraux commandant les divisions militaires, préfets maritimes, premiers présidents des cours d’appel, procureurs généraux, archevêques et évêques.
Le gouvernement tout entier est réuni à Versailles. L’Assemblée s’y réunit également. L’armée, au nombre de 40 000 hommes, s’y est concentrée en bon ordre, sous le commandement du général Vinoy.
Toutes les autorités, tous les chefs de l’armée y sont arrivés. Les autorités civiles et militaires n’exécuteront d’autres ordres que ceux du gouvernement régulier résidant à Versailles, sous peine d’être considérées comme en état de forfaiture.
Les membres de l’Assemblée nationale sont invités à accélérer leur retour pour être tous présents à la séance du 20 mars.
La présente circulaire sera livrée à la publicité.
Signé : THIERS.
Versailles, 19 mars, 10 h. matin.
Les déplorables évènements qui ont eu lieu hier à Paris, depuis l’heure où je vous faisais concevoir des espérances, entraînent une grande concentration de forces militaires dans notre ville.
Le chef du pouvoir exécutif, qui ne saurait se séparer de l’Assemblée nationale, est venu se fixer près d’elle avec tous les ministres, et se trouve placé de façon à donner tous les ordres et à obtenir tous les concours nécessaires.
La ville de Versailles, qui n’a rien à redouter, grâce aux forces dont le gouvernement dispose, a de grands devoirs à accomplir.
Il faut surtout que notre armée soit bien accueillie par elle, et, à cet égard, je suis heureux de pouvoir féliciter notre population des excellentes dispositions qu’elle a déjà manifestées.
Espérons que le calme se fera bientôt dans les esprits, que la loi sera respectée et l’ordre public rétabli ; qu’enfin la république sortira encore une fois victorieuse des cruelles épreuves que lui imposent les passions anarchiques.
Le maire de Versailles, député de Seine-et-Oise,
RAMEAU.
Le Journal officiel tombé au pouvoir des révolutionnaires publie les pièces suivantes dans sa partie officielle.
FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE.
ORGANE DU COMITÉ CENTRAL.
Si le comité central de la garde nationale était un gouvernement, il pourrait, pour la dignité de ses électeurs, dédaigner de se justifier. Mais comme sa première affirmation a été de déclarer « qu’il ne prétendait pas prendre la place de ceux que le souffle populaire avait renversés, » tenant à simple honnêteté de rester exactement dans la limite expresse du mandat qui lui a été confié, il demeure un composé de personnalités qui ont le droit de se défendre.
Enfant de la république qui écrit sur sa devise le grand mot de : fraternité, il pardonne à ses détracteurs ; mais il veut persuader les honnêtes gens qui ont accepté la calomnie par ignorance.
Il n’a pas été occulte : ses membres ont mis leurs noms à toutes ses affiches. Si ces noms étaient obscurs, ils n’ont pas fui la responsabilité, – et elle était grande.
Il n’a pas été inconnu, car il était issu de la libre expression des suffrages de deux cent quinze bataillons de la garde nationale.
Il n’a pas été fauteur de désordres, car la garde nationale, qui lui a fait l’honneur d’accepter sa direction, n’a commis ni excès, ni représailles, et s’est montrée imposante et forte par la sagesse et la modération de sa conduite.
Et pourtant les provocations n’ont pas manqué ; et pourtant le gouvernement n’a cessé, par les moyens les plus honteux, de tenter l’essai du plus épouvantable des crimes : la guerre civile.
Il a calomnié Paris et a ameuté contre lui la province.
Il a amené contre nous nos frères de l’armée qu’il a fait mourir de froid sur nos places, tandis que leurs foyers les attendaient.
Il a voulu vous imposer un général en chef.
Il a, par des tentatives nocturnes, tenté de nous désarmer de nos canons, après avoir été empêché par nous de les livrer aux Prussiens.
Il a enfin, avec le concours de ses complices effarés de Bordeaux, dit à Paris : « Tu viens de te montrer héroïque ; or nous avons peur de toi, donc nous t’arrachons ta couronne de capitale. »
Qu’a fait le comité central pour répondre à ces attaques ? Il a fondé la fédération ; il a prêché la modération – disons le mot – la générosité ; au moment où l’attaque armée commençait, il disait à tous : « Jamais d’agression, et ne ripostez qu’à la dernière extrémité ! »
Il a appelé à lui toutes les intelligences, toutes les capacités ; il a demandé le concours du corps d’officiers ; il a ouvert sa porte chaque fois que l’on y frappait au nom de la république.
De quel côté étaient donc le droit et la justice ? De quel côté était la mauvaise foi ?
Cette histoire est trop courte et trop près de nous pour que chacun ne l’ait pas encore à la mémoire. Si nous l’écrivons à la veille du jour où nous allons nous retirer, c’est, nous le répétons, pour les honnêtes gens qui ont accepté légèrement des calomnies dignes seulement de ceux qui les avaient lancées.
Un des plus grands sujets de colère de ces derniers contre nous est l’obscurité de nos noms. Hélas ! bien des noms étaient connus, très connus, et cette notoriété nous a été bien fatale !…
Voulez-vous connaître un des derniers moyens qu’ils ont employés contre nous ? Ils refusent du pain aux troupes qui ont mieux aimé se laisser désarmer que de tirer sur le peuple. Et ils nous appellent assassins, eux qui punissent le refus d’assassinat par la faim !
D’abord, nous le disons avec indignation : la boue sanglante dont on essaye de flétrir notre honneur est une ignoble infamie. Jamais un arrêt d’exécution n’a été signé par nous ; jamais la garde nationale n’a pris part à l’exécution d’un crime.
Quel intérêt y aurait-elle ? Quel intérêt y aurions-nous ?
C’est aussi absurde qu’infâme.
Au surplus, il est presque honteux de nous défendre. Notre conduite montre, en définitive, ce que nous sommes. Avons-nous brigué des traitements ou des honneurs ? Si nous sommes inconnus, ayant pu obtenir, comme nous l’avons fait, la confiance de deux cent quinze bataillons, n’est-ce pas parce que nous avons dédaigné de nous faire une propagande ? La notoriété s’obtient à bon marché : quelques phrases creuses ou un peu de lâcheté suffit ; un passé tout récent l’a prouvé.
Nous, chargés d’un mandat qui faisait peser sur nos têtes une terrible responsabilité, nous l’avons accompli sans hésitation, sans peur, et dès que nous voici arrivés au but, nous disons au peuple qui nous a assez estimés pour écouter nos avis, qui ont souvent froissé son impatience : « Voici le mandat que tu nous as confié : là où notre intérêt personnel commencerait, notre devoir finit ; fais ta volonté. Mon maître, tu t’es fait libre. Obscurs il y a quelques jours, nous allons rentrer obscurs dans tes rangs, et montrer aux gouvernants que l’on peut descendre, la tête haute, les marches de ton hôtel de ville, avec la certitude de trouver au bas l’étreinte de ta loyale et robuste main. »
Les membres du comité central,
ANT. ARNAUD, ASSI, BILLIORAY, FERRAT, BABICK, ÉD. MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIER, LAVALETTE, FR. JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLIER, HENRI FORTUNÉ, G. ARNOLD, VIARD, BLANCHET, J. GROLLARD, BAUROUD, H. GÉRESME, FABRE, POUGERET, BOUIT.
AU PEUPLE.
Citoyens,
Le peuple de Paris a secoué le joug qu’on essayait de lui imposer.
Calme, impassible dans sa force, il a attendu, sans crainte comme sans provocation, les fous éhontés qui voulaient toucher à la république.
Cette fois, nos frères de l’armée n’ont pas voulu porter la main sur l’arche sainte de nos libertés. Merci à tous, et que Paris et la France jettent ensemble les bases d’une république acclamée avec toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui fermera pour toujours l’ère des invasions et des guerres civiles.
L’état de siège est levé.
Le peuple de Paris est convoqué dans ses sections pour faire ses élections communales.
La sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la garde nationale.
Hôtel de ville de Paris, ce 19 mars 1871,
Le comité central de la garde nationale,
ASSI, BILLIORAY, FERRAT, BABICK, ÉD. MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIER, LAVALETTE, FR. JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLIER, BLANCHET, J. GROLLARD, BARROUD, H. GÉRESME, FABRE, POUGERET.
Le comité central de la garde nationale,
Considérant :
Qu’il y a urgence de constituer immédiatement l’administration communale de la ville de Paris,
ARRÊTE :
1° Les élections du conseil communal de la ville de Paris auront lieu mercredi prochain, 22 mars.
2° Le vote se fera au scrutin de liste et par arrondissement.
Chaque arrondissement nommera un conseiller par chaque vingt mille habitants ou fraction excédante de plus de dix mille.
3° Le scrutin sera ouvert de 8 heures du matin à 6 heures du soir. Le dépouillement aura lieu immédiatement.
4° Les municipalités des vingt arrondissements sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Un avis ultérieur indiquera le nombre de conseillers à élire par arrondissement.
Hôtel de ville de Paris, ce 19 mars 1871.
Le comité central de la garde nationale,
ASSI, BILLIORAY, FERRAT, BABICK, ÉDOUARD MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIER, LAVALETTE, FR. JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLIER, BLANCHET, J. GROLLARD, BARROUD, H. GERESME, FABRE, POUGERET, BOUIT, VIARD, ANT. ARNAUD.
CITOYENS DE PARIS,
Dans trois jours vous serez appelés, en toute liberté, à nommer la municipalité parisienne. Alors ceux qui, par nécessité urgente, occupent le pouvoir déposeront leurs titres provisoires entre les mains des élus du peuple.
Il y a en outre une décision importante que nous devons prendre immédiatement : c’est celle relative au traité de paix.
Nous déclarons, dès à présent, être fermement décidés à faire respecter ces préliminaires, afin d’arriver à sauvegarder à la fois le salut de la France républicaine et de la paix générale.
Le délégué du gouvernement au ministère de l’intérieur,
V. GRÊLIER.
AUX GARDES NATIONAUX DE PARIS.
Citoyens,
Vous nous aviez chargés d’organiser la défense de Paris et de vos droits.
Nous avons conscience d’avoir rempli cette mission : aidés par votre généreux courage et votre admirable sang-froid, nous avons chassé ce gouvernement qui nous trahissait.
À ce moment, notre mandat est expiré, et nous vous le rapportons, car nous ne prétendons pas prendre la place de ceux que le souffle populaire vient de renverser.
Préparez donc et faites de suite vos élections communales, et donnez-nous pour récompense, la seule que nous ayons jamais espérée : celle de vous voir établir la véritable république.
En attendant, nous conservons, au nom du peuple, l’hôtel de ville.
Hôtel de ville de Paris, ce 19 mars 1871.
Le comité central de la garde nationale,
ASSI, BILLIORAY, FERRAT, BABICK, ÉDOUARD MOREAU, C. DUPONT, VARLIN, BOURSIER, MORTIER, GOUHIER, LAVALETTE, FR. JOURDE, ROUSSEAU, CH. LULLIER, BLANCHET, J. GROLLARD, BARROUD, H. GÉRESME, FABRE, POUGERET.
COMITÉ CENTRAL DE LA GARDE NATIONALE.