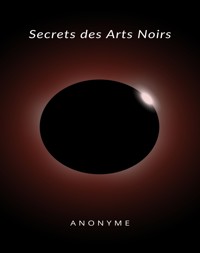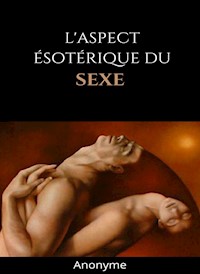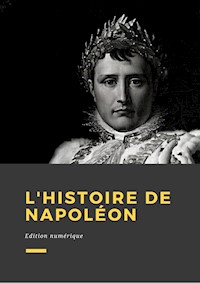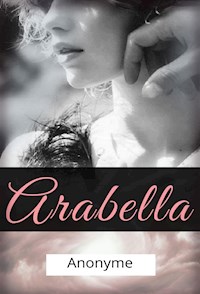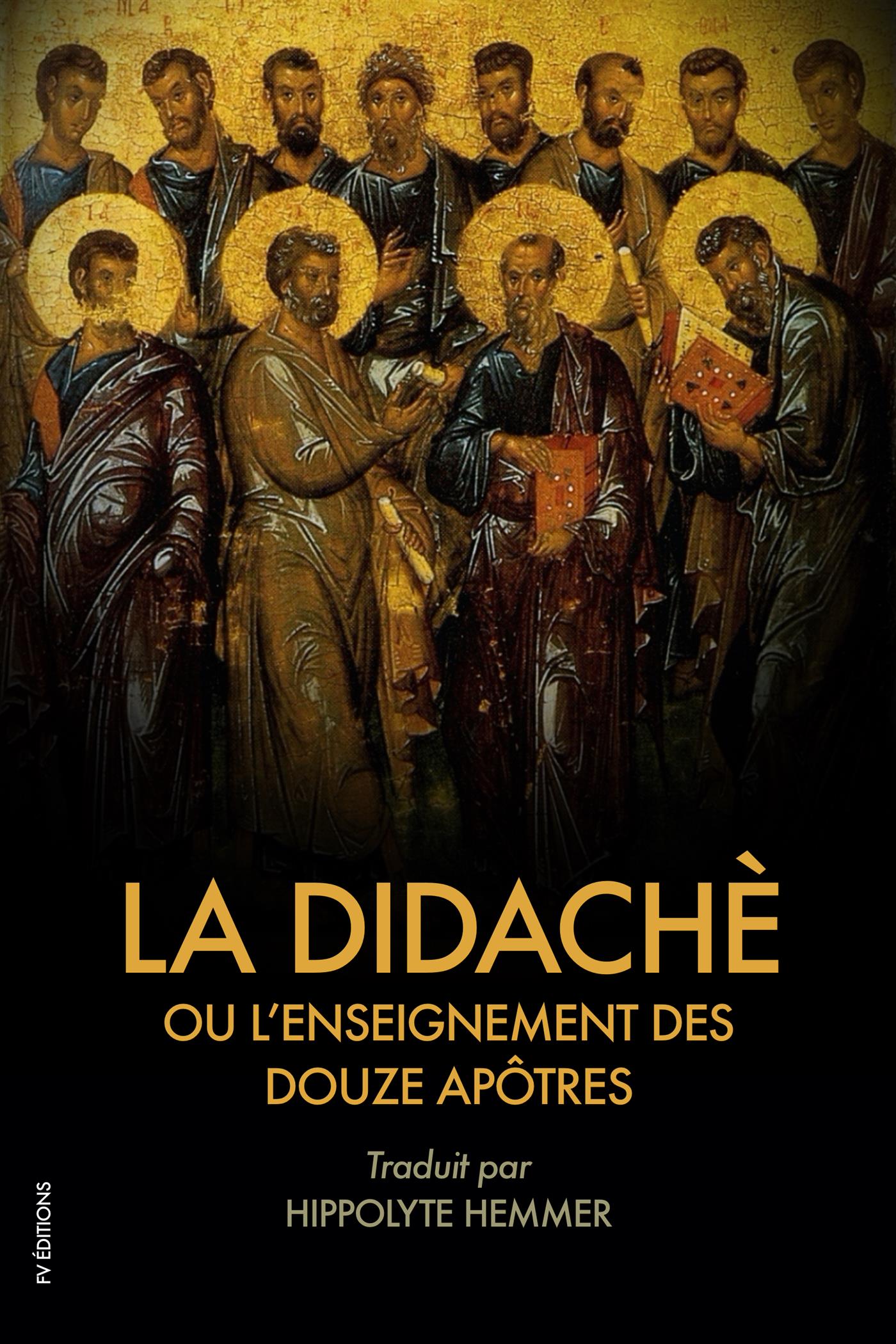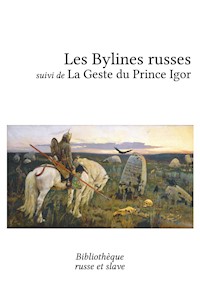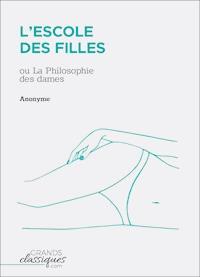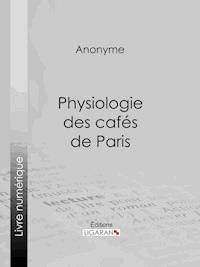19,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Arrivé à Madagascar en 1896 comme gouverneur général, Gallieni (1849-1916) entreprend immédiatement de mettre de l'ordre dans la jeune colonie, avec des méthodes que l'on qualifiera (prudemment) de musclées. Après moins de deux ans sous son administration, il entreprend, du 2 juin au 8 octobre 1898, un grand tour de l'île afin de vérifier, et si besoin est de consolider, les résultats de la «pacification». Dans sa suite, un officier dont le nom ne nous est pas parvenu relate le voyage (signé X?). Son récit tient évidemment de l'hagiographie : le général Gallieni est accueilli partout sous des arcs de triomphe aux accents de la Marseillaise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anonyme
Voyage du général Gallieni: Cinq mois autour de Madagascar
table des matières
Le général Gallieni a, pendant les mois de juin, juillet, août et septembre 1898, fait le tour de Madagascar, afin de résoudre sur place un certain nombre de questions d’ordre militaire, administratif ou économique. C’est le récit de cet intéressant voyage, écrit par un des officiers qui accompagnaient le général, que nous publions.
I DE TANANARIVE À ANKAZOBÉ. Départ de Tananarive. – Les bourjanes et le filanzane. – Les Fahavalos. – Ranavalo III. – Le 4 e territoire militaire. – Arrivée à Fihaonana. – L’École de Fihaonana. – Ankazobé et ses constructions, son école professionnelle, sa ferme-école. – Le zèle religieux de Rakotomanga.
Le 2 juin 1898, le général Gallieni quittait Tananarive pour aller inspecter les provinces du littoral, se rendre compte de l’état d’avancement des grandes voies de communication en construction, route de Tananarive à Majunga et de Tananarive à Tamatave, etc., et s’efforcer de dissiper le malentendu qui retenait encore éloignées de nous certaines populations de l’Ouest et du Sud-Ouest. On pouvait compter que le voyage du général Gallieni se prolongerait au moins trois ou quatre mois. Aussi le général, afin de pouvoir pendant ce long voyage continuer à diriger toutes les affaires de l’île et résoudre sur-le-champ les questions pendantes ou qui se présenteraient en cours de route, emmenait-il avec lui un personnel relativement nombreux : son officier d’ordonnance, le lieutenant Martin, deux officiers d’étatmajor (le capitaine Hellot, du génie, et le capitaine Nèple, de l’infanterie de marine), l’administrateur adjoint Guyon, et l’administrateur-interprète Berthier. Après cette présentation, nous pouvons, si le lecteur veut bien nous le permettre, monter en filanzane 1. Donc, le 2 juin, par un bel après-midi d’automne, nous quittons Tananarive au milieu d’une foule immense d’indigènes qui, rangés sur les côtés des rues jusqu’aux dernières maisons de la ville, acclament le général à son passage, chantant, battant des mains en cadence suivant la coutume malgache.
Un nombre considérable de colons, de fonctionnaires, d’officiers, ont tenu à accompagner le général. Mais déjà, les bourjanes accélérant l’allure, le nombreux cortège défile au grand pas gymnastique entre les haies pressées de la foule des indigènes chantant, applaudissant, criant au milieu du brouhaha des bourjanes et de la cohue des filanzanes qui s’atteignent, se dépassent, se croisent, s’entre-croisent, se poussent, se heurtent, se choquent, ou parfois s’arrêtent brusquement au détriment de l’équilibre du voyageur prudemment cramponné aux brancards, à travers les lazzis des porteurs qui, pressés, tiraillés, rejetés, bousculés, souvent même tamponnés par le filanzane qui les suit, ne perdent pas pour si peu leur bonne humeur ni leur entrain. C’est une véritable course folle de chevaux échappés. Chaque équipe veut en effet que son vazaha 2 soit au premier rang et n’a pas de cesse qu’elle n’y soit arrivée, jouant des coudes ou se glissant, se faufilant, s’intercalant, chevauchant même à demi sur les filanzanes voisins ou même fréquemment descendant dans le fossé, le plus souvent, il est vrai, involontairement. Ni la chaleur, ni la poussière, ni l’encombrement, ni la bousculade, ni les « mora, mora » 1 répétés sur tous les tons, ni les objurgations désespérées du vazaha n’y peuvent rien. À la fin, celui-ci résigné, impuissant, mais solidement fixé aux brancards, prend le parti de s’abandonner entièrement à la grâce de Dieu et à l’habileté de ses bourjanes au milieu de ce flot humain que ne retient plus nulle digue, et à la vérité c’est ce qu’il y a de mieux à faire, car s’il y a quelques horions à recevoir, le brave bourjane les prend à son compte et le vazaha en sort toujours indemne.
1 On sait que le filanzane n’est autre chose qu’une chaise à porteurs, un siège à dossier fixé entre deux brancards dont les extrémités reposent sur les épaules de quatre indigènes. Ces porteurs ainsi que ceux des bagages sont appelés bourjanes. Pour de longs trajets on affecte à chaque filanzane deux ou même trois équipes de quatre porteurs qui se relaient à leur guise.
2 Son blanc, son Européen.Race précieuse que ce bourjane, honnête, dévoué et infatigable, qui avec son chapeau de paille, sa chemise en rabane et sa cuiller dans le dos, parcourt la grande île dans tous les sens en des randonnées fantastiques sous tous les climats, plateaux glacés des hautes régions, ou terres brûlantes du Bouéni et du Betsiriry, par tous les temps et sous toutes les intempéries, au milieu des rafales violentes qui balaient éternellement les plateaux, comme à travers les orages épouvantables qui, pendant l’hivernage, fondent sur les sommets ou grondent avec fracas dans les gorges, jetant sur le pays la foudre et le déluge. Au milieu de tout cela, l’humble bourjane, enfant perdu dans l’immensité de la grande île, transporte fidèlement, sur n’importe quel point et par n’importe quel temps, le blanc qui s’est confié à lui, vivant de quelques centimes de riz ou de racines arrosées d’eau claire et couchant le plus souvent à la belle étoile, sans autre literie que le sol durci par le soleil ou détrempé par la pluie. Aujourd’hui, c’est pour un voyage de plus de quatre mois, sur terre et sur mer, à travers des régions inconnues que ces bourjanes partent gais, pleins d’entrain, insouciants du lendemain et n’ayant pour tout effet, de rechange ou autre, que le complet que nous avons dit plus haut : chapeau de paille et chemise de rabane. N’est-ce pas là la chemise de l’homme heureux de je ne sais plus quel conte ? Cependant nous arrivons aux dernières maisons du village d’Andohatapenaka, faubourg extrême de Tananarive. Un grand nombre de colons et de fonctionnaires prennent alors congé du général, qui les remercie et leur serre la main en leur disant adieu. Puis nous nous engageons sur la longue digue qui borde la rive droite de l’Ikopa. Une heure après, nous atteignons la limite du secteur d’Ambohidratrimo, que marque un arc de triomphe et où le général se sépare des derniers officiers et fonctionnaires qui l’ont accompagné. Le temps est superbe, et tandis que le soleil lentement disparaît à l’horizon dans un lit de pourpre et d’or, la brise du soir, douce, pure, vivifiante, s’élève et vient nous caresser le visage. Les habitants des localités voisines, accourus en foule sur le passage du général forment, avec ceux d’Ambohidratrimo, une longue haie double à l’entrée du village. Hommes, femmes, enfants, tous ont revêtu leurs plus beaux habits de fête ; et tout ce monde souhaite à sa façon la bienvenue au chef de la colonie, battant des mains en cadence et répétant un refrain à la louange du général. Ce n’est pas tout : le fok’olona1 a dressé d’élégants arcs de triomphe ornés de feuillage et de drapeaux et auxquels pendent les fruits les plus appétissants, oranges, bananes, ananas, etc., que le bourjane altéré déjà guigne de l’œil. La tentation est trop forte ; aussi, à peine le général les a-t-il dépassés, assailli maintenant par une pluie de fleurs, que nos porteurs font des bonds invraisemblables pour les atteindre, au risque d’entraîner l’écroulement de tout l’arc sur les derniers filanzanes. Ainsi, au général les fleurs, aux bourjanes les fruits. Et toute la foule de courir se reformer de nouveau en avant dans une course folle à travers champs, au milieu des rires, des plaisanteries, des chocs et des chutes. Tout cela vit, est animé, et combien cet accueil empreint d’une gaieté si franche, d’un empressement si spontané, diffère de notre enthousiasme officiel, de nos réceptions guindées si uniformes avec nos habits noirs et également pareilles, qu’il s’agisse de la venue du chef de l’État, d’un enterrement ou d’un mariage.
1 Doucement, doucement. 1 La communauté, les gens du village, le corps du village.Nous retrouverons d’ailleurs cet accueil tout le long de la route, avec accompagnement de fanfares ou d’orchestres dans les centres importants, de modestes accordéons dans les localités secondaires, mais toujours aussi empressé, aussi chaleureux, quelque petite que soit la bourgade traversée.
Franchement, ce peuple ne s’accommode pas trop mal du nouveau régime, et il semble qu’un plébiscite ne laisserait aucun doute à cet égard.
Quel changement depuis moins de deux ans dans cette partie de l’Émyrne, quel progrès surtout au point de vue politique ! Pour s’en faire une idée il faut se représenter que ce village d’Ambohidratrimo était, à la fin de 1896, le poste extrême occupé par nos troupes dans cette direction et chef-lieu de cercle militaire. Et même en août et septembre de cette année, la zone comprise entre Ambohidratrimo et Tananarive, c’est-à-dire la banlieue de la capitale, n’était qu’imparfaitement protégée, puisque dans le courant du mois d’août un faubourg de Tananarive était en partie brûlé par les Fahavalos 1 et que, dans les premiers jours de septembre, une bande venant de l’Ouest faisait irruption dans un village à moins de 5 kilomètres de Tananarive, incendiant un temple et un hameau. On peut évaluer à 10 000 au moins le nombre des indigènes qui, pour cette seule partie du 3 e territoire actuel, se trouvaient à cette époque dans les camps de la rébellion, ayant abandonné leurs villages. L’année dernière même, dans les premiers jours d’avril 1897, une attaque générale était résolue par les insurgés. Un groupe de 80 rebelles parvenait à s’emparer d’un important village et l’occupait jusqu’à l’arrivée de quelques soldats d’infanterie de marine accourus du sanatorium voisin, où ils se trouvaient en convalescence. Une battue générale, exécutée aussitôt, exterminait presque entièrement cette bande, ainsi qu’une autre qui la suivait à un jour de marche. Aujourd’hui, ce pays, comme toute l’Émyrne, et même la plus grande partie de l’île, est aussi sûr que n’importe quel endroit de France, au point qu’une personne isolée peut y voyager aussi bien de nuit que de jour sans la moindre arme.
1 Le mot Fahavalos signifie, comme on le sait, voleurs à main armée, brigands, ennemis ; il s’applique plus particulièrement aux rassemblements armés ayant le vol pour mobile et résistant aux agents de l’autorité. Dans ces derniers temps, on a appelé Fahavalos tous les indigènes, armés ou non qui, refusant de reconnaître notre autorité, tenaient la brousse ou la forêt.
C’est à petite distance de notre route, derrière le rideau formé par les collines voisines, que s’élève le hameau de Fenoarivo, aujourd’hui appelé Manjakazafy, où naquit Ranavalo III en 1862. On ne connaît pas au juste le mobile qui détermina le tout-puissant premier ministre Rainilaiarivony à la choisir comme reine et comme épouse en 1883, à la mort de Ranavalo II, dont elle n’était qu’une parente éloignée. D’après les témoignages recueillis, la raison de ce choix, qui ne laissa pas de surprendre, serait, soit la parfaite nullité de la princesse, soit un caprice qu’elle aurait su faire naître chez Rainilaiarivony. Les mauvaises langues d’aujourd’hui prétendent que la première explication serait la plus plausible. Toujours est-il que Ratrimo, premier mari de la princesse et frère du prince Ramahatra, mourut en temps opportun. On sait comment le général Gallieni mit fin à cette situation équivoque, incompatible avec les droits et la dignité de la France, d’une reine en pleine colonie française, excitant et faisant exciter ses sujets à la révolte contre notre autorité et au massacre de nos nationaux. Le 28 février 1897, Ranavalo III était exilée à la Réunion, où, suivie de plusieurs membres de sa famille et débarrassée d’un sceptre beaucoup trop lourd pour elle, elle a vécu très heureuse d’une pension de 25 000 francs que lui assurait la colonie de Madagascar, jusqu’au jour où on la déporta en Algérie au commencement de 1899.
Bientôt nous atteignons la limite entre le 3 e et le 4 e territoires militaires. Le commandant du 4 e territoire, son officier adjoint et le commandant du secteur sur lequel nous entrons, y attendent le général. C’est d’abord le lieutenant-colonel Lyautey, un de nos plus brillants officiers de cavalerie, breveté d’étatmajor, devenu, depuis le Tonkin colonial passionné (qui ne le deviendrait avec le général Gallieni !) et dont l’activité trouve à peine un aliment suffisant dans son vaste territoire, plus grand que 20 de nos départements de France. Son adjoint, le jeune lieutenant Grüss, de l’infanterie de marine, Herr Grüss, comme nous l’appelons familièrement, est un officier d’avenir doublé d’un charmant garçon. Quant au commandant du secteur, le capitaine Freystætter, également de l’infanterie de marine, il a pris une part brillante à l’expédition de 1895 et à la répression de l’insurrection de 1896-1897, ce qui lui a valu la rosette d’officier de la Légion d’honneur.
Nous arrivons ensuite à la fertile vallée de Moriandro, riche en rizières et appelée à un certain avenir. Cette vallée, en effet, est desservie par d’excellentes communications. Sa situation si avantageuse ne pouvait échapper au commandant du secteur, dont la ténacité a fini par avoir raison de l’apathie des indigènes. Grâce à ses efforts persévérants, non seulement toutes les anciennes rizières ont été remises en culture, mais encore par des travaux d’assèchement bien compris, plus de 100 hectares ont été conquis sur les marais et convertis en rizières. De plus, les habitants que nous interrogeons le long de la route nous affirment que la dernière récolte a dépassé comme rapport tout ce que l’on avait vu jusqu’alors.
La foule nombreuse qui fait escorte au général se déroule en longs lacets, offrant avec ses lambas blancs et ses robes aux couleurs voyantes un aspect des plus pittoresques.
Un peu avant d’arriver à Ampanotokana, nous traversons un marché créé récemment par le commandant du secteur et au sortir duquel un tombeau indigène attire notre attention. Comme tous les tombeaux de l’Émyrne, c’est une masse carrée revêtue d’assez belles pierres ; sur la face qui regarde la route, le destinataire a eu l’idée au moins originale d’inscrire à côté de son nom le prix déboursé pour cette dernière demeure : 2 500 francs. Excusez du peu ! Double satisfaction non seulement d’avoir bien fait les choses, mais encore d’avoir fait que nul n’en ignore. Vraiment ce petit trait peint bien l’un des côtés du caractère malgache.
Après avoir déjeuné à Ampanotokana, ce qui nous permet d’apprécier les produits de la laiterie-fromagerie du capitaine Freystætter, nous continuons sur Fihaonana. Le pays, encore assez peuplé jusqu’à Ampanotokana, ne tarde pas à devenir complètement désert en même temps que les arbres se font de plus en plus rares. Sans doute c’est toujours la même succession de mamelons au sol rougeâtre, mais les villages maintenant n’apparaissent que de loin en loin, et les arbres ne sont guère plus nombreux que les villages . Cà et là quelques rares bouquets couronnent une crête, mais souvent aussi c’est un arbre complètement isolé qui profile sa silhouette à l’horizon. Plus ou presque plus de cultures, seulement quelques rizières dans les fonds . Tous ces mamelons sont uniformément recouverts d’une graminée peu élevée, mais touffus, rappelant l’alfa d’Algérie et constituant l’unique fourrage des bestiaux . Bref, ce sont les paysages lunaires qui commencent, pour nous accompagner jusqu’au Bouéni .
Cependant nous arrivons à hauteur de Babay, ancien cheflieu du cercle, transféré aujourd’hui à Ankazobé, et qui n’est plus occupé. Les habitants sont descendus de leur nid d’aigle au-devant du Général et le précèdent en chantant et battant des mains. C’est avec plaisir que nous voyons en parfait état la pépinière créée sur le versant Nord de la montagne par les soldats de l’ancien poste.
Je n’ai pas besoin de dire, à ce propos, que cette si importante question du reboisement ou du boisement (car il y a deux écoles) a, dès le début, été l’objet des préoccupations et surtout d’instructions très précises du Général, instructions dont l’effet commence déjà à être appréciable . J’ajouterai que cette partie de la route a par les soins du commandant du secteur été bordée de jeunes plants de lilas de Perse, essence, qui avec l’eucalyptus croît le plus rapidement. La route nous mène enfin à la limite du secteur de Fihaonana. Là nous trouvons une foule considérable d’habitants de ce nouveau secteur accourus au-devant du général. Un groupe assez important de partisans, le ruban tricolore au chapeau, forme la haie en présentant les armes. Le général est reçu par le commandant du secteur, le lieutenant Edighoffen, officier d’un réel mérite, agissant plus qu’il ne parle, et par le sous-gouverneur indigène M. Paul Ratsimiabe, qui porte avec une véritable distinction l’habit noir et la cravate blanche. Paul, comme, on l’appelle d’habitude, n’est d’ailleurs pas le premier venu, on va s’en convaincre. Après avoir suivi les cours de l’école militaire de Saint-Maixent et même fait un stage comme officier de réserve dans un régiment d’infanterie du Midi, il occupait à la cour de Ranavalo III une situation privilégiée, tout à fait privilégiée même. Aide de camp de la reine, il en partageait les bonnes grâces et même, dit-on, les faveurs avec son frère Philippe Razafinmandimby, également aide de camp et ancien élève de SaintMaixent.
Une petite intrigue de cour faillit peu de temps après notre entrée à Tananarive lui coûter cher. Mais fort heureusement pour lui, il en fut quitte pour méditer pendant quelques jours à huis clos sur le danger des délations vraies ou fausses. Rendu à la liberté, il fut envoyé en France avec mission de remettre au Président de la République l’étoile de Radama, une étoile qui de nos jours a bien pâli. Mais il en est de cela comme de beaucoup d’autres choses. Je suis du moins heureux de pouvoir dire que Paul est demeuré un parfait gentleman dont j’ai apprécié le tact et l’intelligence. Mais le plus piquant de son histoire est assurément de se retrouver aujourd’hui sous les ordres de son ancien camarade de Saint-Maixent, le lieutenant Edighoffen, qui y suivait les cours en même temps que lui.
La fanfare de Fihaonana, que dirige un soldat d’infanterie de marine, est également à son poste et salue le général d’une Marseillaise enlevée avec une maestria à nulle autre pareille. Puis le cortège se remet en marche aux sons du « Père la Victoire », qu’accompagnent les acclamations et les chants de la foule. Cette foule de plusieurs milliers d’indigènes, tous munis de chapeaux tricolores et dévalant au grand pas gymnastique sur les lacets de la route, présente un coup d’œil vraiment original. À l’arrivée à Fihaonana, dont le nom signifie « rencontre, assemblée », nouveau concours de population en habits de fête qui acclame le général en agitant des milliers de drapeaux tricolores pendant que la musique, qui se retrouve là je ne sais par quel miracle, attaque à pleins poumons une deuxième Marseillaise. Bis repetita placent.
Sans perdre un instant et à peine descendu de filanzane, le général, comme toujours, visite les écoles, interroge les enfants, parcourt le village, se fait présenter les autorités indigènes, etc.
Il se montre très satisfait des progrès réalisés depuis sa dernière tournée (février 1898) par les enfants des deux sexes dans l’étude du français, sous la direction du soldat d’infanterie de marine Briat, transformé en instituteur. Aussi leur fait-il remettre de nombreuses gratifications. Vraiment l’on se croirait dans une école de France en voyant tout ce petit monde habillé à l’européenne, d’un côté les fillettes dansant des rondes en chantant, de l’autre les petits garçons jouant au saut de mouton, ou grimpant aux agrès d’un gymnase rudimentaire. Et tout cela vit, est gai, animé, respire la santé et l’aisance. Comme il est loin le temps où toute cette population errait en haillons à travers les forêts, mourant de misère et de faim ! Se pourrait-il que cette foule regrettât cette période de désolation et de mort ? Mais ce qui est réellement surprenant, ce sont les divers exercices d’assouplissement et de boxe exécutés au sifflet avec une correction et un ensemble parfaits par les garçons (dont quelques-uns sont de véritables bambins), réunissant dans leur costume uniforme les trois couleurs nationales, béret bleu, veston blanc et culotte rouge. Les mouvements aux agrès sont également bien enlevés. En vérité ce minuscule bataillon scolaire de Fihaonana ne le cède en rien à nombre de nos sociétés de gymnastique de France.
Le général visite ensuite le poste d’infanterie de marine, le casernement de la milice, ainsi que toutes les constructions et créations. C’est merveille de voir tout ce qui a été fait depuis notre occupation. Il faut dire, en effet, qu’au moment de l’arrivée de nos troupes à Fihaonana pas une seule case ne restait debout : le village entier, incendié par les Fahavalos, n’était plus qu’un amas de ruines encore fumantes. La presque totalité des habitants était passée de gré ou de force aux rebelles, enfin la région dévastée, désolée, et aux trois quarts déserte, ne présentait plus aucune sécurité. Aujourd’hui, non seulement toutes ces ruines ont été relevées, mais un grand nombre de constructions nouvelles ont été édifiées. Routes, jardins, pépinières, écoles, marchés, tout a été mené de front en même temps que la pacification et l’organisation politique et administrative du pays. C’est une véritable résurrection. Outre un élégant marché couvert qui occupe dans le village même un vaste emplacement et réunit chaque jeudi plusieurs milliers d’indigènes, Fihaonana possède maintenant une magnanerie et plusieurs fabriques de rabanes. Cette dernière industrie y était fort en honneur avant l’insurrection et les produits en étaient envoyés à Tananarive. Ce n’est pas tout : le lieutenant Edighoffen a eu l’heureuse idée d’installer dans le village un petit magasin, où un grand nombre d’articles de commerce français, toiles, cotonnades, quincaillerie, etc., sont tenus par un indigène pour le compte d’un commerçant de Tananarive. Cette petite succursale a réussi au delà de toute espérance et réalise, chaque mois, un important chiffre d’affaires. D’ailleurs, d’une manière générale, les transactions commerciales ont déjà pris une importance qu’elles n’avaient jamais eue.
De là nous descendons à la pépinière, qui se trouve dans un fond, sur les bords d’une pièce d’eau dont on a très bien su tirer parti ; ce petit lac qui n’a pas moins de 8 mètres de profondeur, entouré de jardins de tous côtés, bordé de bosquets, forme un site des plus agréables et qui rappelle nos parcs d’Europe. Parmi les plantations nous remarquons surtout un carré de caféiers du pays qui, bien abrités et bien exposés, semblent promettre une complète réussite.
Les résultats obtenus au point de vue politique ne sont pas moins importants. Ce pays, qui même avant l’insurrection était constamment exposé aux alertes, en butte non seulement aux attaques des Tontakely1, mais encore aux invasions, aux razzias des Sakalaves, jouit aujourd’hui d’une sécurité absolue ; les vols de bœufs même ont complètement cessé ; les Sakalaves n’ont plus reparu. Il est difficile de se faire une idée de la terreur qu’exerçaient ces audacieux pillards ; aussi, pour se mettre à l’abri de leurs attaques, les habitants entouraient-ils leurs villages d’immenses fossés. Tous les villages du secteur sont ainsi protégés. Le fossé de Fihaonana, en particulier, large de 3 ou 4 mètres, n’a pas moins de 7 à 8 mètres de profondeur.
Tout le pays aujourd’hui est calme, tranquille. Tous les villages ont été reconstruits et repeuplés. Partout règnent la sécurité et la confiance. Les habitants respirent enfin, libres, sans appréhension, et s’adonnent entièrement, sans crainte ni arrière-pensée, à leurs cultures. Cette soirée à Fihaonana se termine par un concert des chœurs français et malgaches et par un bal en plein air qui obtient un légitime succès. La fête prend fin par une retraite aux flambeaux à travers les allées du jardin. Tous ces lambas blancs qui glissent et serpentent sous les ombrages touffus à travers les bosquets parfumés, aux sons d’une musique bizarre, avec des chants plus bizarres encore, à la lueur de lanternes vénitiennes qui vont et viennent dans le feuillage comme de grosses lucioles, forment par cette nuit sereine, sous l’éclat argenté des premiers rayons de la lune, un tableau réellement pittoresque.
1 Tontakely, voleurs de bœufs.Après Fihaonana, les villages s’éclaircissent de plus en plus, les cultures également ; cette fois, c’est la solitude presque absolue. On croirait avoir quitté l’Émyrne. Pourtant nous sommes à peine à une cinquantaine de kilomètres de Tananarive. Le pays, du reste offre toujours le même aspect, suite sans fin de mamelons à bases larges piqués de touffes de véro1 encore tendres et vertes à cette époque de l’année. Le temps est superbe, l’air un peu frais.
La sécurité la plus complète règne aujourd’hui dans tout ce pays, et depuis longtemps les voyageurs même isolés le parcourent de nuit comme de jour sans aucune espèce d’escorte. Il serait dangereux toutefois de vouloir supprimer les quelques petits postes de trois ou quatre hommes qui assurent l’ordre et la police dans les faritanys2 ; il est même indispensable de conserver pendant un certain temps encore un petit noyau de troupes dans ce pays si profondément bouleversé pendant la dernière insurrection. Cette partie du secteur d’Ankazobé semble inhabitée. On n’y rencontre ni villages, ni cultures. C’est à peine si certains fonds présentent quelques maigres rizières. À ce moment, nous abandonnons la première route carrossable pour suivre un nouveau tracé à flanc de coteau, qui permettra d’éviter de nombreux lacets. Ce nouveau tronçon est en pleine construction. Après avoir cheminé ainsi pendant quelque temps au milieu des travailleurs, nous apercevons les cases de Sambaïna blanchies au kaolin. Les habitants accourus en foule, de fort loin sans doute, font au général une réception non moins enthousiaste que les villages précédents. Les enfants de l’école, dirigée par un soldat alsacien, ont quelque peu retenu sa prononciation ; aussi est-ce avec un accent qui n’a rien de béarnais qu’ils entonnent, accompagnés par leur maître, le chœur des montagnards : « Mondagnes Byrénées ». Nous déjeunons dans un vaste bâtiment, qui a été pour la circonstance décoré de feuillages et de fleurs par les soldats du poste et les indigènes, et nous remontons en filanzane. À petite distance de Sambaïna, on rencontre encore deux grandes cases isolées, puis plus rien. Le pays est absolument désert ; aussi loin que la vue peut s’étendre on n’aperçoit pas un village, pas un arbre, pas un oiseau, pas un animal quel qu’il soit. Cette solitude et ce silence ont quelque chose d’effrayant. La route que nous suivons, qui est la route définitive, s’écarte très sensiblement, dans cette partie du trajet, de l’ancienne piste muletière construite et employée par le corps expéditionnaire en 1895. Au lieu d’emprunter la vallée de l’Andranobé par Ambohitromby, nous suivons le faîte d’une longue croupe qui pique droit sur Ankazobé.
1 Graminée très commune qui sert de fourrage aux bestiaux. 2 Le faritany est à peu près l’équivalent du canton en France.Le principal défaut de cette région consiste dans la faible densité de la population ; les villages y sont peu importants et très clairsemés. C’est là, il est vrai, un défaut que beaucoup d’autres régions de notre nouvelle colonie partagent avec celleci. C’est même, à mon sens, le plus grand défaut de Madagascar, le plus gros obstacle qu’y rencontrera la colonisation. La grande île manque de bras, elle n’est pas suffisamment peuplée. Pour une superficie de 600 000 kilomètres carrés, la population n’atteint pas 6 000 000 d’habitants, peut-être 5 000 000 au maximum. C’est donc moins de 10 habitants par kilomètre carré, proportion tout à fait insuffisante. Seuls les environs de Tananarive, l’Ambodirano et le Betsiléo présentent une densité très satisfaisante.
Cependant nous commençons à découvrir quelques villages à gauche de la route ; puis paraissent quelques troupeaux de bœufs paissant çà et là sur les flancs des collines. Nous rentrons un peu dans le monde animé. Au loin, dans le prolongement de la route, le sommet rocheux de l’Angavo se détache dans une échancrure. Bientôt même nous devinons Ankazobé assis dans l’ombre au pied de l’Angavo. Toutefois le chef-lieu est encore loin, et nos bourjanes ont encore à jouer des tibias avant d’en admirer les splendeurs. Mais voilà que tout à coup, à un tournant du chemin, paraît une fort jolie charrette anglaise qui arrive sur nous au grand trot d’une belle jument noire. Nous serrons la main à cet excellent camarade Détrie, qui rentre à peine d’une tournée dans la brousse vers l’ouest du territoire. Puis le colonel repart avec lui toujours au grand trot pour donner ses derniers ordres à Ankazobé. Déjà commence la descente sur l’Andranobé.
À leur tour nos bourjanes, stimulés par la vue de l’équipage qui file à fond de train, détalent à une allure des plus vives. Après trois quarts d’heure environ de cette course folle nous arrivons sains et saufs au grand pont de l’Andranobé, beau travail élégant et solide exécuté par le garde d’artillerie de marine Rebuffat. De là, quelques minutes suffisent pour gravir le plateau sur lequel est construit Ankazobé, où le général fait son entrée aux salves d’artillerie, aux acclamations de plusieurs milliers d’indigènes rangés des deux côtés de la grande avenue jusqu’à un arc de triomphe.
Au delà, les troupes et la milice formant la haie rendent les honneurs, tandis que les clairons sonnent aux champs et que la musique malgache joue la Marseillaise. Tous les bâtiments, jusqu’aux plus humbles cases, sont décorés d’une véritable profusion de drapeaux tricolores. En outre, des guirlandes de petits drapeaux et de bannières, tendues tout le long du village d’un côté à l’autre de la vaste avenue, produisent un très heureux effet.
Ankazobé est très bien sous cette parure de fête. Le village, disons mieux, la petite ville d’Ankazobé, a été construit d’après un plan vaste. Percé de larges avenues, présentant déjà quelques belles constructions, telles que le logement du commandant du territoire, du commandant du cercle, le bureau de poste, la gérance d’annexe, l’infirmerie, l’école professionnelle, la maison des passagers, etc., le chef-lieu du 4 e territoire a grand air. Combien il semble loin le temps où le capitaine Nicard prenait possession, sous le feu des révoltés, des ruines de l’ancien poste hova d’Ankazobé, après le meurtre du gouverneur du Vonizongo ! Tout cela cependant ne date pas encore de deux ans. Vingtdeux mois à peine se sont écoulés depuis cette époque sinistre, et déjà, sur cet emplacement qui n’était qu’une ruine fumante et ensanglantée, s’élèvent de belles et spacieuses habitations. Les habitants disséminés aux quatre coins du territoire, fuyant devant la mort et la désolation, sont revenus rassurés, confiants et plus nombreux qu’avant l’insurrection. Des routes ont été construites, des écoles créées, dont une école professionnelle qui, réduction de celle de Tananarive, forme, sous la direction de quelques soldats européens, des charpentiers, des menuisiers, des forgerons, des ferblantiers et des peintres. Le reboisement du pays a été commencé ; sur de nombreux points, des jardins fournissent en abondance tous les légumes du pays en même temps que ceux de France. Déjà le commerce a pris un certain essor. Ce n’est pas encore tout. Le général ayant décidé de demeurer à Ankazobé toute la journée du lendemain 5, j’en profite pour me rendre à « la Ferme ». Cette ferme, autre création du commandant du territoire, est située à environ 2 kilomètres d’Ankazobé ; elle est gérée par un Français, M. Billard. Outre quelques cultures qui paraissent être en très bonne voie et un assez beau troupeau, j’y trouve, non sans quelque surprise, une laiterie bien aménagée, munie d’un matériel assez complet et fournissant déjà des produits très satisfaisants. Cet essai montre que, malgré ces vastes étendues presque complètement désertes, les exploitations agricoles pourront néanmoins tirer parti de ce cercle d’Ankazobé. La principale richesse passée et future du cercle paraît devoir être l’élevage. Nombreux sont les terrains qui pourront être utilisés pour cet objet. D’ailleurs, dans la dernière partie du trajet, entre Fihaonana et Ankazobé, nous avons pu apercevoir une certaine quantité de beaux zébus paissant tranquillement par groupes assez compacts au milieu des « véro », leur fourrage favori. Ces bovidés étaient autrefois très nombreux dans le Vonizongo. Réduits de plus de moitié par l’insurrection, les troupeaux sont aujourd’hui en bonne voie de reconstitution, grâce aux mesures prises à temps par le général, qui a vite su reconnaître que les bœufs ont toujours été et seront toujours un des principaux, sinon le principal élément de richesse de Madagascar, pays d’élevage avant tout.
Un de nos amis a baptisé Ankazobé la Versailles malgache. Il y a sans doute une petite et même une grosse pointe d’ironie dans cette appellation. Les filanzanes ne rappellent que de très loin les carrosses dorés du Roi Soleil et ni les constructions ni les arbres n’évoquent le souvenir du château et du parc où les Rois de France aimaient à séjourner. Mais vraiment, comme je le disais plus haut, la ville a grand air.
Enfin, ce qui vaut tout autant, la ville et la région qui l’entoure, hier encore théâtre de la lutte la plus acharnée, sont aujourd’hui calmes, tranquilles et absolument sûres. Partout les habitants vaquent paisiblement à leurs cultures, plus nombreuses et plus belles que jamais. Les vallées voisines fertiles et peuplées sont susceptibles de fournir d’excellents lots de colonisation…