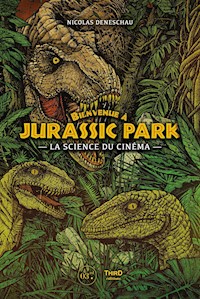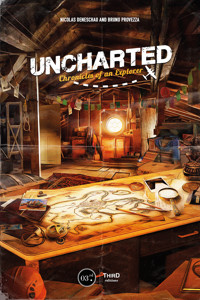Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Godzilla, à travers la trentaine de films produits entre 1954 et 2021, est devenu une figure emblématique de la culture populaire !
La première vision du Godzilla de 1954, réalisé par Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya, s'avère souvent déroutante. Bien loin de l'image pop qu'il véhicule aujourd'hui, Godzilla constituait, à ses débuts, la somme de toutes les peurs du Japon. De 1954 à nos jours, chaque film de la série Godzilla a porté les stigmates de son époque, faisant de la monstrueuse créature un précieux témoin historique du mal-être de son pays d'adoption. Dans
L'Apocalypse selon Godzilla. Le Japon et ses monstres, Nicolas Deneschau et Thomas Giorgetti décortiquent cette franchise aux multiples facettes, qui s'est réinventée à de nombreuses reprises. Des coulisses des longs-métrages aux interprétations des thématiques sociétales, cet ouvrage analytique, à la fois accessible et pointu, ravira les néophytes comme les fans les plus exigeants
Découvrez les coulisses de ces célèbres longs-métrages et les interprétations sociétales de leurs thématiques !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
黙示録1
Fumihiko est le premier à ouvrir les yeux. La nuit a été agitée, il est en nage. Il est à peine six heures du matin mais il fait déjà chaud ; dehors, les bruits de la ville résonnent. Akinaru et Keiji ne tardent pas à le rejoindre en silence jusqu’à la table basse. Derrière les fusuma2, Fumihiko devine sa mère en train de faire réchauffer le peu de haricots qu’il reste. Le goût du riz est presque un vague souvenir pour de si jeunes enfants. Fumihiko se demande même si Akinaru, sa petite sœur, en a déjà mangé.
L’école commence tôt en été, pour éviter cette insupportable chaleur moite qui colle les vêtements à la peau. Une fois les enfants préparés, Fumihiko ouvre la marche, cartable au dos. Keiji veut aller se baigner cet après-midi – ils auront peut-être l’occasion d’attraper des sauterelles. L’école se trouve à huit cents mètres à peine de chez eux. On traverse les petites ruelles serrées entre les maisons traditionnelles en bois, puis, en débouchant sur la grande rue commerçante, il faut continuer jusqu’à la petite façade et sa pancarte de bambou annonçant : Shōgakkō3.
Keiji et sa petite sœur Akinaru courent retrouver leurs amis dans la cour de récréation. Fumihiko, lui, a décidé d’attendre Motoko sous le grand préau métallique de l’école. Comme ces trois dernières semaines, il la surveille. Il n’a jamais osé lui adresser le moindre mot, mais il préfère l’épier de peur qu’un autre garçon n’ose l’aborder.
Dans la rue, des paysans poussent du bétail amaigri ; un homme d’affaires pose sa mallette, dénoue sa cravate et agrandit son col pour respirer sous une chaleur déjà pesante. Des commerçants préparent leurs étals, le regard cerné. Partout, des enfants courent pour ne pas arriver en retard. Une agitation qui offre un spectacle réjouissant aux oreilles de Fumihiko. Au loin, il aperçoit Motoko. Elle porte un petit foulard rouge. Il sourit.
Soudain, la terre tremble. Un premier coup, comme un pas lourd de géant, fait tomber l’homme d’affaires. Des vitres se brisent sous l’impact. Fumihiko est interloqué. Puis un deuxième, plus fort, énorme, cyclopéen. Partout, un vacarme assourdissant, des cris et des bruits similaires à un éboulement. Les bâtiments vibrent, se déchirent et s’effondrent. Le garçon est à terre. Il ouvre un œil et remarque que tous les passants sont comme figés dans le marbre, les yeux rivés vers le ciel. Les visages sont transformés de peur. Lui, sous le préau, ne voit pas ce qui semble interpeller tout le monde. Enfin, un rugissement. Comme un énorme râle démoniaque, bestial, colossal, inhumain. Fumihiko tourne le regard vers la fine silhouette de Motoko, mais à peine une fraction de seconde plus tard, le monde change de couleur. Une lumière incandescente irradie et inonde l’atmosphère. Un éclair monstrueux fige les regards terrorisés. Le monde s’écroule. Fumihiko perd connaissance.
Le jeune garçon ouvre les yeux. Tout son corps n’est que douleur. Des minutes, peut-être même des dizaines de minutes ont passé depuis qu’il a perdu connaissance. Il est allongé au sol sous un monceau de débris, de gravats, sous la grande tôle du préau qui s’est complètement détachée de la structure et l’a probablement assommé. Il s’extrait péniblement des morceaux de bois, de pierre et de briques de son école. Son bras le fait souffrir atrocement, un clou est planté en plein dans son biceps. La chair est déchirée. Il se lève et peine à voir quoi que ce soit dans ce magma de fumée, de poussières volantes et de chaos gris et noir.
Hagard, il fait quelques mètres en trébuchant. Le sol n’est plus. Tout n’est que débris et flammes. Il n’y a plus rien, plus d’école, plus de maisons, plus de commerces. Uniquement des ruines fumantes et noires. Les couleurs de la vie n’existent plus. Fumihiko est perdu. Sans les murs, ses repères s’estompent. Il cherche du regard la cour d’école, mais n’observe qu’un tas de ruines et de cendres. Seuls le bruit du brasier et la poussière dans ses oreilles viennent interrompre le silence.
Il trébuche à nouveau sur une masse informe, carbonisée, ornée d’un foulard dont on devine qu’il fut rouge. C’est Motoko. Il veut crier toute son horreur, mais aucun son ne sort de sa bouche. Fumihiko déambule vers la cour d’école, avant de se résigner rapidement : les flammes et la fumée lui empêchent toute progression. Que sont devenus Akinaru et Keiji ? Il doit retourner chez lui. Il s’engouffre, en se protégeant les yeux, dans une colonne de poussière qui semble être la grande rue commerçante. À quelques mètres, un enfant finit d’agoniser. Ses jambes sont deux grands morceaux de charbon. Le blanc de ses yeux mourants tranche avec le noir de son visage calciné.
Au milieu du boulevard, Fumihiko se perd encore. Plus de maisons, plus de bâtiments, tout est plat, amas de tôle, de bois brûlé, de poteaux électriques semblables à des toiles d’araignées. Deux ou trois ombres chancelantes, hébétées, gémissent à travers les volutes de poussières et de fumée. C’est l’apocalypse.
Après plusieurs minutes de déambulations insensées dans cet enfer, Fumihiko aperçoit une première âme. Une femme allongée sur le dos, en « V », au-dessus d’un amas de détritus carbonisés. Elle respire bruyamment. Son kimono est déchiré, ses cheveux gris et fumants. Il se rapproche. Elle meurt.
D’autres ombres quasi humaines, immobiles, accroupies dans des poses endolories, restent silencieuses. Personne ne semble comprendre quelle monstruosité a pu déverser une telle fureur sur la ville. Fumihiko reconnaît enfin son quartier, puis sa rue, et enfin ce qu’il reste de sa maison. Sous les décombres et les flammes, il aperçoit le kimono de sa mère. La vision qu’il a de son corps, encore respirant, le submerge d’une horreur pure, insondable. L’amas de chair, toujours doué de raison, suffoque devant lui. Écorchée vive, la peau de celle qui lui avait donné le sein était complètement retournée, comme un gant, ne tenant plus que grâce aux ongles noircis de ses mains, ballant jusqu’au sol. Les lambeaux de vêtements entortillés autour de son cou et de sa taille flottent comme des algues dans l’eau. De ses blessures suinte un sang brûlé, gris. Le regard fixe de sa mère s’éteint.
Le désespoir et l’épuisement ont finalement raison des jeunes forces de Fumihiko. Les larmes ne tombent pas. La nausée lui griffe l’estomac, il vomit un liquide jaunâtre. Il s’allonge sur le trottoir, incapable de bouger. Il fixe les volutes de fumée et les corps rampants. Quelques gouttes de pluie noire tombent sur ses joues meurtries. Finalement, ses yeux se ferment.
Ce jour-là, une créature apocalyptique a changé à jamais la vie des âmes mutilées qui peupleront ce pays. Le Japon devient une terre outragée.
Ce 6 août 1945, un jour d’été, le bombardier américain Enola Gay a largué la bombe atomique sur la ville d’Hiroshima.
« Monsieur,
Certains travaux récents d’Enrico Fermi et Léo Szilárd, dont les manuscrits m’ont été communiqués, me conduisent à prévoir que l’élément uranium peut devenir une source nouvelle et importante d’énergie dans un futur immédiat. Certains aspects de la situation qui est apparue me semblent demander une attention et, si nécessaire, une action rapide de la part de l’administration. Je pense donc qu’il est de mon devoir d’attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants.
Ces quatre derniers mois, il est devenu possible, grâce aux travaux de Joliot en France ainsi que ceux de Fermi et Szilárd en Amérique, de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d’uranium. Grâce à elle, une grande quantité d’énergie et de grandes quantités de nouveaux éléments similaires au radium pourraient être produites. Maintenant, il semble presque certain que ceci pourrait être atteint dans un très proche avenir.
Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes et il est concevable, quoique bien moins certain, que des bombes d’un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien détruire l’ensemble du port ainsi qu’une partie de la zone aux alentours. »
Lettre d’Albert Einstein à Franklin Roosevelt, président des États-Unis. Le 2 août 1939 (six ans et quatre jours avant le bombardement d’Hiroshima)
1 Apocalypse.
2 Écran opaque coulissant muni d’une poignée.
3 École primaire.
AVANT-PROPOSGODZILLA, LE LANCEUR D’ALERTE
« Le premier Godzilla que j’ai vu était un film particulièrement sombre. Il y avait un ton si dramatique, un tel sens de la tragédie… On ressentait l’oppression, la guerre, la consternation et le désespoir. C’était un film vraiment dur, et au milieu de ça, il y avait un monstre dont je suis tombé amoureux. Godzilla ne m’apparaissait pas comme un divertissement. En tant qu’enfant, je l’ai trouvé puissamment profond et touchant. »
Guillermo del Toro
La première vision du Godzilla de 1954, réalisé par Ishirō Honda et Eiji Tsuburaya, s’avère souvent déroutante. Bien loin de l’image pop qu’il véhicule aujourd’hui, le Roi des Monstres constituait, à ses débuts, la somme de toutes les peurs du Japon. Le film est une succession de tableaux pessimistes, entre le naufrage d’un navire de pêche et de leurs sauveteurs, des morts civiles successives, des scientifiques et un gouvernement perdus, la destruction d’une capitale sur fond de cauchemar apocalyptique et un final sacrificiel. Paré d’un magnifique mais morbide noir et blanc artificiellement obscurci, ainsi que de plans larges de destructions renvoyant aux pires visions d’une guerre dont les plaies, à peine neuf ans après, étaient encore bien ouvertes, Godzilla fut tourné comme une thérapie autant que comme un message d’alerte aux jeunes générations. Il délivre son sous-texte à peine voilé au travers d’un titan mutique, hideux et menaçant, mais inoubliable. Godzilla est la métaphore des névroses d’un pays dont les blessures sont encore vives.
Qu’elles soient infligées par les innombrables catastrophes naturelles ou humaines, de ses blessures, le Japon s’est toujours relevé. Néanmoins, chaque coup, chaque attaque, chaque désespérante calamité a laissé des traces et des traumatismes chez son peuple que ni le temps ni cette incroyable force de résilience n’ont jamais pu effacer.
Nous aurions pu commencer ce livre en vous parlant de l’impact prépondérant qu’a eu Godzilla, cette icône populaire du cinéma japonais, sur toute une jeunesse cinéphile, avide de combats colorés, décalés et grandiloquents. Cependant, il nous a paru indispensable de comprendre que la naissance du Roi des Monstres fut l’objet d’une dualité fataliste entre les réminiscences des cauchemars d’une société et la volonté de divertir dans la plus pure tradition du film à grand spectacle. Godzilla est né des cendres et des larmes du Japon.
Le colosse légendaire est le premier lanceur d’alerte de l’histoire du cinéma. Ses apparitions mystérieuses sont toujours l’augure d’une catastrophe imminente. Il est le messager de funestes présages : danger nucléaire, catastrophe écologique, menace capitaliste ou aveuglement scientifique. Godzilla est le prophète des plus grands changements sociétaux du Japon, mais aussi du monde occidental moderne.
La série sera l’une des licences les plus prolifiques de l’histoire du cinéma. De 1954 à nos jours, en presque soixante-dix ans d’incessants retours, chaque film a porté les stigmates de son époque, faisant de Godzilla un précieux témoin historique du mal-être de son pays d’adoption. Au fil des années, le personnage sera dévoyé à certaines tendances propres à leurs époques. De témoin apocalyptique à icône pop destinée aux plus jeunes, le monstre n’en gardera pas moins un sous-texte éminemment politique et social.
Il nous est donc apparu évident qu’avant de vous proposer de découvrir les arcanes de la création du mythe, ou même d’évoquer les créateurs et les artisans de cette saga, il fallait comprendre un pays, le Japon, et les psychoses multiples qui ont forgé l’essence même de Godzilla. Pour avoir ces indispensables clefs de compréhension, il va falloir remonter le temps et observer de l’intérieur les fastes, les tribulations, les déchéances et le destin d’une grande nation.
Les auteurs
Nicolas Deneschau
Nicolas Deneschau se nourrit de films de monstres et de romans de piraterie. Passé par la case du cinéma de genre avant de traîner sa plume sur le site d’analyse Merlanfrit.net, Nicolas collabore aujourd’hui avec Third Éditions. Il est notamment l’auteur des Mystères de Monkey Island. À l’abordage des pirates.
Thomas Giorgetti
Habitué aux cases de comics et à leurs adaptations cinématographiques qu’il décortique sur Geekzone.fr et le podcast Les Clairvoyants, Thomas fait aujourd’hui ressortir la passion pour les kaiju et le Roi des Monstres à l’occasion de cette première collaboration avec Third Éditions.
PARTIE 1JAPON, TERRE OUTRAGÉE
CHAPITRE 1 : UNE BRÈVE HISTOIRE DU JAPON
Le royaume oublié
Géographiquement, le Japon est un petit archipel perdu dans l’immensité des mers asiatiques. Ce bout de terre, dérisoire rejeton tectonique de la grande Chine, séparée par un petit millier de kilomètres, a toujours souffert de l’hégémonie totale qu’opérait l’empire Céleste sur toute l’Asie. Modestes navigateurs, les Japonais ont, pendant des siècles, dû mettre des réserves sur leurs velléités bien naturellement humaines de s’étendre et de découvrir d’autres horizons. De toute façon, à l’est, se trouve l’immensité de l’océan Pacifique, et à l’ouest, la Chine, un territoire cinquante fois plus vaste et puissant. Le Japon a donc évolué pendant quelques centaines d’années avec ce sentiment de territoire étriqué mais naturellement protégé. Malgré cela, l’hégémonie de la culture chinoise a fini par atteindre les côtes du pays du Soleil levant. Et quel impact ! Le Japon doit tout son fondement culturel à sa titanesque voisine : l’écriture en idéogrammes (les Kanjis 漢字), qui s’est intégrée tant bien que mal dans l’usage courant, la religion bouddhique originaire d’Inde mais transfigurée par la Chine, la philosophie de Confucius, l’art de l’estampe, de la laque, de la soie, de l’équitation, et même l’organisation civile et administrative sont autant d’éléments qui ont aidé à l’unification des royaumes qui composaient le Japon. Ces échanges contrôlés et timides entre les deux nations ne dupent ni l’un ni l’autre. Seul le millier de kilomètres maritimes qui les sépare empêche les Chinois de conquérir militairement l’Archipel. Au XIIIe siècle, Kubilaï Khan, petit-fils de Gengis Khan et maître divin du plus grand empire que l’histoire ait connu, cède à la tentation et envoie ses armées fortes de plus de cent soixante-dix mille hommes. Manquant d’être submergés, les Japonais ne doivent leur salut qu’aux caprices des éléments naturels. Le typhon qui s’abat, le 15 août 1281, au large de la baie d’Hakata, détruit la grande majorité des navires chinois, coréens et mongols. Cette bataille portera le nom de Koan, et le vent qui les a sauvés, le Kamikaze, deviendra le symbole national de l’intervention divine.
En 1549, c’est une autre forme d’« invasion » qu’entreprend le missionnaire jésuite portugais François-Xavier en débarquant sur Kyushu, la plus méridionale des îles du Japon, considérée comme le berceau culturel du pays. Il apporte la religion chrétienne, mais surtout les mœurs d’une civilisation mystérieuse, l’Occident. En quelques années à peine, le Japon comptera plus d’un million de fidèles à cette nouvelle croyance, sur une terre qui doit avoisiner les neuf millions d’âmes. Kyoto, la capitale, et son homme fort, Toyotomi Hideyoshi, ne voient pas ce changement de mœurs d’un bon œil. Hideyoshi alimente alors une méfiance générale, presque viscérale, vis-à-vis d’un Occident lointain, énigmatique, conquérant idéologique et néfaste pour la sérénité et l’assise du pouvoir du daimyo4. En 1587, il promulgue un édit restreignant les libertés des chrétiens puis, cinq ans plus tard, entreprend une invasion ratée de la Corée. Fin du XVIe siècle, les tentatives d’expansion échouées enferment le Japon qui se coupe presque définitivement du monde extérieur. Les répressions envers les étrangers sont violentes, et seuls quelques timides concessions commerciales avec la Chine et la Hollande demeurent. Pendant presque deux siècles, le Japon vivra en autarcie quasi complète et redeviendra un royaume oublié.
La naissance d’un empire
À partir du XVIIe siècle, les shoguns – régents militaires – de la famille Tokugawa apportent une unité et une paix civile indiscutée. C’est l’ère fastueuse du Japon, celle des samouraïs, bras armé du shogunat, qui assurent la sécurité dans le pays. C’est aussi l’assise d’une bourgeoisie naissante et d’un développement des richesses essentiellement basé sur l’agriculture dans les campagnes et l’artisanat des villes. Au début du XIXe siècle, et malgré son isolationnisme, le Japon n’a aucunement à rougir de sa prospérité. Sa population est équivalente à une grande nation occidentale, et son avancée culturelle et sociale est presque sans pareille. C’est en juillet 1853 que la fracture commence. Le commandant américain Matthew C. Perry jette l’ancre dans le port d’Edo au commandement de quatre imposants navires de guerre à vapeur. Il fait remettre une lettre du président des États-Unis à l’empereur pour négocier des voies commerciales exclusives, et promet de revenir chercher la réponse un an plus tard. En 1854, comme promis, c’est à la tête de huit navires surarmés qu’il revient et encaisse une réponse négative du Japon. Mais le mal est fait. Devant l’insistance militaire et l’imposante armada déployée, les shoguns concèdent finalement le traité de Kanagawa le 31 mars 1854, qui ouvre deux ports japonais aux Américains. Dans les années qui suivent, les traités Ansei des cinq nations (Anglais, Russes, Hollandais et Français) vont définitivement mettre un terme à l’isolationnisme du Japon.
Évidemment, cette ouverture est vue comme une invasion et une insulte à l’intégrité du Japon par les puissantes branches les plus radicalement conservatrices des samouraïs et des daimyos. Et l’Occident ne s’en cache pas. Les étrangers arrivent massivement et traitent avec une forte condescendance ce peuple aux traditions ancestrales et primitives. Les tensions montent, des échauffourées éclatent et le shogunat est sérieusement ébranlé. Le 3 janvier 1868, un coup d’État est lancé sur le palais impérial de Kyoto et le jeune empereur Mutsuhito, âgé de quatorze ans, est mis sur le trône. Il ouvre l’ère « Meiji » (le règne éclairé). Pour la première fois, l’empereur n’est plus un simple symbole déléguant la politique à ses shoguns, il devient un chef politique réel. Cette « Ishiin » (renaissance) du pouvoir centralisé va se travestir avec l’époque moderne ainsi que l’arrêt de traditions violentes et ancestrales déléguées aux vassaux. L’ère Meiji devient la réelle fusion entre efficacité, richesse nationaliste du Japon et modernité sous l’égide d’un maître quasi divin, l’empereur. D’État féodal, le Japon passe à État national sans transition et sans révolution.
En 1873, les samouraïs, pourtant à l’initiative du coup d’État, disparaissent et un service militaire obligatoire de trois ans est mis en place. Parallèlement à la création d’un ministère de l’Industrie en 1870, d’innombrables initiatives privées font exploser les avancées techniques du pays avec enthousiasme. Le chemin de fer fait son apparition et le costume occidental devient l’apparat officiel de la cour. En marge, le développement d’une véritable armée régulière et d’un attirail militaire est évidemment à l’ordre du jour. En 1874, le Japon lorgne plus que jamais sur les autres îles du Pacifique, se sentant à l’étroit sur son petit territoire. L’armée envahit l’Archipel qui la sépare de Taiwan, alors chinoise. Deux ans après, ces îlots seront simplement annexés et rebaptisés préfecture d’Okinawa.
Fukoku Kyohei5 !
En 1894, avec une redoutable efficacité, la Corée est envahie. La Chine cède Taiwan l’année suivante par traité, médusée. L’Occident n’a pas encore pris la mesure de l’importance de l’armée japonaise et de sa force de frappe, jusqu’alors regardées avec une certaine condescendance.
La rivalité entre Russie et Japon trouve son point culminant en 1904, lorsque l’empereur, sous l’influence des généraux ultra-nationalistes, lance les hostilités. Ce sera le début d’une guerre ouverte et sanglante. En février, la bataille de Moukden, en plaine mandchourienne, laisse plus de quarante mille cadavres derrière elle. Dans une hallucinante manœuvre militaire, la flotte russe de la Baltique fait un improbable tour du monde, contournant l’Afrique et l’Asie, pour finir par accoster dans le détroit entre le Japon et la Corée le 27 mai 1905. Tentant de forcer le passage et de prendre Port-Arthur, les Russes se cassent le nez, la flotte est décimée. C’est la fin de la guerre, et le Japon en sort victorieux, sous les yeux ébahis de tout l’Occident. L’empire de l’ère Meiji est devenu une véritable puissance avec laquelle le monde doit compter.
L’escalade colonialiste
Ce n’est ni par affinité ni par devoir que le Japon choisit le camp des Alliés lorsque l’empereur déclare la guerre à l’Allemagne le 23 août 1914. C’est un simple calcul stratégique. L’empire gagne les coudées franches en Chine où il est de bon ton de s’entendre avec le Royaume-Uni. À peine un mois plus tard, les armées du Soleil levant marchent sur la province « allemande » du Shandong et s’emparent de Qingdao. Au même moment, la marine japonaise prend le contrôle des territoires allemands du Pacifique : les Marshall, les Mariannes et les Carolines.
Fort de ces succès adoubés par les Alliés alors qu’aucun soldat nippon n’ira combattre en Europe, les ambitions de l’empereur n’ont plus de limites. Devant une dynastie chinoise en pleine déliquescence – la république de Chine est proclamée en 1912 par Sun Yat-Sen, et le pays va alors se diviser –, le Japon va renforcer son emprise sur le continent et dévorer petit à petit les différentes routes commerciales. Le chaos dans lequel l’Europe est plongée force les Occidentaux à se faire uniquement les observateurs hébétés de la croissance inébranlable de l’empire Meiji. Le traité de Versailles en 1919 consacre le dépouillement de la Chine au profit du Japon.
L’empereur, dieu vivant du nationalisme
Le 25 décembre 1926, succédant à un père malade, Hirohito, le nouvel empereur, est acclamé. Il a voyagé et fait ses études en Occident. Il connaît l’ennemi. Il est l’héritier d’une dynastie qui a régné sans interruption depuis des temps immémoriaux. Il est l’incarnation des ancêtres sacrés. Il est grand prêtre de la religion. Il est « sacré et inviolable » par la Constitution elle-même. Le jeune empereur est exalté et veut magnifier le destin de son pays.
La restauration impériale du Japon et son adaptation réussie dans l’ère moderne sont des succès aussi galvanisants que les conquêtes et victoires militaires. Ce royaume oublié de tous est devenu en moins d’une centaine d’années l’une des plus grandes puissances mondiales, comme si, depuis des siècles, elle avait préparé sa revanche contre le reste du monde. L’effervescence nationaliste n’a d’ailleurs plus de limites. Le premier ministre Hamaguchi, à qui on reproche de s’être « couché devant les Occidentaux » pendant les négociations sur la régulation de l’armement naval lors de la conférence de Londres en 1930, sera assassiné à Tokyo le 14 novembre de la même année. La Nikkyo6 prend une telle importance sur l’échiquier politique qu’elle tue dans l’œuf toute contestation possible. En Mandchourie, la région chinoise étant occupée par l’armée japonaise, les répressions se durcissent.
En 1935, l’empire fait de nouvelles revendications territoriales à Tchang Kai-Chek, le dirigeant chinois qui est contraint d’accepter, trop affaibli par sa lutte contre les factions communistes naissantes. Au Japon, en 1936, une dictature nationaliste, violente mais silencieuse, s’instaure. Les factions militarisées les plus radicales prennent le pouvoir, évinçant les plus proches d’Hirohito, dont son premier conseiller qui sera assassiné le 26 février. Dans l’ombre, c’est une véritable toile d’araignée politique qui précipite l’empire vers une escalade violente de poussée expansionniste et fanatique. Le pays, malgré sa modernité apparente et l’efficacité de son industrie, est bien loin des modèles Occidentaux. La société ne laisse aucune place à l’expression individuelle.
En 1937, l’invasion de la Chine se termine après la conquête de Pékin, de Shanghai et de Nankin. L’avancée de l’armée japonaise est d’une violence presque inouïe et inédite, même au regard des massacres de la Première Guerre mondiale. Près d’un million de combattants et trois millions de civils périssent dans l’incident chinois du pont Marco-Polo. Un massacre qui signe la fin totale des relations internationales de Tokyo avec le reste du monde.
L’engagement dans la Seconde Guerre mondiale
Cette escalade conduit naturellement le Japon à signer le fameux accord tripartite du 27 septembre 1940 avec l’Allemagne d’Adolf Hitler et l’Italie de Mussolini. Le traité est simple : d’un côté, les Allemands colonisent l’Europe, de l’autre, les Japonais rayonnent sur l’Asie. Le 7 décembre 1941, c’est la célèbre et non moins funeste attaque de Pearl Harbor qui précipite les événements. L’aviation japonaise pilonne par surprise la base, située dans les îles Hawaï, coulant la plus grande partie de la marine de guerre américaine, sans même avoir déclaré la guerre. Profitant de la surprise, les soldats nippons mènent des attaques foudroyantes sur Hong Kong (décembre 1941), Singapour (février 1942), la Birmanie (mai 1942) et, enfin, l’Indonésie (avril 1942).
Se présentant comme un libérateur aux yeux des territoires conquis, pour former une « grande puissance asiatique », le Japon, au contraire, exploite les richesses locales pour son seul profit. Mais vers 1942, l’expansionnisme et les victoires multiples de l’empire commencent à s’ébranler. Une invasion ratée de l’île de Midway dans le Pacifique en 1942, puis le débarquement américain à Guadalcanal dans les îles Salomon en février 1943 sont les premiers signes de faiblesse militaire de l’ère Meiji.
La bataille du Pacifique sera l’une des plus sanglantes et coûteuses en vies humaines qu’ait jamais connues l’Asie. Les soldats de l’empereur se battent sans relâche, gonflés par l’élan nationaliste d’une politique du culte impérial savamment orchestrée depuis deux décennies. Les pertes américaines sont monumentales. De 1943 à 1945, des combats d’une violence inouïe émiettent malgré tout l’empire japonais, qui recule toujours plus devant les attaques de son adversaire. Début 1945, la prise des îles Iwo-Jima puis Okinawa permet aux États-Unis de créer des bases aériennes destinées à lancer les bombardiers B-29 pour pilonner les grandes cités japonaises.
Les sirènes de l’horreur
De février à août 1945, plus de trois cents B-29, avions au large rayon d’action, bombardent consciencieusement Tokyo, Kyoto, Kobe, Osaka et les autres grandes villes japonaises. Quotidiennement, de jour comme de nuit, c’est un déferlement de feu, de métal et de mort qui s’abat sur la population civile japonaise, sans distinction.
La nuit du 9 au 10 mars, dans le ciel de Tokyo, c’est plus de 1 700 tonnes de bombes qui sont larguées, anéantissant absolument tout sur un rayon de quarante kilomètres, au seul son des sirènes d’alerte, des explosions, des cris et des vrombissements des B-29. Le journaliste français Robert Guillain, alors en poste pour l’AFP, raconte : « Les premières forteresses volantes ont marqué par les flammes le centre de la zone à détruire. […] Les avions suivants en délimitèrent le contour et le quadrillèrent de feu pour enfermer les habitants, puis ce fut l’arrosage à volonté. Sous les ailes des terrifiants oiseaux qui semblaient voler en tous sens et à des hauteurs diverses, de 1 500 à 3 000 mètres, tombaient des milliers de cylindres de métal qui déversaient sur la ville une rosée incendiaire, première version du napalm. » Les habitations tokyoïtes sont essentiellement constituées de bois, et l’urbanisation resserrée favorise sans peine la propagation des incendies et la destruction rapide de toute forme d’habitat. Les foules sont rapidement submergées et piégées par les flammes et le chaos. « Pendant quelque temps, les B-29 étaient encore là, survolant l’enfer, et rouges eux-mêmes comme s’ils étaient en feu, par le reflet des incendies sous leurs ailes. Puis ils laissèrent le reste du travail au vent qui se chargeait de faire rejaillir l’embrasement d’un quartier à un autre. »
L’usage de ces bombes incendiaires est essentiellement destiné à infliger un maximum de dégâts, casser le moral des Japonais et dissuader l’empereur et son premier ministre belligérants de continuer sur le chemin de la guerre. Hélas, les pertes civiles sont telles que même dans les rangs du général MacArthur, alors responsable américain du front sur le Pacifique, on s’indigne. Dans l’ouvrage Orient Extrême, Robert Guillain rapporte les mots de l’assistant du général Douglas MacArthur : « C’est l’un des massacres les plus impitoyables et barbares de non-combattants de toute l’Histoire. » Pendant plus de neuf mois, partout au Japon, les civils apprennent à vivre au rythme des sirènes et des bombardements nocturnes. La propagande, notamment au cinéma, bat son plein. La famine s’instaure. Les restrictions pullulent ; plus l’empire est menacé, plus il devient intransigeant. Les villes deviennent des champs de ruines, et le peuple se réfugie dans les campagnes.
Cependant, cet empire agonisant refuse d’admettre sa défaite et de plier devant l’avancée des Alliés dans le Pacifique. Pourtant, dès le début 1945, Robert Guillain assure que « les Japonais savaient qu’ils avaient perdu la guerre ». Avant même tout signe de reddition, les Alliés imaginent l’après-guerre pour l’Asie lors de la conférence de Potsdam, le 26 juillet 1945. Il faut maintenant trouver un moyen de la terminer, cette guerre…
CHAPITRE 2 : LA SCIENCE DU MAL
« […] La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. […] Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison. »
Albert Camus dans Combat, le 8 août 1945.
La crainte de voir les puissances de l’Axe développer une arme atomique est l’un des fondements officiels de la recherche américaine. Le Japon n’a pas les moyens industriels et scientifiques pour y parvenir, mais les Alliés voient dans la bombe A la possibilité d’instaurer une nouvelle force de persuasion pour les inévitables rivalités de puissance de l’après-guerre.
Après la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945, et avec l’accord du président Truman, la bombe atomique sera pour la première fois utilisée dans un conflit « sans avertissement préalable, sur une cible à haute densité de population et à caractère militaire, de façon à obtenir le maximum d’effets psychologiques », comme le stipule le rapport de Henry Lewis Stimson à destination de Truman, daté de mai 1945. Sur les cinq cibles désignées (Kyoto, Hiroshima, Kokura, Niigata et Nagasaki), ce sont les conditions météorologiques qui décideront arbitrairement de la mort de dizaines de milliers de civils japonais. Malgré la mise en garde d’éminents scientifiques sur les probables retombées incontrôlables a posteriori et l’absence totale de maîtrise d’une telle arme, l’armée américaine est bien décidée à mettre fin à l’aveuglement japonais, et surtout à lancer un message durable et terrible à l’ensemble de la planète.
Fin juillet 1945, un ultimatum est adressé au Japon, exigeant une capitulation sans conditions, sans quoi il « subira une destruction rapide et totale ». Évidemment, le premier ministre Suzuki ne mesure pas la nature de cette menace secrète, sans précédent et inconnue : la bombe nucléaire. Le 30 juillet, devant ce que les Américains prennent pour un refus méprisant de l’empire nippon, Truman ordonne le largage des bombes. Le croiseur Indianapolis transporte les composants de Little Boy (la bombe à uranium) et Fat Man (la bombe au plutonium) vers Tinian sur l’archipel des îles Mariannes. Sans le savoir, le navire militaire transporte le calvaire d’une nation, de l’humanité, pour des dizaines d’années à venir.
Le matin du 6 août 1945, la ville côtière d’Hiroshima, comptant trois cent cinquante mille habitants, est choisie pour son ciel dégagé. À 8 h 15, heure locale, le bombardier Enola Gay largue Little Boy qui explose à six cents mètres au-dessus de l’hôpital Shima, en plein centre-ville. Du point d’impact, les habitants à moins d’un kilomètre n’entendent même pas le bruit de la bombe. Un flash lumineux souffle littéralement toutes vies et tous bâtiments. La température atteint subitement plus d’un millier de degrés, propageant des vents incandescents de mille kilomètres à l’heure. Dans un rayon de deux kilomètres, plus aucune âme ne subsiste et aucune structure ne résiste. En une fraction de seconde, soixante-dix mille personnes sont tuées, ce qui constitue à ce jour le plus grand massacre jamais perpétré de l’histoire humaine. Les incendies, les blessures et les gaz toxiques tuent presque autant de civils dans les quelques heures qui suivent, élevant le bilan direct des victimes de la bombe à cent cinquante mille Japonais. Les dommages sont innombrables, incalculables, terrifiants. Hiroshima est un instantané de l’apocalypse. En contemplant le titanesque champignon atomique laissé derrière lui, Robert Lewis, copilote d’Enola Gay, a un sursaut d’effroi : « Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? »
Le Japon et le monde ne mesurent pas l’ampleur de ce qui vient d’être expérimenté à Hiroshima. Le rejeton de la science d’Einstein, de Fermi et de Joliot-Curie a été dévoyé pour atteindre un degré d’horreur insoupçonné. L’arme ultime de l’homme contre la nature, sa propre nature. À peine quelques jours après ce funeste déclin, alors que les cendres d’Hiroshima sont encore brûlantes, le 9 août, Fat Man descend inexorablement au-dessus de Nagasaki. Quatre-vingt mille morts. Le Japon accepte les conditions de la reddition. Le 15 août, c’est la fin de la guerre.
« À Hiroshima, trente jours après la première bombe atomique qui détruisit la ville et fit trembler le monde, des gens qui n’avaient pas été atteints pendant le cataclysme sont encore aujourd’hui en train de mourir mystérieusement, horriblement, d’un mal inconnu pour lequel je n’ai pas d’autre nom que celui, ignoble, de peste atomique. »
Wilfred Burchett dans le Daily Express, le 5 septembre 1945.
La terre outragée
Malgré la propagande américaine censée minimiser la communication autour des effets néfastes et dévastateurs des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, le Japon découvre les horreurs de la peste atomique. Impossible de savoir précisément quelles sont les retombées exactes sur la population qui continue à mourir des radiations mortelles, mais les hibakusha7, froidement observés par l’ABCC8, deviendront une caste sociale maudite et rejetée. Ils n’auront pas le droit de faire d’enfants, de toucher les autres de peur que la « maladie » ne se propage. Beaucoup se suicideront, tous se tairont.
Les souffrances psychologiques directement liées aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ne sont pas quantifiables. Les témoignages de l’horreur sont si irréels qu’ils ne trouvent pas de crédit. Le Japon a perdu, l’empire est déchu. La souffrance et les plaies sont trop vives. Comme pour effacer de la mémoire collective les balafres laissées par l’arme ultime, les reconstructions autour d’Hiroshima démarrent très vite, dès 1946. En 1948, le tramway est à nouveau opérationnel. En 1953, la ville a presque nettoyé toutes les traces de l’apocalypse. Mais la psychose restera. Dans les mémoires et dans la peau des témoins. La terre est irradiée, violée, outragée.
Résilience
Le peuple japonais, plus qu’aucun autre, possède dans son ADN les affres de la souffrance contre les éléments naturels. Petit bout d’archipel aux confins des plaques tectoniques, le pays a souffert, en moins d’un siècle, de dix-sept séismes d’intensité supérieure à six sur l’échelle de Richter. Certains furent presque aussi meurtriers qu’une bataille sanglante, comme celui de 1923, provoquant un gigantesque incendie à Tokyo et tuant plus de cent quarante mille de ses habitants. Ou celui de 1948, à Fukui, à peine trois ans après la fin de la guerre, alors que le pays panse ses plaies. Notons aussi celui de 1995, à Kobe, et bien sûr celui de 2011 à Tohoku, de magnitude 9 – le plus violent tremblement de terre enregistré au Japon – provoquant le tsunami qui a engendré le fameux incident de la centrale nucléaire de Fukushima.
On prête au peuple japonais une capacité fataliste et exclusive à renaître chaque fois de ses cendres. Une force commune, une coopération, un calme et une acceptation qui lui donnent la volonté d’aller de l’avant. C’est la fameuse résilience. Le terme est emprunté à la chimie et définit la capacité d’un matériau à résister à des conditions ou à des expériences qui devraient le conduire à sa destruction. Et force est de reconnaître, que catastrophes après chutes, le monde entier observe ce peuple se relever, encore et toujours.
Les Japonais seraient-ils prêts à endurer tous les sévices, naturels, belliqueux ou même atomiques avec une abnégation presque inhumaine ? Pas vraiment. Au lendemain de la catastrophe du séisme de Tohoku en 2011, des habitants de Tokyo témoignaient : « Quand les Japonais vont mal, ils ne parlent à personne. Ils continuent, autant qu’ils peuvent. Et quand ils n’en peuvent vraiment plus, ils se suicident. » La conscience collective transporte avec elle l’héritage des souffrances d’un peuple. Les traces des catastrophes incroyables qu’ont endurées les Japonais, plus que tout autre peuple, sont dans l’ADN même de la société. Et si les conventions ne permettent pas de les formuler verbalement, il existe des exutoires. Le cinéma en fait partie de manière évidente.
Les cendres d’Hiroshima continuent de pleuvoir sur les psychoses du peuple. Les images des atrocités de la guerre ont imprégné les rétines de plusieurs générations. C’est d’ailleurs dans les ruines d’une capitale dévastée qu’un cinéaste est venu saisir des images pour immortaliser et mieux donner corps à ces traumatismes.
Un cinéaste du nom d’Ishirō Honda.
CHAPITRE 3 : ISHIRO HONDA (1911-1993)
« Godzilla, Rodan, The Mysterians, The H-Man ou Mothra sont des films qui ont hanté l’imagination des jeunes cinéphiles comme moi et des millions d’autres pendant tant d’années. »
Martin Scorcese
Ishirō Honda a trente-huit ans. Grand, fin et élancé, il a la silhouette d’un rêveur discret. Ce matin-là, comme depuis quatre jours maintenant, il quitte le dortoir du studio Oizumi9 situé dans un recoin calme du quartier tokyoïte d’Ikebukuro. Il endosse son matériel et sa caméra portative, puis il profite des ruelles ombragées et désertes pour allumer sa première cigarette. En rejoignant les artères principales du Nishiikebukuro-Dori, le cinéaste décide de continuer à pied vers le marché noir qui entoure les austères bâtiments du Kanamecho Hospital. Il y passera la journée, tantôt assis au bord d’une fontaine, tantôt s’engouffrant dans les étroites allées piétonnes regorgeant de badauds, sous la chaleur étouffante de ce mois de juillet 1949.
Si peu de temps après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, la capitale semble toujours abasourdie par la défaite. Tokyo peine encore à se remettre des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les ruines noircies côtoient des baraques aux décorations tapageuses dissimulant des marchandises bariolées que les passants n’ont pas les moyens d’acheter. Les riverains aux regards vides se mêlent aux soldats étrangers paradant triomphalement dans leurs uniformes fringants. Ils laissent la place, le soir venu, aux criminels, filles de joie et clochards en quête d’un lieu où dormir. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre les fracas d’une rixe ou un coup de feu déchirer la morosité ambiante des rues.
Avec grande précision, Ishirō Honda installe calmement son objectif et saisit les instants quotidiens des allées et venues, des bruits et des mouvements de ce magma humain. Ses yeux observent le va-et-vient, entrecoupé par le passage du large linge qu’il extirpe de sa poche pour essuyer la sueur de son front. Patient et sans un bruit, se fondant dans la masse, il sélectionne les moments qu’il juge propices et les immortalise. Il reviendra demain, ici ou à Shinbashi ou même à Ueno ou à Ginza, pour saisir et capter au mieux cette atmosphère, entre bâtiments décharnés par les bombardements, poussière et chaleur omniprésentes, mais surtout pour filmer l’extraordinaire vie qui se dégage de cette terre brûlée.
Chien enragé
Depuis l’extravagant périple de son retour des camps de prisonniers chinois en 1946 et sa traversée d’Hiroshima – « l’atmosphère lourde qui y régnait était celle de la fin du monde » –, Ishirō Honda tente désespérément de retrouver sa carrière de cinéaste et, ainsi, ses premières amours. La guerre l’a injustement privé de toute ambition professionnelle, et pour la Toho10, la société de production à laquelle il est syndiqué, il est déjà considéré comme trop âgé pour entreprendre une carrière de réalisateur. Néanmoins, sa persévérance est grande. Son ami Akira Kurosawa11 lui a proposé, lors d’un dîner en janvier 1949, de reprendre du service en tant qu’assistant réalisateur pour son prochain film, Chien enragé12. C’est l’adaptation d’un roman que Kurosawa a lui-même écrit. Un polar sous influence du grand maître belge du genre, le romancier Georges Simenon, qui a notamment créé le célèbre personnage du commissaire Maigret. Honda accepte sur-le-champ le rôle et la responsabilité de tourner des scènes seul, sans acteur, pour capturer l’ambiance du Tokyo d’après-guerre.
Le script du film dépeint les tribulations d’un jeune policier, incarné par Toshirō Mifune13, qui perd son arme de service lors d’un trajet en tramway. Abattu par la honte, il parcourt Tokyo pour la retrouver avant qu’un drame n’arrive inévitablement. Ainsi, Ishirō Honda va promener sa caméra, seul, ou juste accompagné d’un assistant, à travers les quartiers populaires et à peine reconstruits de la capitale nippone. Parfois, il mimera même la silhouette de Mifune, doublant ce dernier dans les déambulations infructueuses du policier.
Kurosawa n’a pas choisi Honda au hasard. Ce dernier est un artisan solide, à l’œil précis et à la sensibilité réaliste. Passionné de naturalisme et d’art figuratif, Ishirō Honda, né en 1911 dans la province de Yamagata, comptait déjà, avant-guerre, une vingtaine de participations techniques ou artistiques à des films et documentaires pour le compte de la Toho. Cependant, il fut mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et envoyé par trois fois en Chine. Il y fut témoin des atrocités de l’armée impériale japonaise, témoin actif rejetant la violence et l’embrigadement aveugle et destructeur des jeunes militaires. Pendant son dernier séjour, en 1944, il est fait prisonnier. Relâché en 1946 après de nombreux mois de détention dans les geôles chinoises, il revient tant bien que mal au pays où il découvre une terre de feu et de sang, où les traumatismes des bombardements et de l’atome brûlaient encore les esprits. Un artisan de choix, pour Kurosawa, qui va habilement utiliser les talents techniques et le regard triste et blessé d’Honda pour marquer son film autant d’un sentiment eschatologique que d’un optimisme puissant. Akira Kurosawa, dans son livre Comme une autobiographie (1981), dit de lui : « Il y a peu d’hommes aussi honnêtes et fiables qu’Honda. Il a fidèlement rapporté les images exactes que je lui ai demandées. Presque tout ce qu’il avait filmé a été utilisé dans le montage final du film [NdA : dont un passage de presque huit minutes, sans dialogues, ne comptant que des images des bas-fonds tokyoïtes, dans la version restaurée du film]. On me dit souvent que j’ai particulièrement bien retranscrit l’atmosphère du Japon d’après-guerre dans Chien enragé, et si c’est vraiment le cas, nous devons cela au seul talent de M. Honda. »
Shin Honda
Ces premiers espoirs de retour dans le sérail de la production cinématographique commencent à prendre forme lorsque la Toho missionne Honda pour réaliser un semi-documentaire intitulé Histoire de coopérative (Kyodokumiai no hanashi). Dans ce court-métrage aux forts relents de propagande positiviste, un jeune soldat de retour au pays va trouver du travail dans une coopérative agricole et ainsi participer à la reconstruction du pays. Encore une fois, Honda fait preuve de qualités particulièrement appréciées des producteurs. Il est rapide, discret, fiable et efficace. Son travail est impeccable, et le film remporte un joli succès d’estime. Une reconnaissance qui, quelques mois plus tard, lui donnera les clefs de son premier long-métrage, presque cinq ans après son retour du front.
C’est sur une adaptation du roman de Katsuro Yamada, Les Ruines de la mer (Umi no haien), qu’Honda porte son dévolu. Il en écrira le scénario, et le film sortira le 3 août 1951 sous le titre La Perle bleue (Aoi Shinju). L’idée première lui est suggérée par son ami Sojiro Motoki, l’un des producteurs les plus influents du moment. Le résultat, à la frontière du documentaire, esquisse les traits solides de la patte du réalisateur. S’inspirant d’un travail de commande qu’il avait effectué l’année précédente pour promouvoir les attraits touristiques de l’île de Mie (Ise-Shima – 1951), Honda filme les campagnes et les jeunes pêcheuses de perles dans un noir et blanc cru, lent et naturel. Il est à noter d’ailleurs que les scènes sous-marines révèlent deux compétences inédites : une maîtrise technique hors pair – c’est le premier film japonais à comporter des scènes sous-marines –, et une obsession pour l’océan, qui ne quittera jamais le réalisateur et fait déjà écho à certains aspects de son futur Gojira.
L’intrigue de La Perle bleue dépeint l’histoire d’amour tragique entre la jeune pêcheuse Noe et l’instituteur Nishida. Honda en profite pour régler quelques comptes avec le Japon d’après-guerre et sa profonde division entre modernité et conservatisme. Un pays bouleversé par l’émergence d’une pensée progressiste et d’une parole féministe. Le réalisateur parvient avec subtilité à diluer les traumas sociétaux qu’il observe dans une intrigue d’apparence triviale et classique en profitant des codes du cinéma de genre, en l’occurrence la romance provinciale. C’est aussi une caractéristique qui transpirera plus que jamais dans tout son cinéma. Plus qu’un simple faiseur, qu’un homme de studio, Ishirō Honda est un auteur.
Le film suivant du réalisateur, La Peau du Sud (Nangoku do Hada), continue, dans le même style documentaire, à traiter des traumas sociaux du Japon. Adapté d’un roman de Seito Fukuda, le long-métrage narre les malheurs de plusieurs familles dont la région a été dévastée par un récent typhon. Le film est particulièrement notable parce qu’il s’agit d’une production importante pour la Toho en 1952, mais surtout parce qu’on retrouve au générique deux personnes qui auront toute leur importance dans le présent ouvrage : le directeur artistique Akira Watanabe, qui signera le design final de notre monstre préféré deux ans plus tard, et Eiji Tsuburaya aux effets spéciaux. La même année, Honda retrouve les stars Toshirō Mifune et Takashi Shimura, déjà en tête d’affiche du Chien enragé de Kurosawa, pour le drame Un homme est venu au port (Minato e kita otoko). Le film restitue l’ambiance des grands ports de chasseurs baleiniers à grands renforts d’images authentiques du plus pur style documentaire d’Ishirō Honda. C’est aussi la première collaboration entre ce dernier et le producteur Tomoyuki Tanaka, dont nous reparlerons sous peu.
Début 1953, la Toho missionne Honda pour la réalisation de L’Adolescence – deuxième partie (Zoku shishunki), suite du métrage éponyme de Seiji Maruyama. Pur film de commande, le tournage solidifie néanmoins le respect mutuel entre l’influent producteur Tanaka et le réalisateur qui prend une place de plus en plus prépondérante dans la machine à construire des films du studio. Honda devient un artisan respecté, et plus rien ne semble pouvoir l’empêcher désormais de diriger les films à gros budget du studio, à l’instar de son ami Akira Kurosawa.
Ce sera chose faite avec le tournage de L’Aigle du Pacifique (Taiheiyō no washi), énorme et ambitieuse production que la Toho veut aussi grandiloquente que les films hollywoodiens. Malgré ses réserves sur le fait de faire un film de guerre, Honda ne peut refuser un tel projet. Le scénario profite du relâchement du contrôle et de la censure américaine pour s’autoriser quelques largesses avec les faits historiques, l’ambition étant de retracer la vie de l’amiral Isoruku Yamamoto (1884-1943), l’un des principaux artisans de l’attaque de Pearl Harbor (1941) et de la bataille de Midway (1942). L’arrivée d’Honda sur le projet modifie néanmoins quelque peu l’ode à la gloire des héros de guerre en un film militant sur la responsabilité du Japon dans l’issue fatale du conflit. Le long-métrage est aussi l’occasion d’admirer un remarquable travail d’orfèvre de la part d’Eiji Tsuburaya dans des reconstitutions impressionnantes des grandes et nombreuses batailles qui émaillent le film. Le succès est au rendez-vous. Le film engrange plus de recettes qu’aucun autre en 1953, et Honda devient définitivement l’un des atouts enviés de la Toho.
4 Le daimyo (大名) est un titre de noblesse japonais signifiant « Grande personne ». Il est un gouverneur de province issu de la classe militaire, et dans le cas d’Hideyoshi, l’un des grands unificateurs du pays.
5 « Un pays riche, une armée forte. » Slogan national datant de 1892.
6 Société japonaise pour la lutte unifiée des patriotes.
7 Personnes affectées par la bombe.
8 Atomic Bomb Casualty Commission. Une entité américaine qui s’installa à Hiroshima au lendemain de la bombe et qui observa les effets sur la population sur le long terme, sans avoir jamais cherché à soigner les malades et les mourants.
9 Le studio Oizumi appartient, à l’époque, à la société japonaise de production cinématographique Toho. En 1956, revendu à la Tœi, il deviendra un grand studio d’animation produisant les premières séries animées japonaises. C’est aujourd’hui un musée proposant aux visiteurs de découvrir les premières heures de séries d’animation comme Galaxy Express 999 ou Astro.
10 Célèbre société de production japonaise fondée en 1932 et basée à Tokyo.
11 Akira Kurosawa est probablement le plus grand et le plus célèbre des réalisateurs japonais. Sa filmographie compte nombre de chefs-d’œuvre dont Les Sept Samouraïs (1954), Ran (1985) ou Kagemusha, l’ombre du guerrier (1980).
12Chien enragé (en VO – Nora inu) d’Akira Kurosawa, sorti en 1949, avec Toshirō Mifune et Takashi Shimura. Le film est considéré comme le tout premier polar noir japonais. Et c’est, objectivement, un chef-d’œuvre…
13 Toshirō Mifune est un célèbre acteur japonais, né en 1920 et campant des rôles d’hommes forts et charismatiques qui inspirèrent Clint Eastwood lui-même. Il est notamment remarquable dans les films de sabre de Kurosawa : Les Sept Samouraïs (1954), Yōjimbō (1961) ou encore Rashomon (1950).
PARTIE 2GOJIRA
« Au plus tard le 31 décembre 1945, et très probablement avant le 1er novembre, le Japon aurait capitulé même si les bombes atomiques n’avaient pas été lancées, même si la Russie n’était pas entrée en guerre et même si aucune invasion du pays n’avait été planifiée ou envisagée. »
Rapport de la commission américaine des bombardements stratégiques (Strategic Bombing Survey), janvier 1946.
CHAPITRE 4 : TOMOYUKI TANAKA (1910-1997)
20 mars 1954. Tomoyuki Tanaka est un homme élégant, même engoncé dans l’un des quatre-vingt-quinze sièges inconfortables du Lockheed Constellation, l’avion qui le ramène à Tokyo. Mais ses grandes lunettes noires peinent à cacher son anxiété. Sur le siège à côté de lui, sa sacoche en cuir contient encore les preuves du fiasco. Rien ne s’est passé comme prévu à Jakarta. Pourtant, In the Shadow of Honor avait tout d’un grand film. Toutefois, Tanaka aurait dû se douter que le silence coupable des autorités indonésiennes depuis plusieurs semaines cachait une issue désastreuse pour ce qui devait être, à l’origine, le premier projet de film en couleurs à grand spectacle de la Toho. Il faut dire que le sujet du long-métrage souffrait directement des relations diplomatiques tendues entre l’Indonésie et le Japon. Dans le scénario, un ancien soldat japonais partait, formait et combattait aux côtés des forces populaires qui se sont soulevées partout dans l’archipel indonésien pour leur indépendance (1945-1949). Une relecture historique évidemment trop patriotique et visant sans ambiguïté à gommer les traces sombres de l’occupation japonaise. Parce que si le Japon fut accueilli comme un libérateur et confrère asiatique, libérant en 1942 les îles de Bornéo et de Sumatra puis la ville de Jakarta des troupes coloniales néerlandaises – qui occupaient l’Indonésie depuis le XVIIe siècle –, les exactions qui furent commises jusqu’en 1945 sur ce peuple pacifique par l’armée impériale japonaise ont laissé une plaie ouverte dans le cœur de tout l’archipel. In the Shadow of Honor, malgré la remarquable pugnacité de Tanaka, était un projet mort-né, et le ministère de la Culture indonésien ne donna finalement pas son aval. Dans cet avion, au printemps 1954, le producteur de quarante-quatre ans allume nerveusement et laisse se consumer cigarette sur cigarette.
La Toho a besoin d’un film de grande envergure pour la fin de l’année, il reste à peine six mois à Tanaka pour trouver l’idée qui le sauvera. Il est conscient que s’il est entré dans cet avion sans film, il faudra qu’à son arrivée, à l’aéroport de Tokyo-Narita, il en sorte avec un nouveau projet. « En quelques minutes, il fut si facile d’anéantir des mois de travail, mais alors, je devais trouver une idée ambitieuse à la mesure des attentes de la Toho pour le remplacer », confiera-t-il dix ans plus tard au magazine LIFE, en 1964. Tanaka sort un magazine de la pochette de son siège et parcourt les pages à l’affût du moindre signe providentiel. Un petit encart rapporte la sortie au Japon, quelques mois plus tôt, d’un film spectaculaire, une production américaine de série B appelée Le Monstre des temps perdus, réalisé par le Français Eugène Lourié14 et adapté d’une nouvelle de Ray Bradbury15. Le film raconte qu’à la suite d’un test nucléaire conduit dans le cercle Arctique – l’« Operation Experiment » –, une créature préhistorique gigantesque, prisonnière des glaces, se réveille d’un sommeil millénaire. Le monstre colossal attaque la côte Est des États-Unis avant d’envahir Manhattan. En dessous de l’article, Tanaka reste hypnotisé par la petite vignette représentant la magnifique créature réalisée par Ray Harryhausen16, sorte d’iguane hypertrophié et démesurément puissant. Tanaka repose le magazine sur ses genoux et scrute l’océan par le hublot. Quelques mois plus tôt, déjà, une ressortie du grand classique King Kong (1933), de Merian Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack, avait rencontré un succès imposant dans les salles obscures tokyoïtes. Monstres géants, destructions grandiloquentes et spectacles grandioses étaient l’apanage du cinéma américain. Le public japonais semblait sensible à ses charmes, et aucune production locale n’avait seulement osé rivaliser avec Hollywood sur ce créneau. Pourtant, le savoir-faire des techniciens nippons n’était plus à prouver. Les réalisations de Tsuburaya, notamment dans les films de guerre, pouvaient aisément se comparer aux meilleurs plans truqués d’Hollywood.
Évidemment, l’idée de Tanaka doit se démarquer de la concurrence occidentale, ainsi le monstre viendra plutôt de la mer – l’océan est le partenaire mystérieux de toujours du Japon, et la créature destructrice pourrait servir de métaphore de la bombe nucléaire. Quel peuple au monde pourrait être plus sensible aux horreurs de l’atome ? « Le thème du film, depuis ma toute première idée, est la terreur de la bombe A », témoigne Tomoyuki Tanaka dans Godzilla Days. « L’humanité a créé la Bombe, et maintenant la nature va prendre sa revanche sur l’humanité. » C’est seulement neuf ans plus tôt que Fat Man et Little Boy ont instantanément ôté la vie de trois cent mille âmes, et bien plus encore aujourd’hui souffrent d’atroces séquelles. L’occupation américaine qui a directement suivi la guerre a imposé une censure sur nombre de sujets polémiques, dont la bombe atomique. Cependant, ce veto culturel a disparu lors de la relaxe de 1952, et il est maintenant tout à fait envisageable de se montrer plus critique avec les horreurs de la guerre. En témoignent les sorties précipitées des Enfants d’Hiroshima (1952) de Kaneto Shindo ou Hiroshima (1952) d’Hideo Sekigawa. Ce dernier n’hésite pas à dépeindre les bombardements comme de purs crimes raciaux où les Japonais ne furent considérés que comme de vulgaires cobayes par une Amérique mondialement despotique.
En 1954, le Japon, malgré les affres de la guerre et les traumatismes associés, a retrouvé une certaine prospérité. Néanmoins, la montée des deux blocs, soviétique et américain, et les prémices de la guerre froide entraînent des anxiétés nouvelles à la population. Les États-Unis, notamment, continuent de travailler sur des bombes encore plus puissantes que celles lancées sur Hiroshima et Nagasaki, dans le Pacifique, sur les îles Marshall. Aux frontières de l’Archipel nippon, la guerre de Corée est en pleine escalade, et la peur d’un nouveau bombardement fait la Une des quotidiens tokyoïtes. Mais c’est un terrible événement qui va définitivement influencer la teinte du projet de Tanaka et l’écriture de son scénario.
L’incident du Daigo Fukuryu Maru
Au matin du 1er mars 1954, les États-Unis font exploser une bombe à hydrogène d’une puissance de quinze mégatonnes – soit sept cent cinquante fois plus puissante que celle d’Hiroshima – dans l’atoll des Bikini, à peine à 2 500 miles au sud-est d’Honolulu. L’« Opération Bravo » était alors considérée comme un essai de routine par la Commission énergétique atomique. Rappelons-nous que la « maîtrise » de ces essais était toute relative et que leurs résultats furent bien plus ravageurs que prévu. L’explosion annihila instantanément une large partie de l’atoll et propulsa alentour des milliers de tonnes de débris sur un diamètre de plus de sept mille miles nautiques. Des débris hautement radioactifs. À moins d’une centaine de kilomètres de là, un petit bateau de pêche japonais, le Daigo Fukuryu Maru (le mal nommé « Dragon chanceux numéro 5 ») rabattait ses filets avec vingt-trois marins à bord. Ces derniers furent littéralement aspergés des résidus du souffle nucléaire, une poussière radioactive surnommée Shi-No Hai – les cendres de la mort. « Des particules blanches, comme de la neige, tombaient sur nous », se rappelle Matakichi Oishi, un des membres de l’équipage, dans son autobiographie The Day the Sun rose in the West (2011). « Elles nous transperçaient littéralement, dans les yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles. Nous n’avions absolument pas conscience que cela pouvait être dangereux… » Quelques heures plus tard, certains hommes commencèrent à sentir des maux de tête violents, des nausées et des irritations au niveau des yeux. Au matin du 3 mars, des matelots découvrirent d’étranges teintes noires sur le visage ou différentes parties du corps. Même s’il ne comprenait pas l’origine de ce mal, le capitaine du Daigo Fukuryu Maru décida d’abandonner la saison de pêche et mit le cap vers le Japon. Rentré à Yaizu, dans la préfecture de Shizuoka, le mal des marins ne tarda pas à faire la Une de la presse locale, devenant l’origine d’une nouvelle psychose nationale. Le 16 mars, le quotidien Yomiuri Shimbun mit en cause directement les États-Unis et les essais nucléaires perpétrés dans l’atoll des Bikinis. Hypocrite, le gouvernement américain réfuta les accusations en suspectant officiellement le petit navire d’être un appareil espion, mais il envoya néanmoins 2 millions de yens (environ 16 000 euros aujourd’hui) en dédommagement aux pêcheurs comme gage de sympathie. Six mois plus tard, Aikichi Kuboyama, chef radio du bateau, décède d’une leucémie à Tokyo, faisant de lui la première victime d’une bombe nucléaire post-Nagasaki.
Bien sûr, l’affaire relance une vague de psychose dans le pays et génère même un effondrement national du marché du poisson, notamment du thon, pendant presque deux ans. En 1955, une pétition nationale atteindra trente-deux millions de signataires pour faire interdire l’usage mondial de la bombe atomique, avec le succès qu’on lui connaîtra. L’incident est même à l’origine de la grande vague pacifiste, sans précédent, qui traversera l’Archipel nippon aux cours des années 1950.
Il donnera aussi naissance au Roi des Monstres.
CHAPITRE 5 : PUROJEKUTO G-SAKUHIN17
Tomoyuki Tanaka, en descendant de la passerelle de son avion, sait que son idée ne lui offre qu’un court répit. Le projet est encore assez flou, mais le concept est là : faire un film avec un monstre géant venant de la mer et incarnant la menace atomique. Il s’engouffre dans un taxi et, sans plus attendre, fait route vers les studios de la Toho. Son projet n’existera pas tant qu’il n’aura pas l’aval d’Iwao Mori, le puissant producteur exécutif en poste depuis 1937. Pour illustrer son idée, Tanaka a emporté avec lui plusieurs coupures de presse relatant l’incident dramatique du Daigo Fukuryu Maru, espérant ainsi convaincre Mori que le moment est propice pour monter un tel film. Il surnomme très opportunément son idée : The Giant Monster from 20 000 Miles Beneath the Sea – le titre anglais du Monstre des temps perdus est The Beast from 20,000 Fathoms.
Quoique jugée audacieuse, l’idée de Tanaka plaît immédiatement à Iwao Mori. Le film de monstres, et le film fantastique en général, n’a pour le moment jamais été exploité dans la production cinématographique nippone, plus habituée aux films de guerre, aux drames familiaux et aux chambara (films de sabre). Mori a bien en tête l’impressionnante réception positive de la ressortie du King Kong