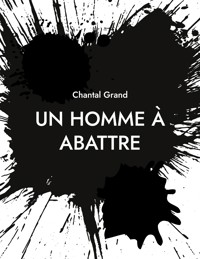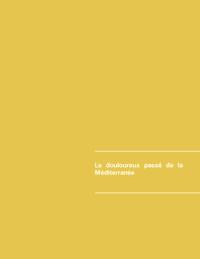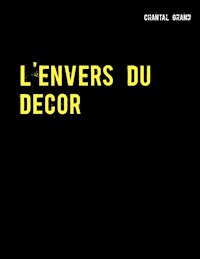
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
André Malraux, disait : " l'ombre parée de Versailles, nous cache son âme ravagée ". Lorsque vous franchissez les portes du château de Versailles, vous entrez dans un monument qui a une histoire. Vous serez étourdi d'ors et de marbres, et vous fatiguerez vos yeux sur les tableaux et les meubles. Des grands noms apparaissent, des dates pour mieux comprendre, que vous entrez dans le songe d'un Roi. Grandiose, subtilement démesuré, le château de Versailles, est une scène, un théâtre, face au Royaume, et à toute l'Europe, ou une famille s'exhibe, avec les courtisans, pour écrire une page de notre histoire de France. La cour s'installe à Versailles le 6 mai 1682, après des années de travaux, de plâtre etc... La vie réglée au geste près, surveillée, commentée, factice et en même temps terriblement humaine. La vie de tous et de chacun, s'organise autour de sa personne. La pyramide est en réalité une nébuleuse. On s'y pousse du coude pour paraître, on se croit ce que l'on n'est guère. On intrigue. La Bruyère dans ses Caractères, a peint, sous la brillante écorce, l'ambition nue du courtisan et l'obscène suffisance des Princes " peuple singe du maître ", a lâché La Fontaine dans la Fable " les obsèques de la Lionne ". Un tout petit monde, en vérité, où l'ami trahit, où l'idiot triomphe, où l'on rencontre aussi des âmes d'airain, des femmes fortes, des hommes d'Etat. Mais l'envers du décor, est-il, toujours aussi reluisant ?...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHAPITRES
Introduction :
Louis XIII-Anne-D'Autriche
Le siècle de Louis XIV de Monsieur de Voltaire
Louis XIV le Roi-Soleil de 1638 à 1715
Hygiène de Louis XIV
La face cachée duy Roi-Soleil
La Reine, Marie-Thérèse d'Autriche
Le secret de Marie-Thérèse
Monsieur, frère de Louis XIV
Élisabeth-Charlotte de Bavière
La mauvaise éducation des enfants de Louis XIV
La Fille du Duc de Chartres
Le Duc de Chartres, fils de Monsieur Frère du Roiet d' Elisabeth-Charlotte de Bavière
Melle de Blois, fille de Louis XIV, et épouse duDuc de Chartres
Descendance de Louis XIV
Mme de Maintenon, épouse de Louis XIV
Dureté du Roi, par le Duc de Saint-Simon
Question du Roi-Soleil à la Princesse Palatine
Le prince de Conti
L'apparence du Roi-Soleil
Le grand Dauphin fils légitime de Louis XIV
Paule-Marguerite-Françoise de Gondi
Mme de Sévigné destinataire des mémoires duCardinal de Retz
La Fronde
La Duchesse de Hohensollern
Le comte de Horn
Le Duc de Vendôme
Mort du Duc de Vendôme
Les apparences
La princesse d'Harcourt
Les observations de Liselotte
Scudéry
Pélisson
L'Académie Française
Les Grands Hommes
Hyacinthe Rigaud
Racine
Molière
Jean-Baptiste Colbert
Louvois
l'espionnage des lettres
La pension du Gascon
Les monarques étrangers
François Harlay de Champvallon
L'église à cette époque
Les rapports de police sous Louis XIV
Intrigues et jalousies à la cour
Le Terrible Hiver de 1709
La vie de chaque jour sous Louis XIV
Une société fondée sur l'inégalité
Paris sous Louis XIV
L'homme au masque de fer
Les mentalités en France au XVIIe siècle
Le corsaire malouin Duguay-Trouin
Le Roi d'Angleterre
Le Maroc
Un ambassadeur douteux
Le Ier septembre 1715
Le Roi peu regretté
Liselotte, Princesse Palatine
Conclusions
INTRODUCTION
Louis XIII - Anne d'Autriche
Après vingt-deux ans d'un mariage stérile, c'est un miracle qui pousse le roi et la reine, l'un vers l'autre, il n'y a toujours pas un héritier pour le trône.
C'est incompréhensible, quand on est le fils du vert-galant, Henri IV. Il faut un dauphin, la France s'inquiète. Avant de se fâcher avec la reine, Louis XIII a pourtant rempli plusieurs fois son devoir royal, mais par quatre fois, Anne d'Autriche a avorté. Elle a beau se traîner dans toutes les églises de Paris pour implorer le seigneur de ramener le roi dans sa couche. Rien n'y fait, et elle a déjà 36 ans.
Cela fait treize ans que le roi la délaisse, préférant courir le cerf dans ses forêts plutôt que de sonner l'hallali dans le lit de la reine. Il faudrait donc un miracle pour voir Anne d'Autriche enfanter. Bref, Louis XIV n'aurait jamais régné si un miracle n'était pas survenu le 5 décembre 1637.
Pour en arriver là, il a fallu un étrange concours de circonstances, sûrement d'origine divine. Le matin, après avoir séjourné plusieurs jours dans son petit château de Versailles, Louis XIII se met en route pour son palais de Saint-Maur. Le temps est horrible. Les nuages sont noirs et les éléments se déchaînent. Le cortège royal traverse Paris, le roi décide de faire une halte au monastère de la Visitation, rue Saint-Antoine, pour saluer Louise Angélique Motier de la Fayette.
Cette demoiselle est le petit rayon de soleil de Louis, celle qu'il aime d'un amour tendre et chaste. Ils se sont rencontré deux ans auparavant lors de sa présentation à la cour.
Elle était douce, timide et ravissante. Louise Angélique aime Louis XIII d'un amour désintéressé. Elle a même refusé au cardinal de Richelieu de l'espionner. Cette attirance mutuelle effraie la douce jeune fille, qui décide d'entrer en religion. En mai 1637, Mademoiselle de la Fayette entre comme novice au couvent de la Visitation.
Régulièrement, Louis XIII lui rend visite, espérant toujours la convaincre de revenir à la cour. Mais, l'entourage du roi le presse de partir, car l'orage gronde, il tombe des hallebardes, les éclairs fusent.
Monsieur Guitaut, capitaine des gardes, convainc son maître que la meilleure des choses à faire est de se replier sur le Louvre. La reine accueille agréablement son royal époux, lui offrant de partager sa table et plus si affinités. Le destin de la France en dépend. Apparemment, ça marche, puisque deux mois plus tard, le 30 janvier 1638, la reine est enfin grosse du futur Louis XIV !. Et quand la délivrance s'annonce, fin août, les prières publiques se multiplient dans la capitale pour soutenir la nouvelle mère de 37 ans, l'âge à l'époque d'être grand-mère.
Le dimanche 5 septembre 1638, Anne d'Autriche met au monde Louis XIV, au château de Saint-Germain-en-Laye.
On lui donne les noms de Louis, comme son père, et Dieudonné pour remercier Dieu. Le peuple est ravi de voir ses vœux exaucés.
Fou de joie, le nouveau papa fait chanter un Te deum à Saint-Germain à 13 heures le jour même de la naissance, et un deuxième dès le lendemain matin à notre-Dame de Paris en présence du clergé de la capitale, du corps de la ville et de tous les magistrats. Le soir même, il fait tirer le canon à Paris, les échevins font allumer de multiples feux de joie, les cloches des églises sonnent à toute volée. Le vin coule à flots. Le lundi est jour chômé avec processions, prières publiques, exposition du Saint-Sacrement, feu d'artifice. Le mardi, bis repetita, et le mercredi ter repetita. Jamais aucun peuple, dans aucune occasion, n'a montré plus d'allégresse, note Hugo Grotius, un juriste hollandais de passage à Paris.
Le futur Louis XIV, est un enfant surdoué, puisqu'à l'âge de deux jours, il donne ses premières audiences. Plusieurs délégations viennent le complimenter. Le Roi est très fier. À l'ambassadeur de Venise à qui il présente son fils, il déclare :
«Voici un effet miraculeux de la grâce du Seigneur Dieu, car c'est bien ainsi qu'il faut appeler un si bel enfant, après mes vingt-deux années de mariage et les quatre malheureux avortements de mon épouse.»
Il écrit également un billet plein d'enthousiasme à sa tendre Louise Angélique de la Fayette. Le souverain fêtera la naissance en remettant son épouse enceinte trois mois plus tard.
Le roi que l'on appellera plus tard le roi soleil, doit sa conception à un orage...
LE SIÈCLE DE LOUIS XIV de Monsieur de Voltaire
Voltaire a vingt et un an à la mort de Louis XIV. Le 9 septembre 1715, huit jours après la disparition du roi, il a été le témoin des manifestations d'hostilité qui ont accompagné le convoi funèbre sur la route de Versailles à Saint-Denis.
Contemporain de la dernière partie de ce règne long et glorieux, il décide en 1732 d'en écrire l'histoire. Choix surprenant de la part d'un écrivain qui s'est employé à condamner, de façon plus ou moins détournée, l'absolutisme monarchique, l'intolérance religieuse, l'inégalité de la société.
D'ailleurs, l'image que l'on garde dans une grande partie de l'opinion est celle du monarque absolu, de l'adversaire des parlements, du signataire de la révocation de l'édit de Nantes, du roi guerrier insensible à la misère de ses peuples, cette image qu'à fustigée Montesquieu dès 1721 dans ses «Lettres persanes».
En fait, la contradiction n'est qu'apparente. Ce qui séduit Voltaire, c'est la figure du Grand Roi protecteur des lettres et des arts et, à ce titre, bienfaiteur non seulement de ses sujets, mais du genre humain tout entier. Outre qu'exalter Louis XIV est, une fois encore, une manière détournée de critiquer son successeur. L'ouvrage paraît enfin, en 1752, à Berlin et sous un pseudonyme, la première phrase est explicite :
«Ce n'est pas seulement la vie de Louis XIV, qu'on prétend écrire, on se propose un plus grand objet.
On veut essayer de peindre à la postérité, non les actions d'un seul homme, mais l'esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais».
Certes, le roi est au centre du livre, mais s'ordonnent les hommes connus ou anonymes, les relations sociales, et surtout l'éclat des lettres, et des observateurs attentifs que sont Saint-Simon et la Princesse Palatine. Enfin, sont époque, dans sa globalité. Et en tout cas, cela n'est pas une généralité.
En mémorialiste, le duc de Saint-Simon, ne lésine pas sur les détails, parfois croustillants, parfois glauques, lorsqu'il s'agit de relater les petites et grandes intrigues à la cour du Roi Soleil.
Il nous y décrit les habitudes de cet illustre roi, de ses ballades en voitures sur routes poussiéreuses et défoncées qu'il impose, fenêtres ouvertes, par tout temps à toute sa tribu, et, qui seront la cause de beaucoup de fausses-couches parmi les dames de sa cour, à ses conquêtes, ou ses folies de construction, comme son domaine de Marly. Mais tout l'entourage y passe aussi, de Monsieur, frère du roi, à Monseigneur, premier Dauphin... Aux bâtards, charmants termes désignant les enfants de Louis XIV, avec Madame de la Vallière, demoiselle d'honneur de Madame, première épouse de Monsieur Frère du roi, (oui, il faut suivre), et avec Madame de Montespan.
Les bâtards indignent d'ailleurs le duc de Saint-Simon, qui n'admet pas, comme beaucoup à la cour, que ces enfants soient légitimés et aient les mêmes droits et reconnaissances que les princes du sang. Mais, tout de même, ils n'ont pas le droit au trône,(il ne faut pas pousser), même si Louis XIV, voyant la liste de ses héritiers diminués dangereusement, avait pensé en 1714 à accorder le droit de succession, à défaut de tous les princes de sang royal, à ses deux fils bâtards légitimés qu'il avait eus de Madame de Montespan.
Ces mémoires, c'est l'historique des petits et grands événements, des chamailleries entre princes, Ministres, bâtards, jusqu'au spectacle de la fin de règne, et la mort en quelques années de la quasi-totalité de tous les successeurs légitimes du roi, mais aussi ses proches.
Louis XIV perd Monsieur, son frère, en 1701 d'une crise d'apoplexie, qui a fait suite à une violente dispute avec le roi. En 1705, l'aîné du duc de Bourgogne décède en bas âge. En 1711, c'est le seul fils que Louis XIV a eu de la Reine Marie-Thérèse, le Grand Dauphin, qui décède de la petite vérole à l'âge de 49 ans.
En 1712, une épidémie de rougeole emporte le duc de Bourgogne qui est l'aîné des petits-fils du Roi, devenu le nouveau Dauphin à la mort du Grand Dauphin, son épouse la duchesse de Bourgogne devenue la Dauphine et leur fils de 5 ans. En 1714, c'est le plus jeune des petits-fils de Louis XIV, qui succombe après une chute de cheval. Reste un garçonnet de 2 ans, dernier arrière-petit-fils légitime en vie, qui deviendra Louis XV, et évincera du trône les bâtards de Louis XIV.
Louis XIV fut extrêmement éprouvé, par ses deuils successifs et rapprochés.
La princesse Palatine belle-sœur de Louis XIV, qui dressa un portrait réaliste, sans concession ni tabou de la Cour, et qui était mariée en deuxième noce avec Monsieur, frère du roi.8
Elle écrivit 60 000 lettres, à sa tante, à sa famille, mais aussi à toutes les têtes couronnées et pour en avoir lu quelque une, j'ai découvert à travers ses écrits, qui sont parfois directs, voir extrêmement francs, une femme drôle, sensible, intelligente, droite et qui avait de la moralité. Elle a toujours montré envers le Roi du respect, et aussi envers son mari. Elle mourait d'ennui à Versailles, sauf les jours du théâtre.
Nous nous appuierons donc sur ces deux mémorialistes pour illustrer nos propos.
LOUIS XIV LE ROI – SOLEIL de 1638-1715
Le grand siècle de Louis XIV reste marqué par l'image d'un roi absolu et d'un état puissant. Investi très jeune dans ses fonctions, éduqué par le Cardinal Mazarin, le Roi-Soleil pose les fondements de l'absolutisme.
En 1682, il s'installe, entouré de sa Cour, au Château de Versailles, meilleur symbole de son pouvoir et de son influence en Europe. Surnommé, Louis-Dieudonné, Louis XIV naît en 1638, à Saint-Germain-en-laye. Devenu à 5 ans, à la mort de son père Louis XIII, Roi. Le jeune souverain reçoit d'Anne d'Autriche, sa mère, et du cardinal Mazarin, une éducation complète.
Mazarin est officiellement chargé de son initiation politique. Sa mère assure la régence. C'est le temps de la fronde (1648-1653), la rébellion de la haute noblesse et du peuple de Paris. L'enfant se sent humilié par l'arrogance des grands et menacés dans sa capitale. Il s'en souviendra.
Louis XIV épouse à Saint-jean-de-Luz, en 1660, sa cousine germaine, Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Leur union cimente la réconciliation de la France et de son voisin espagnol.
Le Roi et la Reine ont six enfants. Un seul survivra, Louis de France.
En 1683, le Roi épouse secrètement Madame de Maintenon qui succède à ses premières favorites, Mademoiselle de la Vallières et de Montespan avec qui il eut plusieurs descendants légitimés.
HYGIÈNE DE LOUIS XIV
L'apparence prime sur la propreté.
«… La toilette de Louis XIV, décrite par le Duc de Saint-Simon, met en évidence l'absence d'eau. Le seul rituel de lavage qu'observe le Roi-Soleil consiste à se rincer les mains avec de l'esprit-de-vin. C'est que la toilette au XVIIe siècle obéit à de tout autres repères que les nôtres. Elle cherche précisément à éviter l'eau, considérée comme nocive, mais elle fait, en revanche, une très large place aux produits odorants».
Ce qui s'appelle, le camouflage très organisé.
Les médecins pensaient que le bain lui-même est malfaisant pour le corps, que les miasmes de la nature pénètrent d'autant plus facilement à l'intérieur du corps, que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur, laissant un libre passage aux maladies. La toilette se résume donc à des gestes d'ablutions du visage et des mains.
À la place, on va se parer, de parfums, poudres et autres pommades, venus d'Italie et qui sont à la mode. Plutôt que d'éliminer la saleté, on en camoufle l'odeur en usant d'artifices. La propreté est celle du linge, non celle du corps, à Versailles, on change de toilette 5 fois par jour. Se développe alors la «toilette sèche», en se frottant avec des linges.
Ce qui fait que poux et autres bestioles bien sympathiques devaient cohabiter, sur le même individu et que cela ne dérangeait personne.
LA MEDECINE À L'ÉPOQUE DE LOUIS XIV
Dans le malade imaginaire Molière aime se moquer sans retenue des comportements parfois ridicules et risibles des hommes du XVIIe siècle. Du bourgeois prétentieux et envieux au noble désargenté, du dévot que des manières excessives rendent comique, au séducteur insatiable et résolu, nul n'est épargné par les répliques acerbes, d'un valet malicieux.
Les médecins du temps de Louis XIV, subissent régulièrement des attaques ironiques de Molière. Le personnage du praticien vieillissant, jaloux d'un savoir dépassé et inefficace, apparaît à l'occasion d'une scène. Le spectateur s'amuse de ses incompétences, de son orgueil méprisant, de ses habitudes grotesques comme :
«Argan : les médecins ne savent donc rien, à votre compte ?
Béralde : si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser ; mais, pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout».
La caricature ne doit certes pas tromper. Mais, elle se construit sur une réalité existante et révèle l'image que les contemporains de l'écrivain se font de ceux à qui ils confient leur santé.
Dans son ultime chef d'œuvre, le Malade Imaginaire, Molière décrit avec humour sans concession le moment où Argon, dont le rêve est de devenir médecin, se présente à l'examen qui ouvre les portes de la profession.
Les maîtres de l'Université l'interrogent, à tour de rôle, en latin :
«Comment soigner l'hydropisie ?» Le candidat répond:
«Clysterium donare, postea saignare, ensuita purgare».
Ce qui veut dire :
Utiliser le clystère, puis saigner et enfin purger.
L'examinateur donne son avis : «Bene, bene»
Bien, Bien.
Viens l'étude d'un cas pratique : un malade souffre de violents
maux de tête, de fièvres, de douleurs abdominales. Que faire ? Argon à la solution :
«Clystérium donare, postea saignare, ensuita purgare».«Bene, bene.» lui répond-t-on.
Un maître plus malicieux, tente de prendre le futur praticien en défaut :
«Et si, malgré cela, le mal ne se dissipe pas ?
Argon triomphe:
«Clystérium donare, postea saignare, ensuita purgare. Ensuita, resaignare et repurgare».
Le jury applaudit aux brillantes réponses du candidat, le félicite et lui décerne le titre de Docteur en médecine. Ses compétences démontrées à tous, il obtient le droit d'exercer son activité librement.
Les spectateurs s'amusent du comique de la situation. Les acteurs jouent évidemment le rôle qui est le leur, mais, chacun reconnaît derrière leurs mimiques grossières et risibles les attitudes du praticien que l'on consulte parfois à regret.
C'est un fait, la médecine du Roi-Soleil tue davantage qu'elle ne guérit. Aujourd'hui, la chose est inconcevable. Il y a quatre siècles, les populations admettent que les soins prodigués par les spécialistes de la santé puissent emporter un malade affaibli.
Au XVIIe siècle, la saignée est l'une des rares thérapies que l'on connaisse. Les maîtres de l'université, enfermés dans les convictions héritées des savants du Moyen-âge, demeurent persuadés que le sang transporte à l'occasion les - mauvaises humeurs -, responsables de la maladie. Pour combattre le mal, il n'est pas d'autre moyen possible que celui d'évacuer les microbes nocifs par d'abondants saignements que le chirurgien provoque d'un coup de lancette.
On saigne à peu près pour n'importe quel motif. Du nourrisson au vieillard, chacun subit la douloureuse épreuve sans protester, qui oserait d'ailleurs contester le savoir d'un prestigieux docteur, issu des rangs de la faculté !.
La saignée vient à bout de bien des maux croit-on. Elle facilite la percée dentaire du nouveau-né, adoucit la grossesse des femmes enceintes et rend l'accouchement moins douloureux. La duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV, attrape la vérole, l'une des plus terribles maladies d'autrefois. On la saigne à 4 reprises.
Le marquis des Sourches raconte le plus sérieusement du monde qu'un courtisan de Versailles accourt au passage du roi. Il est tant ému qu' en s'inclinant pour la révérence, il heurte violemment du coude son voisin. Un flot de sang volumineux s'échappe du nez blessé. Le médecin que l'on appelle aussitôt prescrit pour soigner le traumatisme... Devinez quoi ? Une saignée !!!
Quand on ne saigne pas, on purge. Quoique différent, le remède est tout aussi désagréable à endurer.
Il s'agit d'introduire à l'aide d'une énorme seringue une grande quantité d'eau aromatisée dans le corps du patient par l'orifice anal. Le liquide injecté doit, pense-t-on, nettoyer les entrailles et permettre l'évacuation rapide des «mauvaises humeurs» responsable d'une douleur à l'estomac, d'un désordre intestinal, d'une digestion difficile. Le roi lui-même ne peut échapper aux purges quotidiennes, et jusqu'à dix-huit en une seule journée !, que lui administre son médecin personnel. Quand cela ne suffit pas, les praticiens disposent de tout un arsenal de potions aussi compliquées à préparer qu'elles sont inefficaces.
En 1665, Anne d'Autriche, la mère du Roi-Soleil, se découvre atteinte d'un cancer du sein.
Les spécialistes se succèdent à son chevet et prescrivent divers élixirs aux savantes compositions. On dépose même sur la poitrine malade des emplâtres de poudres de pierres. Un traitement aussi rudimentaire n'est bien évidemment pas en mesure d'enrayer la progression du mal.
Au bout d'une année, la tumeur a tellement grossi que les chairs en viennent à pourrir, la gangrène s'installe.
Contemplant sa main enflée, la souveraine a une phrase qui en dit long sur ses souffrances :
«Ne mourrai-je pas bientôt». Le 20 janvier 1666, c'est chose faite.
Ce n'est donc pas pour rien que Molière se moque si cruellement des médecins de son époque. Leurs pratiques empiriques et dépassées sont souvent bien davantage responsables de la mort d'un malheureux patient, que de la maladie elle-même.
On ignore la cause des maladies, infectieuses que l'on soigne avec des saignées, purgations, régimes alimentaires, ventouses (système de succion sensé attiré le mauvais sang), bains, etc. On cautérise les plaies avec un instrument rougi au feu.
Le roi Louis XIV, n'échappera pas aux maladies de son temps, variole, scarlatine, rougeole, et survivra grâce à sa constitution robuste. Il sera néanmoins en mauvaise santé toute sa vie, dysenterie, goutte, fièvres, vapeurs, problèmes dentaires, etc. Il sera vaincu par la gangrène à 77 ans, peut être consécutive à un diabète et une septicémie, que l'on ne savait pas soigner à cette époque.
La médecine des anciens reposait sur 4 humeurs : le sang, venant du cœur, la pituite ou phlegme, rattachés au cerveau, la bile jaune, venant du foie, l'atrabile, venant de la rate.
Ce qui est fort peu.
En fine mouche, la Princesse Palatine, nous informe dans une lettre du 22 juillet 1714 ceci :
Extrait :
«... Ce m'est toujours un nouveau sujet d'étonnement que tant de gens aiment le café ; il a pourtant un goût horriblement désagréable. Je lui trouve une odeur d'haleine corrompue : le défunt archevêque de Paris sentait comme ça. Vous avez bien raison de ne pas vous mettre entre les mains d'un chirurgien malhabile. Le mien fait admirablement les saignées, il s'appelle Carrer, mais aussi, je lui permets de rester constamment en exercice : il saigne tout Paris...
Et, comme disait mon bon Molière : «Les choses ont bien changé». Fort heureusement pour nous...
LA FACE CACHÉE DU ROI SOLEIL
C'est probablement la fistule anale dont il commence à souffrir le 5 février 1686, selon le journal du marquis de Dangeau :
«le roi se trouva assez incommodé d'une tumeur à la cuisse et garda le lit tout le jour».
En cette époque, à force de chevauchée, les anus se fissurent. Le souverain n'y échappe pas.
Ses médecins et chirurgiens multiplient les traitements sans aucun effet. Même le nettoyage de la plaie au moyen d'une lancette tranchante s'avère inutile. L'entourage du souverain tente de garder le secret sur son mal, mais la rumeur se répand dans toute l'Europe. Certains envisagent déjà la mort du roi de France.
Ses médecins ne savent plus quoi faire. Un moment, ils envisagent d'envoyer leur illustre patient tremper ses fesses dans les eaux de Barèges, réputées réparatrices dans le domaine. Mais, avant d'entreprendre le lointain déplacement, il est décidé de tester lesdites eaux avec quatre personnes souffrant de la même maladie sous la surveillance d'un chirurgien de l'hôpital de la Charité. Quand elles reviennent quelques semaines plus tard, leur fistule est toujours présente.
Des charlatans espérant faire fortune, assiègent Versailles avec des onguents soi-disant miraculeux. On ne les renvoie pas. Louvois accueille ces docteurs, dans son hôtel particulier à Paris pour qu'ils fassent la démonstration de leur efficacité sur des fistules, trouvées dans la rue. Mais sans succès.
Bref, il ne reste plus que la grande opération, comme on disait à l'époque, à tenter, c'est-à-dire l'ouverture totale de la fistule pour sectionner les chairs corrompues, afin que la cicatrisation puisse se dérouler. Inutile de dire qu'à cette époque dépourvue d'anesthésie et d'antibiotique, l'intervention chirurgicale constitue le dernier recours. Le roi convaincu par Louvois, donne son accord.
Mieux vaut tenter le tout pour le tout que mourir à petit feu. On choisit pour cela le premier chirurgien du roi, Charles-François Tassy, dit Félix, un homme extrêmement compétent, quoiqu'il n'ait jamais opéré de fistule jusque-là. Qu'importe, il se rattrape en se faisant la main sur 75 fistuleux de Paris, réquisitionnés dans les hôpitaux et les prisons. Cela lui permet de concevoir un bistouri spécialement adapté à cette chirurgie, qui restera dans les annales. Sa forme est courbe et il est prolongé par un stylet long, pointu et flexible. À la mi-novembre, notre chirurgien est prêt.
L'intervention se déroulera à Versailles où le roi revient le 15 novembre, après un séjour à Fontainebleau.
Le 16, il visite ses jardins de Versailles à cheval, ne montrant aucune appréhension. Il parle plaisamment avec les uns et les autres. Le dimanche 17, la journée s'écoule normalement sans accro à l'étiquette. Le lendemain matin, le souverain est réveillé vers 5 heures par ses apothicaires venus préparé le champ d'opération à grands coups de lavements.
Une fois ce préambule effectué, les intervenants et les invités arrivent les uns après les autres, à savoir, le père Lachaise, confesseur du roi, le chirurgien bien entendu, les médecins d'Aquin, Fagon, Bessière de Laraye. Enfin Louvois et Madame de Maintenon complète l'assemblée.
Le roi demande calmement à son chirurgien de lui expliquer le fonctionnement de chaque instrument disposé sur la table, car la chambre du roi sert de salle d'opération. Louis XIV s'allonge nu sur son lit, un traversin sous le ventre, dans une position tournée vers la fenêtre.
Un écarteur d'anus en argent lui est alors introduit dans l'orifice. Deux apothicaires lui agrippent les jambes pour les maintenir écartées. Le chirurgien commence par faire une petite incision dans la fistule, pour y introduire le long stylet flexible fixé à l'extrémité du bistouri. Celui-ci, traverse la paroi de l'intestin où le chirurgien attrape délicatement son extrémité avec son index introduit dans l'auguste rectum. Voilà donc notre Félix, avec dans une main le manche du bistouri, et dans l'autre son extrémité flexible. Courageux, Louis XIV ne pousse pas un cri.
Le chirurgien n'a plus qu'à tirer à lui, d'un mouvement sec, son instrument pour ouvrir la fistule sur tout son long. Le roi serre les dents. Le chirurgien coupe avec une paire de ciseaux toutes les callosités encombrant la fistule. Huit coups suffisent.
Le roi n'émet toujours pas le moindre grognement.
L'opération est maintenant presque achevée.
Le chirurgien Félix introduit dans l'anus béant, «une grosse tente de charpie recouverte d'un liniment composé d'huile et de jaune d'œuf», puis enduit la plaie de plumasseaux. Il finit par des compresses et des bandages.
L'intervention a duré trois heures.
L'incroyable courage de Louis XIV qui reprend alors le cours de sa journée avec seulement une heure de retard. Il accueille au pied de son lit les courtisans habituels. Le roi fait prévenir son fils à la chasse et son frère qui est à Paris de la réussite de l'intervention.
Chacun guette une expression de douleur sur la face royale, en vain. Le souverain ordonne que la journée se déroule à l'ordinaire.
Après le déjeuner, il tient conseil comme à l'habitude.
Le lendemain, il reçoit les ambassadeurs étrangers, sans même montrer le moindre signe de fièvre. Au cours des jours suivants, le souverain n'éprouve toujours aucune douleur.
Quinze jours plus tard, cependant, Félix constate que la cicatrisation ne se fait pas correctement. Le 6 décembre, il doit à nouveau manier les ciseaux, puis le 7, il lui faut inciser plus profondément pour que la cicatrisation se déroule dans le bon ordre, depuis le fond de la plaie vers l'extérieur. Cette fois, le roi déguste et doit renvoyer le Conseil à plusieurs reprises. La cicatrisation est enfin en bonne voie.
Le samedi 11 janvier 1687, 54 jours après la grande opération, le roi peut enfin se promener à pied dans l'Orangerie.
En guise de récompense pour son intervention, Félix reçoit une fortune : 50 000 écus (environ 6 millions d'euros d'aujourd'hui), et la terre des Moulineaux de même valeur. Tous les autres médecins sont également récompensés.
De nombreux courtisans demandent à subir la grande opération, plusieurs de ceux qui la cachaient avec soin avant ce temps n'ont plus eu honte de la rendre publique.
«J'en ai vu plus de trente qui voulaient qu'on leur fît l'opération, et dont la folie était si grande, qu'ils paraissaient fâchés lorsqu'on les assurait qu'il n'y avait point nécessité de la faire» (écrit Pierre Dionis, le chirurgien de la reine Marie-Thérèse).
À jamais, l'opération de la fistule de Louis XIV restera dans les annales de la médecine.
Le portrait de Fagon médecin de louis XIV Lettre de la Princesse Palatine, Port-Royal le 15 juillet 1696. Extrait :
«Le docteur Fagon est une figure dont vous aurez peine à vous faire une idée. Il a les jambes grêles, comme celles d'un oiseau, toutes les dents de la mâchoire supérieure pourries et noires, les lèvres épaisses, ce qui lui rend la bouche saillante, les yeux couverts, la figure allongée, le teint bistre et l'air, aussi méchant qu'il l'est en effet. Mais, il a beaucoup d'esprit et il est très politique. Je ne crois pas, je le répète, et vous en conviendrez après cette description qu'il vous eut été possible de vous faire une idée exacte de ce personnage». Guy Fagon (1638-1718), était professeur de botanique au jardin des plantes, il devint médecin du Roi en 1693... D'après la description, il paraît, en plus, mauvais état que ceux qu'il soigne...
LA REINE MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE
épouse de Louis XIV
Fille de Philippe IV d'Espagne et d' Élisabeth de France, Marie-Thérèse naît en 1638, à l'Escurial, palais proche de Madrid. En 1660, suite au traité des Pyrénées, elle épouse Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, mariage qui scelle la réconciliation entre la France et l'Espagne. Elle est décrite comme timide et effacée.
Timide, patiente, douce et très pieuse, elle reste à l'écart du monde de la Cour, ayant des difficultés à parler Français. Elle s'entoure surtout de suivantes espagnoles. En 1666, la mort d'Anne d'Autriche la prive d'un appui précieux. Très admirative de son époux, elle souffre de ses infidélités.
Marie-Thérèse d'Autriche attache de l'importance à son rôle de mère et apporte son soutien à Bossuet, chargé de l'instruction du Dauphin, comme en témoigne leur correspondance :
«Ne souffrez rien, Monsieur, dans la conduite de mon fils, qui puisse blesser la sainteté de la religion qu'il professe, et la majesté du trône auquel il est destiné».
Bien que nommée Régente par louis XIV en 1672, lors de la guerre de Hollande, sa nature l'écarte de toute ambition politique. Elle accompagne le Roi lors de tous ses déplacements officiels.
En 1667, elle participe notamment au voyage dans les Pays-Bas espagnols. Mais en 1683, son périple en Bourgogne et en Alsace l'épuise. À son retour à Versailles, elle tombe malade et meurt brutalement d'un abcès. Le Roi a alors cette phrase cruelle qui montre bien le peu d'intérêt qu'il éprouvait à l'égard de son épouse :
«Voilà le premier chagrin qu'elle m'ait donné».
Et pourtant, Marie-Thérèse, reine de France et épouse du Roi-Soleil, en voyant la belle Montespan au bras de Louis XIV, dira en soupirant «Cette pute me fera mourir...», avec un fort accent espagnol.
LE SECRET DE MARIE-THÉRÈSE
Le 16 novembre 1664, plusieurs dignitaires de la cour attendent, autour du lit, dans la chambre du Louvre où la reine Marie-Thérèse est en train d'accoucher. L'épouse de Louis XIV est bien malade depuis quelque temps, d'où cet aréopage de personnalités. D'après certains témoins de l'époque tels que Madame de Motteville suivante d'Anne d'Autriche, la princesse de Conti, fille légitimée du roi, ou Saint-Simon lui-même, la reine quelques jours avant, son accouchement était dans un état de nervosité terrible, frôlant la dépression. Quand la délivrance vient enfin, stupeur !
Le bébé qui sort du ventre royal n'est pas du rose attendu, mais une petite fille... Noire.
L'abbé de Gordes, aumônier de la reine, s'évanouit pendant que Monsieur, le frère du roi, fait une moue de dégoût, il trouva d'ailleurs que l'enfant avait un air de ressemblance avec le petit maure qui ne quittait pas sa majesté. La Princesse Palatine, belle-sœur du roi, témoignera plus tard que l'enfant était laide, et était morte.
Bourbon-Condé, un des plus importants princes de sang, se met à rire nerveusement et toute l'assistance à sa suite, comme le rapportera dans ses mémoires Mademoiselle de Montpensier, la cousine germaine du Roi-Soleil.
C'est donc vers Nabo, l'un des nains préférés de la reine, que convergent aussitôt les soupçons. Il faut dire que c'était une pratique à l'époque d'avoir des nains à la cour. Notamment à celle d'Espagne où a grandi l'infante Marie-Thérèse.
On ne sait pas qui a donné l'esclave. Il s'agit peut-être d'un cadeau d'ambassadeurs du Dahomey, Bénin actuel.
Quoi ! Nabo ne se serait pas contenté de chastes pirouettes et d'innocentes facéties ?
Comment la reine de France, qu'on dit si pieuse, a-t-elle pu s'enticher de son petit page noir ? On dira aussi que Marie-Thérèse était également très bête, d'une grande bonté, mais parfaitement ignorante, croyant tout ce qu'on lui racontait.
Il n'y a rien d'étonnant, car il y avait entre les maîtresses et leurs esclaves une vraie proximité. Elles se laissaient parfois toucher des parties de leur corps.
Ces jeux ont pu devenir charnels et dégénérés, d'autant que Louis XIV, étaient occupé ailleurs avec ses maîtresses, et délaissait sa femme.
Pour enrayer le scandale qui se propage à la cour, on tente d'étouffer l'affaire, en vain.
On annonça la mort du bébé, mais la petite fille noire fut envoyée loin de Paris, en province peut-être à Cahors, sous la responsabilité d'un valet de confiance.
Adolescente, elle réapparaît chez les chanoinesses de l'abbaye de Notre-Dame-de-Meaux, puis entre dans un couvent de Bénédictines, aujourd'hui disparu, à Moret-sur-Loing, près de Fontainebleau. C'est dans cet édifice borgne que grandit la légende de la Mauresse de Moret, suscitant la curiosité de Saint-Simon ou de Voltaire, qui ira la voir, comme beaucoup d'autres, cette religieuse, extrêmement basanée. Voltaire quittera le couvent avec la quasi-certitude qu'elle est la fille du roi. Marie-Thérèse et Louis XIV était cousin germain, s'il y avait ressemblance, il n'y à rien d'étonnant.
Ce dont elle-même s'était persuadée, après les confidences malencontreuses d'un curé, n'hésitant pas à appeler le Grand Dauphin, mon frère. Ce qui est sûr, c'est que les princes et princesses de France ne manqueront pas de lui rendre visite dans les moments cruciaux de leurs vies, mariage ou évènement. Elle sera entourée des meilleurs soins, par contre, il n'existe pas d'écrits sur la visite du roi.
Quand elle devient religieuse en 1695, à l'âge de 31 ans en prenant le nom de sœur Louise-Marie-Thérèse, c'est en présence de plusieurs hauts personnages. Dont sa mère Marie-Thérèse, qui venait régulièrement de Versailles, mais ne se laissait jamais aller à des effusions maternelles.
Elle a eu jusqu'à la fin une vie sans relief, un destin sacrifié. Elle est morte à l'âge de 56 ans.
Ce qu'il faut savoir, on appelait Mauresse au XVIIe siècle, toute personne à la peau noire, originaire d'Afrique. À cette époque, les personnes de couleur sont fort peu nombreuses en France, reléguées au statut d'esclave, elles sont soit employées dans les ménageries, soit servent d'ornement au sein des familles les plus nobles, notamment à la cour. La couleur de leur peau différente des autres leur avait fait une réputation maléfique.
Et Nabo dans tout ça, que devient-il ? Il paraît que celui-ci mourut subitement quelques jours après l'annonce de la grossesse royale.
En 1779, le portrait de la Mauresse était encore accroché dans le bureau de l'Abbesse du couvent de Moret-sur-Loing.
Il se trouve aujourd'hui à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le dossier l'accompagnant est classé dans les archives de cette même bibliothèque, mais, il est vide, seule la couverture subsiste revêtue d'une inscription.
MONSIEUR, frère de Louis XIV
Philippe de France, frère de Louis XIV dit, Monsieur, est laissé à l'écart de toute gestion politique du royaume. Connu pour préférer ses favoris à ses épouses, plus Parisien que Versaillais, il connaît une victoire militaire en 1677, contre Guillaume d'Orange. Marié en deuxième noce à la Princesse Palatine, il donne naissance aux deux futurs régents qui gouverneront pendant la minorité de Louis XV, au siècle suivant.
Philippe de France est appelé, petit Monsieur, titre alors réservé sous l'Ancien Régime au frère cadet du Roi, pour le distinguer du frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, le Grand Monsieur. À la mort de ce dernier en 1660, il reprend le titre initial de Monsieur, et devient, à 20 ans, chef de la maison d'Orléans.
Quinze ans plus tard, en 1671, après la mort de sa première femme, Louis XIV contraint son frère à épouser Élisabeth-Charlotte de Bavière, dite la Palatine. De cette union naissent trois enfants, dont Philippe d'Orléans, futur régent, et Mademoiselle de Chartres.
Attiré par les costumes féminins et les parures excentriques, entouré de ses favoris et adepte du vice italien, Philippe de France ne se voit confier aucune charge politique par le Roi, qui n'approuve pas son comportement. Il sort pourtant victorieux de la bataille de Cassel le 11 avril 1677, pendant la guerre de Hollande. Guillaume d'Orange est battu.
Monsieur vit entre le Château de Saint-Cloud et le Palais Royal, délaissant la Cour et sa femme, où il introduit Molière et sa troupe. Son château est considéré comme l'autre Versailles. Les jardins dessinés par Le Nôtre et les appartements décorés par le peintre Mignard rivalisent avec le palais de Louis XIV.
Monsieur, eut comme mignons, entre autres, le chevalier de Lorraine et le Marquis d' Effiat,
Mémoires de Saint -Simon :
«le goût de Monsieur n'était pas celui des femmes, mais le goût de Henri III, il ne s'en cachait même pas...» Philippe sera élevé de la manière la plus efféminée, afin qu'il ne puisse jamais devenir un chef de parti et prétendre au trône. Est-ce cette éducation de fille qui a été la cause de l'homosexualité, de Monsieur frère du Roi ? Sûrement pas.
Si Monsieur est très coquet, porte de nombreux bijoux et collectionne les antiquités, ce n'est pas pour autant une folle. Remarquable combattant, il se couvre de gloire sur les champs de bataille et sa bravoure est reconnue par ses soldats qui disaient de lui «qu'il craignait plus le hâle du soleil que de recevoir un boulet !», faisant allusion à l'aversion des aristocrates pour un bronzage qui trahissait le travailleur des champs.
Tordant le cou au cliché qui veut que les homosexuels soient des poltrons, le prince efféminé charge à la tête de ses troupes, l'épée au poing, sous la mitraille. Les nombreuses victoires que remporte Philippe irritent le roi, jaloux de la gloire militaire de son frère.
Après le triomphe de Monsieur sur le prince d'Orange à la bataille de Cassel, Louis XIV refuse désormais de lui confier le commandement de l'armée. Le 30 janvier 1670, le château de Versailles est en émoi. Le bruit court que Madame Henriette d'Angleterre, première épouse de Monsieur qu'il a épousé en 1661, a obtenu l'exil du chevalier de Lorraine, l'amant de son mari.
Jusque-là, le roi avait toléré les amours de son frère, mais le chevalier de Lorraine avait dépassé les bornes en manifestant publiquement sa jalousie vis-à-vis d'Henriette. Louis XIV avait donné satisfaction à l'épouse délaissée en exilant le trop séduisant chevalier. Quelques mois plus tard, Henriette meurt subitement et la rumeur publique accuse le marquis d' Effiat, nouvel amant de Monsieur, de l'avoir empoisonnée avec une potion envoyée par le chevalier de Lorraine. En fait, il est probable que Madame soit morte d'une maladie abdominale héréditaire chez les Stuart.
Monsieur se jette alors au pied du roi, le supplie de rappeler le chevalier de lorraine. La scène du retour en grâce du chevalier est rapportée par Mme de Sévigné, dans une lettre du 16 février 1672 :
«Eh bien, dit le roi, il reviendra, je vous le redonne et je veux que vous m'ayez toute votre vie cette obligation, et que vous l'aimiez pour l'amour de moi... Je fais plus, je le nomme maréchal de camp dans mon armée». Là-dessus, Monsieur se jeta aux pieds du roi, lui embrassa les genoux, et lui baisa une main avec une joie sans égale. Le roi le releva et lui dit :
«Mon frère, ce n'est pas ainsi que des frères doivent s'embrasser. Et il l'embrassa fraternellement».
Quelques mois plus tard, Philippe d'Orléans épouse en secondes noces Élisabeth-Charlotte, princesse Palatine, dont les lettres et les mémoires sont une source précieuse de renseignements sur l'homosexualité de son mari. Raison d'état oblige, celui-ci remplit ses devoirs conjugaux, comme il s'en était montré capable avec Henriette d'Angleterre sa première épouse.
Mais pour honorer la volumineuse Allemande, il consolide sa virilité défaillante avec un chapelet de reliques. Sa femme surprise par cet accessoire, ancêtre du cocring, lui reproche ce procédé peu catholique :
«Je vous demande pardon, Monsieur, mais vous ne me persuaderez point, que c'est honorer la Vierge, que de promener sur son image les parties destinées à ôter la virginité».
Est-ce grâce à cette technique originale que Monsieur fait trois enfants à la princesse, dont le troisième est un garçon, Philippe, qui deviendra le régent du royaume à la mort de Louis XIV, et désigné par le roi.
Ses obligations dynastiques accomplies, Monsieur n'a qu'une hâte, quitter le lit conjugal. Il ne rencontre plus sa femme que dans les réceptions officielles et vit avec ses favoris, dont il épouse les querelles et les prétentions.
La plus extravagante est celle du marquis d' Effiat, qui veut la charge de gouverneur du jeune Philippe. L'amant du père deviendrait le gouverneur du fils !. Monsieur ose appuyer cette demande auprès du roi, mais c'est sans compter sur la princesse rebelle :
«Ce ne serait pas un honneur pour mon fils, si l'on pouvait penser qu'il est la maîtresse d' Effiat, car il est certain qu'il n'y a pas de plus grand sodomite dans toute la France, il a toujours sa chambre pleine de pages et de jeunes garçons. Il donnerait, ma foi, de beaux exemples à mon fils !».
Elle en appela au roi lui-même.
Louis XIV déteste les homosexuels, cependant, il ménage les favoris de son frère qui lui servent d'espions. Il fait semblant de conserver sa faveur à d' Effiat, mais il ordonne à Monsieur de renoncer à lui confier la charge de gouverneur de son neveu. Ce n'est qu'une feinte du souverain pour obtenir des rapports précis sur les intrigues de son frère, tout en obligeant les favoris à influencer Monsieur dans le sens de sa politique.
Bientôt, Monsieur délaisse complètement sa femme qui semble s'accommoder de cette situation. Mais elle n'accepte pas de bon cœur que l'argenterie de sa dot serve à payer les nouveaux mignons de son mari :
«Monsieur a fait fondre et vendre toute l'argenterie qui est venue du Palatinat et a distribué l'argent à ses mignons. Chaque jour, on lui en amène de nouveaux et, pour leur faire des cadeaux, il vend ou met en gage tous ses bijoux. Monsieur dit hautement, et il ne l'a pas caché à sa fille ni à moi, que, comme il commence à se faire vieux, il n'a pas de temps à perdre, qu'il veut tout employer et ne rien épargner pour s'amuser jusqu'à la fin».
Monsieur meurt subitement en 1701.
Le premier soin de la princesse est de brûler les lettres de ses mignons, pour qu'elles ne tombent pas en de mauvaises mains.
«Si l'on pouvait savoir dans l'autre monde ce qui se passe dans celui-ci, feu Monsieur serait fort content de moi, car j'ai cherché dans ses bahuts toutes les lettres que ses mignons lui ont écrites et je les ai brûlées sans les lire, afin qu'elles ne tombent pas en d'autres mains».
Élisabeth-Charlotte montre plus d'indulgence pour l'homosexualité de son mari que l'opinion publique. Elle était donc tolérante, même si elle n'approuvait pas du tout.
Elle dira avec Humour à sa tante ; lettre de Port-Royal du 2 août 1696:
«Si l'on veut recouvrer sa virginité après, n'avoir pas pendant dix-neuf ans couché avec son mari, pour sûr, je suis redevenue vierge...»
Une chanson qui court les rues de Paris, conservée à la bibliothèque nationale, témoigne de la cruauté subie, contre les homosexuels et qui ne date pas d'aujourd'hui :
«Philippe est mort la bouteille à la main. Le proverbe est fort incertain, qui dit que l'homme meurt comme il vit d'ordinaire. Il montre bien le contraire, car s'il fut mort comme il a vécu, il serait mort le vit au cul».
Mais n'oublions pas que le fils de Monsieur, Philippe sera la «tige» des Bourbon-Orléans, l'ancêtre des principaux souverains d'Europe jusqu'au 19e siècle, et de presque tous les princes catholiques vivant ou régnant encore, comme Albert de Belgique. Étonnante lignée pour un prince qui n'aimait pas les femmes !
L'homosexualité à la cour voilà ce qu'elle en dit : lettre du 23 juin 1699, de Saint-Cloud à la Raugrave Louise :
«...Les comtes de Nassau ont l'air de braves enfants. J'espère qu'ils n'apprendront rien de mal ici. Je suis grand gré à nos bons et honnêtes Allemands de ne pas tomber dans l'horrible vice qui est tellement en vogue ici, qu'on ne s'en cache plus, car on plaisante les jeunes gens de ce que tel ou tel est amoureux d'eux, comme en Allemagne, on plaisante une fille à marier. Il y a pis : les femmes sont amoureuses les unes des autres, ce qui me dégoûte encore plus que tout le reste...»
ÉLISABETH-CHARLOTTE DE BAVIÈRE Princesse Palatine
surnommée aussi Liselotte
La Princesse Palatine, Élisabeth-Charlotte de Bavière, grande épistolaire reconnue, peut-être surnommée Madame Europe. Ainsi grâce aux quelque 60 000 lettres écrites par Élisabeth-Charlotte à travers l'Europe, car, elle correspondait avec l'Angleterre, la Suède, le Danemark, les cours de Lorraine, de Savoie et Modène, l'Espagne, la Sicile. On peut retracer sa vie, faite de joies, de peines, et surtout prendre connaissance des mœurs de la Cour... Elle ne mâchera pas ses mots, mais sera juste honnête dans ses écrits.
Aïeule de la plupart des princes catholiques et de Marie-Louise, 2e épouse de Napoléon 1er, arrière grand-mère de Marie-Antoinette et des empereurs Joseph II et Léopold II, arrière petite fille d'un roi de Bohême ainsi que d'un roi d'Angleterre et d'Écosse, née en mai 1652, décédée le 8 décembre 1722, elle fut la 2e épouse de Philippe, Duc d'Orléans, frère de Louis XIV, que l'on appelait Monsieur. (description faite ci-dessus).
Maigrelette à la naissance, elle devient potelée à 6 ans, joue avec les épées et les fusils de son frère, se promène dans le Palatinat à cueillir le raisin, parle patois et écoute les contes populaires. Tiraillée entre des parents désunis, sa tante Sophie de Hanovre la prend sous son aile pendant 5 ans, lui apprend les langues, la danse, la musique, l'écriture, elle gardera un souvenir ému des fêtes de Noël, de Carnaval et de Pentecôte.
Lorsque ses parents lui parlent de mariage, elle a 18 ans, plusieurs prétendants tels Guillaume d'Orange Nassau, le prince du Danemark, le roi de Suède, le prince électoral de Brandebourg, l'héritier du duché polonais de Courlande, mais elle souhaite un vrai mariage d'amour.
Grâce à Anne de Gonzague, Élisabeth-Charlotte se convertit à la religion romaine, puis est mariée par procuration en novembre 1671 au Duc d'Orléans, contrat ou Philippe reçoit tous les biens de son épouse !...
Elle arrive en France complètement abandonnée par sa famille, ne cessant de pleurer pendant les 9 jours de voyage. Les filles sont nées pour obéir. Au moment même où Liselotte, surnom qu'on lui donnait, est conduite à Saint-Germain, résidence de la cour de France, en pleurant comme un veau. Elle dira elle-même qu'elle gueulait ou bramait pendant tout le voyage.
Son trousseau se résume à «une robe de taffetas bleu, une écharpe de zibeline, 6 chemises de nuit et autant de jour».
Madame est surprise à la vue de Philippe de taille modeste, juché sur des talons hauts et paré de bagues, bracelets et pierreries :