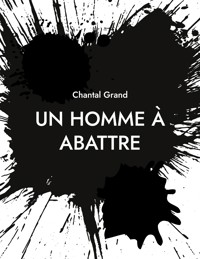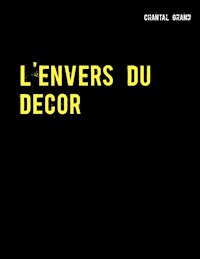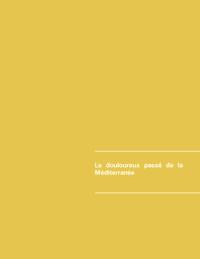
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La méditerranée a des siècles d'une histoire passionnante et très mouvementée. Son passé tragique a laissé des traces dans la culture, la science, la langue, la mémoire. L'Islam a joué un rôle de relais, très important, dans l'épanouissement scientifique du haut Moyen-âge. Madame Taubira Christiane déclara dans l'Express du 4 mai 2006 : "Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane, pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos, tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes " C'est oublier la traite des blancs, restée tabou longtemps. L'histoire ne se réécrit pas. il faut l'assumer pour grandir et regarder vers l'avenir. "Savoir, c'est se souvenir " Aristote.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chapitres
Introduction
Les Origines de la conquête
La traversée des Pyrénées
l'Emirat de Cordoue
Successeur Abd el-Rahman
Abd al-Rahman II, l'âge d'or
Les Taïfas (1031-1086)
Les Almohades
La Bataille de Las Navas de Tolosa
.
Le Royaume de Grenade
La révolte des Morisques 1609
les ethnies du VIIIe au XIVe siècle
La Reconquista
Economie et commerce
Présence sarrasine en France
Histoire du Languedoc-Roussillon
Commune de Passa, PO, le Monastir del camp
Guifred le Velu
Science arabe
Quel héritage les Arabes ont-ils légué à l'Espagne
L'histoire du Commerce en Europe
La Finance italienne et les premières banques
Et, après la reconquista
Les pirates barbaresques ont réussi à tenir en échec
Esclavage des blancs
L'histoire oubliée des blancs réduits en esclavage
La traite des Slaves
La condition humaine, des blancs en terre d'Islam, dans le passé
Pourqoi y a-t-il, si peu d'intérêt pour l'esclavage en Méditerranée ?
L'histoire d'une attaque pirate
Droit de la mer et des littoraux
L'entrée en jeu des marines et de l'US Navy 1801-1805
Conquête de l'Algérie, par la France
Victor Hugo et la conquête de l'Algérie
Les justificatifs idéologiques de la conquête
Conclusions
INTRODUCTION
Al-Andalus, est le nom qui rappelle l'ensemble des terres de la péninsule Ibérique, et de la Septimanie qui furent sous domination musulmane au Moyen-âge ( 711-1492).
L'Andalousie actuelle, qui en tire l'origine de son nom, n'en constitua longtemps qu'une petite partie.
La conquête et la colonisation du pays par les Maures, furent extrêmement rapides, mais aussi imprévues et correspondirent à l'essor du monde musulman.
Al-Andalus devint alors un foyer de haute culture au sein de l'Europe médiévale, attirant un grand nombre de savants et ouvrant ainsi une période de riche épanouissement culturel.
L'historien et islamologue allemand Heinz Halm a démontré en 1989 qu'Al-Andalus, provient de l'arabisation de la désignation wisigothique de l' Espagne « landa-hlauts », signifiant « attribution des terres par tirage au sort », composé de landa – terre – et hlauts – sort, héritage.
Ce terme aurait été repris par les Maures au VIIIe siècle et déformé phonétiquement en al-Andalus.
LES ORIGINES DE LA CONQUÊTE
Après la conquête de la totalité de l'Afrique du Nord, le gouverneur Moussa Ibn Noçaïr, bute sur la ville de Ceuta, qui lui résiste.
Territoire byzantin, comme toute la côte africaine avant l'arrivée arabe, la ville est trop distante de Constantinople pour être secourue efficacement.
Pour se protéger, Ceuta se tourne vers l'Espagne des Wisigoths.
Julien, le gouverneur de la cité envoie même sa fille à Tolède afin qu'elle puisse y parfaire son éducation.
Le comportement du roi Rodéric, qui viole la jeune femme fait pourtant basculer la situation. Julien en colère souhaite se venger, et il conclut un pacte avantageux avec Moussa en lui ouvrant les portes de sa ville, tout en lui vantant les mérites d'une conquête de l'Hispanie.
Pour prouver sa bonne volonté, il met à la disposition des troupes musulmanes ses vaisseaux, mais, Moussa préfère toutefois demander l'autorisation au calife Walid qui lui répond : « Faites explorer l'Espagne par des troupes légères, mais gardez-vous pour le moment du moins d'exposer une grande armée aux périls d'une expédition d'outremer ? ».
Moussa obéit au calife et envoie donc un dénommé Abou-Zora accompagné de quatre cents hommes et cent chevaux qui franchissent le détroit de Gibraltar à bord de quatre navires affrétés par Julien, le gouverneur de Ceuta.
Après avoir pillé les côtes autour d'Algésiras, ils retournent en Afrique au mois de juillet 710.
Satisfait du résultat, Moussa profite des troubles qui occupent le roi Rodéric au nord pour envoyer Tarîq ibn Ziyâd, général de son avant-garde, avec 7 000 hommes.
N'ayant que les quatre navires offerts par Julien, Tarîq réunit ses troupes sur la montagne qui porte aujourd'hui son nom, Gibraltar.
Immédiatement alerté, Rodéric se met en marche contre Tarîq avec une grande armée.
Ne pouvant évacuer ses troupes avant l'arrivée des Wisigoths, le général musulman opte pour l'affrontement direct et demande même à Moussa l'envoi de renforts qui lui offre 5 000 combattants Berbères, si bien que les forces musulmanes s'élèvent à 12 000 hommes, très peu comparés aux armées de Rodéric, dont on estime qu'elles étaient au nombre de 40 000.
Malgré, ce net désavantage numérique, c'est la trahison au sein du camp wisigoth qui aidera les armées musulmanes.
Rodéric ayant contre lui un parti très puissant de nobles qui l'accusaient d'avoir usurpé le trône en assassinant son prédécesseur, Wittiza. Obligés de participer aux guerres de Rodéric, ces nobles n'en gardaient pas moins une haine envers leur roi.
Pour l'anéantir, ils se mettent d'accord afin de le trahir durant la bataille avec les musulmans. Cette trahison n'avait pas pour but de livrer l'Hispanie aux musulmans, car ces nobles pensaient que le but de Tarîq était uniquement de piller la région puis de repartir.
La bataille a lieu sur le rivage du Guadalete le 19 juillet 711. Les deux fils de Wittiza commandent les ailes de l'armée espagnole et finissent par trahir Rodéric qui gouverne le centre. Durant la bataille, il est probable que Rodéric perde la vie, ce qui laisse le pays sans chef.
Tarîq profite de cette situation et contrairement à ce que lui avait ordonné Moussa, mais aussi à ce que pensaient les nobles Wisigoths, il marche en avant. L'avancement des troupes musulmanes est renforcé par le soutien qu'ils rencontrent au sein du petit peuple, mais aussi des Juifs qui ont longtemps été opprimés.
Après avoir conquis Ecija, Tarîq peut à présent envisager la prise de Tolède, la capitale, mais aussi Cordoue, Archidona et Elvira. Archidona, abandonnée par sa population, est prise sans peine, Elvira quant à elle, est confiée à des troupes juives et musulmanes.
Cordoue est livrée à Tarîq par un berger qui lui indique une brèche d'où il peut facilement entrer avec ses troupes, et Tolède est conquise à la suite d'une trahison des Juifs de la Cité. Le commandement de cette dernière est donné à un frère de Wittiza.
En Afrique, Moussa qui avait pourtant ordonné à Tarîq d'y retourner après avoir pillé les côtes ibériques est mécontent. La popularité de son général l'agace et il décide de prendre part à la conquête de la péninsule. Au mois de juin 712, il passe donc le détroit de Gibraltar accompagné de 18 000 soldats arabes et prend Médina-Sidonia et Carmona, puis se met en route vers Tolède où il rencontre Tarîq qui est fortement réprimandé pour sa conquête solitaire de la péninsule.
Le reste de l'Hispanie, sans chef à sa tête, se soumet rapidement à la conquête arabe. Les premières années de la présence musulmane sont assez chaotiques, mais très rapidement les dirigeants musulmans imposent l'ordre et la domination arabe est acceptée par le peuple qui a le droit de conserver ses lois et ses juges, mais voit aussi la nomination de gouverneurs et de comtes locaux. Les serfs qui connaissaient l'exploitation des terres conservent leur rôle, mais doivent reverser au propriétaire du terrain les quatre cinquièmes des récoltes et si les terres appartiennent à l' État ce n'est que trois cinquièmes.
La situation des Chrétiens est très variable, selon les villes et les conditions lors de la signature du traité, mais, en général, ils conservent la plupart de leurs biens. Ils doivent payer à l' État un impôt de 48 dirhams pour les riches, 24 pour la classe moyenne et de 12 dirhams pour ceux qui vivent d'un travail manuel.
Les femmes, les enfants, les moines, les handicapés, les malades, les mendiants et les esclaves en sont toutefois exemptés.
Enfin, l'impôt est levé si la personne se convertit à l'islam.
L'arrivée des Arabes est considérée, comme une source de liberté pour de nombreuses couches de la société.
Durant les rois Wisigoths, le clergé et la noblesse disposaient de nombreux privilèges comme la possession de vastes étendues de terres en partie inexploitées. Lorsqu'une ville capitulait pacifiquement comme à Mérida, Beja ou encore Évora, les nobles wisigoths pouvaient conserver leurs terres, si bien que certains documents attestent de la présence de très riches propriétaires terriens wisigoths jusqu'aux XIIe siècle et l' Église elle aussi pouvait conserver ses terres.
En revanche, si comme à Séville, la ville s'était révoltée à l'arrivée musulmane, les Arabes divisaient les terrains des nobles et les réattribuaient à un grand nombre de personnes comme aux serfs, favorisant ainsi les petites propriétés. Ces derniers, opprimés durant la règle des rois Wisigoths, jouissent d'une certaine indépendance dans l'exploitation de ces terres dans la mesure où leurs nouveaux maîtres sont de piètres agriculteurs et donc laissaient leurs subordonnés cultiver comme, ils le souhaitaient.
Le morcellement des terres ayant appartenu aux nobles Wisigoths a pour conséquence d'améliorer la culture et le rendement des exploitations.
Quant aux esclaves, il leur était extrêmement facile de recouvrer la liberté puisqu'il leur suffisait de se présenter devant les autorités et de prononcer la profession de foi musulmane, ils étaient immédiatement affranchis selon la loi islamique. Ces nouvelles lois ont pour conséquence la conversion de nombreux serfs et esclaves. Pour les plus hautes couches de la société, la conversion permet de ne plus payer l'impôt prévu pour les non-musulmans.
L'arrivée des Musulmans apporte aussi son lot de difficultés et de maux. Bien que le culte chrétien soit libre, l'Église est sous l'autorité musulmane et juive qui préside les réunions. Les sultans nomment les évêques et les traités signés entre Musulmans et Chrétiens s'estompent au fil des décennies.
En 784, soit près de soixante-dix ans après l'arrivée des Arabes dans la péninsule, Abd al-Rahman Ier, impose aux Chrétiens la vente de la moitié de la cathédrale de Cordoue pour cent mille dinars, il viole aussi le traité qu'avaient signé ses prédécesseurs en confisquant les terres d'Ardabast, descendant de Wittiza, uniquement parce qu'il trouve qu'un Chrétien ne peut avoir de terres aussi vastes. Afin d'accélérer le processus de conversion, les impôts que doivent payer les non-musulmans augmentent.
En 714, Tarîq et Moussa sont appelés à Damas pour enquête. Le nouvel émir al-Hurr poursuit de 716 à 719 la conquête et parvient jusqu'aux Pyrénées, détruisant Tarragone et occupant Barcelone. Ses successeurs iront même au-delà des Pyrénées, vers la Septimanie wisigothique, d'où ils lanceront des expéditions vers le nord.
La Septimanie est conquise ( en 719) et Narbonne devient sous le nom d'Arbûna, le siège d'un Wali pendant quarante ans. La capitale d'une des cinq provinces d'Al-Andalus, aux côtés de Cordoue, Tolède, Mérida et Saragosse. Les Musulmans laissèrent aux anciens habitants, chrétiens et juifs, la liberté de pratiquer leur religion moyennant tribut. En 759, Narbonne est reprise par Pépin le Bref et les Musulmans chassés de la Gaule.
L'arrêt de la conquête musulmane en Occident s'explique certes par la contre-attaque des Francs, mais surtout par l'insurrection berbère au Maghreb, appuyée sur le kharidjisme (740).
Les Berbères d'Espagne se soulèvent eux, aussi, formant plusieurs colonnes qui menacent Cordoue et Tolède. Face à ce péril, les Arabes, peu nombreux, ne sont pas unis. Une opposition traditionnelle existe entre Kaisites ( bédouins nomades de l'Arabie du Nord et du Centre), et kalbites ( cultivateurs sédentaires originaires du Yémen). La révolte berbère est malgré tout matée par le kaisite Baldj, avec quelques milliers de Syriens qui avaient été évacués de Ceuta assiégé, et qui restèrent finalement en Espagne.
Par ailleurs, des nobles wisigoths se réfugient dans les zones montagneuses du nord-ouest de la péninsule ( dans l'actuelle région des Asturies). Vaste, montagneuse et pauvre cette région est difficile d'accès.
Or, les Arabes désireux de se concentrer sur la riche vallée du Rhône ou l'Aquitaine, ne souhaitant pas et surtout ne peuvent pas du fait d'un manque de soldats, se lancer dans une longue guerre contre cette poignée de fuyards trop faibles pour les menacer. Ignorée par les émirs andalous, cette communauté se développera et initiera ultérieurement, la Reconquista.
Une frontière tacite au nord, l' Èbre et du Douro donne naissance à un no man's land émaillé de citadelles et de châteaux, berceau de la future Castille.
À partir de 720, les conflits internes s'aggravant alors que la tendance kaisite l'emporte. Durant cette période de confusion, le pays voit de 711 à 726 la succession de 21 gouverneurs qui prennent de plus en plus d'indépendance par rapport au califat de Damas.
Le premier gouverneur, un certain Ayyub, désigné probablement par le camp berbère après de difficiles tractations avec les Arabes, est un homme pieux et sans grande autorité.
Le nouveau gouverneur prend la décision de déplacer la capitale du pays de Séville à Cordoue, afin de satisfaire les populations berbères nombreuses dans la ville. Cette décision est d'autant plus notable qu'il ne demande la permission ni à Suleiman gouverneur d'Afrique ni encore moins au calife de Damas, signe de la volonté d'émancipation de la péninsule.
Les impôts et le tribut ne sont plus envoyés à Damas, et bien que lent à réagir, Suleiman gouverneur d'Afrique décide d'envoyer de nouveaux gouverneurs, dont l'un nommé Al-Sahm parviendra partiellement à réconcilier les différents clans.
Une grande révolte des Berbères éclate ( 739) dans le Maghreb occidental et se répercute en Espagne. D'abord victorieux à Cordoue, ils seront vaincus et doivent quitter pour certains la péninsule. La guerre civile perdurera pendant une quinzaine d'années.
Le renversement des Omeyyades par les Abbassides a pour conséquence l'émancipation de l'Espagne.
Abd al-Rahmân, petit-fils du dernier calife Omeyyade, se réfugie en Afrique du Nord, parmi les Berbères dont sa mère est issue. Son affranchi Badr, lui ayant obtenu le ralliement des Syriens et d'une partie des kalbites d'Espagne, il passe dans ce pays et s' empare de Cordoue en 756, où il se proclame émir.
LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES
Au VIIIe siècle, les premiers Musulmans arrivent en France, et s'installent dans les environs de Toulouse, Narbonne, dominée par les Wisighots, à une population romanisée héritière de l'Empire romain d'occident.
La ville dispose toujours des murailles de l'époque romaine, chantées par l'évêque Sidoine Apollinaire en 465 et dont les fragments sont toujours visibles dans la ville et au musée lapidaire. Selon une histoire locale connue des Narbonnais, les Sarrasins seraient entrés dans la ville par surprise, à l'automne 719 ou 720, en profitant de l'ouverture des portes en cette période des vendanges.
Cette hypothèse explique pourquoi la ville fut si facilement conquise, en dépit de ses ouvrages défensifs, et fut si longue à reprendre. L'incertitude quant à la date exacte de la prise de la ville est un élément de plus qui laisse à penser à une prise des fortifications de la ville, plus que de la ville elle-même, qui semble avoir été épargnée à l'exception de ses défenseurs.
Le chef musulman, Al-Samah, troisième gouverneur d'Espagne, fait mettre à mort les hommes ayant tenté de défendre la cité, déporter leurs femmes et enfants en Espagne et installe une garnison. La ville est le siège d'un Wali. Al-samah, habile politique, après avoir rétabli l'ordre en Espagne, vint assiéger Narbonne, la prit et en tua les habitants. Puis des hordes d'Arabes vinrent, suivies de leurs femmes et de leurs enfants, s'établir dans le Languedoc, avec l'intention d'occuper le pays. Narbonne devient dès lors la place-forte des musulmans en France.
Son port, assurait leurs communications avec la mer, et sa forte position pouvait les rendre maîtres du pays.
Al-samah se porta sur Toulouse, mais Eudes, duc d'Aquitaine sauva sa capitale par une victoire où Al-samah fut tué.
En vain, les habitants du languedoc, essayèrent de reprendre Narbonne, une guerre à mort s'engagea, et elle durait encore, sans avoir amené de résultat, lorsque Ambiza, successeur d'Al-samah, franchit les Pyrénées en 724. Carcassonne, Nîmes tombèrent en son pouvoir et :
« le vent de l'islam, dit un auteur arabe, commença dès lors à souffler de tous les côtés contre les chrétiens ».
Toute la septimanie, l'Albigeois, le Rouergue, le Gevaudan, le Velay, l'Auvergne méridionale, furent dévastés, incendiés, dépeuplés, puis de là, les Sarrasins fondirent sur Lyon, qu'ils pillèrent en 732.
Mâcon, Châlons, Beaume, Autun, la Franche-Comté, le Dauphiné, furent ravagés à leur tour, sans que Eudes, accablé ou Charles Martel, en guerre avec la Germanie, opposassent la moindre résistance. Il fallait l'arrivée d' Abd-er-Rahman, au gouvernement de l'Espagne, et son projet de conquérir la Gaule tout entière, pour que la situation change.
Abd-er-Rahman, avait rassemblé une armée, il prit sa route à travers l'Aragon et la Navarre, entra en France, par les vallées de Bigorre et de Béarn, brûlant Oloron, Aire, Bazas, Bordeaux, Libourne, Poitiers. Il s'avançait sur Tours, attiré par les richesses de l'abbaye de Saint-Martin, lorsqu'il apprit l'arrivée de Charles Martel, accouru pour s'opposer :
« À cette tempête qui renversait tout, à ce glaive pour qui rien n'était sacré ».
Les Musulmans imposent aux habitants, chrétiens et juifs, le statut de Dhimmi qui les autorise à pratiquer leur religion d'une manière strictement encadrée et leur impose de payer un tribut. Ils deviennent des citoyens de conditions inférieures, dans leur propre pays.
Les Arabes sont défaits ( en 721) par Eudes d'Aquitaine aux portes de Toulouse, Al-Samah, trouve la mort et l'armée musulmane bat en retraite.
De cette courte période ( 40 ans à Narbonne tout de même), il ne reste aujourd'hui que peu de traces qui se résument à quelques pièces de monnaie éparses.
Du point de vue du califat de Bagdad, la province de Narbonne n'avait qu'une faible importance, l'ancienne Gaule et l'Europe en général étant secondaire, comparées aux richesses de l'Inde et de la Chine.
Ambiza succède à Al-Samah.
Carcassonne et Nîmes sont prises ( en 725), puis les Sarrasins commencent à remonter le Rhône. Les Arabes pénètrent à Avignon et arrivent aux portes de Lyon. Ambiza trouve la mort à son tour.
Ils traversent la Bourgogne où ils assiègent Autun le 22 août 725, et pillent Luxeuil.
Avec l'aide de Mauronte ( en 735), duc de Marseille, Arles est conquise. Il est difficile d'apprécier l'importance du peuplement musulman au nord des Pyrénées.
Les Musulmans se sont-ils établis comme en Andalus, avec un véritable projet de peuplement ou bien leur présence, c'est-elle limitée au stationnement de contingents militaires dans les principales villes ?
L'historien Paul Diacre (VIIIe siècle), indique que les Sarrasins « ont pénétré dans la province Aquitaine de Gaule accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, comme pour l'habiter », mais les villes prises n'ont été occupées que quelques années et leurs environs ne semblent pas avoir connu de foyer de peuplement majeur.
D'autre part, il n'existe aucun vestige archéologique de présence musulmane durable et significative à Narbonne, ni dans les environs, en dépit d'une discussion sur la présence éventuelle d'une mosquée dans un atrium de la ville, ce qui serait un endroit singulier.
Toutefois, les historiens sont partagés sur le but réel de cette avancée en territoire franc. Colonie de peuplement ou simple razzia hors d'Espagne ?
Les raids, les pillages d'églises et de monastères pourraient laisser penser à une entreprise de pillage sans aucun but que celui d'amasser le maximum de richesses. Mais, d'un autre point de vue, cette technique de harcèlement permettait d'affaiblir une région en vue de la conquérir plus facilement par la suite.
Après la défaite de la Berre, la garnison arabe de Narbonne subsiste à l'abri des importants ouvrages défensifs de la ville, mais son rôle de relais pour les expéditions et razzias n'est plus significatif.
En 759, à l'arrivée de Pépin le Bref dans la région, les habitants se soulèvent et les derniers Mauresques évacuent la ville définitivement.
Certainement, la résistance de la région de Narbonne et la bataille de Berre ont porté le coup d'arrêt à l'expansion musulmane en Europe occidentale, ainsi que le note le géographe arabe Zuhrî, au XIIe siècle, à propos de sa visite de la ville.
On y trouvait la statue sur laquelle était inscrit : « Demi-tour, enfants d'Ismaël, ici est votre terme !. Si vous me demandez pourquoi, je vous dirai ceci : si vous faites demi-tour, vous vous battrez les uns, les autres jusqu'au jour de la Résurrection ».
C'est entre Tours et Poitiers que se livra la bataille que l'historiographie officielle monta en épingle. Les Francs remportèrent la victoire et firent de cette victoire, qui n'avait rien de décisif, la poursuite des incursions sarrasines dans le Midi de la France, pendant encore des siècles à le prouver amplement. Un outil des propagandes pour la monarchie franque. Quoi qu'il en soit, Abd-re-Rahman avait été tué, et les Arabes s'étaient sauvés vers la Sud. Charles, satisfait de les avoir empêché de traverser la Loire, rentra dans ses États, et joignit à son nom cette terrible épithète de Marteau, parce que :
« comme il martiaus débrise et froisse le fer et l'acier, et tous les autres métaux, aussi froissoit-il et brisoit-il, par la bataille, tous les ennemis et toutes autres nations ».
Mais en fuyant les sarrasins dévastèrent la Marche, le Limousin, et revinrent à Narbonne. Abdel-Malek, successeur d'Abd-re-Raham, résolut de reprendre l'offensive :
« Tel qui fut vaincu hier, disait-il aux Arabes consternés, triomphe aujourd'hui »
Il attaqua les chrétiens du nord de l'Espagne, puis il rétablit la domination des Arabes dans la Septimanie et la Provence, secondé par quelques comtes goths avides de pouvoir. Il prit Arles et Avignon, et s'il n'eût éprouvé une défaite dans la Cantarbrie, les sarrasins seraient redevenus aussi redoutables qu'avant leur désastre de 732.
Cependant, ils prirent Valence, Vienne, Lyon, et attaquèrent la Bourgogne et le Piémont.
Enfin en 735, Charles Martel, allié avec Luitprand, roi des Lombards, envoya une armée contre eux. Childebrand son frère, qui la commandait, battit les Arabes, les chassa devant lui, et prit Avignon.
Luitprand et Charles Martel marchèrent sur Narbonne, battirent les Arabes sur les bords de la Berre. Mais, ne pouvant prendre Narbonne, il résolut de détruire les fortifications de toutes les villes de la Septimanie, afin de ne laisser aux Sarrasins d'autre place que Narbonne. Ce fut alors, qu'on brûla les arènes de Nîmes.
En 739, Charles Martel revint en Languedoc, fit occuper Marseille, et les sarrasins de Narbonne n'osèrent plus s'avancer au de là du Rhône. De plus, les guerres civiles qui eurent lieu à cette époque entre les Arabes d'Espagne et d'Afrique, donnèrent aux chrétiens d'Espagne et de la Septimanie de nouvelles forces, et lorsque en 752, Pépin le Bref ( fils de Charles Martel) vint attaquer Narbonne, une armée assez faible la bloqua et la força de se rendre en 759.
Ainsi, la France était provisoirement délivrée de la présence des sarrasins.
Ce ne fut qu'en 792, que le calife de Cordoue, Hescham, résolut de reprendre la Septimanie, en levant une armée pour pénétrer en France.
En 793 Charlemagne ( petit fils de Charles Martel), étant occupé à faire la guerre contre les Avars, que les sarrasins passèrent les Pyrénées et se dirigèrent sur Narbonne, impatients de reconquérir un boulevard où ils s'étaient maintenus si longtemps. Guillaume, comte de Toulouse, marcha à leur rencontre, mais les Francs furent vaincus à Villedaigne, entre Narbonne et Carcassonne.
Cependant, les Arabes ne purent s'emparer de Narbonne.
Cette invasion détermina Charlemagne à les attaquer, et, dans ces guerres dont nous ne parlerons pas ici, les provinces entre l'Èbre et les Pyrénées tombèrent au pouvoir des Francs. Charlemagne assura ainsi ses limites au midi.
Toutefois, les pirates arabes d'Afrique, qui depuis longtemps infestaient la Méditerranée, commencèrent à ravager les Côtes de l'empire de Charlemagne. Déjà, entre 728 et 739, ils avaient pillé le monastère de Lérins. Mais, à partir de cette époque, leurs invasions en France, devinrent plus redoutables.
La Corse, la Sardaigne, les îles Baléares, furent dévastées, en 806, 808, 809, 813.
Charlemagne fit établir des forts au lieu de débarquement, et des flottes pour repousser les ennemis. Tant qu'il vécut ces moyens et la terreur de son nom suffirent pour préserver les côtes de ses États.
Après sa mort, les sarrasins recommencèrent leurs courses.
En 820, la Sardaigne fut ravagée.
Vers 838, Marseille, fut livrée au pillage.
La mort de Louis, le Débonnaire, et les guerres qui eurent lieu, entre ses enfants, laissèrent aux sarrasins le champ libre. Aussi les embouchures du Rhône, puis Marseille en 848, furent-elles dévastées. Une armée partit d'Espagne s'avança en France, et ne se retira que comblée de présents par Charles le Chauve.
En 869, les pirates sarrasins firent une nouvelle invasion de la Camargue. En 889, ils s'établirent sur les côtes de Provence, à Fraxi, et, dans le golfe de Saint-Tropez, et de ce point, leurs ravages s'étendirent dans toute la vallée du Rhône, et jusqu'aux frontières de l'Allemagne.
En 906, les sarrasins sortirent de ce repaire, et ravagèrent le Dauphiné et la vallée de Suse. En 908, des pirates africains saccagèrent les environs d'Aigues-Mortes. En 920, les Arabes d'Espagne passèrent les Pyrénées, et poussèrent jusqu'aux portes de Toulouse.
Pendant ce temps, les environs de Fraxinet se trouvaient entièrement dévastés. Marseille, Aix, Sisteron, Gap, Embrun, furent successivement pillées. La Savoie, le Piémont et la Suisse, n'étaient pas, malgré les Alpes, à l'abri des attaques des sarrasins.
En 940, Fréjus et Toulon furent prises. Toute la contrée fut dépeuplée. Le mal devint tel, que Hugues, comte de Provence, fit alliance avec l'empereur grec pour prendre Fraxinet.
En 942, Hugues et les Grecs s'emparèrent, en effet, de ce port si important. Mais Hugues apprenant que l'Italie, qu'il convoitait, allait passer à son rival Bérenger, fit alliance avec les Arabes et leur rendit Fraxinet pour pouvoir disposer de ses forces contre son adversaire.
Dès lors, la puissance des sarrasins alla toujours croissant. Il n'entre pas dans notre sujet de parler ici de leurs invasions en Italie.
Contentons-nous de dire, qu'ils vinrent cent jusque sous les murs de Grenoble, dont ils se rendirent maître.
Une victoire de Conrad, en 952, fit chanceler leur puissance.
En 960, on leur enleva le mont Saint-Bernard, et les communications entre l'Italie et l'Allemagne, et la France, furent rétablies.
En 965, ils furent chassés du diocèse de Grenoble, puis postérieurement à 972, de Sisteron et de Gap.
De toutes part, les seigneurs féodaux, secondés par le peuple et excités par le clergé, se soulevaient contre les envahisseurs.
Enfin, vint le moment de la délivrance, Guillaume, comte de Provence, appela à lui tous les guerriers de la Provence, du bas Dauphiné et du comté de Nice, et résolut de prendre Fraxinet. D'abord, les sarrasins furent vaincus à Trourtour près de Draguignan, puis malgré leur résistance, obligés de fuir de Fraxinet. C'est vers 975 que la France, fut enfin délivrée de ces terribles incursions. Ceux qui ne furent pas tués, devinrent serfs et se fondirent peu à peu dans la population.
Il fallut bien que les Arabes se résignassent à regarder la France, comme étant à l'abri de leurs atteintes. Ils s'en consolèrent en disant que :
« Les Français, étant exclus d'avance du paradis, Dieu, avait voulu les dédommager en ce monde par le don de pays riches et fertiles, où le figuier, le châtaignier et le pistachier étaient leurs fruits savoureux ».
Il y eut bien encore depuis cette époque des attaques partielles.
En 1019, contre Narbonne, en 1047, contre Lérins, etc...
Mais ces attaques tiennent moins à l'histoire des invasions sarrasines proprement dites qu'à celle de la piraterie des Barbaresques, qui allait durer jusqu'au début du XIXe siècle, elle furent pour la France, l'un des motifs de la prise d'Alger en 1830.
L' ÉMIRAT DE CORDOUE
En 750, le calife Omeyyade s'éteint avec la défaite de la bataille du Grand Zab, et toute la famille est assassinée par les Abbassides, hormis Abd al-Rahman Ier. Après avoir franchi la Palestine, l' Égypte puis l'Afrique du Nord, avec sans cesse la volonté d'arracher une terre où il peut gouverner, le dernier héritier Omeyyade comprend, qu'il lui est impossible d'affirmer son autorité au milieu de ces vastes étendues composées d'une grande multitude de populations et de tribus.
Finalement, après maintes péripéties, il réalise que son unique issue serait d'atteindre la péninsule ibérique où la famille Omeyyade compte encore beaucoup de partisans.
Au mois de juin 754, Badr un homme de confiance d'Abd Al-Rahman franchit le détroit de Gibraltar, avec dans ses mains une lettre indiquant la volonté de ce dernier, d'accéder au trône si la population andalouse l'accepte. La lettre est favorablement acceptée au sein de la noblesse andalouse qui y donne un avis positif, mais préfère demander toutefois la permission du gouverneur, Yusuf al-Fikri et de son subordonné Al-Sumayl. Les deux hommes se disputent immédiatement à propos de cette lettre, Yusuf un homme faible de caractère, accepte la proposition d'Abd Al-Rahman, mais ce n'est pas le cas d'Al-Sumayl, qui décide de prendre les armes. Les envoyés d'Abd Al-Rahman, décident de se tourner vers les Arabes d'origine yéménite adversaires d'Al-Sumayl.
Fort du soutien de deux tribus arabes et doté d'une somme confortable Badr achète un bateau qui part immédiatement vers l'Afrique où l'attend le descendant Omeyyade qui embarque pour Almunécar ( Al-Munakab), dans la province de Grenade à l'est de Malaga.
Pendant un moment, Abd al-Rahman se laissa conseiller par ses partisans, conscients des risques de son entreprise.
Yusuf, proposa à Abd al-Rahman une de ses filles en mariage ainsi que des terres.
Ceci représentait moins, que ce qu'il espérait obtenir, mais il se serait résigné à s'en contenter si l'insolence d'un des messagers de Yusuf, un renégat espagnol, n'avait pas outré Obeidullah, un des chefs loyaux aux Omeyyades. Il se gaussa de l'incapacité d'Obeidullah à bien écrire l'Arabe. En réponse à la provocation, Odeidullah dégaina son épée.
Désormais appuyé par les Kalbites, en 756, Abd al-Rahman mena une campagne, dans la vallée du Guadalquivir qui se termina le 16 mai par la déroute de Yusuf et sa fuite de Cordoue. Les troupes d'Abd al-Rahman étaient faibles. Abd al-Rahman aurait été le seul à disposer d'un bon cheval de guerre, mais ayant lui-même, une mère berbère issu d'une tribu originaire du Maroc actuel, de la tribu dite Nafza plus exactement, il s'intègre facilement et arrive à enrôler de nombreux soldats arabes et berbères, au sein de son armée. N'ayant pas de bannière, ils en improvisèrent une avec un turban et une lance. Ce signe devait devenir le symbole des Omeyyades d'Espagne.
En juillet, Abd al-Rahman officialisa son alliance avec les Kalbites. Un mois plus tard, il devint mâlik ( roi), et émir d'al-Andalus marquant ainsi la scission avec les Abbassides d'Irak et faisant de son pays la première région à se détacher du califat de Bagdad, ce qui ne manque pas d'inquiéter ces derniers qui craignent que d'autres gouverneurs prennent exemple sur Abd al-Rahman pour proclamer leur indépendance.
Le long règne d'Abd al-Rahman fut principalement marqué par de nombreuses mises à l'ordre des Arabes et des Berbères pour les rallier sous un même mandat.
Il mate une rébellion (en 759 ), fomentée par l'ancien Émir qui se termina par l'exécution de ce dernier.
Il doit affronter ( en 763) dans sa propre ville des partisans à la solde des Abbassides. Cette révolte menée par un certain Al-Ala Mughit Al-Yahsubi, qui lève étendard noir ( ce n'est pas nouveau) des Abbassides prennent rapidement de l'ampleur, après une vigoureuse attaque, Abd-al Rahman parvient à les vaincre et fait couper, saler et tremper dans la naphtaline la tête des meneurs, avant de les faire envoyer au califat d'Orient en guise d'avertissement.
En 777, Ibn Arabi, gouverneur de Saragosse désireux de prendre son indépendance traverse les Pyrénées et demande l'aide du roi Franc Charlemagne et, dès 778 une grande armée se met en route vers la Catalogne. La menace par Abd al-Rahman était de taille. Mais, une révolte des Saxons au nord, qui sont parvenus au Rhin et menaçaient, Cologne obligea Charlemagne à retirer son armée.
C'est durant le voyage du retour que Charlemagne et ses hommes sont attaqués, à Roncevaux par les Vascons et où Roland, héros d'une des plus célèbres chansons de geste, et Duc de la marche de Bretagne, meurt.
SUCCESSEUR Abd al - RAHMAN
Dans ses dernières années, Abd al-Rahman dut également déjouer et réprimer brutalement une succession de complots dans son Palais, permettant de poser solidement les bases de la dynastie qui assura le contrôle de l'Espagne aux Omeyyades jusqu'en 1031. Il fit également construire la mosquée de Cordoue qui fut achevée peu avant sa mort.
Le génie d'Abd al-Rahman est certainement d'avoir posé les bases d'un nouvel état inspiré du modèle de Damas, chose que ses prédécesseurs n'avaient pas pensé à faire. Se plaçant comme émir ou roi ( malik), jamais Abd al-Rahman ni ses descendants jusqu'à Abd al-Rahman III n'oseront prendre le titre de calife ( khalifat Al-Rasul). L' émir gouverne le pays, et nomme les chefs des armées, les juges et les hauts-fonctionnaires.
Durant la fin de sa vie, il s'attellera à construire à Cordoue une mosquée que ses descendants agrandiront et amélioreront sans cesse. Il divise le pays en province avec à leur tête un Wali et la province la plus importante étant celle de Cordoue.
À la fin de sa vie Abd Al-Rahman décide de mener une enquête discrète pour déterminer qui de ses deux fils, Suleiman ou Hicham, pourra gouverner le pays. Blond aux yeux bleus né après l'arrivée de son père dans la péninsule, Hicham est un homme pieux et cultivé qui s'entoure de savants et de poètes contrairement à son frère Suleiman qui préfère les plaisirs mondains.
À la mort de leur père, c'est donc son fils Hicham Ier, alors âgé de 30 ans, qui monte sur le trône. Furieux, son frère Suleiman décide de prendre les armes et parts de Tolède. La bataille entre les deux frères a lieu à Jaén où Suleiman est battu, il sera chassé du pays et expulsé vers l'Afrique du Nord, où on n'entendra plus parler de lui.
Hicham Ier, poursuivra l'œuvre de son père, et mis à part des révoltes mineures dans la région de Tortosa et Saragosse le règne du nouveau calife est paisible. Il se caractérise par sa piété, s' habillant d'une extrême simplicité.
Il parcourait les rues de Cordoue afin de rendre visite aux pauvres et aux malades, distribuant la monnaie aux voyageurs et demandait à son peuple de faire de même. La période de stabilité que connaît le pays permet à Hicham de lancer des attaques contre les royaumes chrétiens qui menaçaient les frontières de l'émirat. Il attaque Castille en 791, et les Asturies en 793. Il expulse les Francs de Gérone et de Narbonne en 795, il s'empare d'Astorga dans les Asturies.
À la même époque vivait de l'autre côté du monde musulman, à Médine le juriste et fondateur de l'école qui porte son nom l'imam Mâlik ibn Anas. Lorsqu'on rapporte à ce dernier, le comportement de l'émir Omeyyade Hicham, il ne tarit pas d'éloges envers ce dirigeant, voyant en lui l'idéal du gouverneur musulman face aux Abbassides qu'il considère comme des usurpateurs.
Bien que, cela puisse paraître secondaire, de cette union entre les deux hommes va naître une lignée de juristes dont l'Espagne a grandement besoin.
Hicham encourage vivement les échanges avec l'imam Mâlik et le malikisme deviennent la branche officielle de l'islam sunnite d'Al-Andalus. Au moment de la mort d'Hicham, d'illustres juristes comme le Berbère Yahiya, un des plus brillants élèves de l'imam Mâlik, enseignent le droit en Espagne.
Hicham 1er, meurt à l'âge de trente-neuf ans ( en 796), et c'est son fils Al-Hakam qui est choisi. Son règne est marqué par une flambée de violence intérieure et extérieure.
L'année de son arrivée au pouvoir, Alphonse II des Asturies, un oncle de Hakam ainsi que le gouverneur de Barcelone rencontrent Charlemagne et lui proposent une action au-delà des Pyrénées.
Se souvenir du terrible échec qu'il avait subi au temps d'Abd Al-Rahman Ier, Charlemagne hésite, mais finalement en 798, son fils Louis le Pieux décide d'entreprendre une guerre en Andalus.
En 801, Charlemagne créée la Marche franque de Barcelone, qui défend son empire et commence réellement la Reconquista.
Inquiets des contacts directs de Charlemagne avec Bagdad, l'émir Al-Hakam, se résigne à cette situation et accepte de signer avec l'empereur franc des traités entérinant la frontière sur l'Èbre entre 810 et 812.
Moins de cinq ans, après son arrivée sur le trône, Al-Hakam assiste donc impuissant à la perte de Barcelone trop occupé à mater les rébellions internes, comme avec les Banu Qasi, qui dominaient la vallée de l'Èbre, mais aussi avec des bandits berbères, habitant les montagnes et ne descendant que pour piller les villages des alentours. L'armée d'Al-Hakam, incapable de les arrêter, car encore trop nombreuse, était constituée de nombreux mamelouks ( soldats esclaves), éléments chrétiens et notamment slaves, regroupés sous le nom générique d'Esclavons, dont Al-Hakam en fait sa garde personnelle.