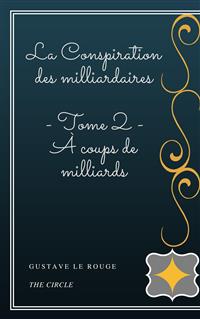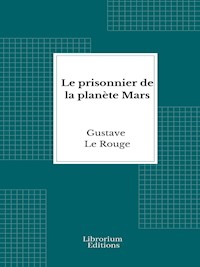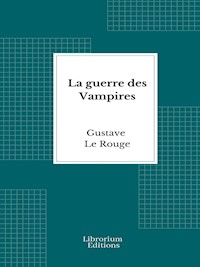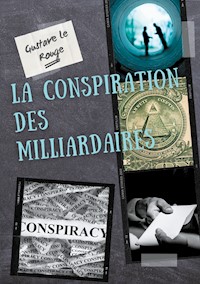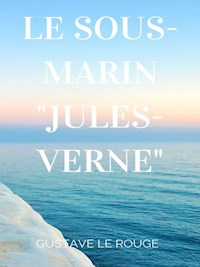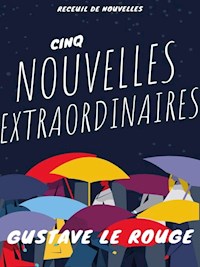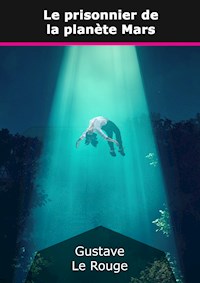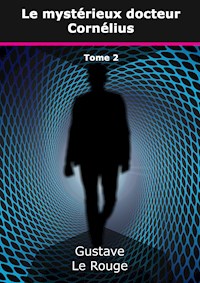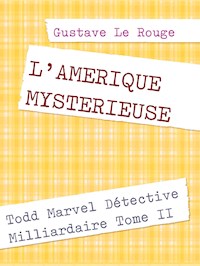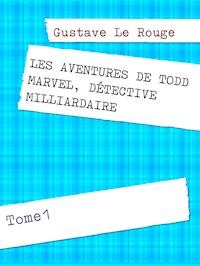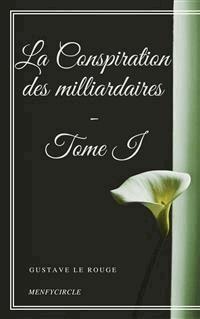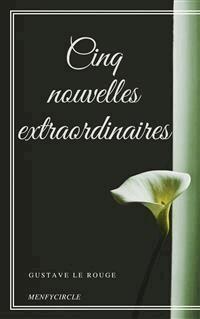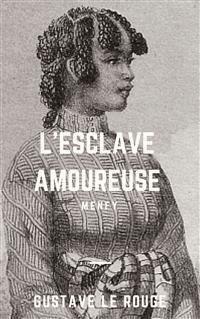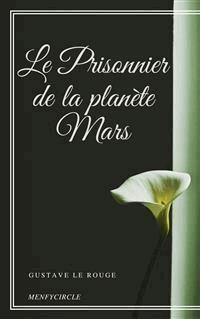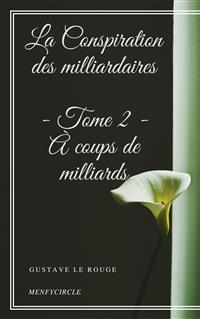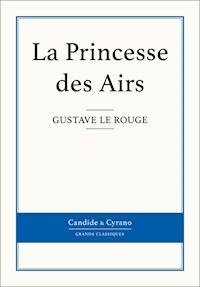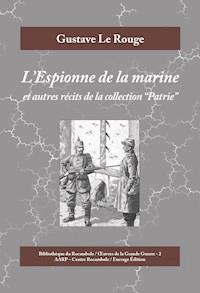
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encrage Édition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Œuvres de la Grande Guerre
- Sprache: Französisch
Souvenirs, témoignages et chroniques de la Grande Guerre
De 1917 à 1921, Rouff fait appel à des romanciers populaires pour alimenter sa collection « Patrie », dédiée aux récits et témoignages de guerre.
Ce volume reprend les cinq titres signés de Gustave Le Rouge, alors correspondant de guerre, qui propose, tour à tour, des témoignages indirects : journal d’un otage ou souvenirs d’un prisonnier, ou encore relation sur la ville de Reims, victime des bombardements ennemis ; mais aussi un témoignage vécu au front, avec la mort d’un confrère, journaliste du
Petit Parisien. Enfin, un récit d’espionnage sur les côtes anglaises qui est plus dans la veine du romancier.
Ces divers écrits relatent tour à tour différents épisodes de la Première Guerre mondiale
EXTRAIT
— Il y a un siècle que je ne vous ai vue, Mme Gervais !… Reims n’est pourtant pas une grande, grande ville, mais malgré cela, dès que l’on n’habite plus le même quartier, on arrive à négliger ses amies !… J’avais, justement, une course à faire ce matin, à l’Hôtel de Ville, c’est ce qui me permet d’avoir la bonne fortune de vous rencontrer !
— Moi, je vais avenue de la Paix, j’ai une commission pour Marthe…
— C’est vrai !… Vous devez être très occupée, en ce moment !… Toutes mes félicitations !… J’ai reçu le faire-part, je ne manquerai pas d’assister à la bénédiction nuptiale… C’est pour le 3 août, n’est-ce pas ? A Saint-Rémi ?…
— Oui… Saint-Rémi est notre paroisse.
Deux femmes causaient ainsi, sur la place Royale, le matin du 30 juillet 1914.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Gustave Le Rouge est né en 1867 et mort en 1938. Auteur de nombreux romans d'aventures empreints d'une touche de fantastique, Gustave Le Rouge s'est illustré dans plusieurs genres, notamment le théâtre, les essais et la poésie. Il se lie d'ailleurs d'amitié avec Paul Verlaine et Blaise Cendrars, qu'il rencontre lorsqu'il est reporter au
Petit Parisien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :
www.lerocambole.net
Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie
Bibliothèque du Rocambole
Œuvres de la Grande Guerre - 2
collection dirigée par Alfu
Gustave Le Rouge
L’Espionne de la marineet autres récits de la collection “Patrie”
1917-18
AARP — Centre Rocambole
Encrageédition
© 2012
ISBN 978-2-36058-907-4
Avertissement
de Philippe Nivet
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie
Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits
Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journalFillette, la presse illustrée, commeL’IllustrationouLe Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.
Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.
Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».
Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.
Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.
Préface
d’Alfu
En 1880, Jules Rouff crée une maison d’édition dont une large partie de la production — d’abord sous forme de fascicules en collection puis de volumes vendus à bon marché — sera consacrée à la littérature populaire. On lui doit entre autres, une belle édition illustrée en couleurs des aventures de Rocambole par Ponson du Terrail.
Durant la Grande Guerre, son fils, Frédéric, qui reprend la direction de la maison familiale, décide de créer, en 1917, une collection de petits livrets de 24 puis 32 pages, au format 14 × 19 cm, destinée au plus vaste public, pour faire état de la guerre sous tous ses aspects, à la fois du côté des combattants et du côté des civils, avec en fond un discours patriotique destiné à valoriser le martyre des Français et dénoncer la barbarie des Allemands.
Pour cela il sollicite des auteurs qui connaissent bien leur métier d’écrivain : les auteurs populaires qui ont déjà fait leurs preuves et ont été publiés par la maison Rouff ou par d’autres.
Ainsi, parmi les 39 signatures qui vont apparaître dans la collection, retrouve-t-on Léon Groc — alias parfois Paul Carillon ou Jacques Mongis, — Jean Petithuguenin et Georges Spitzmuller, eux-mêmes combattants, mais aussi Georges-Gustave Toudouze et d’autres, plus éloignés du front.
Gustave Le Rouge (1867-1938) a d’abord fréquenté les symbolistes et les décadents. En 1890, il rencontre Paul Verlaine dont il devient intime. Mais il commence à écrire des romans fantastiques ou de science-fiction avec Gustave Guitton : La Conspiration des milliardaires (1899-1900) et La Princesse des airs (1902). Il poursuit bientôt sa carrière seul, avec, entre autres, Le Prisonnier de la planète Mars suivi de La Guerre des vampires (1908-09) et surtout Le Mystérieux docteur Cornélius (1912-13).
C’est donc l’un des meilleurs romanciers populaires de son temps qui accepte l’offre de Rouff auquel il va livrer cinq récits très différents, mais représentatifs de la palette proposée par la collection « Patrie ».
Le premier volume, Reims sous les obus (n°22, 1917), fait, à travers le destin de quelques civils pris dans la tourmente, le portrait de la ville martyre, victime de la barbarie allemande dont le crime est physique mais aussi culturel :
« Le monument subsistait, mais ce n’était plus qu’un squelette. Les barbares ont, de propos délibéré, pour le plaisir sauvage de détruire, voulu abattre ce temple, anéantir toutes les traditions de gloire qu’il abritait. Ils ont cru, peut-être, abattre la France en la terrorisant ; ils ne sont parvenus qu’à se couvrir de honte aux yeux du monde civilisé. » (29)
Mais leurs victimes ne se laissent pas faire, à l’image du maire, le Dr Langlet. Et cela est efficace, car « l’Allemand qui est brutal et cruel avec le faible, hésite dès qu’on lui tient tête » (17) !
Et déjà apparaît le thème de l’espion qui facilite la tâche des agresseurs : « Comme on le sait, ils avaient à Reims un grand nombre d’espions et ils étaient admirablement renseignés » (19).
L’espion, ou plus particulièrement l’espionne, est le personnage central du deuxième récit, L’Espionne de la marine (n°26, 1917), dont l’action se déroule en Angleterre.
On se rappelle que Le Rouge a déjà écrit des récits d’espionnage dont l’un met en scène une espionne — mythe très ancré à l’époque et qui fera florès après le procès et l’exécution de Mata-Hari : La Dame noire des frontières (1914).
Non seulement, encore une fois, les Français et leurs alliés doivent combattre des ennemis visibles mais il leur faut encore se défaire des ennemis invisibles, de ceux qui peuvent apparemment être des amis ou des proches.
Victime innocente par excellence, l’otage est le personnage du récit suivant : Journal d’un otage (n°34, 1918). Et au premier rang, dans une commune, le maire.
Son action s’inscrit dans l’Histoire :
« Son grand-père était maire de Senlis au moment de l’invasion des alliés, en 1815 ; son père l’était en 1870 et avait été décoré pour sa belle conduite. Le fils allait continuer les traditions. » (67)
Ici, Le Rouge en profite pour dénoncer sous une autre forme les exactions allemandes :
« Un désordre inextricable régnait partout. Il n’y avait pas une chambre qui n’eût été bouleversée et souillée. Les meubles avaient été fracturés, les tiroirs jetés sur le parquet ; des armoires anciennes défoncées, les glaces brisées, les tentures arrachées, les sièges éventrés, et, par-dessus le chaos des objets détruits pour l’unique plaisir de les détruire […] » (77)
L’ennemi est donc d’autant plus odieux qu’il n’agit pas pour les nécessités de la guerre mais seulement par plaisir de nuire !
Le quatrième récit, Souvenirs d’un prisonnier (n°39, 1918), écrit sous le pseudonyme de P. Trubert, est l’occasion d’évoquer la désinformation dont se rendent coupables les Allemands.
« Le matin, à l’heure de la soupe, on nous annonça que l’avant-garde de l’armée de von Kluck était à quinze kilomètres de Paris, le président Poincarré était assassiné, la révolution ensanglantait la capitale… » (97)
Et, un peu plus loin est nommément cité l’authentique Journal des Ardennes, organe rédigé en français pour « informer » les populations des territoires occupés par les Allemands.
Enfin, bien sûr, sont dénoncées les conditions d’existence dans les camps de prisonniers :
« De terribles nouvelles nous parviennent alors des camps voisins, de Langensalza, de Cassel, où de formidables épidémies de typhus se sont déclarées. Les Français et les Russes meurent par milliers. » (111)
Pour finir sa collaboration avec « Patrie », Le Rouge propose Le Carnet d’un reporter (n°62, 1918), qui est un récit autobiographique.
On peut penser authentique l’anecdote qui le fait embaucher comme correspondant de guerre par le journal L’Information et les événements qui s’en suivent, jusqu’à la mort, au front, de son collègue du Petit Parisien, Serge Basset1.
Ce récit est l’occasion pour lui — par l’intermédiaire de son propre personnage — de répondre à une rumeur qu’il dénonce, tout en invitant les journalistes à la prudence :
« Empêcherez-vous les imbéciles […] de dire que les articles des journalistes du front sont faits à tête reposée, sur une table de café de l’arrière ? Non ! Vous avez le souci de la vérité et je vous loue hautement, mais permettez-moi, mon cher confrère, de vous dire qu’en bien des cas la recherche de la vérité n’oblige pas à commettre des imprudences. » (142)
Ces cinq volumes de la collection « Patrie », qui en comprendra finalement 154, sont très intéressants à plusieurs titres.
Certes, comme témoignage sur les événements de la Grande Guerre, ils sont à lire avec prudence — même s’ils recoupent souvent d’autres sources avérées. Mais ils sont tout à fait révélateurs de la mentalité de guerre qui habite la population française durant les années de conflits.
Par ailleurs, ils sont une démonstration — peu fréquente dans l’histoire de la littérature populaire — du talent des romanciers de fiction au service d’une « cause ».
Après Gaston Leroux, Gustave Le Rouge apporte une belle pierre à l’édifice.
1Lire l’article publié dansLe Petit Parisienle 1erjuillet 1917.
Reims sous les obus
1.
Veille de mariage
— Il y a un siècle que je ne vous ai vue, Mme Gervais !… Reims n’est pourtant pas une grande, grande ville, mais malgré cela, dès que l’on n’habite plus le même quartier, on arrive à négliger ses amies !… J’avais, justement, une course à faire ce matin, à l’Hôtel de Ville, c’est ce qui me permet d’avoir la bonne fortune de vous rencontrer !
— Moi, je vais avenue de la Paix, j’ai une commission pour Marthe…
— C’est vrai !… Vous devez être très occupée, en ce moment !… Toutes mes félicitations !… J’ai reçu le faire-part, je ne manquerai pas d’assister à la bénédiction nuptiale… C’est pour le 3 août, n’est-ce pas ? A Saint-Rémi ?…
— Oui… Saint-Rémi est notre paroisse.
Deux femmes causaient ainsi, sur la place Royale, le matin du 30 juillet 1914.
Celle qui avait abordé Mme Gervais était une bonne vieille modeste rentière, dont la vie tout entière s’était écoulée dans sa ville natale, ayant pour unique horizon les tours de la cathédrale ; pour passe-temps, les petits potins chez la voisine.
L’autre était grande, à la figure énergique, les cheveux noirs parsemés de fils d’argent, on devinait, en la voyant, la mère de famille, la femme du foyer.
On aime à bavarder, en province. Il est certain qu’on ne s’en prive guère à Paris, mais, en province, on peut mieux causer dans les rues, où le mouvement est moins intense que dans la capitale, on se rencontre souvent, aux mêmes heures, aux mêmes endroits, on se connaît davantage, on se conte plus facilement ses affaires qu’à Paris, où les voisins de palier, la plupart du temps, s’ignorent !
Les deux femmes se rencontraient, c’était l’occasion de faire la causette.
— Ça vous fera une fille de plus, total, quatre enfants, pas vrai ?… reprit la petite vieille.
— Quatre enfants, oui, Mme Mercier !… Mais, en réalité, ça me change rien !…
— C’est juste, c’est vous qui avez élevé Marthe, vous l’avez avec vous depuis la mort de sa mère ? Voilà bientôt, dix ans, à ce que je crois !… Comme le temps passe !
— Eh oui ! Marthe avait neuf ans.
— Vous étiez très intime avec sa mère !…
— Oui, et feu mon mari était aussi très lié avec son père. Quand sa femme est morte. M. Fillot — il est mort depuis, le pauvre ! — m’a dit : « Ma chère Marie m’a laissé cette enfant. J’ai peur de la mettre en pension… C’est pour elle que je vais travailler à présent, mais il faut qu’en ma qualité de représentant en vins de Champagne, je voyage beaucoup !… — Bon, bon ! lui ai-je de suite répondu ; donnez-moi Marthe, je m’en charge », et voilà !…
— Vous n’avez pas eu à le regretter, je crois, car Marthe est une travailleuse, une couturière émérite ! Pierre, votre fils, a un bon métier…
Il est mécanicien à l’usine Charon, du quartier de la Laine, il y est entré en sortant de l’Ecole des Arts et Métiers de Châlons, y a six ans. Il l’a quittée pour accomplir son service ; il a retrouvé son poste l’an dernier, quand il a été libéré.
— Alors, il a vingt-quatre ans ?… Comme ça pousse ; moi qui l’ai vu au maillot ! Et vos deux petites ?
— Mes deux petites, Jeanne, l’aînée, a dix-sept ans, Madeleine, la plus jeune, a quatorze ans. Elle va entrer à l’école professionnelle… Jeanne, elle, prépare l’Ecole normale… Toutes deux, comme vous voyez, ont encore besoin de moi !… En ce moment, elles sont en vacances et m’aident dans les préparatifs de la noce… Marthe n’a pas quitté son atelier de couture, elle y retourne encore demain, de même que mon fils retourne à l’usine. Après, ils prendront quinze jours de vacances, pour faire un petit voyage de noces…
— Ils ont bien raison !
— Oh ! ils ne seront pas malheureux ; tous deux gagnent largement leur vie. Marthe a un petit avoir qui lui revient de son père et, de plus tout le berloquin 1de ses parents !…
— Vous le lui avez conservé ?…
— Mais, oui, Mme Mercier… Le berloquin, n’est-ce pas la richesse de l’ouvrier, c’est le mobilier acheté petit à petit, grâce au travail du père, aux économies de la mère. Marthe a celui de ses parents, elle y ajoutera plus tard ce qui lui plaira, mais à ce sujet elle pense comme moi… Ces meubles, témoins de l’existence des siens, évoquent trop de souvenirs pour qu’elle consente à s’en débarrasser !…
— Et elle a bien raison !… Je l’approuve. Moi, je crois que j’aimerais mieux mourir tout de suite plutôt que de me voir dépouiller de mon berloquin !… Je me dis parfois : « S’il arrivait que ta maison brille et que ton mobilier flambe, ma pauvre vieille, vaudrait autant brûler avec lui !… » Allons, faut pas songer à des choses si tristes ! quoique, cependant, il paraît que nous sommes dans une crise qui pourrait bien amener la guerre !…
— Bah ! on dit ça ! Voilà quarante ans passés qu’on en parle !…
— Oui, mais cette fois paraît que c’est sérieux. Vous n’avez donc pas lu les journaux ?…
— Je ne comprends pas grand-chose à ce qu’on raconte !… Votre fils saura mieux vous expliquer ça que moi. On dit que depuis l’assassinat de l’archiduc d’Autriche, ça gronde fort du côté de l’Allemagne et de la Russie !… Et alors, ça pourrait bien nous entraîner !… Tout ça, après tout, ce n’est peut-être que des on-dit !… Néanmoins, avez-vous su que la maison de champagne Mumm a fermé ?… Le patron est parti en Allemagne !…
— Voyage d’affaires !… Allons, au revoir, Mme Gervais, à mardi !
— Ben oui, ben oui !… espérons encore que tout s’arrangera !…
— Au revoir, Mme Mercier !…
Les deux femmes se séparèrent.
Les paroles de Mme Mercier résonnaient péniblement aux oreilles de Mme Gervais, tandis qu’elle revenait de sa course à l’avenue de la Paix.
Si nous avions la guerre, pensait-elle, Pierre devrait partir de suite !… C’est affreux !…
Et l’idée lui vint de faire un détour pour passer devant la cathédrale. En regardant la statue de Jeanne d’Arc, qui semble si petite et si frêle en face de l’imposante basilique, elle ne put s’empêcher d’invoquer la bonne Lorraine :
— N’est-ce pas, Jeanne, que si les ennemis envahissent notre territoire, on les jettera hors de France !…
Après cette invocation Mme Gervais rentra chez elle. Les enfants l’attendaient pour le déjeuner.
C’était un couple ravissant que formaient les deux fiancés. Pierre, grand, fort, musclé, brun, les yeux vifs, était dans toute la robustesse de ses vingt-quatre ans. Beau garçon, sans avoir rien du bellâtre, il avait vraiment grand air sous sa cotte bleue de mécanicien. Il y avait de la distinction dans ses manières, de la bonté dans son sourire, de la volonté dans son regard.
Marthe était de taille moyenne, elle avait les traits fins, les cheveux blonds. Elle paraissait sans doute un peu mièvre, mais gracieuse et fière de se sentir aimée et protégée par ce beau garçon qui avait été le compagnon de son enfance.
Et les deux sœurs, Jeanne et Madeleine, entouraient de leur affection et de la grâce de leur jeunesse ces deux êtres qui allaient s’unir.
En entrant, il sembla à Mme Gervais que Pierre et Marthe avaient soudain composé leur visage.
— Mes enfants, leur dit-elle, vous me cachez quelque chose !… J’ai été tellement absorbée ces temps-ci, que je n’ai prêté aucune attention aux journaux, que je n’ai pas pris garde au mouvement des rues depuis plusieurs jours… Il a fallu que je rencontrasse Mme Mercier ce matin, pour qu’un mot d’elle m’enlevât le bandeau que j’avais sur les yeux… Et toi-même, Pierre, pourquoi ne m’as-tu rien dit ?… Nous allons avoir la guerre, n’est-ce pas ?…
— Mais non, maman, répondit le jeune homme, on parle de mobilisation, simplement !… La mobilisation, ce n’est pas la guerre !…
— Pour moi, c’est tout comme !… Et, si on mobilise, tu pars.
— Le deuxième jour, maman, il faut que je rejoigne à Châlons !…
— Mais alors, ton mariage ?…
— Ceci ne me regarde pas seul !… Et, la première à consulter, c’est Marthe !… Elle sait que je ferai ce qu’elle voudra !…
— Pierre, répondit noblement la jeune fille, dont les yeux clairs s’illuminèrent, je t’ai donné ma parole !… Quels que soient les événements, tu es mon fiancé !… Je n’ai qu’un mot à ajouter : Fais ton devoir !… Je ne voudrais pas être ta femme si je te savais capable d’hésiter, un seul instant, à servir la patrie !…
1Berloquin, pécule, fortune, économie ; expression rémoise.
2.
Les Allemands à Reims
Le deuxième jour de la mobilisation, le 3 août, devait être le jour de son mariage ; Marthe accompagna à la gare son fiancé qui partait rejoindre son régiment à Châlons.
Devant Mme Gervais, dont les yeux étaient embués de larmes, devant les deux jeunes sœurs, Jeanne et Madeleine, qui ne pouvaient cacher leur chagrin, la courageuse fiancée resta calme, maîtresse d’elle-même. Sa voix, en disant adieu au bien-aimé, trembla bien quelque peu, mais elle sut dominer son émotion jusqu’après le départ.
Alors seulement, lorsqu’elle se trouva avec les trois femmes, elle mêla ses pleurs aux leurs, mais sa volonté reprit aussitôt le dessus.
— Maman, dit-elle, vous avez toujours été une femme énergique et je vous admire autant que je vous aime !… Aujourd’hui, il faut plus de courage que jamais !… Je vous promets de vous aider à en avoir !…
La maison de couture où travaillait Marthe ferma ses portes, la jeune fille revint seconder la mère de son fiancé. Elle intéressa ses sœurs à divers travaux de couture, pour que l’ennui n’apportât pas le découragement. Elle fut l’âme de la maison. Et, la semaine ne s’était pas écoulée, qu’à l’abattement compréhensible de la première heure avait succédé chez Mme Gervais, la ferme résolution d’envisager l’avenir avec confiance !…
Les semaines s’écoulèrent. Pierre donnait assez exactement de ses nouvelles… Il était en Alsace. Les journaux parlaient de succès. On avait franchi la frontière ; l’armée française, après un brillant combat, s’était emparée d’Altkirch, elle était aux portes de Mulhouse.
D’un autre côté, la Belgique repoussait vaillamment l’envahisseur ; la résistance de Liège était héroïque et nous permettait d’arriver en forces, pour repousser les Allemands !…
Puis les communiqués devinrent de moins en moins bons. La face des choses changeait. C’était le désastre de Charleroi et la retraite…
Quelques habitants de Reims, en petit nombre, surtout ceux qui n’avaient aucune attache dans le pays, commencèrent à quitter la ville. Le 2 septembre, les journaux de Paris n’arrivèrent plus, la poste cessa de fonctionner. A Mme Gervais qui commençait à broyer du noir, Marthe prodigua les encouragements ; elle trouvait dans son cœur les mots qui consolent et qui rendent l’espoir :
— Pourquoi nous inquiéter du manque de nouvelles, déclarait-elle carrément ; on ne peut pourtant pas inventer des mensonges ; pourquoi vous étonner de ne pas recevoir de lettres de Pierre ? Le gouvernement retarde toutes les correspondances de peur d’indiscrétion. Patientons, ma chère maman, ayons confiance !…
Mais brusquement, le 4 septembre, les Français évacuaient la ville à neuf heures du matin, et les Allemands y entraient le jour même, à quatre heures du soir.
Le premier acte des Allemands, après leur entrée dans la ville, fut de faire des réquisitions très fortes en pain et autres denrées nécessaires à l’alimentation de leurs troupes.
Le Dr Langlet, maire de Reims, avec une énergie et un sang-froid dont il ne devait pas se départir un seul instant, tint tête aux exigences des soudards de l’état-major teuton.
Comme l’intendant en chef saxon du XIIe corps d’armée réclamait, à titre de garantie de la fourniture des denrées réquisitionnées, une caution d’un million, le maire répondit fièrement :
— Je sais que mes protestations sont vaines et que je dois m’incliner devant la force. Je ne le fais que dans le but d’éviter à mes concitoyens des représailles que vous ne manqueriez pas d’exercer. Les fils de la France de 1914 ont appris ce dont vous étiez capables en 1870. La caution que vous demandez sera versée, mais vous en fournirez reçu !… Je n’ignore pas que ce reçu ne signifie pas grand-chose, pour vous qui n’avez aucun respect pour les chiffons de papier… Mais ce sera un document pour l’avenir !… Et le jugement des peuples appréciera !…
— L’Allemagne est au-dessus de tout ! répliqua le Saxon. D’ailleurs, Reims sera ville d’empire avant peu…
— Ce n’est nullement certain !…
— L’armée française est battue !…
— Pas encore !
— Nous serons à Paris dans huit jours !…
— Je ne le crois pas, mais, en tout cas, donnez-moi le reçu que je vous demande !… C’est à cette condition seulement que la somme vous sera versée !…
L’intendant en chef de la XIIe armée s’exécuta.
L’Allemand qui est brutal et cruel avec le faible, hésite dès qu’on lui tient tête. C’est sans doute pour cette raison que l’ordre fut donné par leur état-major aux officiers de payer leurs achats chez les commerçants. La plus grande partie se contenta de remettre des bons, moyen très simple et très pratique d’obéir tout en ne déboursant rien !…
Mais, tandis que les officiers supérieurs étaient en conférence à l’hôtel de ville, un sifflement prolongé, suivi d’une détonation, vint jeter l’émoi parmi eux.
— Que se passe-t-il ? s’écria l’intendant avec stupeur… Est-ce que les Français attaquent ?…
— Non, lui répondit-on, ce sont les Allemands qui bombardent !…
— Ce n’est pas possible, grommela le Saxon interdit, quelle idée auraient-ils de se mettre à bombarder une ville où nous sommes déjà ?… Ce n’est pas possible !…
Les officiers partageaient l’étonnement de leur chef ; ils se disposaient à aller aux renseignements quand un soldat leur apporta un culot d’obus récemment tombé. Ils comprirent alors qu’ils étaient bel et bien bombardés par leurs camarades !
Sans l’ombre d’une excuse, puisque tous les abords de la ville avaient été évacués et qu’ils en avaient été informés, pendant une grande demi-heure les Allemands continuèrent le feu.
* * *
— Veux-tu, maman, demanda Marthe en préparant le petit-déjeuner du matin, veux-tu que nous allions à Saint-Rémi ?….
— Est-ce prudent ?…
— Que veux-tu qu’il nous arrive ?… Nous sommes quatre femmes, nous ne sommes pas armées, n’avons-nous pas le droit d’aller où nous voulons ?…. Du reste, tout est calme. Le bombardement n’a pas repris hier, et ne reprendra sûrement pas aujourd’hui. Ils ne vont pas tirer sur leurs propres soldats, je suppose !… C’était une fausse manœuvre, certainement !…
Mme Gervais ne protesta pas davantage. Jeanne et Madeleine furent vite habillées. On partit.
Dans les rues, des troupes et des convois des IIe et IIIe corps de l’armée prussienne défilaient sans discontinuer, se dirigeant vers la Marne, vers Epernay et Montmirail.
— Oh ! maman, quel malheur, regarde !… s’exclamèrent soudain les jeunes filles en passant devant l’église de Saint-Rémi.
Le petit portail était balafré par les obus ; une grande fenêtre, ornée de superbes vitraux, entièrement démolie. Au retour, après l’office, la mère et ses filles furent de nouveau, douloureusement, impressionnées. Près de la cathédrale qui, heureusement, n’avait pas encore été atteinte, plusieurs maisons étaient sérieusement endommagées, l’immeuble du journal local entièrement détruit.
— Oh ! les vandales ! les vandales ! Vont-ils être victorieux ? murmura la mère en rentrant, hantée par la vision des ruines.
— Victorieux ? répliqua Marthe. Ils ne le sont pas encore, ils ne le seront pas !… Ne t’effraie pas ainsi, ma bonne mère ; est-ce que la visite des taubes et des zeppelins, les semaines précédentes, t’a effrayée ?… Non !… Crois-tu que la morgue des officiers prussiens est capable de m’intimider ?… Non va, ce n’est pas la soldatesque boche qui triomphera !…
— Hélas ! ma chère petite, il n’en est pas moins vrai que nos armées reculent !
— Si Pierre était là, maman, il te dirait que ce recul est une nécessité stratégique… Mais si la muraille des poitrines françaises recule devant le flot des envahisseurs, elle ne se rompt pas !… Tant qu’une bataille décisive ne sera pas livrée, tant que la muraille vivante ne sera pas renversée, nous ne devons pas considérer les Allemands comme nos vainqueurs !…
Marthe avait raison…
Quatre jours après leur arrivée, les occupants faisaient leurs préparatifs de départ. Les raisins de la Champagne n’avaient point mûri pour eux !
Le jeudi matin 10 septembre, les allées et venues d’estafettes se succédant presque sans interruption au quartier général allemand, le brusque départ d’une partie des troupes, et aussi un défilé tout autre que celui de la semaine précédente éveillèrent à nouveau l’attention des Rémois.
Les colonnes de soldats qui passaient remontaient vers l’est, et, derrière les régiments, de lourds chariots suivaient, remplis d’objets de toutes sortes : ustensiles de ménage, meubles, pendules, glaces, outils de jardinage, jusqu’à des coffres-forts et des pianos !
Couchés, vautrés plutôt, sur des matelas et des couvertures volées, comme le reste, dans les maisons des villages abandonnées, les pillards étaient mornes et semblaient découragés.
Ces forbans ne chantaient plus, ils ne criaient plus : « A Paris !… A Paris !… » Ce n’étaient plus des triomphateurs, mais des bandits emportant le produit de leurs vols et fuyant devant l’approche de l’armée française.
Au loin, la canonnade grondait et le bruit se rapprochait sans cesse, C’était la voix souveraine de la Patrie irritée !
D’heure en heure, les nouvelles se répandaient dans la ville. Les cœurs anxieux des habitants, qui s’étaient armés de patience et de résignation, s’ouvraient de nouveau à l’espérance. La ruée allemande fléchissait, il n’y avait plus à en douter ; du reste, les soldats et les blessés qui arrivaient en grand nombre disaient que le Xe corps allemand et la garde étaient particulièrement éprouvés.
Brusquement, vers quatre heures de l’après-midi, le dernier régiment quitta la ville. A cheval, en auto, à pied, les officiers de l’intendance et leurs hommes suivirent, se dirigeant du côté de Rethel. Le tir de l’artillerie française était d’une précision effroyable et fauchait impitoyablement les fuyards !…
Cette fois, c’était bien la retraite.
Sur les hauteurs, au sud de Reims, les boches essayaient encore de résister. Mais nos soldats se précipitaient dans leurs lignes, sous la mitraille, et les délogeaient dans un élan admirable. A neuf heures du soir, les troupes françaises entraient dans la ville par la porte de Paris.
Dans leur précipitation, les ennemis avaient laissé leurs blessés dans l’ambulance installée dans la cathédrale.
D’ailleurs, les Allemands, avant de partir, avaient mis au pillage toutes les maisons riches, toutes les collections de tableaux et d’œuvres d’art. Comme on le sait, ils avaient à Reims un grand nombre d’espions et ils étaient admirablement renseignés ; ils possèdent la liste de tous les objets de quelque valeur que pouvaient posséder les particuliers.
Dans la hâte de leur fuite, heureusement, ils n’eurent pas le temps de se livrer à un déménagement aussi méthodique qu’ils l’ont fait depuis dans d’autres localités.
Voici un trait qui donnera une idée de la mentalité boche. Comme on vient de le voir, ils avaient abandonné leurs blessés, ils se gardèrent bien d’abandonner leur butin.
C’est dans les voitures d’ambulance qui auraient dû servir au transport de ces mêmes blessés que les officiers allemands entassèrent le fruit de leur pillage. Comme nos artilleurs, par respect pour la Convention de Genève, évitaient de tirer sur les voitures de la Croix-Rouge, on peut supposer que le produit des vols commis à Reims est arrivé sans encombre en Allemagne.