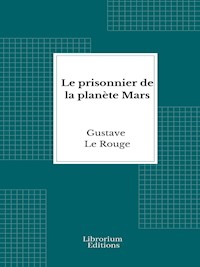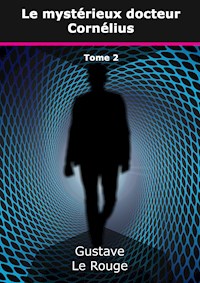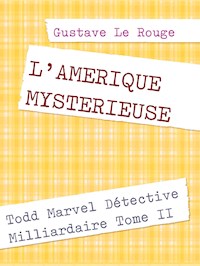Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Candide & Cyrano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une édition de référence de La Princesse des Airs de Gustave Le Rouge, spécialement conçue pour la lecture sur les supports numériques.
« – Vous regardez l’eau avec tant d’attention qu’on dirait que vous avez envie d’établir ici un moulin.
– Vous ne vous trompez pas, mon cher Ludovic, répondit Alban avec un grand sang-froid. C’est bien un moulin que je veux construire. Je suis, en ce moment, en train de me demander quel est l’endroit le plus propice à l’installation d’une écluse.
– Un moulin ? fit Ludovic avec étonnement... Mais nous n’avons ici, ni froment, ni orge, ni céréales d’aucune sorte. C’est même, peut-être, la seule denrée de première nécessité qui nous fasse défaut.
– Aussi, reprit Alban, n’est-ce point à moudre du blé que servira mon moulin. Ce n’est point de la farine qu’il produira.
– Quoi, alors ? demanda Ludovic, dont la curiosité était excitée au plus haut point.
– De l’électricité, mon cher ami, simplement de l’électricité. » (Extrait du chapitre I, 3e partie)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le plus grand soin a été apporté à la mise au point de ce livre numérique de la collection Candide & Cyrano, afin d’assurer une qualité éditoriale et un confort de lecture optimaux.
Malgré ce souci constant, il se peut que subsistent d’éventuelles coquilles ou erreurs. Les éditeurs seraient infiniment reconnaissants envers leurs lectrices et lecteurs attentifs s’ils avaient l’amabilité de signaler ces imperfections à l’adresse [email protected].
La Princesse des airs
Gustave Le Rouge
Première partie
I Le docteur et l’acrobate
À Saint-Cloud, dans son vaste cabinet de travail, dont les quatre fenêtres donnaient sur le parc, et qu’encombrait un pêle-mêle d’appareils électro-thérapiques, de flacons et de livres, le célèbre docteur Rabican était, depuis plus d’une heure, en grande conférence avec un de ses anciens clients, un gymnasiarque devenu aéronaute, et nommé Alban Molifer. Le fils du docteur, le jeune Ludovic Rabican, qui écoutait derrière la porte, et collait, de temps en temps, son œil au trou de la serrure, ne pouvait, malgré ses louables efforts, attraper que des lambeaux de conversation. Il savait qu’Alban, que son père avait, autrefois, guéri, grâce à une opération d’une hardiesse merveilleuse, s’occupait alors, dans le plus grand secret, de la construction d’un aérostat, conçu suivant des données toutes nouvelles.
Ce fait expliquait bien au petit curieux la présence d’une foule d’épures qu’Alban avait étalées sur la grande table de porcelaine du cabinet, et dont il discutait les détails avec le docteur. Ce que l’enfant comprenait moins, c’étaient les feuilles de papier timbré, couvertes d’une grosse écriture, dont Alban faisait la lecture à demi-voix. À ce moment, le jeune indiscret sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna, honteux de sa curiosité ; il se trouvait face à face avec sa sœur Alberte, une belle et sérieuse jeune fille de seize ans, pour laquelle Ludovic, son cadet de trois années, éprouvait autant de respect que d’affection.
– Tu n’as pas honte, dit sévèrement Alberte, d’espionner ainsi notre père !... Ce que tu fais là est mal. Il s’agit peut-être d’affaires très sérieuses, que tu ne dois pas connaître.
Ludovic balbutia des excuses et supplia sa grande sœur de ne pas instruire son père de la faute dont il venait de se rendre coupable.
– Je ne dirai rien pour cette fois, fit-elle en le menaçant du doigt ; mais que je ne t’y prenne plus. Justement, je viens chercher papa, que l’on demande en ville.
Pendant que Ludovic se retirait, tout penaud, Mlle Rabican, après s’être annoncée par trois coups discrètement frappés, pénétrait dans le cabinet de travail paternel.
Le docteur sourit à la vue de sa fille et mit un baiser sur son front. Alban Molifer, après un profond salut, s’était retiré à l’écart.
– Qu’y a-t-il donc, petite, demanda joyeusement le docteur, pour que tu viennes ainsi nous troubler dans nos savantes méditations ?
– Rien de bien grave, papa. C’est encore votre confrère, l’honorable professeur Van der Schoppen, qui a fait des siennes. En appliquant, à trop forte dose, une potion kinésithérapique à l’un de ses malades, M. Tabourin, il lui a démoli un tibia.
– Ce diable de Van der Schoppen est enragé. Avec sa fameuse méthode, et ses biceps de lutteur, il finira par écloper toute la population.
– Mais, interrompit Alban, vous ne devriez pas vous en plaindre. Van der Schoppen travaille à augmenter votre clientèle. Chaque fois qu’il estropie un de ses malades, c’est un client qu’il perd et un que vous gagnez.
– Je suis suffisamment occupé, dit le docteur, pour ne pas désirer un surcroît de travail... Mais je cours chez M. Tabourin. C’est à deux pas d’ici. Vous voudrez bien être assez aimable pour m’attendre un instant... Les journaux d’aujourd’hui sont sur ce guéridon.
Le docteur s’habilla en toute hâte et, suivi de sa fille, quitta le cabinet de travail. Mais à peine avait-il franchi la porte de la rue que Ludovic, toujours aux aguets, se glissait doucement dans la pièce, afin d’aller faire un bout de causette avec son ami Alban, et de découvrir, s’il était possible, tout ou partie du fameux secret.
Le docteur Rabican, une des gloires de la science française, avait fondé à Saint-Cloud, depuis une dizaine d’années, une maison de santé luxueusement aménagée et dont l’installation était renouvelée à de fréquents intervalles, selon les dernières découvertes de la médecine et de la chirurgie modernes.
L’institut Rabican était connu dans le monde entier. Le docteur avait toujours, parmi ses pensionnaires, un nombre respectable de lords splénétiques, d’Américains millionnaires, rois du pétrole ou du coton, de petits princes allemands atteints de maux d’estomac.
Le docteur Rabican méritait, d’ailleurs, l’universelle renommée dont il jouissait. Pour lui, il n’y avait guère de maux incurables ; on citait, à son actif, des guérisons véritablement miraculeuses.
Il tentait parfois des opérations d’une stupéfiante hardiesse, et il les réussissait presque toujours.
On lui avait amené, une fois, un Italien qui se mourait d’un cancer à l’estomac. Le docteur n’avait pas hésité à faire entièrement l’ablation de l’organe contaminé. L’estomac avait été enlevé, l’œsophage raccordé avec le duodénum par des points de suture et le malade nourri artificiellement pendant un mois. Au grand désappointement des confrères jaloux qui avaient, à l’unanimité, pronostiqué la mort du patient, celui-ci s’était rétabli ; et, résultat véritablement déconcertant, il avait repris l’usage des aliments solides, digérait bien, et se portait à merveille. La sorte de poche qui s’était formée dans le tube digestif, remplaçait d’une façon très satisfaisante le viscère absent.
Une autre fois, une grande famille anglaise lui avait confié un orateur, membre du Parlement, atteint depuis trois ans d’une folie qui paraissait incurable. Le docteur avait promptement reconnu qu’un épanchement sanguin s’était produit dans un des lobes cérébraux. Le baronnet avait été dûment chloroformé ; un fragment de la boîte crânienne avait été scié, et le cerveau mis à nu, consciencieusement nettoyé. Peu de semaines après, le noble lord, tout à fait rétabli, reprenait, au Parlement, la série de ses éloquentes invectives, contre les empiètements coloniaux de la France et de l’Allemagne en Afrique.
Le docteur Rabican faisait plus fort encore. Il avait inventé un appareil à rajeunir les vieillards.
La principale cause de la caducité est l’artériosclérose, c’est-à-dire le durcissement lent, le racornissement graduel, la pétrification, en quelque sorte, des tissus élastiques, dont se compose le système artériel de l’homme. Ce durcissement peut être, sinon entièrement évité, au moins considérablement retardé, par l’application graduée et raisonnée d’un faible courant électrique, sur les centres vasomoteurs du cerveau. Partant de ce principe, le docteur faisait asseoir son malade sur une sorte de chaise longue munie d’appareils électriques spéciaux. Un bandeau entourait son front. Ses pieds, ses mains et son torse étaient pris dans des anneaux métalliques. Puis, on actionnait les piles. Les effluves électriques se répandaient dans tout le système nerveux, et cela pendant plusieurs heures chaque jour. Au bout de très peu de temps, le vieillard soumis à ce traitement commençait à recouvrer son énergie, redressait sa taille, reprenait des travaux depuis longtemps abandonnés, enfin se remettait à faire des projets d’avenir. Le docteur avait eu des clients qui, après une saison de cure électrique, s’étaient remariés à un âge invraisemblable, au grand désappointement de leurs héritiers.
La fortune que le docteur Rabican avait gagnée, grâce à ses cures fabuleuses, était considérable. Il en faisait, d’ailleurs, le plus noble usage, mettant indistinctement, au service des pauvres et des riches, le pouvoir presque surnaturel de sa science.
C’est ainsi qu’il avait fait la connaissance d’Alban Molifer.
Un jour, une femme, encore revêtue du maillot pailleté des acrobates, était venue, tout en larmes, frapper à la porte de l’institut. Son mari, dans un exercice de voltige aérienne, avait manqué le second trapèze ; et au milieu d’un long cri d’horreur poussé par la salle entière, était venu lourdement s’abattre sur le filet tendu au-dessous de lui, sur la piste. Dans sa chute, son poignet avait porté sur le globe d’une lampe électrique qu’il avait brisé. Les nerfs et les artères étaient coupés ; le sang coulait à flots. Le gymnasiarque pouvait périr d’un instant à l’autre.
Dans l’écurie du cirque, où, avec des couvertures de cheval, on avait improvisé un lit au blessé, le docteur se trouva en présence d’un homme, jeune encore, d’une physionomie remarquablement intelligente et noble, que le sang qu’il avait perdu faisait d’une pâleur mortelle.
Le docteur courut au plus pressé. Il procéda d’abord à la ligature des artères.
Puis il appliqua un premier pansement, et libella une ordonnance.
Très peu de jours après, l’acrobate alla mieux. Le bras en écharpe, il se présenta lui-même à l’institut. Il semblait profondément désespéré. Quand il eut remercié le docteur, qui refusa d’accepter toute espèce d’honoraires, le gymnasiarque enleva le pansement qui recouvrait son poignet malade, et montra anxieusement, au docteur, la blessure en voie de guérison.
– La section des vaisseaux sanguins, dit celui-ci, soignée à temps comme elle l’a été, ne laissera pas de traces.
– Mais, s’écria Alban avec angoisse, ma main est inerte ! En recouvrerai-je jamais l’usage ? Si elle demeure paralysée, c’est pour moi et les miens la ruine et la mort.
Le docteur eut une petite toux sèche, par laquelle il cherchait à dissimuler son émotion. Le ton navrant du blessé l’avait profondément touché.
– Hum !... fit-il, c’est vrai, le nerf est coupé. Il faudrait une opération très osée, très délicate, que je ne crois même pas qu’on ait encore essayée...
– Je suis prêt à tout risquer ; je me remets entre vos mains.
– Eh bien, soit, fit le docteur devenu pensif. Revenez après-demain. Si vous êtes encore décidé, j’essaierai de remplacer le nerf.
Malgré tout son courage, Alban ne peut réprimer un léger frisson de crainte quand on l’eut installé dans le fauteuil à opérations, et qu’il sentit un invincible engourdissement s’emparer de lui, lorsque l’appareil à chloroforme eut commencé de fonctionner.
Sitôt le malade endormi, le docteur rapidement, tira la tringle d’un rideau. Le corps, garrotté et anesthésié, d’un chien de forte taille, apparut sur une table d’amphithéâtre. Le docteur prit quelques instruments dans sa trousse étalée. Il y eut une lueur d’acier. En deux ou trois mouvements, aussi rapides que ceux d’un prestidigitateur, le docteur venait de fendre l’une des pattes du chien et d’en retirer un filament blanc, qui était un nerf encore plein de vie. C’est ce nerf qui fut greffé sur celui d’Alban et servit à en raccorder les deux bouts.
Quand Alban se réveilla, le cerveau endolori, la salle d’opération avait repris son aspect habituel.
– C’est fini, dit le docteur en souriant. Vous n’avez plus, maintenant, qu’à rester quelques jours dans une immobilité absolue. Vous n’enlèverez l’appareil plâtré que j’ai mis autour de votre poignet, sous aucun prétexte, d’ici quinze jours. Au début de ce temps, nous saurons si l’opération a réussi.
Elle réussit, et si bien qu’Alban put reprendre, quelques mois après, sans inconvénient, ses exercices ordinaires d’acrobatie.
Depuis ces événements, deux ans s’étaient écoulés. Alban, qui s’était entièrement voué à l’aérostation, avait, alors, une quarantaine d’années. À sa face complètement rasée, à ses yeux d’un bleu très doux, à ses vêtements entièrement noirs, on eût put le prendre indifféremment pour un acteur ou pour un ministre de l’Église anglicane, si la souplesse de sa démarche, la manière d’effacer les épaules et de bomber le torse, n’eussent révélé l’ancien gymnasiarque, l’homme rompu à tous les sports.
En somme, il y avait en lui quelque chose d’énigmatique, qu’accentuait encore, à certains moments, l’ironie du sourire. Pour un observateur, il eût été difficile à classer. On pouvait seulement être sûr d’une chose, c’est qu’Alban Molifer était un homme bâti pour l’action.
Cela se sentait, rien qu’à la franchise de son regard, à la courbe accentuée du nez, à la saillie de son maxillaire inférieur, et à la forme busquée de son front, que recouvrait une forêt de cheveux blonds taillés en brosse.
Alban, qui avait été autrefois à la tête d’une grande fortune, qu’il avait dépensée en expériences aérostatiques, possédait, d’ailleurs, une éducation et des manières que l’on rencontre rarement chez ses pareils. Il se trouvait, selon l’occasion, tout aussi à l’aise dans un salon que dans la coulisse d’un cirque ou dans la nacelle d’un aérostat.
En voyant entrer Ludovic, dont il connaissait l’espièglerie, il referma négligemment la serviette bourrée de plans et d’épures qu’il tenait ouverte sur la table, et le petit curieux éprouva de ce fait une première déconvenue.
Ludovic, dont les grands yeux noirs pétillaient de malice, et qui tenait de sa mère une délicatesse de physionomie et de tempérament presque maladive, s’avança vers Alban d’un air un peu boudeur.
– Est-ce que vous avez envie d’emmener papa en ballon ? demanda-t-il à brûle-pourpoint... Vous devez comploter tous deux un voyage dans votre Princesse des Airs.
– Attendez d’abord, enfant impatient, qu’elle soit construite.
– Mais quand elle sera terminée, est-ce que papa y montera avec vous ?
– Si le docteur me demande de faire une ascension, certainement que je ne le lui refuserai pas.
– Et moi, me permettriez-vous d’y aller aussi ?
– Si votre père vous y autorise. Seulement, je crains qu’il ne vous trouve encore bien jeune.
– Mais vous emmenez bien Armandine, qui n’est pas plus âgée que moi et qui est une petite fille !
– Elle, c’est bien différent. Elle a été habituée, tout enfant, aux ascensions. C’est une aéronaute de naissance.
Avec la mobilité d’esprit de son âge, Ludovic, voyant qu’il ne pourrait, ce jour-là, rien apprendre de plus sur son sujet favori, l’aérostation, passa brusquement d’une idée à l’autre.
– Vous savez, dit-il, que le docteur Van der Schoppen a encore endommagé un malade... C’est tout de même singulier qu’il conserve des clients avec sa kinésithérapie... Papa m’a expliqué ce que c’était ; mais tout ce que j’en ai retenu, c’est qu’on donne des coups aux malades pour les guérir... Vous savez ce que c’est, vous ?
– Oui. J’ai connu autrefois, très intimement, le docteur Van der Schoppen. La kinésithérapie, qui est une méthode médicale très en honneur dans les pays scandinaves et le nord de l’Allemagne, consiste à traiter toutes les affections par des coups brusquement décochés sur la partie malade... Ainsi, quand vous avez le hoquet, si on vous applique brusquement, sans prévenir, un grand coup de poing, vous êtes guéri.
– Tiens, c’est vrai !... constata naïvement l’enfant.
– Le docteur Van der Schoppen en agit de même avec toutes les maladies. Il a remarqué que les lutteurs et les soldats, qui passent toute leur vie à se battre, sont les hommes les plus vigoureux et ceux qui se portent le mieux... Partant de ce principe, si un vieux monsieur chétif vient le consulter pour des maux d’estomac, par exemple, Van der Schoppen l’interroge hypocritement, se fait indiquer exactement la partie souffrante ; puis, au moment où le malade est sans défiance... vlan !... il lui décoche un coup de poing à renverser un bœuf...
– Et que se passe-t-il ? demanda Ludovic.
– Généralement, le client se sauve en hurlant et va trouver un autre médecin ; mais il arrive pourtant à Van der Schoppen d’opérer des cures radicales... Ainsi, l’an dernier, il a guéri une dame anglaise, en lui cassant, d’un maître coup de poing, une molaire jusque-là rebelle au davier de tous les dentistes.
– Mais pourquoi M. Van der Schoppen est-il venu en France ?... Papa m’a dit qu’il avait été directeur d’un hôpital en Allemagne...
– C’est exact. Le docteur est un grand savant, quand il se contente d’écrire des livres et qu’il n’opère pas lui-même... Il a perdu sa place de directeur d’un hôpital militaire pour avoir ordonné, aux malades de toute une salle, le massage nasal et réciproque.
– Le massage nasal ?
– Oui. Admettons que nous soyons malades tous les deux... vous m’appliquez un coup de poing sur le nez, je vous en applique un autre ; et cela dure comme ça jusqu’à ce que nous soyons complètement guéris.
– Mais si je suis le moins fort ?
– Alors, je vous aplatis le nez, je vous brise les dents et je vous poche les yeux... C’est ce qui est arrivé à l’hôpital du docteur. Les malades les plus vigoureux ont rossé les autres. Il en est résulté une bagarre épouvantable ; et le scandale a été si grand que le docteur a été destitué...
– C’est sans doute pour cela que les huit petits Van der Schoppen, depuis Karl, l’aîné, qui a deux ans de plus que moi, jusqu’au jeune Ludwig, qui commence à épeler ses lettres, sont toujours déchirés, couverts de bleus et d’écorchures, et passent toute la journée à se battre avec leurs condisciples.
– Vous pouvez en être certain. Et s’il faut en croire les mauvaises langues, le docteur applique même, rigoureusement, sa méthode à Mme Van der Schoppen, chaque fois qu’elle a le malheur de se trouver malade. Le résultat, c’est qu’ils n’ont plus chez eux que de la vaisselle ébréchée, des tables boiteuses et des fauteuils à trois pieds... On leur donne congé tous les six mois ; et il faut vraiment que Van der Schoppen ait beaucoup de conviction et de philosophie pour ne pas envoyer à tous les diables sa méthode.
Ludovic partit d’un franc éclat de rire ; mais il s’arrêta net et demeura coi. Il venait de se sentir pincer par une oreille. C’était le docteur Rabican qui était rentré, sans faire de bruit, et s’était approché, à pas de loup, pour surprendre son fils en flagrant délit de paresse.
– Va donc faire ta version, ordonna-t-il, avec une sévérité que tempérait un ton plein de bonhomie.
Ludovic adorait son père. Il s’empressa d’obéir, Alban et le docteur purent reprendre leur entretien. L’aspect du docteur Rabican formait, avec celui de son interlocuteur, un contraste parfait.
De stature élevée, mais un peu voûté dans sa maigreur nerveuse, le docteur approchait de la cinquantaine. Son visage, d’un ovale très allongé, au front légèrement dégarni par les veilles, s’encadrait de favoris grisonnants et de longs cheveux, presque entièrement blancs, brillants et ténus comme de la soie. Les méplats du visage étaient fortement accusés ; le nez était long et effilé, un nez de flaireur et de chercheur. La bouche, aux lèvres délicates sans être minces, offrait, habituellement, un sourire plein de sérénité, le sourire de l’homme parfaitement conscient et sûr de lui. Le menton, aux rondeurs de médaille antique, les yeux, gris et malicieux, qui avaient conservé l’éclat et la pureté de la jeunesse, complétaient cet ensemble, où le physionomiste n’eût relevé aucun symptôme d’hypocrisie ou de méchanceté. Comme tous ceux qui se sont fait un devoir de consacrer leur existence à des recherches désintéressées, le docteur était, naturellement, très enjoué, et si modeste qu’il s’étonnait encore, avec un peu de naïveté, de cette gloire et de ce succès qui lui étaient venus sans qu’il les cherchât.
Le docteur s’était marié de bonne heure, avec une jeune fille sans fortune, une amie d’enfance qu’il avait épousée lorsqu’il n’était encore que simple chef de laboratoire d’un grand hôpital parisien.
Jamais union ne fut plus heureuse.
C’est grâce à l’affection dévouée et au désintéressement de Mme Rabican, que le docteur avait dû de surmonter les difficultés, toujours si âpres, d’un début scientifique.
Grâce à l’affection sûre dont il se sentait entouré, il avait résisté courageusement, d’abord aux privations, à l’insuccès de ses premières expériences ; ensuite, lorsqu’il commença à devenir célèbre, aux attaques envieuses de confrères jaloux et mieux rentés.
Présentement, le docteur Rabican jouissait, sans arrière-pensée, d’une fortune laborieusement conquise. L’institut de Saint-Cloud, que le docteur avait installé dans l’ancien hôtel des comtes de Lussac, était cité comme une merveille d’élégance moderne et de confort artistique. Un peu à l’écart de la ville, il était précédé d’une monumentale grille en fer forgé, du plus pur style Louis XIV, et entouré de superbes jardins, d’où l’on avait vue sur le parc.
C’est là, en écoutant gronder le tumulte affaibli de la ville lointaine, que les convalescents, miraculeusement arrachés à la mort par le docteur, se promenaient lentement, au bon soleil, appuyés sur leur canne d’ivoire. L’institut Rabican n’avait rien qui sentit l’hôpital ou la maison de santé ordinaires. Éclairées et chauffées à l’électricité, encombrées de meubles d’art et de bibelots précieux, toutes les pièces, depuis le grand salon, muni d’un orgue signé par un facteur célèbre, jusqu’à la salle d’opérations aux murs revêtus de porcelaine et pourvus d’antiseptisateurs électriques, répondaient à l’idéal de confort des malades les plus exigeants.
Le docteur était parfaitement heureux. Sa fille, Alberte, vivant portrait de Mme Rabican, montrait déjà la beauté, la parfaite distinction, la générosité de sentiments et d’intelligence, qui devaient faire d’elle, plus tard, une femme supérieure.
Seul, Ludovic donnait parfois quelques inquiétudes à son père. D’un cœur excellent, d’une mémoire prompte et sûre, d’une intelligence très vive, il montrait une telle pétulance, dans ses désirs et dans ses caprices, un tel entêtement dans ses plus folles imaginations, que le docteur craignait, parfois, d’avoir, plus tard, beaucoup de peine à le diriger.
– Vous avez vu ce petit bonhomme, dit-il, quand Ludovic eut refermé la porte, il m’effraie quelquefois par son trop d’imagination... Bon cœur, mais mauvaise tête... Il raffole de vous et de vos ballons.
– Mais il n’y a pas de mal à cela, reprit Alban, dont le sourire ironique s’accentua... Ne tient-il pas en cela de son père ?
– Vous me faites songer, dit le docteur dont les longues mains sèches s’égarèrent nerveusement dans le fouillis des papiers et des plans, que je vous ai déjà fait perdre une heure, et qu’il faut en finir au plus vite avec ces signatures...
Alban relut les papiers timbrés, qu’il avait mis de côté lors de l’arrivée de Ludovic, et que le docteur cherchait inutilement parmi les épures.
– Alors, dit Alban, il ne vous reste plus qu’à signer.
– C’est bien. Passez-moi la plume... Il est donc entendu que je prends à ma charge toutes les dettes que vous avez contractées pour la construction de vos premiers moteurs. De plus, pour compléter l’aménagement intérieur, et procéder au montage, au gonflement, aux essais de machines, et au lancement de notre aérostat, je vous crédite jusqu’à concurrence de sept cent mille francs. Je veux que la Princesse des Airs soit munie des appareils les plus perfectionnés. C’est une condition indispensable à notre succès. Il faut que l’aménagement intérieur en soit aussi assez confortable pour permettre de longs voyages ; il faut que le fonctionnement des accumulateurs électriques et des appareils producteurs d’air liquide soit impeccable. Ne vous hâtez donc pas, prenez votre temps...
– Je ne dépasserai pas la date que je vous ai fixée. Du moment que vous me commanditez si généreusement, tout ira très vite. Les derniers appareils vont m’être livrés, par les constructeurs, avant la fin de la semaine. Robertin et son aide procèderont immédiatement au montage et à l’ajustage. Nos essais seront très courts, puisque je suis sûr de mes plans. Avant trois semaines vous pourrez assister aux évolutions du premier « aéroscaphe » vraiment pratique et dirigeable qui ait jamais été lancé dans les plaines immenses de l’air.
– Les chemins de fer supprimés et rendus inutiles, les communications devenues presque instantanées, les guerres impossibles, les douanes sans objet, voilà, tout simplement, les résultats qu’aura produits votre découverte !...
– Il est certain que les cuirassés de vingt millions, les canons longs et courts, à freins hydropneumatiques, deviendront parfaitement inutiles lorsque, sans risques aucuns, un aéroscaphe, monté par une demi-douzaine d’ingénieurs, pourra, en lançant commodément quelques bombes électriques, anéantir toute une flotte, ou une ville grande comme New York ou Londres... J’oublie encore, ajouta Alban avec son sempiternel sourire d’ironie, les progrès considérables que fera la science météorologique...
– On arrive déjà à produire des pluies artificielles et à détruire les trombes, en tirant dessus à coups de canon... Le temps viendra où l’homme pourra faire, à sa guise, la pluie ou le beau temps.
– En attendant, je connais un météorologiste qui sera plutôt vexé, lors de la première ascension de la Princesse des Airs.
– Vous voulez sans doute parler de mon vieux camarade Bouldu ?...
– Précisément.
– Sans lui vouloir de mal, je vous avoue que je ne serai pas fâché de la contrariété qu’il éprouvera. Je lui garde rancune de la manière dont il a agi envers vous.
– Je ne lui en veux plus. Je suis persuadé que ce coquin de Jonathan, son âme damnée, a été pour beaucoup dans notre brouille... Enfin, je sais maintenant ce que c’est qu’une haine de savant.
– Prenez-y garde, Alban. Ce sont les plus terribles... Prenez-y garde.
Et le docteur répéta encore son avertissement, en reconduisant, jusqu’à la porte, le futur capitaine de la Princesse des Airs, qui avait soigneusement serré, dans son portefeuille, les contrats, maintenant revêtus de la signature de son généreux commanditaire.
Alban franchit la grille dorée de l’institut Rabican.
Un personnage, qui se tenait caché dans l’enfoncement formé par deux maisons voisines, se dissimula vivement pour n’être pas aperçu de lui.
Quand l’aéronaute eut fait une centaine de pas, l’espion sortit de sa cachette, et se mit à le suivre, à distance, en ayant soin d’utiliser les angles propices des maisons en retrait, les tournants de rues, les voitures, pour dissimuler sa marche à celui qu’il « filait ».
L’inconnu, d’un âge indécis, et d’une forte corpulence, était reconnaissable à ses moustaches rasées, à sa barbiche taillée en pinceau, pour un citoyen de la libre Amérique. Son teint, rougi par l’abus des boissons alcooliques, son profil anguleux et dur, la ruse et l’hypocrisie que reflétaient ses prunelles métalliques et froides, étaient loin de lui conférer une physionomie sympathique. Il était coiffé d’un chapeau haut de forme roussi, et vêtu d’un ample ulster, à carreaux jaunes et bleus. Il marchait lourdement, le dos courbé, en s’appuyant sur un énorme gourdin de bois de fer.
Alban descendit vers la ville basse, traversa la Seine, et alla frapper à la porte d’une maison de très modeste apparence.
C’est là qu’il habitait.
Quand l’Américain qui, toute la matinée, l’avait espionné, fut sûr qu’il était bien rentré chez lui, il poussa un juron étouffé et reprit, en sens inverse, le chemin qu’il venait de parcourir.
Ce Yankee n’était autre que Jonathan Alcott, à la fois domestique, préparateur et secrétaire du météorologiste Théodore Bouldu, un des camarades de jeunesse du docteur Rabican, et dont l’habitation était située à quelques pas de l’institut.
L’intérieur d’Alban Molifer, plus que sommairement meublé, offrait la preuve de ses préoccupations scientifiques.
Les murs étaient ornés de plans et de dessins d’appareils, de lavis de machines, de photographies d’aérostats et d’aéronautes célèbres.
À la place la plus en vue, un tableau noir, qu’un contrepoids permettait de lever ou d’abaisser à volonté, était couvert de signes algébriques. Dans un autre angle, un établi était encombré de délicates pièces d’acier, de cuivre et d’aluminium ; le sol y était jonché de limaille et de copeaux métalliques.
Quand Alban entra, Mme Molifer achevait de mettre le couvert, tandis que sa fille Armandine, armée d’un pinceau et de plusieurs godets à encre de Chine, achevait de colorier, en teintes plates, une épure de vaste dimension.
– Vous savez, cria joyeusement Alban dès le seuil de la porte, que j’ai les signatures... Le docteur a la foi !... Il m’ouvre un crédit presque illimité !... Enfin, je touche donc au succès ! Dans quelques jours, la Princesse des Airs nous enlèvera tous les trois dans les airs, pour la confusion des envieux et le plus grand triomphe de la science.
Armandine, une maigriote fillette qui gardait, de sa prime enfance, passée dans les baraques foraines, quelque chose d’étrange et d’un peu sauvage, sauta au cou de son père si brusquement, qu’elle renversa un des godets d’encre de Chine.
– Sois donc raisonnable, lui dit sa mère. Tu as failli gâter l’épure du grand moteur... Ne sois pas si folle... On dirait que tu apprends quelque événement inattendu... Moi, j’étais sûre que le docteur nous tirerait d’embarras. Il est trop bon, il aime trop la science pour ne pas s’être enthousiasmé pour les découvertes de ton père.
– Oh ! s’écria Alban, dans un élan de reconnaissance enthousiaste, le docteur m’a sauvé deux fois !... Malgré la certitude que j’ai de réussir, je tremble qu’un accident quelconque ne se produise au dernier moment... Les capitaux qu’il risque pour moi sont considérables. Je serais désolé qu’un échec, même partiel, entraînât de nouvelles dépenses.
– Pourquoi craindre ? s’écria Mme Molifer avec une belle confiance. Je suis, pour ma part, certaine de ton triomphe.
– Oh ! je n’ai pas de craintes sérieuses, fit Alban, dont le front s’assombrit un instant. Mais ce succès si inespéré, si rapide, si complet, m’effraie un peu. J’éprouve je ne sais quels étranges pressentiments.
Mme Molifer eut vite fait de rassurer son mari. Une minute après, il ne pensait plus à ces fâcheuses idées, et s’était plongé dans un calcul de volts, d’ohms et d’ampères qui l’absorbait tout entier.
Armandine s’était mise à orner la robe de sa poupée d’un morceau de paillon emprunté à un ancien maillot d’acrobate.
Mme Molifer arracha bientôt le père et la fille à leurs occupations, en annonçant que le déjeuner était servi.
II Le terrible monsieur Bouldu
En pénétrant, sans frapper, dans le laboratoire de son protecteur et maître, le savant météorologiste Théodore Bouldu, Jonathan Alcott fit claquer violemment la porte vitrée.
Le savant, alors occupé à consulter un vaste tableau des hauteurs barométriques, se retourna et, d’une voix où perçait un commencement d’irritation :
– Eh bien, Jonathan, que signifie ce vacarme ? Tu as encore, probablement, quelque mauvaise nouvelle à m’annoncer ?
– Rien qui doive vous surprendre, répliqua l’Américain, avec une familiarité presque insolente... Ce que j’avais prévu arrive, voilà tout. Nous sommes volés.
– Alors, notre invention, nos plans ?...
– ... Sont, en ce moment-ci, mis à exécution par ce scélérat d’Alban Molifer, avec la complicité du docteur Rabican, qui a fourni les capitaux.
– Tu es bien sûr de ce que tu avances ?
– Absolument certain, reprit le Yankee avec un sang-froid gouailleur bien fait pour exaspérer l’irritable météorologiste... J’ai filé Molifer toute la matinée. Il est allé chez un notaire, à la Banque, puis chez le docteur... Voilà, je crois, des démarches bien significatives ?
– Mais, qui te dit, interrompit presque rageusement le savant Bouldu, que ces démarches aient abouti, que le docteur ait donné de l’argent ?... Alban n’a peut-être fait qu’une tentative inutile sur le coffre-fort du docteur ?
– Le doute n’est pas possible... Ce maudit saltimbanque a, bel et bien, palpé la forte somme... La meilleure preuve, c’est qu’à son atelier les travaux continuent sans interruption, et qu’il a fait, encore hier, d’importantes commandes à Paris.
– Tu aurais dû me prévenir plus tôt, s’écria impétueusement M. Bouldu... J’en ai suffisamment appris. Laisse-moi réfléchir cinq minutes. Je vais prendre, immédiatement, une décision.
Jonathan savait, par expérience, combien il était imprudent de contrecarrer les volontés du savant, surtout lorsqu’il était en colère.
Il se retira dans un coin, et fit mine de s’absorber dans la contemplation d’une carte des courants aériens ; mais un sourire railleur restait figé sur ses lèvres ; et il observait sournoisement son maître, du coin de l’œil.
Théodore Bouldu, Breton d’origine, acariâtre et coléreux par tempérament, était un petit homme à la barbe d’un blond sale, au front têtu, chez lequel le tempérament bilieux et le tempérament sanguin se combinaient pour produire l’être le plus impatientant et le plus désagréable qui se pût rêver.
Quoiqu’il fût du même âge que le docteur Rabican, et qu’il se fût signalé par des découvertes capitales, il n’avait jamais pu atteindre à la grande notoriété, à cause de la virulence de ses propos, à cause de la facilité avec laquelle il disait, sans y être invité, la vérité aux gens, en leur fourrant le poing sous le nez.
Le docteur Rabican était un des rares savants avec qui il ne fut pas fâché mortellement. Le professeur Bouldu était redouté dans toutes les Académies d’Europe, et même d’Amérique. Il n’avait pas son pareil pour accoler une épithète vengeresse au nom d’un confrère déloyal. Les lettres d’invectives qu’il avait écrites se comptaient par centaines.
Aussi, à part de rares amitiés, dues à sa loyauté, malgré tout irréprochable, était-il cordialement détesté de tous les corps savants. Quand il annonçait une communication à quelque Académie, les trois quarts des membres s’abstenaient de venir, ce jour-là, à la séance, dans la crainte des attaques injurieuses et même des gifles, par quoi se terminaient régulièrement les discussions.
Malgré ses défauts, Théodore Bouldu était estimé comme météorologiste. Ses ouvrages faisaient autorité en la matière.
Heureusement doué d’une assez belle fortune, il poursuivait depuis dix ans, à ses frais, le rêve chimérique de régulariser le cours des saisons, de faire disparaître les différences de climat, en un mot, de rayer entièrement des almanachs les tempêtes, ouragans, trombes, cyclones, tornades, simouns, siroccos et autres cataclysmes atmosphériques.
Le professeur Bouldu avait déjà obtenu quelques résultats. Il prétendait qu’avec des capitaux suffisants, il eût été possible d’installer des paratonnerres de son invention, pour aspirer, au moment des orages, toute l’électricité nuageuse.
Il avait, aussi, publié une formule très simple permettant de produire, à bon marché, les nuages artificiels, dont les vignerons font usage pour éviter les gelées.
Il était l’auteur d’un « Mémoire sur le dégel des régions arctiques, par la création de geisers artificiels », et il avait soumis, l’année précédente, au ministre des colonies – qui avait failli le faire interner à Sainte-Anne – un projet détaillé pour la suppression des vents brûlants qui désolent les régions sahariennes, et condamnent d’immenses territoires à l’infertilité et au néant.
Les courants atmosphériques sont produits, comme on sait, par une différence de température entre deux couches aériennes. L’air froid descend à la place de l’air chaud qui monte. C’est la température élevée du sol, dans les régions équatoriales, qui produit les vents alizés.
Partant de ce principe, le professeur Bouldu proposait d’installer, au centre du désert saharien, une série de gigantesques lentilles. Elles auraient, selon lui, décuplé la puissance du soleil tropical, et auraient suffi à produire un simoun artificiel qui, prenant l’autre simoun en travers, l’eût fait dévier et l’eût dirigé, par-delà l’Atlantique, chez les Yankees ou les Brésiliens. De cette façon, les colonies africaines eussent pu entrer dans une voie de prospérité jusque-là inconnue ; et les Provençaux eux-mêmes eussent été, une fois pour toutes, débarrassés du sirocco, répercussion affaiblie du grand courant atmosphérique saharien, qui vient briser ses dernières colères contre les glaciers des Alpes.
En dehors de ces projets, scientifiquement vraisemblables, mais peu pratiques, le savant breton avait doté une grande cité industrielle de ventilateurs puissants, dont l’installation avait, en quelques mois, fait diminuer le chiffre des décès de cinquante pour cent.
Le ventilateur Bouldu, en progrès sur celui du suédois Oscar Ostergren et sur les éventails électriques employés aux États-Unis, se compose essentiellement d’une immense tourille de métal remplie d’air liquide et surmontée d’un arbre à hélice creux, chargé de larges éventails métalliques, qu’un ingénieux système fait se mouvoir automatiquement. En quelques minutes, dans le plus vaste hall de construction, sur la place publique la plus encombrée de foule, au cœur de l’été, le ventilateur, en dégageant, à flots, un air pur et presque glacé, fait succéder la fraîcheur de la brise marine ou du sommet des montagnes, à l’atmosphère la plus viciée et la plus malodorante.
Le professeur eût eu grand besoin, en ce moment, de son bienfaisant appareil de ventilation.
Depuis la nouvelle que venait de lui apporter Jonathan, il était dans une violente colère. Il piétinait sur sa chaise, donnait des coups de poing sur son bureau, grinçait des dents et faisait mine de s’arracher les cheveux. La flamme d’une fureur sauvage passait dans ses yeux d’un bleu glauque, de la couleur de la mer, comme ceux de la plupart des Armoricains.
Jonathan, cependant habitué aux emportements de son maître, et qui, d’ordinaire, en riait sous cape, ne l’avait jamais vu dans un tel état d’exaspération. Le professeur, heureusement, se calmait aussi vite qu’il se mettait en colère.
Au bout de quelques minutes, il avait reconquis tout son sang-froid. Mais on voyait qu’il faisait de grands efforts pour se contenir. Ce fut d’une voix sèche et cassante qu’il dit à Jonathan :
– Toi, reste là. Tu vas me prendre la moyenne de la pression barométrique à Paris, hier et avant-hier. Je rentrerai dans une demi-heure.
Au moment où le professeur franchissait, d’un pas saccadé, le vestibule, dont la mosaïque représentait une rose des vents exécutée en marbre, de huit couleurs différentes, il s’entendit appeler par la voix joyeuse et fraîche de son fils Yvon.
– Eh bien, papa, où vas-tu ?... Et le déjeuner ?... Marthe, la bonne, a déjà sonné une fois.
Le docteur se radoucit visiblement, à la vue de son fils, un bel adolescent au regard limpide de franchise, au front intelligent ; et ce fut d’une voix d’où était bannie toute trace de mécontentement, qu’il répondit :
– Marthe attendra... Tu déjeuneras seul, ce matin... Je vais à côté, chez le docteur Rabican, pour une démarche très importante.
– Je vois, papa, que tu es encore en colère. Surtout ne te fâche pas avec les Rabican, j’en serais très peiné.
– Je vais faire mon possible. Au revoir...
M. Bouldu, pour éviter une explication embarrassante, ferma la porte de la rue ; et toujours du même pas saccadé, se dirigea vers la grille de l’institut Rabican.
Le docteur prenait le café dans son cabinet, en consultant une pile volumineuse de revues scientifiques, lorsqu’on lui annonça la visite du professeur Bouldu.
– Diable ! se dit le docteur, nous allons avoir une explication violente, ou je me trompe fort... Ce pauvre Théodore n’a jamais pu se guérir de ses violences de caractère.
Dès les premières paroles de son ami, le docteur Rabican s’aperçut qu’il avait deviné juste.
– Comment, s’écria M. Bouldu sans préambule, j’apprends que tu commandites une invention qui m’a été volée, ainsi que je te l’ai raconté moi-même !... Voilà qui est trop fort, par exemple. Cela me passe !... Je n’en ai rien cru. Il faudra que tu me l’apprennes de ta propre bouche, pour que j’y ajoute foi.
– Je t’en prie, fit le docteur, d’un ton conciliant, n’entame pas la discussion sur ce ton... Je serais désolé de me fâcher avec un ami de trente ans, un savant dont j’apprécie la haute valeur.
– Ne déplaçons pas la question, cria le professeur qui bouillait d’impatience. Es-tu, oui ou non, le commanditaire de ce saltimbanque, de ce coquin que j’ai dû chasser de chez moi, et qui s’est approprié les découvertes de mon préparateur, de mon aide, de mon fidèle Jonathan ?... Grâce à la direction des aéroscaphes, j’allais renouveler la météorologie, réaliser mon grand rêve de l’unification des climats ! C’est une gloire dont tu me dépouilles.
– Je t’ai déjà dit mon opinion sur ton fidèle Jonathan. C’est lui qui a volé une partie des découvertes d’Alban Molifer, que j’estime et que j’admire... Il est très exact que j’ai fourni des fonds à Alban pour la construction d’un dirigeable.
– Je ne te reverrai de ma vie !... rugit M. Bouldu, en se levant aussi brusquement que s’il eut été décoché par un ressort.
– Rassieds-toi, ordonna le docteur, agacé à son tour. Au lieu d’entrer en fureur, tu ferais mieux de m’écouter et de raisonner.
Le météorologiste se rassit, et pour se donner une contenance, se mit à mordre, rageusement, la pomme d’argent de sa canne.
Le docteur continua gravement :
– Depuis que Jonathan est à ton service, il n’a jamais fait aucune découverte intéressante... Alban n’est pas dans le même cas... À ma connaissance, il a réalisé sept ou huit perfectionnements, dont le moindre suffirait à faire la réputation d’un savant... Ce seul fait devrait te convaincre. D’ailleurs, j’ai toujours regardé Jonathan comme un fourbe et comme un hypocrite.
– Je suis sûr de son dévouement !
– Et moi de la loyauté d’Alban... J’avais bien remarqué que tu me battais froid, depuis cette histoire des plans volés. Mais, tu es dans ton tort. Livre-toi à une enquête sérieuse, et tu verras que j’ai raison.
Le météorologiste s’était levé, et avait remis son chapeau.
– C’est tout ce que tu trouves à me dire ?... Je ne ferai pas d’enquête. Ma conviction est faite. Je sais, maintenant, comment apprécier ta conduite. C’est la dernière fois que tu me vois ici.
Le docteur se précipita pour le retenir.
– Mon vieux Bouldu, s’écria-t-il, mon cher camarade ! Est-ce donc là le cas que tu fais d’une amitié de trente ans ?
Théodore Bouldu, qui avait déjà franchi le seuil de la porte, se retourna, et lança, dans un geste foudroyant :
– Non, jamais je ne te reverrai. Tu as aidé à me dépouiller ; tu es un faux bonhomme et un faux savant !
Sur ces paroles, il partit brusquement et le docteur l’entendit descendre, quatre à quatre, les escaliers. À ce moment, Mme Rabican, qui venait de voir le savant Bouldu traverser la cour d’entrée, au galop, en gesticulant, pénétra dans le cabinet de travail de son mari qui, en peu de mots, la mit au courant.
Elle partagea le chagrin que le docteur éprouvait de sa rupture avec un ancien ami, surtout dans de semblables conditions.
– Tu as pourtant raison, dit-elle... Ce M. Bouldu est un être insociable. Pourtant j’éprouve beaucoup de contrariété de ce qui vient d’avoir lieu. Son fils Yvon était, pour notre Ludovic, un excellent camarade. Sa fréquentation exerçait, sur lui, une heureuse influence... Désormais, ils ne pourront guère se voir.
– Je ne m’oppose pas à ce qu’Yvon continue ses visites ici... Bouldu m’en veut, mais moi je ne lui en veux nullement. Il est victime de son malheureux caractère... En tout cas, reprit le docteur, avec vivacité, notre rupture avec les Bouldu dût-elle être définitive, je ne pouvais pas faire autrement... Comme savant et comme honnête homme, je devais prendre le parti d’Alban, que tout le monde attaque, et qui a raison contre tous.
Mme Rabican se retira, pour accompagner sa fille Alberte à son cours de danse ; et le docteur eut bientôt oublié, dans une passionnante expérience sur la vitalité des cellules nerveuses, les sentiments de mauvaise humeur que venait de lui causer la déplorable sortie de son ancien camarade.
Il n’en fut pas de même de son adversaire. Théodore Bouldu rentra chez lui, dans un état de fureur à peine concevable.
Il rabroua Marthe, la vieille bonne, tança vertement son préparateur Jonathan, dont les sourires ironiques l’agaçaient, et envoya même promener Yvon, qui essayait de se faire expliquer par son père, les raisons de cet emportement.
– Tout ce que j’ai à te dire, vociféra-t-il, c’est que, désormais, je t’interdis expressément de fréquenter les Rabican, et d’adresser la parole à Ludovic ou à Alberte.
– Mais, mon père, objecta timidement Yvon...
– Je te défends même de les saluer, entends-tu ? Je les mets à l’index ; je les maudis ; je les excommunie... Va travailler ; et surtout ne t’avise pas de me désobéir.
Yvon se retira, le cœur gros. Il adorait le docteur et sa famille.
Privé, de bonne heure, de sa mère, il avait presque retrouvé, près de Mme Rabican, l’affection et les soins dont il était privé. Il passait la moitié de ses journées à l’institut, et considérait Alberte et Ludovic plutôt comme des frère et sœur que comme des camarades ordinaires.
Cependant sa curiosité combattait son chagrin. Tout en soupçonnant qu’il devait y avoir sous roche quelque rivalité scientifique, il se demandait quelles raisons avaient bien pu amener, entre les deux amis, une brouille aussi radicale. Son caractère entêté le poussait aussi à se révolter contre les ordres paternels.
– Mon père, s’écria-t-il, veut me séparer de mes plus chers amis... Eh bien, il n’en sera pas ainsi. J’irai chez les Rabican comme par le passé ; seulement, j’irai en cachette. Le docteur est trop indulgent et trop raisonnable pour me fermer sa porte ; et je suis sûr de l’amitié d’Alberte et de Ludovic... Puis, réfléchit-il, il y a dans tout cela quelque chose que je ne comprends pas. Je soupçonne encore quelque machination de cet hypocrite de Jonathan, qui a déjà fait renvoyer d’ici Alban Molifer.
Pendant qu’Yvon s’abandonnait à ses moroses réflexions, son père était en train de cuver sa fureur en se promenant à grandes enjambées dans son laboratoire, sous le regard narquois de Jonathan.
– Eh bien, demanda celui-ci lorsqu’il vit son maître un peu plus calme, le docteur a-t-il avoué sa participation à l’entreprise ?
– Parfaitement, s’exclama le savant... Mais je lui ai dit son fait ! Nous sommes brouillés à mort !...
– Si seulement nous avions le moteur à poids léger, dont j’avais eu la première idée, et qu’ils ont, paraît-il, fait exécuter, nous pourrions entrer en lutte avec eux, construire, nous aussi, un dirigeable, et arriver bons premiers dans la solution du problème.
– Tu es stupide, s’écria M. Bouldu en gesticulant avec fureur. Nous n’avons ni le moteur, ni les capitaux suffisants. Je ne suis pas riche comme ce coquin de Rabican, pour sacrifier un million en expériences... Tiens, je te défends de m’adresser la parole.
Jonathan marmotta une réponse incompréhensible, et se tint coi.
Histoire étrange que celle de ce Yankee, qui avait parcouru tous les pays du monde, et était au courant de toutes les inventions. Il était entré au service de M. Théodore Bouldu sur la recommandation de trois célèbres industriels américains. Pourtant, il eût été incapable de fournir de nettes explications sur son passé.
Il y avait en lui du domestique et du savant, du reporter et de l’industriel, du coureur d’aventures et de l’espion.
Jonathan Alcott avait fait tous les métiers. Né dans les faubourgs de Springfield, dans l’Illinois, d’un sollicitor qui avait fait de mauvaises affaires, Jonathan s’était, dès quinze ans, évadé de la maison paternelle, pour tâcher de gagner sa vie d’une façon indépendante.
Il avait été, tour à tour, commis épicier, contrôleur sur une ligne de tramways électriques, placier en machines à écrire, émailleur dans une fabrique de dents artificielles, enfin contremaître dans une usine d’appareils électriques.
Là, il avait trouvé sa voie.
Une fois au courant des procédés de fabrication de la maison qui l’occupait, il les avait vendus à une maison rivale. Son ancien patron avait fait faillite.
Six mois après, il recommençait la même fructueuse opération avec un industriel plus riche que celui qui avait payé une première fois sa trahison.
Depuis cette époque, il avait continué, passant d’atelier en atelier, d’usine en usine, trahissant tout le monde, et ne laissant derrière lui que ruines et que désastres.
Quoique la morale publique soit peu scrupuleuse, en Amérique, sur ces sortes d’agissements, Jonathan avait fini par en éprouver les inconvénients.
Il avait fait quelques séjours forcés dans les pénitenciers, et s’était vu, à plusieurs reprises, appliquer de magistrales corrections par quelques-uns de ses anciens patrons. Une fois même, il avait dû garder l’hôpital pendant six mois.
À la longue et quoiqu’il prît la précaution de changer de pays le plus souvent possible, il était devenu si connu dans le monde de l’industrie que personne ne voulait plus l’employer.
Jonathan pensa que le meilleur parti qui lui restait à prendre était de passer en Europe, où il pourrait appliquer son système avec toute la maestria que donne une expérience chèrement acquise.
Recommandé par trois industriels peu consciencieux, il vint humblement frapper à la porte du coléreux météorologiste.
Mais là, il éprouva une déception : il n’y avait pas moyen de s’approprier les inventions de M. Bouldu ; et cela pour une excellente raison : elles n’étaient pas à vendre.
Dès qu’il avait fait quelque découverte, M. Bouldu la livrait au public, et en expliquait tous les détails dans les revues et dans les journaux.
Le voler, c’eût été perdre son temps.
Cependant, par suite d’une lassitude de sa vie de rapine et de vagabondage, Jonathan Alcott demeura à Saint-Cloud.
Grâce à ses connaissances spéciales, et surtout à son imperturbable patience, il se rendit indispensable au savant ; et, ce qui semblera plus extraordinaire, il en vint à s’attacher à lui.
Son caractère excentrique, sa grande bonté, avaient fait sur le Yankee une profonde impression.
Pendant cinq ans, il se montra, envers son maître, d’une absolue fidélité.
Aussi, l’on juge de la haine et de la jalousie qu’il éprouva lorsqu’Alban Molifer, à peine remis de sa blessure et présenté par le docteur Rabican, vint, à son tour, collaborer officiellement aux travaux météorologiques de M. Bouldu...
Jonathan était attaché à son maître, mais égoïstement, férocement. Il le voulait pour lui tout seul, avec ses bourrades, ses invectives, son cerveau sans cesse fumant d’imaginations bizarres, et ses éclairs de loyale bonté qui empêchaient qu’on pût lui en vouloir de ses violences.
Dès lors, Jonathan n’eut plus qu’une pensée : évincer, par tous les moyens possibles, cet Alban qu’il jalousait, et dont la supériorité l’humiliait.
C’est alors que ses instincts de détective et de pickpocket reprirent le dessus.
Il épia l’ancien acrobate, et lui subtilisa ses papiers, qu’il remettait en place après en avoir pris copie.
Puis, confidentiellement, en l’absence d’Alban, il entretint M. Bouldu d’une grande découverte qu’il méditait, réussit sans peine à enthousiasmer l’inflammable savant pour la navigation aérienne qui, seule, selon lui, devait donner la clef de tous les grands problèmes météorologiques.
Alban, sans défiance, continuait ses travaux personnels dans le plus grand secret, se proposant de n’en parler à son protecteur que lorsque tout serait complètement terminé.
Il ne lui restait plus à découvrir qu’un perfectionnement au moteur à poids léger, dont l’aéroscaphe devait être pourvu, lorsqu’il se résolut à confier au savant le résultat de ses travaux.
C’est alors que Jonathan intervint, prit à témoin M. Bouldu de l’antériorité de sa trouvaille et accusa nettement l’acrobate de l’avoir dépouillé.
M. Bouldu, après avoir hésité, prit violemment le parti de l’Américain.
Une scène terrible eut lieu, au cours de laquelle le laboratoire fut presque saccagé. Alban dut céder la place ; et toutes les tentatives que le docteur Rabican fit près de son ami, pour rétablir la vérité, furent inutiles.
C’est alors qu’avait commencé la brouille entre le médecin et le météorologiste.
Jonathan Alcott, resté maître de la place, n’était pourtant pas sans inquiétudes.
Il se sentait un adversaire redoutable dans la personne du jeune Yvon Bouldu, qui le détestait d’instinct, ne lui adressait que rarement la parole, et agissait en toutes choses de façon à le contrecarrer dans ses intrigues.
Jonathan sentait bien le péril de sa situation, et il n’en était que plus acharné dans sa haine contre Molifer et contre le docteur Rabican, auquel il en voulait tout spécialement.
M. Bouldu fut tiré de l’état d’irritation qui l’empêchait, cet après-midi-là, de se livrer à aucun travail, par la visite de son ami, le professeur Van der Schoppen, l’apôtre de la kinésithérapie.
L’honorable professeur répondait assez bien, comme physique, au type caricatural de l’universitaire germanique qu’ont popularisé, des deux côtés du Rhin, les journaux illustrés et les revues de fin d’année.
Un vrai géant par la taille, d’une obésité que faisait ressortir la maigreur de ses jambes héronnières, il était vêtu d’un long paletot-sac de couleur verdâtre, chaussé d’espadrilles spéciales, afin de pouvoir décocher plus agilement des coups de pied bas à certains malades, et coiffé d’une casquette de chauffeur à large visière.
De son visage, envahi par une barbe de fleuve qui lui descendait jusqu’à l’estomac, on n’apercevait que des lunettes bleues et de grosses joues roses, si rebondies que le nez en devenait presque invisible.
Le professeur était un fort savant homme, un infatigable chercheur, dont le seul défaut était une certaine naïveté, et trop de passion pour la médecine kinésithérapique.
– Cet animal-là, disait quelquefois M. Bouldu, a plus vite fait d’écrire quatre volumes in-quarto que de guérir un seul malade !... Ses livres sont excellents, mais ses consultations pitoyables... Il devrait se borner à la théorie. Quand il entre dans le domaine de la pratique, tout est perdu.
Par une anomalie assez étrange, Van der Schoppen et M. Bouldu s’entendaient admirablement.
Ils étaient inséparables.
Concession que le météorologiste n’eût faite à personne, il feignait poliment d’ajouter foi aux bienfaits de la kinésithérapie et se laissait, de temps en temps, administrer quelques bourrades démonstratives, par pure condescendance.
De son côté, Van der Schoppen supportait, avec le plus grand flegme, les accès de colère et les invectives.
Quand il pénétra dans le laboratoire, il demeura un instant saisi, à la vue de la face congestionnée du météorologiste.
– Diable ! diable ! fit-il avec un fort accent tudesque, l’apoplexie vous guette, mon pauvre ami.
– Ça m’est égal, fit Bouldu, heureux, au fond, de trouver un confident à sa peine.
Mais le professeur, très ému, et croyant remplir un devoir, s’était approché sournoisement.
Sa large main s’abattit à l’improviste sur la nuque congestionnée de l’irascible M. Bouldu, qui fut presque assommé.
– Vous savez, Van der Schoppen, s’écria-t-il, pas de mauvaises plaisanteries !... Je vous brise ce tabouret sur les reins, si vous recommencez !
Le placide Van der Schoppen, habitué de longue date à la mauvaise humeur de ses clients, se contenta de se mettre hors de portée, tout en s’apprêtant à décocher une seconde « potion » lorsque Bouldu ne se méfierait plus.
Mais le météorologiste, très au courant des ruses thérapeutiques du professeur, ne lâchait pas son tabouret.
Van der Schoppen, le poing serré, guettait l’occasion.
Dans son coin, Jonathan s’esbaudissait franchement.
Les deux honorables savants se regardaient dans le blanc des yeux, comme deux dogues prêts à s’élancer l’un sur l’autre.
La situation était si comique que, malgré toute sa colère, M. Bouldu éclata de rire, et, imprudemment, lâcha son tabouret.
Au même instant, le poing velu de Van der Schoppen s’abattit, pour la seconde fois, sur l’épaule de M. Bouldu.
– Ah çà, grommela ce dernier, moitié furieux, moitié content, j’ai déjà éprouvé assez de désagréments aujourd’hui, sans que vous me cassiez encore les clavicules, pour que la série soit complète... Restez tranquille ou je quitte la place.
Van der Schoppen poussa un éclat de rire qui ressemblait à un hennissement.
– Encore un petit coup seulement, mon bon ami, fit-il... Pour le principe !
M. Bouldu haussa les épaules, et, pour avoir la paix, reçut docilement une troisième bourrade, beaucoup moins violente que les deux autres.
– Ça y est, s’écria triomphalement Van der Schoppen, le sang circule... L’apoplexie est, maintenant, évitée.
– Vous avez peut-être raison, fit Bouldu sans enthousiasme, en frottant son épaule endolorie...
Puis, passant brusquement à un autre ordre d’idées :
– Et Mme Van der Schoppen, et vos huit charmants enfants, comment se portent-ils ?
– Admirablement... Mme la professeur Van der Schoppen devient d’une force étonnante. Elle m’a guéri, hier soir, d’un point de côté, de façon si magistrale, que j’ai bien cru qu’elle avait exagéré la dose... Je suis resté deux heures sans pouvoir bouger... Quant aux enfants, ils se soignent entre eux toute la journée. Ils sont couverts de bleus et de pochons ; mais leur santé est superbe... Par exemple, ce que je ne comprends pas, c’est l’ignorance et la mauvaise éducation des gens de ce pays-ci. Les parents d’un enfant, que mon petit Karl a voulu guérir d’une entorse, sont venus me dire mille injures, et me menacent d’un procès.
– C’est une injustice criante, railla Jonathan.
– Assez sur ce sujet, interrompit M. Bouldu, j’ai à vous parler, mon cher professeur, et sérieusement...
– Je vous écoute.
En quelques phrases brèves, nettes et saccadées, Van der Schoppen fut mis au courant des événements de la journée.
Quoiqu’il estimât fort M. Bouldu, qu’il regardait comme un admirable savant, seulement trop entiché de certaines idées, il ne lui donnait pas entièrement raison dans la querelle. Rivalité médicale à part, il rendait entièrement justice au docteur Rabican, et trouvait que Bouldu avait agi avec beaucoup trop de violence et de précipitation.
De plus, le bon et naïf Van der Schoppen, nourrissait contre Jonathan, une instinctive animosité. Ce serviteur trop habile, qui trouvait moyen d’avoir presque toujours raison, lui était antipathique au premier chef.
Néanmoins, Van der Schoppen, qui était la douceur même, se trouvait très peiné de la colère et du chagrin de son ami.
Pour ne pas encore augmenter sa déconvenue en lui donnant tout à fait tort, il le consola par de prudents raisonnements, qui finirent, peu à peu, par rasséréner le bouillant météorologiste.
– Croyez-le bien, dit-il, le problème de la navigation aérienne est beaucoup trop complexe, beaucoup trop délicat pour que vos adversaires l’aient ainsi résolu du premier coup. Ils ont peut-être réalisé des perfectionnements sérieux, je ne le nie pas ; mais, de là à la solution complète et définitive, il y a loin.
– Ils ont trouvé le moteur à poids léger ! gronda rageusement Bouldu... Avec cela, leur succès est certain.
– Vous raisonnez comme un enfant, reprit paternellement Van der Schoppen. En admettant que vous ayez raison, vous savez bien que, dans une tentative aussi difficile, il suffit de négliger un détail, d’oublier de prendre une précaution élémentaire, pour amener un échec complet. Admettez, par exemple, qu’au dernier moment une tige d’acier renferme une paille et se brise, qu’un orage détraque leurs appareils électriques, c’en est assez pour ajourner une coûteuse ascension et ruiner leur entreprise.
Jonathan qui, dans son coin, ne perdait pas un mot de cette conversation, eut un tressaillement à la dernière phrase du docteur.
Il ne put réprimer un mouvement nerveux.
Un éclair de haine brilla dans ses yeux.
Le plus criminel des projets venait de germer dans son cerveau.
Il entrevoyait maintenant, confusément, le moyen de rendre inutile la générosité du docteur Rabican, et de se débarrasser, à tout jamais, de cet odieux Alban Molifer qui, partout, l’avait supplanté.
Cependant, l’excellent Van der Schoppen, de ce même ton monotone qui agissait, à la longue comme un soporifique sur les personnes nerveuses, continuait à débiter ses consolations platoniques.
– Vous voyez, mon cher Bouldu, disait-il, voici ce qui se produira : ... L’ascension d’Alban Molifer n’aura qu’un demi-succès, échouera même, peut-être, complètement. D’ici là, nous piocherons la question. Je laisserai, momentanément, de côté, ma grande thèse sur « le Pugilat et la Longévité humaine », et nous chercherons ensemble ce moteur à poids léger qui vous tient si fort au cœur.
Sans être tout à fait convaincu par les raisons que lui donnait Van der Schoppen, M. Bouldu fut touché de l’amitié qui lui était témoignée.
Après avoir pris rendez-vous pour le soir avec le professeur, il sentit que sa colère était entièrement évaporée.
– Ma foi, songea-t-il quand l’Allemand se fut retiré, ce brave Van der Schoppen est de bon conseil. À nous deux, nous sommes capables de réaliser des découvertes très intéressantes. Travaillons. Il n’y a pas de déboires qui tiennent contre une heure de météorologie.
Peu d’instants après, M. Bouldu, plongé dans la rédaction d’un mémoire sur « la Circulation atmosphérique dans les régions équatoriales », avait entièrement oublié le reste de l’univers.
III Aux chantiers de l’aéroscaphe
Le docteur Rabican, dont M. Bouldu et Van der Schoppen partageaient, d’ailleurs, les opinions, n’avait jamais voulu confier à d’autres qu’à lui-même l’éducation de ses enfants.
Ludovic Rabican n’avait jamais connu ni devoirs fastidieux, ni leçons fatigantes, ni pensums inutiles.
Le docteur s’était contenté d’éveiller habilement sa curiosité, ou de piquer son émulation.
Dès que l’enfant avait su lire, une collection de volumes, choisis avec soin, avait été mise à sa disposition.
Le docteur complétait, par des explications données sur le ton de la causerie familière, le résultat de ces lectures.
Grâce à cette méthode, Ludovic avait fait des progrès surprenants.
Il était beaucoup plus avancé que nombre de ses camarades plus âgés que lui, et pourtant accablés de leçons et de répétitions.
Tout enfant, il s’était passionné pour l’étude, dont on avait su lui faire goûter le charme, en lui en évitant l’amertume.
Ce système avait même si complètement réussi que, parfois, le docteur craignait d’avoir été trop loin, d’avoir forcé la croissance de ce jeune cerveau.
À certains jours, Ludovic posait à son père des questions effarantes, des questions qui étaient plutôt d’un savant déjà avancé dans sa carrière que d’un enfant.
Ces questions rendaient soucieux le docteur.
Il se demandait, avec inquiétude, si plus tard, devenu homme, Ludovic ne perdrait pas ses brillantes facultés ; si, faute d’un développement graduel et modéré, il n’était pas destiné à devenir, comme la plupart des petits prodiges, un homme fort ordinaire dans la suite de sa vie.
– Pourtant, réfléchissait-il, on ne peut pas dire que je l’ai surmené. Je ne lui ai jamais dit de travailler. Il a étudié toujours avec plaisir, et j’ai dû, bien des fois, me fâcher pour l’envoyer à la promenade, ou lui cacher des volumes qu’il me réclamait avec insistance.
Ludovic était d’une grande vivacité d’intelligence, et d’une extrême sensibilité de tempérament.
Il voulait comprendre tout ce qu’il voyait ; et tout ce qu’il avait compris, il voulait le réaliser.
Il enrageait de n’être pas encore un homme, et de ne pouvoir partir, courageux explorateur, à la découverte de régions inconnues, de ne pouvoir tenter des descentes en navire sous-marin, ou des ascensions en dirigeable.
Mais la navigation aérienne surtout l’enthousiasmait.
Un aéronaute lui apparaissait comme un être merveilleux.
L’imagination de l’enfant, surchauffée par les conversations de son père et par les récits d’Alban Molifer, lui représentait les couches supérieures de l’atmosphère comme la seule patrie vraiment désirable.
Planer au-dessus de la mer des nuages, dans un ciel éternellement pur, éclairé par des astres dont nulle vapeur, nul brouillard ne vient troubler l’éclat, voir à ses pieds se former et se dissoudre les tempêtes, être emporté sans secousse par ces courants aériens qui traversent l’Europe en quelques heures, quel rêve !...
Pour Ludovic, la science laissait bien loin derrière elle les inventions les plus audacieuses des conteurs orientaux.
Le tapis merveilleux de la reine de Saba, l’anneau du Roi des Génies, et même la lampe d’Aladin, ne lui paraissaient que de misérables imaginations à côté du microphone qui permet au premier venu, comme à la fée Fine-Oreille elle-même, d’entendre l’herbe pousser – à côté du téléphone, cent fois plus commode et plus pratique que les miroirs magiques où les enchanteurs faisaient apparaître l’image des absents – à côté des rayons Rœntgen qui photographient jusqu’à l’invisible – du cinématographe qui reproduit les mouvements mêmes de la vie – du phonographe qui emmagasine, pour les siècles futurs, la voix de nos cantatrices et les tirades de nos tragédiens – enfin de cent autres prodiges, effectués par la science, et que l’enfant s’énumérait avec émerveillement.