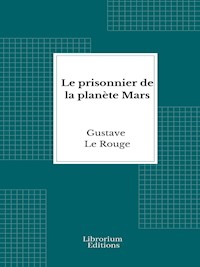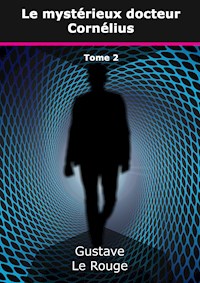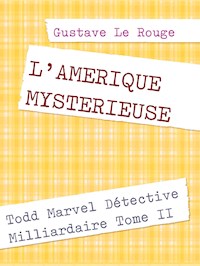0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gustave Le Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cette saga en quatre volumes est le premier roman de Gustave Le Rouge, auparavant, il n'a publié que quelques nouvelles; il l'écrit d'ailleurs en collaboration avec Gustave Guitton. William Boltyn, milliardaire, veut devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la planète, et pour cela, il oeuvre à l'armement à outrance des USA, seul pays digne de dominer le monde civilisé, c'est à dire la vieille Europe. Mais son projet de loi est rejeté. Il convoque alors les principaux magnats américains et leur propose un complot à la hauteur de ses grandioses desseins. La lutte sera terrible, les inventions se succédant à un rythme vertigineux. «Chariot psychique», train ultra-rapide, sous-marin, train étanche subatlantique, robots, toutes les ressources du génie scientifique seront mises en oeuvre. Et l'histoire prouvera que l'argent et la puissance commerciale ne sont pas toujours suffisants pour vaincre... Extrait : - D'une manière très simple, répondit M. Golbert. Aussitôt les premiers rails posés, nous installons dessus un simple bateau sous-marin à roues, qui chaque jour emportera avec lui les rails sur lesquels il roulera le lendemain. Par le moyen de sas à air comprimé, douze scaphandriers peuvent sortir pour travailler. Autrefois, ils étaient simplement reliés au bateau par une corde sur laquelle ils frappaient d'après un alphabet connu. Nous avons remplacé ce moyen primitif par un téléphone dans l'intérieur du casque. Du reste, toutes les conditions de sécurité seront prises. L'électricité éclairera les bas-fonds. Vous voyez que tout cela n'a rien d'invraisemblable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
La Conspiration des milliardaires - Tome II - À coups de milliards
Gustave Le Rouge
Gustave Le Rouge, le grand oublié? Ami des mandragores, des alchimistes, des utopistes et des gitans, intime de Paul Verlaine, fermier, journaliste expert dans les faits divers, auteur dramatique, scénariste de films, animateur de cirque, candidat malheureux à la députation de Nevers, membre d'une conspiration manquée contre le roi des Belges, époux d'une écuyère de cirque, puis d'une voyante défigurée, pionnier de la science-fiction, auteur de livres sur le langage des fleurs et des rêve, Gustave Le Rouge est un homme et un écrivain aux multiples facettes, qui mérite d'être redécouvert. Il débute sa carrière d'écrivain populaire sur les traces de Jules Verne et de Paul d'Ivoi avec «La Conspiration des Milliardaires«, «La Princesse des Airs» et «Le sous-marin Jules Verne». Puis ses écrits se tournent nettement vers la science-fiction ou le fantastique avec son cycle martien - «Le prisonnier de la planète Mars» et «La guerre des vampires» - et «Le Mystérieux Docteur Cornélius», son chef-d'œuvre.
Chapitre1 Le chemin de fer subatlantique
Depuis quelques jours, les journaux parisiens commentaient avec force détails le mariage qui venait d’avoir lieu entre Ned Hattison, le fils de l’inventeur américain connu du monde entier par ses merveilleuses applications de l’électricité, et Mlle Lucienne Golbert, fille d’un savant réputé, membre de l’Académie des sciences de Paris, dont la récente invention d’une locomotive sous-marine occupait encore l’opinion publique.
« Ce mariage – écrivait une feuille qui paraissait bien informée – ne s’est pas fait sans amener de graves dissentiments. Le père du jeune homme, l’ingénieur Hattison, s’y était formellement opposé.
« Nous savons, de source sûre, qu’un désaccord existait entre lui et son fils, au sujet de miss Aurora Boltyn, la fille du milliardaire américain, dont les fabriques de conserves de viande, à Chicago, sont les premières du monde entier.
« C’est afin de dissimuler son peu d’enthousiasme pour miss Boltyn, que le jeune homme avait entrepris un voyage en Europe.
« Il avait fait, à Paris, la connaissance de Mlle Lucienne Golbert, dont il s’était épris. Pour l’épouser, il n’avait pas hésité à braver la colère de son père. Celui-ci avait même franchi l’Atlantique, pour essayer de dissuader son fils de cette union.
« Mais ni les supplications ni les menaces n’avaient pu fléchir le jeune homme. Une rupture violente s’en était suivie. L’ingénieur Hattison était retourné en Amérique. On prétendait en outre que l’affaire se compliquait de raisons politiques.
« Fils unique du savant américain, l’éminent ingénieur qu’est maintenant M. Ned Hattison, fut un élève brillant de l’école de West Point. Sa compétence en matière de balistique et de pyrotechnie est indiscutable. Sa mère, une Canadienne d’origine française, mourut alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Il semble avoir hérité d’elle son amour pour la France.
« Mlle Lucienne Golbert est une grande jeune fille sérieuse, instruite et d’une rare beauté. Leur mariage est maintenant une chose faite. Parmi les témoins, nous relevons le nom de M. Olivier Coronal, l’inventeur de la torpille terrestre. »
Pendant qu’à tort et à travers, les journaux publiaient, sur le mariage, les informations les plus fantaisistes, Ned et Lucienne, tout à la joie de s’aimer, étaient partis en Espagne pour un court voyage de noces.
Et durant ce temps, sous les ordres de M. Golbert, Tom Punch, leur intendant, terminait l’installation de la petite villa que le jeune Américain avait louée dans les environs de Paris.
Sur les bords de la Méditerranée, depuis Barcelone jusqu’à Malaga, leur voyage n’avait été qu’un enchantement.
Alors qu’en France, l’hiver commençait avec la chute des dernières feuilles, que les villes étaient ensevelies sous la brume, que les forêts dénudées frémissaient sous la bise, là le ciel était beau, le soleil resplendissant, les plaines et les vergers couverts de fruits.
Le bonheur de Ned l’avait transfiguré.
Il se sentait revivre vraiment depuis que Lucienne était sa femme.
Sa nature aimante, si longtemps contenue par une éducation rigide sous la tutelle de son père, éclatait librement dans un débordement de tendresse.
Il aimait maintenant, comme on n’aime qu’une fois, la jeune fille qu’il avait choisie pour sa douceur et son intelligence autant que pour sa beauté.
L’avenir lui paraissait moins sombre à présent qu’il avait à ses côtés sa chère Lucienne, qu’il était sûr de son amour.
En même temps qu’une épouse, Lucienne savait être une amie.
Elle se promettait bien d’être toujours pour son mari une compagne dévouée et fidèle ; de l’encourager dans ses travaux et dans ses luttes, de le consoler dans ses déceptions.
Parfois, au milieu de leur tête-à-tête, Ned était pris de tristesses brusques. Un pli amer barrait son front.
Il songeait aux dernières paroles de son père, aux violences dont le vieil inventeur était capable ; il craignait pour l’avenir.
Lucienne alors savait apaiser doucement son esprit, et chasser par un baiser ses appréhensions.
À Barcelone, ville cosmopolite et industrielle, premier port de l’Espagne, les jeunes mariés étaient descendus à l’International Hôtel, au cœur de la ville, sur la Rambla del Centra.
Cette avenue, qui sans égaler les Champs-Élysées est cependant fort belle, prolonge jusqu’au quai ses arbres séculaires, parsemés de kiosques où l’on boit, en passant, une tasse de chocolat, une coupe d’aguardiente[1] que, suivant la coutume espagnole, on fait suivre d’un grand verre d’eau glacée.
À son extrémité, faisant face à la mer, se trouve la statue de Christophe Colomb.
L’élément étranger tient une place considérable dans la population de Barcelone.
Le commerce du port y attire, en plus des Français, des Anglais, des Allemands, des Russes, toute une collection d’Espagnols aux types les plus variés et les plus pittoresques.
À côté des Catalans coiffés de la barrettina[2] nationale, la face rasée, la veste courte, la ceinture de laine aux hanches et les jambes nerveuses enserrées jusqu’aux genoux par des bas blancs, les Valencianos, les Andalous promènent les couleurs claires des foulards de soie qu’ils affectionnent particulièrement.
On rencontre dans les rues des marins de toutes les nations.
Les soldats, les gardes civils avec leurs costumes d’opérette : tricornes de toile cirée, buffletteries jaunes, et guêtres aux mollets, coudoient le long des boutiques les élégants caballeros drapés dans la cape nationale, les jeunes señoritas aux grands yeux noirs, aux lèvres rouges, qu’une duègne sévère accompagne à la promenade.
Lucienne était vivement intéressée par le spectacle nouveau pour elle de cette cohue bigarrée d’où montaient, avec des jurons mélodieux, d’étranges parfums.
Comme beaucoup de Parisiennes, elle n’avait jamais voyagé.
L’idée de se trouver à l’étranger, à des centaines de lieues de Paris, l’amusait.
Elle voulut tout voir ; le port avec son continuel va-et-vient de navires et de barques de pêches, le jardin zoologique et ses belles collections de fauves, la cathédrale au centre de laquelle se trouve un jardin.
Ned souriait de cette inlassable curiosité ; et parlant fort bien l’espagnol, se faisait son guide.
Après huit jours de halte dans la capitale de la Catalogne ils continuèrent leur excursion en suivant le littoral de la Méditerranée.
Séparée par des mers et des montagnes du reste de l’Europe, l’Espagne semble avoir dû à sa position géographique, d’être toujours restée rétrograde et hostile aux progrès effectués dans les moyens de locomotion.
Les rares chemins de fer qu’elle possède n’ont qu’une seule voie et marchent avec une désespérante lenteur.
Dans ce pays, les mœurs américaines n’ont pas encore pénétré.
Bien plus soucieux de respecter les traditions consacrées que d’introduire dans son existence les tracas d’une activité démesurée, l’Espagnol est rarement pressé.
Catholique fervent, et même superstitieux, le paysan vit semblablement depuis des siècles, de la culture nonchalante d’une terre qu’il n’essaie pas d’enrichir.
Il a les qualités de ses défauts ; et s’il est joueur, fanfaron, vaniteux, sa sobriété est exemplaire, son courage et son amour de la patrie sont classiques.
Du compartiment de première où ils voyageaient seuls, Ned et Lucienne regardaient, par les vitres baissées, le délicieux paysage qui, sous un ciel clair et ensoleillé, s’étendait jusqu’aux limites de l’horizon.
À droite, les orangers épandaient dans l’atmosphère le parfum capiteux de leurs corolles blanches. Les branches au feuillage d’un vert sombre ployaient sous le poids des fruits dorés.
Des champs de maïs et des rizières mettaient çà et là leurs couleurs chaudes, leurs taches vertes.
Sur les routes, on voyait passer, en files interminables, les diligences attelées de six ou huit mules en poste, au milieu d’un nuage de poussière.
Les convois de mulets traînaient de ces lourdes voitures au moyen desquelles, plus encore qu’avec les chemins de fer, se font les transports en Espagne.
En tête, un petit âne dirige la caravane, de façon à éviter les fondrières et les voitures venant en sens inverse ; cependant que, nonchalamment étendu, le conducteur se livre aux douceurs de la sieste.
Puis c’étaient des forêts de chênes-lièges, dont les troncs écorchés ressemblaient à des gibets sanguinolents, des caroubiers, des plantations d’oliviers, de massifs de figuiers, de grenadiers offrant la tentation de leurs fruits savoureux.
À gauche, la mer s’étendait jusqu’à l’infini, une mer d’un azur profond, comme scintillant de lamelles d’argent, et dont les flots venaient caresser doucement les grèves de sable fin où des filets de pêcheurs séchaient au soleil.
Des bandes de marmots à moitié nus se disputaient le fretin d’une pêche que, plongés dans l’eau jusqu’à mi-corps, hommes et femmes faisant la chaîne, à chaque bout du filet, venaient de ramener à terre dans un frétillement argenté.
Au large, gagnant Valence ou Alicante, des bricks, des goélettes, gonflaient leurs voiles sous la brise qui fraîchissait. Des paquebots, empanachés de fumée, disparaissaient à l’horizon.
À Tarragone, les jeunes époux ne s’arrêtèrent pas.
Le long d’une voie bordée de platanes, le train filait à petite vapeur, à travers un paysage délicieux.
Le soir même ils s’arrêtaient à Valence dont les maisons en terrasse s’étageaient, blanches sous une lune d’argent bleu.
Valence, le pays classique des oranges, la ville dont le nom seul évoque le printemps éternel, le soleil toujours beau, la nature toujours en fête, est moins cosmopolite que Barcelone, d’une couleur locale plus véritablement espagnole.
À quelques kilomètres de la mer, elle étend, sur les deux rives de son fleuve, ses maisons pittoresques aux persiennes mi-closes, aux balcons ajourés, surmontés de terrasses où des loques multicolores s’alignent sur des cordes, où des gamins dépenaillés fument des cigarettes.
De longues promenades de palmiers, d’aloès, de cactus, bordées de fondas somptueuses, s’emplissent, à l’heure de la promenade, d’une foule élégante qui cause, fume et fait de grands gestes.
C’était aux environs de la Noël. Chacun faisait ses provisions de victuailles et de boissons, pour célébrer dignement la naissance du Christ.
Les rues avaient l’animation des jours de grande fête.
Sur la vaste place du marché couvert, un autre marché en plein air était installé.
Autour des boutiques brillamment éclairées, une foule réjouie s’entassait.
Les marchands ne pouvaient arriver à satisfaire l’empressement de leur clientèle.
Au bras de Ned, Lucienne se promenait par la ville.
– Et nos bons amis de France ? disait-elle. Et papa ? Et M. Coronal ? Et aussi ce brave Tom Punch ?… Avoue, Ned, que nous avons été un peu égoïstes de leur fausser compagnie. Il faut leur envoyer, d’ici, quelque chose, pour leur montrer que nous ne les oublions pas.
– Décidément, fit Ned, tu seras toujours un ange de bonté. Voyons ce que nous pourrons bien acheter pour eux.
Grâce à la sûreté de goût de Lucienne, ce ne fut pas long.
Dans une vieille boutique poussiéreuse, à proximité des fripiers chez lesquels on a pour deux pesetas [3] un habillement complet, ils firent la trouvaille de quelques objets d’art dont le vieux savant, amateur passionné de bibelots anciens, serait certainement ravi : une espingole en acier mauresque et curieusement damasquinée, un fauteuil aux bras et au dossier rectangulaires encore couvert de vieux Cordoue.
Quant à Olivier Coronal, sa bibliothèque s’enrichirait d’un merveilleux exemplaire du Don Quichotte de la Manche, illustré de gravures en taille-douce, et probablement de la première édition.
Ned eut la chance de le découvrir chez un juif, lequel vieillard à barbe blanche, coiffé d’un cafetan crasseux répondit en français à Lucienne, en anglais à Ned, et semblait disposé à offrir ses occasions dans deux ou trois autres langues, si les jeunes gens, heureux de leurs emplettes, ne s’étaient éclipsés.
Tom Punch, lui, en sa qualité d’intendant, recevrait, avec la recette curieuse du lièvre au chocolat, une cargaison toute fraîche de dattes et de grenades, et de plus une collection variée de ces piments et de ces épices sans lesquels il n’y a pas, pour les Espagnols, de cuisine possible.
– Ils doivent parler de nous là-bas, disait Ned. Qu’ils voient donc que nous pensons à eux.
Souvent ils parlaient d’Olivier Coronal comme d’un ami sûr, d’un cœur noble et élevé.
– C’est à lui que j’ai demandé conseil, ma Lucienne, lorsque je me suis enfin senti libre. Lui aussi t’aimait sans doute ; et pourtant il n’a pas hésité à nous mettre la main dans la main, à sacrifier l’affection qu’il te portait. Mais l’avenir lui prouvera que je ne suis pas un ingrat.
Comme ils revenaient à leur hôtel, des processions parcouraient les rues.
La Noël, en Espagne, est la plus grande fête de l’année. On distribue des aumônes. Dans certaines villes, on organise de grands banquets où, par esprit d’humilité, de nobles dames viennent elles-mêmes servir les pauvres et les vagabonds.
Ces coutumes charitables sont séculaires. Elles ont résisté aux révolutions et aux guerres civiles.
Aux portes des églises, des mendiants, drapant leur fierté crasseuse sous des haillons passés de couleur, les pieds nus dans les espadrilles de chanvre, le geste large, font ce jour-là une ample recette.
Des bandes de gamins, armés de bruyantes crécelles, parcourent les rues, installent leur orchestre assourdissant devant chaque boutique, jusqu’à ce que le patron leur ait donné quelque pécule.
Tous les cœurs sont à la joie.
La fière et malheureuse Espagne oublie, ce jour-là, sa misère, dans un hymne d’allégresse.
Quelques jours après, ayant poussé jusqu’à Malaga, dont les maisons blanches égaient nonchalamment tout le rivage, pays des jolies Andalouses, aux yeux trop grands et trop noirs, aux lèvres ardemment carminées, aux pieds mignons et bien cambrés, Ned et Lucienne reprenaient le chemin de Paris, emportant la vision des merveilleuses campagnes fleuries et parfumées.
Un intérieur coquet et confortable les attendait.
M. Golbert avait tout prévu. Dans les moindres détails on sentait la touchante sollicitude du vieillard.
– Combien je suis heureux de vous voir de retour, mes enfants, s’écria-t-il. Vous savez que je suis égoïste. J’ai besoin de vous sentir à côté de moi.
– Eh bien, à présent, monsieur mon papa, nous ne vous quitterons plus, fit Lucienne en l’embrassant tendrement. Vous allez voir comme nous allons vous cajoler à nous deux. À nous trois, ajouta-t-elle ; car j’espère bien que M. Coronal sera souvent notre hôte, n’est-ce pas, Ned ?
– J’y compte bien.
Dans la villa, l’existence prit son cours régulier.
M. Golbert avait assuré à sa fille une dot de cent mille francs.
Une vingtaine de milliers de dollars qui, pour Ned, n’eussent rien été en Amérique, lui étaient restés fort à propos, pour lui permettre d’attendre, quelques années, la situation qu’il espérait bien se créer par son travail.
Bien que Tom Punch ne fût guère utile à personne, Ned n’avait pas voulu se séparer de lui.
L’ex-majordome de William Boltyn lui avait donné des preuves nombreuses d’attachement.
Mais, dans ce décor étroit, qui ne rappelait en rien le somptueux hôtel de son ancien maître, dans cet intérieur bourgeois et rangé, Tom Punch était mal à son aise.
Il commençait à s’ennuyer, d’autant plus que, sans l’avouer à personne, il regrettait Paris et les brasseries de Montmartre, où ses talents de buveur et de joueur de banjo avaient eu tant de succès.
Ned était trop occupé pour faire attention à lui.
Dans un vaste bâtiment attenant à la villa, il avait fait installer un laboratoire.
Les projets de son beau-père sur la locomotive sous-marine l’intéressaient vivement.
Le savant avait eu raison de toutes les objections.
Il avait mathématiquement démontré à son gendre, qu’à part deux ou trois questions d’ordre secondaire, il ne manquait plus que des capitaux pour tenter l’entreprise.
– L’établissement d’une ligne sous-marine entre l’Europe et l’Amérique n’est pas du tout impossible, disait-il. Protégée par une estacade très solide, on commencerait à l’établir à partir du rivage. Là seulement les tempêtes sont à craindre. À vingt-cinq mètres de profondeur, la mer est toujours calme. Travailler sous l’eau n’est plus maintenant qu’un jeu. En plus de l’ordinaire cloche à plongeur nous disposons du ballon captif sous-marin, de l’ingénieur Pratti del Pozzo, qui nous permettra de descendre à toutes les profondeurs. Mais, comme vous le savez, le plateau calcaire qui, sous l’Océan, relie les deux continents, sauf quelques accidents de terrain, est à un niveau à peu près constant.
– Mais, pour l’établissement des rails ? Pour la construction du train, quel métal emploierez-vous que l’eau de mer n’oxyde pas ?
– Vous avez touché le point faible, mon cher Ned. Je ne peux pas encore vous répondre.
Huit jours après, en pénétrant dans le laboratoire, M. Golbert apprit que Ned venait de résoudre la question.
– J’avais bien pensé, pour blinder toutes les parties immergées, à l’emploi du chrome, dit le jeune homme. Or, je viens de trouver le moyen d’obtenir ce métal en grandes masses et à très bon marché. Voyez vous-même, fit le jeune ingénieur en lui mettant sous les yeux une formule chimique. Mais, chut ! ajouta-t-il en posant un doigt sur sa bouche, ceci doit être un secret pour tout le monde. Il ne faut pas qu’on nous devance.
Peu de jours après, Olivier Coronal, qui tout d’abord n’était venu que de temps à autre à la villa, cédait aux sollicitations de ses amis et s’y installait tout à fait, amenant avec lui Léon Goupit, le Bellevillois, le grand ami de Tom Punch qui n’était pas fâché, au milieu de cette atmosphère de science et d’austérité, de retrouver un joyeux compagnon de la trempe du serviteur d’Olivier Coronal.
Pour fêter l’arrivée de celui-ci, on organisa une petite fête intime.
Ce jour là, Tom Punch s’ennuya moins.
Le champagne qui pétillait dans les coupes lui rappela les somptueux dîners d’autrefois.
On but au succès de l’entreprise pour laquelle ces trois hommes d’élite associaient leur intelligence, au triomphe de la locomotive sous-marine.
Dans une pensée de patriotisme, M. Golbert avait tout d’abord offert au gouvernement français l’exploitation de son idée.
Sur les conclusions défavorables d’une commission d’enquête, le ministère avait refusé de voter les crédits nécessaires.
Sans récriminer, M. Golbert avait repris ses plans.
Mais, à l’étranger, l’affaire avait fait beaucoup de bruit.
Une compagnie anglaise avait envoyé un délégué au savant pour lui offrir d’acheter sa découverte, de le mettre à la tête des travaux, et de l’intéresser aux bénéfices.
Avec leur instinct pratique, les industriels anglais avaient vite compris quels avantages énormes on retirerait d’une ligne ferrée permettant d’envoyer d’un continent à l’autre en toute sécurité, et avec une vitesse bien supérieure à celle des express, des convois de voyageurs et de marchandises.
Mais M. Golbert avait refusé toutes les avances des capitalistes britanniques.
Quoique fort perplexe au sujet des moyens qu’il emploierait pour réaliser son œuvre, il ne pouvait se déterminer à signer un contrat qui le frustrerait de tout le bénéfice moral.
Tout cela préoccupait beaucoup le vieux savant.
Dédaigné par ses compatriotes, sollicité par l’étranger, sans capitaux suffisants pour agir de lui-même, il ne savait quel parti prendre.
Ned n’était pas moins soucieux.
Les plans définitifs étaient prêts.
De l’avis de tous, y compris Olivier Coronal, ils pouvaient soutenir toutes les critiques.
Restait à mettre ces plans à exécution.
Souvent, le soir, réunis autour de la lampe, en prenant le thé que Lucienne venait de servir, les trois hommes causaient.
– C’est bien le propre de notre époque, disait Olivier, le signe caractéristique de notre civilisation que de dépenser chaque année des centaines de millions en armements de toutes sortes, à fondre de nouveaux canons, à imaginer des explosifs, à maintenir sous les armes des milliers de travailleurs. En revanche, une œuvre comme la nôtre, destinée à augmenter la richesse sociale, à hâter l’évolution humaine en facilitant les rapports des peuples, ne trouve pas un homme d’État pour s’y intéresser, pas un capitaliste pour la seconder.
– Mais c’est tout naturel qu’on ne veuille pas admettre notre idée, s’écriait Ned. Que deviendraient les puissantes compagnies de navigation, le jour où nous aurions rendu inutile et dangereux leur matériel qui représente des sommes énormes. Ne nous y trompons pas, il nous faudra, pour arriver au but, vaincre plus d’une résistance, déjouer plus d’un complot.
– Eh bien, mais nous sommes trois à lutter, faisait M. Golbert. Ayons confiance en l’avenir. N’est-ce pas, Lucienne, qu’il ne faut jamais désespérer ?
– Oh ! certes non, papa, il ne faut désespérer de rien, même de voir notre brave Tom Punch redevenir gai. Je ne sais pas ce qu’il a depuis quelque temps. On dirait vraiment qu’il songe à se marier.
Tout le monde éclata de rire. On savait que le mariage était la terreur de l’ex-majordome.
Lucienne savait ainsi, par une parole joyeuse, ramener le sourire sur les visages, assombris par les soucis d’une situation qui ne semblait pas vouloir se dénouer.
Dans toutes les revues scientifiques, on parlait beaucoup de M. Golbert et de son invention.
En Amérique, surtout, il ne se passait pas de semaines sans qu’une feuille hebdomadaire ne consacrât un article à la locomotive sous-marine.
Les journaux français, au contraire, semblaient avoir oublié qu’elle existât, qu’elle fût sur le point d’être construite.
Ce silence était l’objet de vives critiques de la part de journalistes yankees.
Ils en profitaient pour démontrer une fois de plus l’infériorité des Français, leur manque d’initiative et de sens pratique.
« Chez nous, écrivaient-ils, cette tentative hardie, d’établir une voie ferrée à travers l’Atlantique, eût rallié tous les suffrages. Les capitaux eussent afflué. L’exécution serait déjà commencée. »
Chaque fois que ces articles lui tombaient sous les yeux, M. Golbert restait songeur.
Il finissait par croire que, plus facilement que partout ailleurs, il aurait, en Amérique, des chances sérieuses de trouver des commanditaires.
Depuis plus d’un mois, cette pensée le travaillait sans relâche.
Il résolut de s’en ouvrir à Ned et à Olivier Coronal, de leur demander leur opinion.
– Lisez-vous les journaux de New York, mon cher Ned ? fit-il un soir.
Les trois hommes achevaient de dîner. Au-dehors, la bise fouettait les vitres.
– Mais certainement, répondit Ned.
– Et que pensez-vous de leurs articles sur notre locomotive ? Ils affirment que, chez eux, les capitaux n’auraient pas manqué, que la chose serait déjà faite.
– Il y a du vrai dans ce qu’ils disent.
– Alors vous croyez que nous aurions des chances de réussite ?
– C’est à peu près certain.
M. Golbert semblait réfléchir.
– Je ne sais vraiment quel parti prendre. J’aurais préféré ne pas porter ma découverte à l’étranger. Pourtant, si j’attends ici qu’un ministère se décide à prendre nos projets en considération, je risque d’attendre longtemps.
– Me permettez-vous de vous donner mon opinion ? fit Olivier Coronal.
– Mais sans doute, mon cher ami.
– Eh bien, je considère que, dans une semblable question, votre patriotisme, pour si louable qu’il soit, n’a pas à intervenir. Vous voulez doter l’humanité d’une richesse nouvelle. De toutes les forces naturelles, l’Océan est celle que l’homme a su le moins dompter. En réduisant à moins de trois jours la durée du voyage entre l’Europe et New York, en supprimant le continuel danger des tempêtes et des naufrages, vous favorisez les relations des peuples entre eux. Que l’argent qui vous est nécessaire vous vienne de France ou d’Amérique, je considère cela comme sans importance.
– M. Olivier a raison, dit Lucienne. Après plus de dix ans d’études et de veilles, il vous est bien dû d’obtenir la compensation d’un succès.
Le savant n’avait pas de raison valable à invoquer. Il se laissa convaincre.
On décida, ce soir-là, de partir pour New York dans le plus bref délai.
L’hiver s’achevait, un hiver glacial et brumeux. Les arbres du jardin se couvraient de bourgeons ; quelques moineaux recommençaient à pépier.
Déjà, parmi l’herbe et la mousse, les premières violettes annonçaient le renouveau.
Pendant les jours qui suivirent, la maison fut en rumeur.
En apprenant qu’il était question d’aller à New York, Tom Punch avait fait la grimace.
– Décidément, pensait Ned, l’Amérique ne lui dit plus rien.
Léon Goupit, au contraire, était plein d’enthousiasme.
Franchir l’Atlantique avait toujours été son rêve.
Peut-être bien, qu’au fond de lui-même, le Bellevillois gardait l’espoir caché de devenir, un jour, roi d’une tribu sauvage, tout comme ses héros favoris des romans-feuilletons.
Les préparatifs du départ ne furent pas bien compliqués. Les meubles, les collections scientifiques resteraient dans la villa. On n’emporterait que l’indispensable, et les plans et les devis de la ligne dont on allait tenter l’exécution.
L’œil morne, et la poitrine gonflée par des soupirs énormes, Tom Punch, aidé de Léon, empilait mélancoliquement, dans de grandes malles, le linge, les vêtements et les appareils du laboratoire.
– Eh bien, nous allons revoir l’Amérique ! fit Ned qui passait.
– Oui, vous allez revoir l’Amérique, répéta le majordome avec un regard désolé.
– Comment, vous ! Je pense bien que tu nous accompagnes ! Eh bien, mais qu’as-tu donc ? On dirait, ma parole, que tes yeux sont humides.
En effet, une grosse larme perlait au bord des cils de Tom Punch, de ses bons yeux ronds, qui regardaient l’ingénieur avec une expression contrite.
– Écoutez, monsieur Ned, vous avez toujours été bon pour moi ; mais je ne puis plus rester avec vous.
– Et pourquoi donc, grands dieux ? Aurais-tu à te plaindre de moi ?
– Oh ! non, bien au contraire. Mais, voyez-vous, je m’ennuie. Et puis…
– Allons, parle. Qu’y a-t-il ? Sans doute une nouvelle idée te tracasse. Je te connais assez pour croire qu’elle ne te réussira pas mieux que les précédentes.
Les aventures bouffonnes du majordome, entre autres la prétention qu’il avait eue, un jour, de confectionner du sirop de tortues, dans un but philanthropique – cette liqueur, disait-il, étant un remède souverain contre toutes les maladies – lui avait fait une réputation méritée de fantaisiste, qui lui attirait souvent des quolibets.
D’ordinaire, il se fâchait tout rouge. Cette fois, il ne releva pas la raillerie.
– Non, fit-il, j’avoue que je n’ai pas toujours été heureux dans le choix de mes idées. Aujourd’hui, c’est sérieux… Lisez, ajouta-t-il en sortant une lettre de sa poche. Le directeur des Folies-Montmartroises, l’une des plus grandes scènes de Paris, me propose un engagement brillant : cinquante francs par soirée, comme joueur de banjo. Il est vrai qu’on ferait du chemin pour trouver mon pareil. Mais enfin, c’est joli. Vous comprenez qu’après avoir été longtemps à votre charge, je ne peux refuser cette proposition.
– Deviendrais-tu fou, par hasard ? T’a-t-on jamais parlé de cela ? Tu vas me faire le plaisir de laisser là ton directeur, et de nous accompagner.
Pas plus que Ned, M. Golbert ni Olivier Coronal ne purent lui faire entendre raison. Il voulait à toute force rester à Paris.
Le Bellevillois lui-même avait beau invoquer leur amitié, lui rappeler leurs communes équipées et lui dépeindre l’avenir sous de riantes couleurs, ils ne pouvaient pas fléchir son obstination.
– Voyons, mon vieux, disait-il ; c’est-y qu’tu s’rais maintenant plus Parisien qu’moi, pour ne pouvoir lâcher Paris d’un’semelle. Puisqu’on t’dit qu’on y r’viendra !
Mais, entre autres qualités, Tom Punch était plus entêté qu’une mule.
C’était du moins l’avis de Léon qui finissait, devant son obstination, par lui tourner les talons en le traitant amicalement de sabot, de vieille baderne et autres expressions aussi distinguées.
Le jour même du départ, Ned était vraiment contrarié de se séparer ainsi de son intendant.
Malgré ses nombreux travers, depuis plus d’une année qu’il vivait avec lui, Tom Punch avait souvent fait montre d’attachement à son égard.
Le jeune homme fit une nouvelle tentative pour lui persuader de l’accompagner à New York.
Peine inutile.
L’ex-majordome de William Boltyn avait son idée fixe : il voulait débuter aux Folies Montmartroises.
Il promit à son maître de lui écrire, et accompagna tout le monde jusqu’à la gare.
En costume de voyage, Lucienne était adorable d’élégance et de beauté.
Olivier Coronal surveillait le transport des malles et des colis.
Quant à M. Golbert, un peu ému, sa figure exprimait une joie intense.
Pour la première fois, il est vrai, il quittait l’Europe ; mais il emmenait avec lui sa fille, maintenant Mme Hattison ; et secondé par des hommes de la valeur de Ned et d’Olivier Coronal, il allait jeter les bases de son œuvre gigantesque, réaliser ses projets les plus chers.
– En avant pour New York, mes enfants, s’écria-t-il en prenant place dans le wagon qui les emmenait au Havre. Espérons que lorsque nous reviendrons…
– Ce sera, interrompit Lucienne, dans notre locomotive sous-marine.
Chapitre2 La fureur d’Aurora
Une ville américaine, pour l’Européen qui la visite la première fois, est un fort curieux spectacle, un continuel sujet d’étonnement.
Il y chercherait en vain tout ce qui, en Europe, a pour lui de l’attrait : les monuments qui lui parlent du passé, les promenades verdoyantes qu’il aime à parcourir en flâneur, l’irrégularité des rues, l’animation joyeuse de la foule.
En Amérique, plus rien de tout cela.
Chaque ville est un vaste damier où les rues tracées au cordeau se coupent à angles droits.
Quiconque en a vu une, les connaît toutes.
Dans ce pays, où l’on cherche, avant tout, à gagner du temps, les cités s’élèvent à la hâte, presque du jour au lendemain.
Telle ville, qui compte à présent plus de cent mille habitants, n’existait pas il y a dix ans.
Les Peaux-Rouges, les Coureurs des bois occupaient librement les paysages qu’elle a transformés, qu’elle inonde journellement de torrents de fumée.
Dans les préoccupations de l’Américain, le souci du beau, de l’élégance, n’existe pas.
Il bâtit comme il peut, le plus pratiquement possible. La pierre ne lui est pas nécessaire. En bois, en fer, en zinc, en carton comprimé et même en aluminium, il bâtit toujours.
Ses maisons de quinze et vingt étages, énormes cubes sans aucune élégance, sont plutôt, d’immenses cages que des habitations humaines.
Uniformément pareilles, elles stupéfient d’abord l’Européen et l’ennuient vite.
Il se sent dépaysé au milieu de cette foule morne et renfrognée qui se hâte silencieusement par les rues, sans jamais avoir un geste d’étonnement, un regard de curiosité.
Au-dessus de sa tête, sur une voie aérienne soutenue par des poteaux, des trains électriques passent à chaque minute.
Des tramways, des omnibus à vapeur sillonnent constamment la ville, s’arrêtant à peine aux stations.
Au lieu de porter, comme en France, des noms d’hommes célèbres, toutes les rues sont numérotées.
Demandez-vous votre chemin à un policeman, il vous tourne dédaigneusement le dos, sans même prendre la peine de vous regarder. Quelquefois un homme, qui passe et entend votre question, dit : « J’y vais ! » Et il continue sa route.
Suivez-le ou ne le suivez pas ; c’est votre affaire.
S’occuper des autres, c’est perdre son temps, c’est-à-dire son argent, agir en écervelé qui se donne du mal sans en tirer profit.
La journée d’un Yankee est toujours bien remplie ; mais s’il travaille beaucoup, ce qu’il mange est effrayant.
Le matin, son estomac réclame quelque chose de plus substantiel qu’une tasse de lait ou de chocolat.
Le Yankee se contente, pour ce premier déjeuner de rosbif froid, de jambon, de tartines beurrées, le tout arrosé de thé.
Jusqu’au soir, lancé à corps perdu dans les affaires, il n’aura pas le temps de faire un nouveau repas.
Debout, à la hâte, il avalera quelques douzaines d’huîtres que des industriels spéciaux débitent en plein air, les puisant à même un tonneau, où, débarrassés de leurs coquilles – pour que cela aille plus vite –, et nageant dans une eau saumâtre, ces mollusques, d’ordinaire appétissants, sont la chose la moins ragoûtante du monde.
Dans tous les bars on vend des sandwiches et le traditionnel rosbif froid aux pommes de terre, le mets national des États-Unis, où la cuisine et la vie intime sont à peu près inconnues.
Les pensions de famille fleurissent.
Quinze jours dans un endroit, un mois dans un autre, l’Américain, celui des villes du moins, a toujours l’air de camper.
Veut-il déménager ? Il boucle sa valise, et sans le souci de meubles à traîner derrière soi, va s’installer ailleurs.
C’est très pratique, et cela s’accorde très bien avec sa vie hâtive de machine surchauffée.
Ayant érigé en théorie le droit du plus fort et du plus audacieux, les hommes du Nouveau Monde s’inquiètent fort peu de ceux qui succombent dans la lutte.
Il faut avoir vécu quelque temps leur existence d’hôtels garnis, d’ascenseurs et de téléphones, pour comprendre tout ce qu’elle a d’horrible, tout ce qu’elle comporte de cruauté, de mépris pour les faibles.
Nul pays au monde ne renferme autant de pickpockets. Ils sont organisés en bandes avec leurs chefs, leurs indicateurs et leurs receleurs.
À San Francisco même, il n’était pas rare, il n’y a pas encore vingt ans, qu’une de ces bandes mît le feu aux quatre coins de la ville, pour piller à la faveur de l’incendie.
Aussi les habitants déposaient-ils prudemment leurs capitaux dans une vaste banque qui mettait à leur disposition des coffres-forts, et qu’un corps de policemen d’élite protégeait nuit et jour contre les coups de main audacieux.
Dans cette lutte fébrile des instincts et des appétits, pour des millions d’êtres qui végètent et meurent de misère, quelques-uns, mieux doués ou plus heureux, réalisent de scandaleuses fortunes.
C’était le cas de William Boltyn, le fondateur des immenses fabriques de conserves de viande, un des hommes les plus riches de l’Union.
Possesseur d’un merveilleux hôtel qui avait coûté plus de vingt millions, propriétaire d’usines gigantesques, abattant, dépeçant et salant par jour des milliers de bœufs et de porcs, père d’une charmante jeune fille, le milliardaire américain n’avait, semblait-il, plus rien à désirer en ce bas monde.
Pourtant, malgré ses fabuleuses richesses, malgré son universelle renommée et sa grande influence à la Chambre des représentants de Washington, malgré le nom suggestif d’Empereur des dollars que lui avaient décerné ses compatriotes, William Boltyn n’était pas heureux.
Il regrettait presque le temps où, vagabond, sans sou ni maille, exerçant tour à tour les professions de garçon de bar, laveur de vaisselle ou vendeur de journaux, il avait parcouru toute l’Amérique, pauvre, mais sans souci.
Depuis quelque temps surtout, encore plus morose qu’à l’ordinaire, il arpentait rageusement pendant des heures, les vastes galeries de tableaux de son hôtel, crevant çà et là à coups de canne les chefs-d’œuvre des maîtres européens, comme s’il eût trouvé une satisfaction à détruire ces toiles, acquises à coups de bank-notes.
D’où pouvait lui venir cette fureur continuelle ?
Qui donc pouvait exaspérer à ce point le richissime Yankee habitué à tout voir plier devant lui, tout s’incliner devant la puissance de ses dollars ?
Cela, son entourage ne se l’expliquait pas.
Les nombreux domestiques de l’hôtel tremblaient devant le maître, dont l’humeur taciturne et violente semblait s’être encore assombrie, depuis qu’au retour d’un récent voyage en Europe, l’illustre ingénieur Hattison était venu lui rendre visite.
Pour le moment, dans son cabinet de travail, où des tableaux synoptiques fixés aux murs indiquaient la production croissante des usines de conserves, William Boltyn, devant son bureau à cylindre, essayait, mais en vain, de s’intéresser à ses affaires, de mettre en ordre les documents qui, sans qu’il voulut y prendre garde, s’amoncelaient depuis plusieurs semaines.
Lui, le travailleur acharné qui d’ordinaire faisait tout par lui-même, n’avait plus aucun courage.
Au milieu d’une statistique, son crayon lui glissait des doigts, son front se plissait, son regard devenait dur.
Tout à coup, d’un geste brusque, il envoya violemment l’amas de ses papiers s’éparpiller au milieu de la pièce, et poussa un formidable juron :
– Ah ! si je le tenais ! Si je le tenais ! répéta-t-il en appuyant ses paroles d’un coup de poing sous lequel la table de chêne ploya.
L’exaspération du milliardaire était indescriptible.
– Et dire que mes millions sont impuissants contre l’obstination et l’ingratitude de ce Ned, reprit-il après un moment de silence. Ma fortune ! Mais je la donnerais tout entière. Je donnerais même mes usines, mes troupeaux du Far West ; je donnerais tout, si cela pouvait sauver ma fille, la tirer de sa torpeur. Je suis assez fort pour triompher de nouveau, pour gagner d’autres millions ; et cependant je ne peux rien contre cet homme qui torture le cœur d’Aurora, ajouta-t-il avec une intonation de rage impuissante…
« La pauvre enfant, fit-il de nouveau ; le mariage de Ned, qu’elle ne connaît pas, va lui porter le dernier coup. Et je ne pourrai rien faire pour calmer sa douleur, moi qui demain peux réduire à la famine des pays entiers, qui bientôt écraserai l’Europe sous mon talon de président de la Société des milliardaires américains.
Et, délaissant tout à fait son travail, William Boltyn, dans l’attitude d’un homme désespéré, s’abîma dans ses réflexions.
D’une taille moyenne, mais les membres ramassés comme ceux d’un lutteur, la figure impassible et froide avec son menton anguleux et terminé par une barbiche rousse, William Boltyn était le véritable type du Yankee volontaire et guindé, esclave des réalités pratiques.
Dédaigneux de tout ce qui n’était pas d’une utilité immédiate, méprisant profondément les choses et les hommes du Vieux Monde, il n’avait d’intérêt que pour les affaires.
Pour lui, la vie n’était qu’une vaste spéculation, une combinaison de chiffres, un continuel marchandage de matières premières, d’hommes et d’idées.
En dehors de sa fille Aurora, son idole dont il ne discutait même pas les volontés, il ne se rappelait guère une affection, un mouvement de sympathie désintéressée.
Tout au plus gardait-il quelque indulgence à son ancien majordome Tom Punch, dont l’intarissable verve, l’allure de géant ventru et la face cramoisie de solide buveur avaient eu le don de l’amuser.
À part ces deux personnes, William Boltyn avait toujours été, pour ceux qui l’avaient approché, le capitaliste au geste cassant, à la parole brève et concise qui n’a pas de temps à perdre, pour qui les sentiments n’existent pas, ne sauraient exister.
Plus d’une heure s’était écoulée.
Vainement le timbre du téléphone, qui reliait le cabinet de travail aux usines, avait sonné par deux reprises.
William Boltyn avait esquissé un geste d’ennui, sans même relever la tête.
Pour la première fois de sa vie sans doute, il se sentait abattu, sans forces pour réagir.
Tout lui était indifférent.
La porte du cabinet de travail s’ouvrit.
Enveloppée d’un peignoir de soie gris perle, frangé de dentelles d’argent, semées çà et là de nœuds de satin mauve, la figure émaciée par une fièvre qu’on devinait à l’éclat maladif de ses yeux pers, la fille du milliardaire entra, la démarche nonchalante.
Sans une parole elle vint s’étendre sur un large rocking-chair qui faisait face au bureau de son père.
Celui-ci était brusquement sorti de sa torpeur en entendant la porte s’ouvrir.
Il avait suivi la jeune fille des yeux.
– Tiens, fit-elle avec lassitude, en montrant du doigt les feuilles éparses sur le tapis, tes papiers sont bien en désordre.
– Un mouvement brusque. Sans doute cela te contrarie. Attends, je vais les remettre en place.
– Mais non, père, dit-elle en protestant faiblement. Cela ne me contrarie pas. Tu sais bien que rien ne me contrarie.
– Rien ne te distrait non plus, hélas ! Et c’est bien ce qui me désespère. Voyons, ajouta-t-il en souriant, comment allons-nous aujourd’hui ? Désires-tu quelque chose ? Parle. Tu sais bien que je ne te refuserai jamais rien. Une jeune fille comme toi doit avoir des caprices, que diable !
– Quels caprices voulez-vous que j’aie, alors que mon cœur souffre ? Vous savez bien que je pense toujours à lui.
– Voyons, fillette, fit Boltyn avec une bonhomie affectée, pourquoi te tourmenter de la sorte ? Tu es jeune, intelligente et riche ; et tu passes ton temps à gémir, comme si l’avenir ne t’appartenait pas. Ton Ned n’est pas perdu. Tu le retrouveras… bientôt.