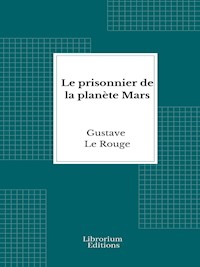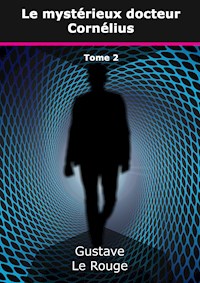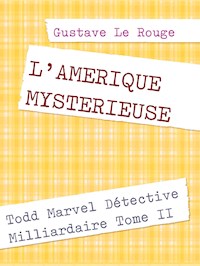0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
– Vous ne sauriez croire, monsieur Georges Darvel, dit le naturaliste Ralph Pitcher, combien votre arrivée fera plaisir à mes amis, le capitaine Wad et l’ingénieur Bolenski ! Ils vous attendent avec la plus vive impatience. Si vous saviez combien nous avons eu de peine à vous découvrir.
– J’en suis encore à me demander comment vous y êtes parvenus.
– C’est une lettre de vous, déjà ancienne, trouvée dans les papiers de votre frère, après la catastrophe de Chelambrun, qui nous a mis sur la voie.
– C’est la dernière que je lui avais écrite, murmura tristement le jeune homme : depuis, je suis sans nouvelles...
– Ne vous désolez pas ainsi ; rien n’est encore définitif ; tout ce que peuvent la science humaine et la puissance de l’or sera mis en œuvre pour le sauver, s’il en est encore temps, je vous le jure !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gustave Le Rouge
La guerre des Vampires
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383837053
Première partie
Les Invisibles
I
Zarouk
– Vous ne sauriez croire, monsieur Georges Darvel, dit le naturaliste Ralph Pitcher, combien votre arrivée fera plaisir à mes amis, le capitaine Wad et l’ingénieur Bolenski ! Ils vous attendent avec la plus vive impatience. Si vous saviez combien nous avons eu de peine à vous découvrir.
– J’en suis encore à me demander comment vous y êtes parvenus.
– C’est une lettre de vous, déjà ancienne, trouvée dans les papiers de votre frère, après la catastrophe de Chelambrun, qui nous a mis sur la voie.
– C’est la dernière que je lui avais écrite, murmura tristement le jeune homme : depuis, je suis sans nouvelles...
– Ne vous désolez pas ainsi ; rien n’est encore définitif ; tout ce que peuvent la science humaine et la puissance de l’or sera mis en œuvre pour le sauver, s’il en est encore temps, je vous le jure !
« Mais revenons à notre lettre, reprit Ralph Pitcher, en essayant de dissimuler la profonde émotion dont il était agité ; elle était datée de Paris, mais ne portait pas d’adresse, vous y parliez de vos études, renseignements assez vagues, vous en conviendrez ; mais miss Alberte voulait absolument vous connaître, et vous savez que notre jeune milliardaire est d’une obstination tout anglo-saxonne.
« Ses agents ont exploré tous les collèges et tous les lycées, multiplié les annonces dans les journaux...
– Sans un hasard véritablement providentiel, tout cela eût été inutile.
« J’avais passé mes derniers examens, je cherchais un emploi d’ingénieur à l’étranger et, grâce à mon diplôme de l’École Centrale...
– L’emploi est tout trouvé ! Mais il faut que je vous mette au courant. Vous ne connaissez encore que les récits des journaux sur l’extraordinaire aventure de votre frère.
– J’ai lu la traduction des messages interastraux. Je sais aussi que miss Alberte s’est retirée dans une solitude profonde.
– Quand il fut malheureusement constaté que les signaux lumineux étaient définitivement interrompus, miss Alberte nous fit appeler, moi, le capitaine Wad et l’ingénieur Bolenski : Mes amis, nous dit-elle, je suis désespérée, mais non découragée. Puisque Robert Darvel a trouvé le moyen d’atteindre la planète Mars, il faut que nous le trouvions aussi, et nous le trouverons, dussé-je y sacrifier ma fortune...
– J’ai compté sur vous pour m’aider.
« Et elle a ajouté, reprit modestement le naturaliste, qu’elle ne trouverait pas dans le monde entier trois savants d’un esprit plus original, d’une faculté créatrice plus...
Ralph Pitcher rougissait comme un collégien et s’embrouillait dans ces phrases élogieuses qu’il était obligé de s’adresser à lui-même.
– Enfin, conclut-il, vous comprenez que nous avons accepté avec enthousiasme. C’était une chance unique.
« Miss Alberte nous a ouvert un crédit illimité ; elle nous a recommandé de ne jamais regarder à la dépense, chaque fois qu’il s’agira d’une chose intéressante ; il y a peu de savants aussi favorisés et, désormais, vous êtes des nôtres ! C’est une chose dite.
Georges Darvel, rouge de plaisir, balbutia un remerciement auquel Pitcher coupa court par un énergique shake hand.
– Il suffit, murmura-t-il.
« En vous associant à nos travaux, nous acquittons une dette sacrée envers le souvenir de notre ami, du glorieux savant que nous retrouverons un jour, j’en suis certain.
Tous deux demeurèrent comme accablés sous le poids de leur pensée et continuèrent à marcher en silence sous les ombrages géants des chênes-lièges, des caroubiers et des pins d’Alep, qui composent en majeure partie la grande forêt de Kroumine.
Ils suivaient en ce moment une des routes forestières qui sillonnent la région sauvage située entre Aïn Draham et la Chehahia.
Pour faire admirer à son nouvel ami cette pittoresque contrée, Pitcher avait proposé de faire le chemin à pied ; un mulet de bât, chargé des bagages et tenu par un Nègre, suivait à une vingtaine de pas.
Ce coin verdoyant de l’aride Tunisie renferme peut-être un des plus beaux paysages du monde.
La route forestière, avec ses larges pierres de grès rouge recouvertes d’une mousse veloutée, serpentait à travers une contrée coupée de vallons et de collines qui, à chaque détour, offrait la surprise d’une perspective nouvelle.
Tantôt, c’était un oued bordé de cactus et de hauts lauriers-roses dont il fallait franchir, à gué, le lit semé de grosses pierres luisantes. Tantôt des landes – véritable maquis de myrtes sauvages, d’arbousiers et de bruyères hautes comme un homme – exhalaient, sous l’ardeur dévorante du soleil, une buée d’entêtants parfums.
Ailleurs, une ruine romaine accrochait sa voûte croulante au flanc d’une colline et de vieux oliviers, contemporains d’Apulée et de saint Augustin, agrippaient leurs racines entre les blocs et secouaient leur grêle feuillage, comme une chevelure, au-dessus du fronton d’un temple. Plus loin, un énorme figuier, au tronc penché par les vents, formait à lui seul tout un bosquet fourmillant d’oiseaux, de caméléons et de lézards ; et parfois, tout au sommet du vieil arbre dont les branches mollement inclinées formaient de commodes sentiers, apparaissaient les cornes et la barbiche d’un chevreau occupé à manger des figues.
Puis, la forêt reparaissait, avec de profondes percées dont la fuite se perdait dans une brume azurée, des ravins délicieusement escarpés, qui semblaient des abîmes de feuillages.
Les pins et les chênes zéens au feuillage d’un gris léger avaient des silhouettes légères et vaporeuses, au milieu desquelles éclatait brusquement la note plus brutale d’un hêtre rouge ou d’un peuplier d’Italie aux feuilles de soie blanche éternellement frissonnantes.
Mais la capitale magie, c’étaient les vignes retournées depuis des siècles à l’état sauvage et lançant, du fond humide des ravins jusqu’au sommet des plus hauts arbres, un feu d’artifice de pampres et de ceps d’une prodigieuses richesse.
C’était une débauche de frondaisons luxuriantes, à faire croire que la terre entière serait un jour envahie par cette impétueuse poussée de sève.
Les sarments jetaient à une hauteur souvent prodigieuse des ponts élégants, des hamacs festonnés, où se balançaient par milliers les ramiers bleus et les tourterelles blanches et roses, tout à coup mis en fuite dans un froufrou de battements d’ailes et de piaillements par l’ombre brune d’un vautour, traçant de grands cercles dans l’air bleu.
Dans les endroits marécageux, des troupeaux de petits sangliers fuyaient entre les hautes lances des roseaux et le cri de la hyène, qui ressemble à un rire ironique et qui s’éloigne à mesure que l’on se rapproche, retentissait à de longs intervalles.
Mais, il faudrait dire la grâce de cette nature vierge, la robustesse élastique et fière de ces arbres jamais émondés, les clairières de fleurs et de hautes herbes et cet obsédant parfum de myrte et de laurier-rose, qui est comme l’haleine embaumée de la forêt magique.
– Regardez ces vignes ! s’écria Ralph Pitcher avec admiration. Ces ceps ont peut-être quinze ou dix-huit cents ans ; à l’automne, ils se chargent encore de grappes excellentes ; on retrouverait sans doute, en les pressurant, les crus perdus dont s’enivraient les Romains de la décadence, les vins qu’on servait à Trimalcion mélangés à la neige dans des cratères d’or...
Georges Darvel ne répondit pas tout d’abord ; ses préoccupations étaient loin de ces réminiscences classiques où se délectait l’érudit Ralph Pitcher.
– Comment donc, demanda tout à coup le jeune homme, vous trouvez-vous en Tunisie ? J’aurais eu plutôt l’idée de vous chercher dans les Indes ou en Angleterre.
– C’est précisément pour dépister les curieux et aussi à cause de la beauté du climat et du site que miss Alberte a choisi ce pays ignoré, rarement visité par les touristes.
« Ici, nous sommes sûrs que personne ne viendra, sous de futiles prétextes, nous déranger dans nos travaux : nous sommes à l’abri des reporters, des photographes, des gens du monde, de tous ceux que j’appelle énergiquement des « voleurs de temps ».
« C’est la paix profonde d’un laboratoire d’alchimiste, dans quelque abbaye du Moyen Âge, mais une abbaye pourvue de l’outillage scientifique le plus complet, le plus puissant dont jamais savant ait disposé.
« Autrefois, au cours d’une croisière de son yacht, le Conqueror, miss Alberte avait eu l’occasion de visiter la Kroumirie et elle en avait conservé un merveilleux souvenir.
« Il y a quelques mois, par l’intermédiaire de son correspondant de Malte, elle acheta, en pleine forêt, la villa des Lentisques, un merveilleux palais arabe, une folie, qu’un banquier sicilien, incarcéré depuis comme recéleur de la Maffia, avait eu la fantaisie de faire construire dans ce désert.
« D’ailleurs, vous allez pouvoir en juger par vous-même.
« Nous sommes presque arrivés. Regardez un peu sur votre gauche ; cette grande masse blanche, c’est la villa des Lentisques...
– Je verrai miss Alberte ! s’écria Georges Darvel. Je pourrai lui dire toute ma gratitude pour ses héroïques efforts en faveur de mon frère !
– Vous la verrez sans doute, mais pas aujourd’hui, ni demain ; vous ne m’avez même pas laissé le temps de vous dire qu’elle ne rentrera que dans le courant de la semaine.
« Elle nous a quittés depuis une quinzaine, les intérêts de son exploitation minière réclamaient impérieusement sa présence à Londres.
– Tant pis, murmura le jeune homme, un peu décontenancé.
– À ce propos, vous savez que le champ d’or découvert par votre frère n’a cessé de fournir le rendement le plus prodigieux.
« C’est le Pactole lui-même qui se déverse dans les caisses de miss Alberte ! Les dépenses de notre laboratoire ne sont qu’une goutte d’eau puisée à ce torrent de richesse débordante.
Un cri étouffé interrompit brusquement Ralph Pitcher, en même temps qu’une troupe d’oiseaux, effarés, quittaient les branches pour s’envoler tumultueusement.
– C’est Zarouk, mon Noir, qui a eu peur, murmura le naturaliste, je vais voir. Il faut dire qu’il s’effraie souvent de peu de chose.
Droit au milieu du sentier, Zarouk demeurait immobile, comme pétrifié par la peur ; son visage avait passé du noir profond au gris livide, ses traits révulsés, son torse cabré reflétaient une épouvante immense.
Georges remarqua alors que le Noir était aveugle, ses prunelles protubérantes étaient voilées d’une taie blanche ; mais cette infirmité ne donnait rien de hideux ni de répulsif à son visage ; son front était haut et bombé, son visage régulier, son nez mince et droit, enfin ses lèvres n’offraient pas cette épaisseur qui imprime à la physionomie une expression bestiale.
Cependant, Ralph s’était approché.
– Qu’y a-t-il donc, mon pauvre Zarouk ? demanda-t-il affectueusement. Je ne te croyais pas si poltron ! Y aurait-il une panthère dans le voisinage ?
Zarouk secoua la tête en signe de négation, trop ému encore pour répondre ; sous le burnous de laine blanche dont il était enveloppé, ses membres étaient agités d’un tremblement et il serrait d’une main convulsive la bride du mulet qui, chose étrange, semblait partager la frayeur du Noir ; il regimbait et était agité d’un violent frisson.
– Voilà qui est extraordinaire, dit Georges à l’oreille de son ami.
« Et cette envolée subite des oiseaux, il y a un instant ?
– Je ne sais que penser, répondit le naturaliste en regardant tout autour de lui avec inquiétude. Zarouk a évidemment deviné un péril ; mais lequel ?
« À part quelques scorpions tapis sous les terres, quelques chats sauvages, la forêt d’Aïn-Draham ne renferme pas d’animaux nuisibles.
– Mais les hyènes ?...
– Ce sont les bêtes les plus lâches et les plus peureuses ; elles ne s’attaquent jamais à l’homme. Zarouk n’est pas capable de s’effrayer pour si peu de chose.
– Vous avez tout à l’heure parlé de panthères ?
– Elles sont extrêmement rares en Tunisie, même dans le Sud ; il se passe quelquefois cinq ou six ans sans qu’on en capture une seule.
« D’ailleurs, Zarouk, qui est né dans le Soudan, d’où les caravanes Chambaa l’ont apporté tout enfant à Gabès, n’aurait pas plus peur des panthères que des hyènes. Il faut qu’il y ait autre chose.
– Nous allons le savoir ; Zarouk commence à se remettre.
– Eh bien, reprit Pitcher en se tournant vers le Noir, parleras-tu maintenant ? Tu sais bien qu’à nos côtés tu n’as rien à craindre.
« Vraiment, je te croyais plus brave.
– Maître, repartit le Noir d’une voix étranglée, Zarouk est brave, mais tu ne peux pas savoir... C’est terrible ! Zarouk n’a pas peur des bêtes de la terre et des oiseaux du ciel ; mais il a peur des mauvais esprits !
– Que veux-tu dire ?
– Maître, je te le jure, au nom du Dieu vivant et miséricordieux, par la barbe vénérable de Mahomet, prophète des prophètes, tout à l’heure, j’ai été effleuré par l’aile d’un des djinns, ou peut-être d’Iblis lui-même !...
« Tout mon sang a reflué vers mon cœur... Je n’ai eu que le temps de prononcer trois fois le nom sacré d’Allah qui met en fuite les djinns, les goules et les afrites... Une seconde, une face effroyable s’est dessinée, comme en traits de feu, au milieu des ténèbres éternelles qui m’enveloppent, et s’est enfuie rapidement, emportée sur ses ailes... Oui, maître, je te l’atteste, une seconde, j’ai vu !
– Comment as-tu pu voir ? interrompit Ralph d’un ton plein d’incrédulité. Nous qui voyons, nous n’avons rien aperçu. Tu as été l’objet de quelque hallucination, comme ceux qui sont ivres de dawamesk ou d’opium.
« Tiens, bois une gorgée de bouka1 pour te remettre et oublie cette sotte frayeur.
Le Noir prit avec une joie évidente la gourde que lui tendait Ralph Pitcher et but à longs traits ; puis, après, un moment de silence :
– Je suis sûr que je n’ai pas rêvé, dit-il lentement ; toi et ton ami le Français, vous avez vu les oiseaux s’envoler, le mulet demeurer moite et frissonnant comme à l’approche du lion, car eux aussi ont eu peur.
« N’est-il pas possible que par la volonté toute-puissante d’Allah, le mauvais esprit soit devenu pour quelques instants visible à mes prunelles mortes, afin de m’avertir de quelque danger ?
– Je persiste à croire, moi que tu as eu une hallucination ; dans ta peur, tu as donné, sans t’en apercevoir, une brusque secousse à la bride, ce qui a effrayé le mulet lui-même, et il suffit qu’au même moment un vautour ait passé...
Zarouk secoua la tête sans répondre, faisant ainsi entendre que l’explication rationaliste de Ralph Pitcher n’était pas de son goût et qu’il s’entêtait dans sa croyance au djinn.
L’on se remit en marche ; seulement, le Noir s’était rapproché de ses deux compagnons, comme s’il eût craint un retour offensif de la terrible apparition.
Ralph Pitcher était, lui, complètement rassuré.
– Zarouk, expliqua-t-il à Georges dont la curiosité était singulièrement excitée, est le plus précieux et le plus fidèle des serviteurs. Sa cécité ne l’empêche pas de nous rendre de grands services. Comme beaucoup de ses pareils, il est donc d’une exquise sensibilité de l’ouïe, de l’odorat et du tact.
« Dans notre laboratoire, il connaît exactement la place de chaque objet et sait le trouver rapidement sans jamais commettre d’erreur ou de maladresse. Il arrive même à connaître certains états du monde extérieur dont les autres hommes ne doivent d’ordinaire la notion qu’à leurs yeux. Je n’ai pas encore pu m’expliquer à l’aide de quelle fugitive notation de sensations, de quelles subtiles associations d’idées il y parvient.
« Ainsi, il dira parfaitement qu’un nuage vient de passer sur le soleil et, s’il y a plusieurs nuages, il arrivera à les compter ; nous l’avons emmené à la chasse, nous lui avons mis un fusil en main et il nous a émerveillés par son adresse. En entrant quelque part, il reconnaît sans la moindre hésitation les personnes avec lesquelles il s’est rencontré seulement une fois.
– Tout cela est merveilleux, fit Georges, mais ce n’est pas absolument inexplicable ; on cite dans le même ordre de faits un grand nombre d’exemples.
– Vous aurez le loisir de l’étudier par vous-même. Zarouk est certainement beaucoup plus prodigieux que vous ne pensez.
« Il y a des moments où je suis tenté de croire que, derrière la taie qui les recouvre, ses prunelles sont sensibles aux rayons obscurs du spectre, invisible pour nous, aux rayons X et peut-être à d’autres radiances plus faibles et plus ténues.
« Pourquoi, après tout, une telle chose ne serait elle pas possible ?
Georges réfléchit un instant, puissamment intéressé par cette aventureuse hypothèse.
– Pourquoi alors, demanda-t-il à son tour, n’avez-vous pas eu l’idée de le faire opérer de la cataracte ?
– Le capitaine Wad y avait pensé le premier, Zarouk s’y est toujours refusé avec opiniâtreté.
Les deux amis cheminèrent quelque temps en silence ; derrière eux, Zarouk avait entamé une de ces mélopées interminables et tristes, qui sont les chansons de route des chameliers du grand désert ; malgré lui, Georges était impressionné par cet air monotone, où les mêmes notes revenaient indéfiniment et qui semblait imiter la plainte déchirante du vent dans les plaines mortes du Sahara.
– Savez-vous, dit-il en riant à Pitcher, que ce que vous venez de me dire n’est pas rassurant ; si vraiment Zarouk – comme ces chauves-souris qui, les yeux crevés, volent en ligne droite et savent se garer des obstacles – possède une puissance de tactilité si étonnante, il doit y avoir quelque chose de vrai dans l’apparition, invisible pour nous, qui l’a effrayé.
– Qui sait ? murmura le naturaliste, devenu songeur. Ne faut-il pas toujours en revenir à la parole de notre Shakespeare, qu’il y a dans le ciel et sur la terre plus de choses que notre faible imagination ne peut en concevoir ?
« Peut-être Zarouk est-il un des précurseurs d’une évolution de l’œil humain qui, dans des centaines de siècles et bien avant peut-être, percevra des radiances qui n’existaient pas aux premiers âges du monde.
« Déjà, certains sujets, en état d’hypnotisme, voient ce qui se passe au loin ou de l’autre côté d’un grand mur et pourtant, au moment où s’exerce cette faculté suraiguë de vision, leurs yeux sont fermés.
« Le jour où la science arrivera à échafauder là-dessus une thèse solide...
Ralph Pitcher n’acheva pas sa pensée ; il y eut un nouveau silence.
– Qu’est-ce que les djinns ? demanda Georges brusquement. Je vous avoue que je suis là-dessus d’une ignorance profonde. L’étude des sciences m’a fait considérablement négliger la mythologie mahométane.
– Je pourrais vous en dire autant ; mais Zarouk va nous renseigner.
« Il a sur ces questions une inépuisable faconde. Comme tous les gens du désert, il a l’imagination farcie de ces contes merveilleux qu’on se répète autour des feux du campement, dans toutes les caravanes.
« Zarouk !
– Maître, dit le Noir en s’avançant avec un empressement qui n’avait rien de servile, j’ai entendu la question de ton ami. Mais est-il prudent de parler de ces êtres terribles, alors qu’ils rôdent peut-être encore autour de nous ?
– Sois sans crainte, ne m’as-tu pas dit toi-même que la puissance de leurs ailes peut les porter en quelques heures à des centaines de lieues ?
Cette réflexion parut faire beaucoup de plaisir au Noir.
– Sans doute, répondit-il, en poussant un soupir de soulagement ; cela est vrai et je n’ai pas menti ; puis, ne suis-je pas sous la protection du Dieu invincible et miséricordieux ?
Et il continua d’une voix nasillarde et chantante :
– Les djinns sont les esprits invisibles qui habitent l’espace qui s’étend entre le ciel et la terre, leur nombre est mille fois plus considérable que celui des hommes et des animaux.
« Il y en a de bons et de mauvais, mais ceux-ci l’emportent de beaucoup. Ils obéissent à Iblis, auquel Dieu a accordé une complète indépendance jusqu’au jour du jugement dernier.
« Le sage sultan Suleyman (Salomon) qui est révéré même des juifs et des infidèles avait reçu de Dieu une pierre verte d’un éclat éblouissant, qui lui donnait le pouvoir de commander à tous les mauvais esprits ; jusqu’à sa mort, ils lui montrèrent une parfaite soumission et il les employa à la construction du temple de Jérusalem ; mais depuis sa mort ils se sont dispersés par le monde, où ils commettent toutes sortes de crimes...
C’était là un sujet sur lequel Zarouk, comme tous les Arabes du désert, était intarissable.
Georges Darvel et son ami Pitcher se gardaient bien de l’interrompre et le laisser énumérer complaisamment les diverses variétés de djinns, d’afrites, de toghuls ou ogres, de goules et d’autres êtres fantastiques, tous doués d’un pouvoir aussi redoutable que merveilleux.
Ils éprouvaient à l’entendre le même plaisir que, tout enfants, ils avaient ressenti à la lecture des Mille et Une Nuits.
Vraiment, ils étaient loin des hautes hypothèses scientifiques qu’ils discutaient un instant auparavant ; ils ne pouvaient s’empêcher de sourire de la gravité avec laquelle Zarouk leur débitait ces étonnantes fables auxquelles il ajoutait certainement la foi la plus entière.
Le Noir, d’ailleurs, avec une facilité que possèdent tous les Orientaux pour les langues, s’exprimait en dépit de ses barbarismes en un français très clair ; comme presque tous les Arabes, il était né conteur.
Ralph et Georges Darvel étaient sous le charme de sa parole, lorsque, au détour d’un massif d’amandiers et de caroubiers, ils se trouvèrent tout à coup en face de la villa des Lentisques.
II
La villa des Lentisques
Bâtie au centre d’une profonde vallée, la villa des Lentisques s’élançait comme une île de marbre blanc d’un océan de fleurs et de verdures. C’était un rêve grandiose réalisé par la féerie du million.
Les merveilles de l’architecture arabe y avaient été combinées, harmonieusement fondues, avec tout ce que le style vénitien déjà si proche de l’Orient, offre de plus noble et de plus magnifique dans ses lignes, de plus éclatant dans sa couleur.
Les briques coloriées, imitées des azulejos de l’Alhambra, les mosaïques représentant de somptueuses brocatelles faisaient ressortir plus nettement la svelte blancheur des colonnes qui soutenaient les galeries ciselées à jour par des sculpteurs venus à prix d’or du Maroc et de Bagdad.
Les toits dorés, les coupoles d’azur rayonnant au soleil semblaient l’environner d’un nimbe irréel, d’une atmosphère de songe.
Cela était trop beau pour être vrai, on ne pouvait s’empêcher de penser qu’un coup de vent allait dissiper la radieuse apparition comme ces mirages d’eaux et de verdures qui hantent les sables stériles du grand désert.
D’après les ordres d’Alberte, les vieux arbres de la vallée avaient été respectés ; une seule percée – dans la direction du nord – laissait apercevoir les sables jaunes de la côte lointaine et la Méditerranée, telle une étroite bande plus bleue sur l’azur profond du ciel.
Georges Darvel était demeuré immobile, sous le coup d’une admiration si vive qu’elle confinait à la stupeur.
La villa des Lentisques, dans son idéale perfection, ne lui rappelait rien qu’il eût vu, ou même qu’il eût lu, à part peut-être ce miraculeux domaine d’Arnheim si complaisamment décrit par Edgar Poe.
– Que pensez-vous de notre petite installation ? demanda Ralph Pitcher avec bonhomie.
– Je pense, dit Georges, que le palais d’Aladin ne devait être qu’une ignoble bicoque, une repoussante tanière auprès de cette villa.
– N’exagérons pas, mon jeune ami, répondit Ralph d’un air de vaniteuse modestie ; mais il est de fait que la villa des Lentisques réunit à elle seule les efforts et les trouvailles de trois civilisations.
« L’élégante noblesse de l’Italie s’y combine au luxe paresseux des Arabes, enfin le sens méticuleux du confort britannique est venu compléter tout cela.
– Il me semble qu’une partie de la toiture est en verre ?
– Oui, c’est notre laboratoire aménagé sur la plus vaste des terrasses ; de même, nous avons utilisé une des coupoles pour y installer notre télescope, tout cela d’ailleurs sans gâter le profil architectural de magnifique demeure.
« Personne ne soupçonnerait que ce palais des contes de fées est un des arsenaux les plus formidablement outillés de la science moderne.
« D’ailleurs, vous allez pouvoir en juger par vous-même...
Pendant cette conversation, l’aveugle Zarouk avait poussé les battants d’une haute porte de cèdre aux ferrures arabesques, un spacieux vestibule apparut, dallé de mosaïque et soutenu par des colonnes de stuc ; de la voûte pendait une ancienne lanterne turque en cuivre ouvragé, dont le dessin était aussi compliqué que celui de certains ostensoirs gothiques.
Le vestibule, par une triple baie à ogives sarrasines, s’ouvrait sur le patio, vaste cour intérieure plantée d’orangers, de citronniers et de jasmins, rafraîchie par le jet d’eau d’une monumentale fontaine surmontée d’une nymphe de bronze.
Un cloître aux grêles colonnades faisait tout le tour du patio et offrait, avec ses fauteuils de cuir de Venise et ses profonds divans, un abri commode contre la chaleur ; dans le silence à peine troublé par le murmure de l’eau courante, c’était là un lieu à souhait entre tous pour la méditation et la rêverie.
Une jeune fille parut, vêtue de toile écrue, les oreilles parées de lourds anneaux.
– Chérifa, dit le naturaliste, tu vas montrer à ce gentleman la chambre qui lui est destinée, puis tu le conduiras au laboratoire où je vais l’attendre. Tu donneras des ordres pour que notre hôte soit pourvu de toutes les choses nécessaires.
Georges regardait la jeune fille. Son teint de bronze clair, ses grands yeux noirs fendus en amande, son nez aquilin, ses lèvres un peu fortes et les tatouages bleuâtres qui la marquaient au front et au bras, disaient clairement son origine.
Elle pouvait avoir quinze ou seize ans ; elle était dans son genre d’une beauté accomplie.
– Chérifa, expliqua Ralph Pitcher à voix basse, est la fille d’un cheik nomade de la Chehahia.
« Miss Alberte l’a soignée et guérie de la variole, une des maladies qui font le plus de ravages parmi les Arabes ; depuis, elle n’a plus quitté sa bienfaitrice à laquelle elle est entièrement dévouée. C’est une sorte d’esclave volontaire, une humble amie qui a toute la confiance de miss Alberte.
« Chérifa est gaie, douce, charmante, intelligente et nous rend de grands services par son incessante vigilance et son sens pratique déjà très développé.
« C’est un exemple de ce que pourraient devenir les Arabes, si on s’adressait à leur raisonnement et à leur cœur, au lieu de les piller et de les brutaliser, comme cela arrive par malheur encore trop souvent.
Georges suivit sa conductrice jusqu’à une haute et spacieuse chambre du second étage, dont les fenêtres ogivales aux vitraux de couleur donnaient sur un balcon qui dominait la campagne.
Il fut surpris de la science du confort et de la simplicité de cette pièce. Les murailles revêtues de céramique aux arabesques éclatantes, le plafond légèrement creusé en voûte offraient des angles arrondis qui ne pouvaient donner asile ni à la poussière ni aux microbes. Les rideaux en perles de Murano tamisaient l’éclat de la lumière sans l’intercepter, enfin les meubles établis d’après les dessins d’un élève de Walter Crane étaient en cuivre forgé ou en porcelaine, suivant une mode qui commence à s’introduire dans les salons de quelques milliardaires.
Des gerbes polychromes de fleurs de verre recelaient les ampoules des lampes électriques et une grande bibliothèque renfermait en des reliures admirables les publications récentes de la science et les chefs-d’œuvre éternels des poètes.
Un vaste cabinet de toilette attenant à la chambre offrait l’appareil le plus complet de bains chauds et froids, de bains électriques et de bains de lumière.
Tout cela était d’un goût parfait et d’une simplicité royale.
– Tu seras bien là, dit Chérifa avec un rire éclatant qui découvrit ses dents blanches. Voici le téléphone, voici le bouton électrique pour appeler les serviteurs à toute heure du jour ou de la nuit.
« Mais, n’as-tu pas faim ? Ne désires-tu pas quelques rafraîchissements ?
– Je te remercie, j’ai déjeuné très suffisamment à Tabarka.
– C’est bien, je te laisse...
Vive et légère comme ces gazelles du désert, dont elle avait les grands yeux tendres et pensifs, Chérifa avait déjà disparu.
Demeuré seul, Georges Darvel prit un tub dont la chaleur et la poussière de la route lui firent particulièrement apprécier le bienfait, puis il remplaça son vêtement de voyage par un complet de pyjama et descendit au patio.
Là, il retrouva Chérifa, qui lui servit de guide jusqu’au laboratoire qui occupait à lui seul la plus vaste des terrasses de la villa. C’était un immense cube de cristal formé de cinq gigantesques vitres maintenues par quatre colonnes et quatre poutrelles d’acier ; on y accédait par une sorte de trappe intérieure.
D’épais rideaux de feutre permettaient d’y produire à volonté – par la seule pression d’un bouton électrique – le jour ou la nuit, la clarté la plus radieuse ou les ténèbres opaques.
Quoique Georges Darvel connût les laboratoires les mieux outillés de Paris et de Londres, il aperçut là une foule d’appareils dont il ignorait l’usage ou du moins qu’il n’avait jamais vus.
Il y avait des plaques photographiques de plusieurs mètres carrés de surface, des miroirs enduits d’un tain spécial qui gardaient nettement pendant quelques minutes les plus fugitives images de nuages et d’oiseaux.
De gigantesques tubes étaient braqués vers le ciel, de puissants microphones devaient apporter aux oreilles des expérimentateurs les plus imperceptibles bruits du ciel et de la terre.
Le jeune homme vit encore des appareils inconnus, composés de miroirs lenticulaires reliés à de puissantes piles et à des flacons à tubulures remplis de liquides multicolores.
Le laboratoire communiquait par un escalier à vis avec une annexe où se trouvaient les armoires de produits chimiques, les puissants fours électriques et les frigorifiques, ainsi que la bibliothèque richement garnie des introuvables bouquins des alchimistes et des talmudistes.
L’ensemble constituait une installation unique et merveilleusement complète.
En pénétrant dans ce sanctuaire de la science, Georges Darvel était demeuré tout interdit, en proie à une respectueuse émotion.
Ralph Pitcher s’empressa de venir au-devant de lui.
– Mon cher ami, lui dit-il, vous êtes des nôtres à partir d’aujourd’hui. Je vais vous présenter à nos collaborateurs, aux amis dévoués de votre illustre frère, le capitaine Wad et l’ingénieur Bolenski.
À ces mots, deux personnages en longue blouse de laboratoire qui, aidés de Zarouk, étaient occupés à décanter le contenu d’une bonbonne dans une grande cuve de verre, abandonnèrent leur besogne et se hâtèrent d’accourir.
Il y avait, entre l’Anglais et le Polonais, un contraste frappant. L’ingénieur Bolenski, de haute stature, avec des yeux d’un bleu très clair et une longue barbe d’un blond pâle, était expansif et bruyant ; tous les côtés impulsifs du caractère slave, – franchise, loquacité, imagination prompte et hardie jusqu’à la témérité, – apparaissaient pour ainsi dire à chacune de ses paroles, à chacun de ses gestes.
Le capitaine Wad, de taille moyenne avec de longues moustaches déjà grisonnantes et des yeux noirs presque durs, était raide, glacial, gourmé ; ses gestes, rares, avaient une précision d’automate.
On devinait qu’il devait être plus sérieux, logique avec lui-même jusque dans ses paroles les plus insignifiantes ; mais, sous ces dehors un peu secs, le capitaine était l’homme le plus loyal et le plus généreux.
Ce fut avec une cordialité réelle qu’il serra la main de Georges, dans un shake hand d’une énergie toute britannique, en l’assurant de toute sa sympathie, et de tout son dévouement.
– Vous savez, monsieur Darvel, fit Ralph Pitcher, que ce n’est pas là une simple formule de politesse, le capitaine ne dit rien à la légère, il pèse le sens de ses mots et il n’est guère prodigue de semblables protestations.
Quant à l’ingénieur, il semblait fou de joie et ne se lassait pas de contempler le jeune homme qui, très intimidé, se confondait en remerciements.
– C’est étonnant, s’écria le Polonais avec émotion, comme monsieur Darvel ressemble à son frère ! Il me semble le voir tel qu’il était quand nous habitions ensemble le désert sibérien.
« Tout à l’heure, en l’apercevant, j’ai ressenti comme un choc en plein cœur ; quoique je fusse prévenu de son arrivée, je n’ai pu m’empêcher, une seconde, de penser que notre cher grand homme était de retour, j’ai cru voir surgir, triomphant, l’explorateur du ciel, le conquérant des astres !
Il y eut un moment de silence, les quatre savants se regardèrent ; ils venaient d’avoir la même pensée.
– Croyez-vous sincèrement, messieurs, dit enfin Georges avec hésitation, que mon frère soit encore vivant ? Qu’il puisse réussir à rejoindre la terre ?
– Je crois fermement, répondit le capitaine Wad d’un ton grave, que votre frère est encore vivant.
– Cependant, ces signaux brusquement interrompus ? objecta le jeune homme avec tristesse. Je vous l’avoue, je n’ose montrer autant d’espoir, autant de confiance que vous-mêmes... Je voudrais bien être dans l’erreur, je vous le jure, et pourtant...
– Mais cela ne prouve rien, jeune homme, que les signaux aient cessé ! interrompit le Polonais d’une voix tonnante.
« Notre ami peut être parfaitement vivant, sans pour cela posséder le moyen de continuer à correspondre avec la Terre, moyen très difficile même pour nous !
« Raisonnons un peu : Robert Darvel a atteint la planète Mars sain et sauf, et il y a acquis assez de pouvoir sur les habitants pour faire établir ces lignes lumineuses que nous avons pu photographier. Pourquoi aurait-il péri ?
« Nous n’avons aucune raison de le supposer.
– Cependant, objecta encore le jeune homme, cette étrange histoire de captivité chez les Erloors à partir de laquelle les signaux n’ont plus paru ?
– Le fait n’est nullement probant. Réfléchissez que Robert a certainement échappé au péril, puisqu’il était en mesure de nous le raconter.
« Il parlait là d’un événement bien antérieur.
– Je vous dirai encore autre chose, fit à son tour le capitaine Wad. Robert Darvel ne peut pas être mort ; il y a des causes mystérieuses et profondes au succès d’une tentative aussi inouïe, elle ne peut pas avoir été vaine. La force consciente qui gouverne les mondes et qui régit les phénomènes avec la plus rigoureuse logique ne peut avoir permis un tel voyage inutilement.
« Qu’on m’accuse si l’on veut d’être un mystique ; mais je crois qu’il fallait de toute nécessité – j’allais dire de toute éternité – que Mars et la Terre, les deux planètes sœurs, entrassent en communication ! Il fallait que Robert Darvel réussît comme il faut qu’il revienne sur la Terre, l’enrichir de toute la pensée, de toute la science d’un univers nouveau !
« C’est une vérité pour moi aussi limpide et aussi claire qu’un théorème d’Euclide...
Le capitaine Wad, si froid l’instant d’auparavant, avait prononcé cette phrase avec un enthousiasme et une chaleur si communicatifs que Georges se sentit à demi persuadé du rôle providentiel attribué à son frère sur la destinée des deux planètes.
– D’ailleurs, ajouta Pitcher, avec son flegme habituel, nous n’attendrons pas que Robert Darvel revienne, nous irons le rejoindre et très prochainement.
– En auriez-vous déjà trouvé le moyen ? balbutia Georges qui, peu à peu, se sentait gagné par la foi ardente des deux savants.
– Nous en sommes bien près, répondit le capitaine, devenu pensif ; nous ne sommes plus arrêtés que par des détails pratiques de construction de notre appareil, des difficultés techniques tout à fait secondaires et que nous résoudrons sûrement.
« C’est l’affaire de quelques semaines.
« Je reconnais d’ailleurs que ce que j’ai pu sauver des notes de votre frère à Chelambrun nous a puissamment servi.
– Je vous aiderai ! s’écria Georges, les yeux étincelants de joie.
– Vous savez, reprit le capitaine qui, absorbé par ses pensées, ne l’avait pas entendu, que tous les phénomènes physiques, mécaniques ou chimiques se réduisent à un seul : le mouvement.
« C’est maintenant une vérité banale.
« La chaleur est un certain mode de mouvement, comme la lumière en est un autre.
« Nous pouvons vérifier tous les jours que le mouvement se transforme en chaleur, la chaleur en électricité, l’électricité en lumière.
« Il était logique de présumer que l’électricité dans certaines conditions peut se transformer en fluide volitif, en volonté.
« L’homme réalisera tout ce qu’il voudra, le jour où il pourra ajouter à son cerveau débile la puissance presque infinie des courants électriques, où il pourra charger son système nerveux de fluide volitif comme on charge d’électricité un accumulateur.
« Alors, il ne connaîtra plus ni la fatigue, ni la maladie, ni peut-être – qui sait ? – la mort.
« Il n’y aura plus d’obstacle pour lui ; il pourra tout ce qu’il voudra !
« Votre frère, lui, avait trouvé le moyen d’emmagasiner le fluide volitif ; nous avons cherché, nous, le moyen de transformer l’électricité en énergie volitive.
– Et vous avez trouvé ? demanda Georges, haletant, émerveillé, presque effrayé des horizons grandioses qui s’offraient à son imagination.
– Je vous l’ai dit, à l’instant, nous ne sommes plus arrêtés que par des détails techniques.
– D’ailleurs, interrompit l’impétueux Bolenski, nous sommes en mesure de vous faire constater dès maintenant des résultats pratiques, nos découvertes ne sont pas de pures théories !
« Vous allez en juger.
Le Polonais alla prendre, sous une cloche, un bizarre casque de verre et de cuivre terminé par un faisceau de fils de platine reliés à un accumulateur.
Il en coiffa le capitaine Wad, qui l’avait laissé faire avec un silencieux sourire et qui ainsi casqué ressemblait assez à un scaphandrier en costume de travail.
– Vous voyez, reprit l’ingénieur, continuant sa démonstration ; en ce moment, le courant fourni par l’accumulateur est en train de se transformer en fluide volitif et de s’emmagasiner dans le cerveau de notre ami.
« Regardez comme ses yeux fulgurent, quelle étrange expression de calme et de puissance a revêtu sa physionomie ; elle semble maintenant entourée d’une sorte d’irréelle clarté !
« Sa volonté est maintenant doublée, triplée, décuplée...
« Il pourrait nous ordonner ce qu’il voudrait ; en dépit de nous, nous serions forcés de lui obéir.
Georges Darvel se taisait ; l’ingénieur Bolenski prit ce silence pour de l’incrédulité.
– Vous en voulez une preuve, dit-il, le capitaine va vous ordonner mentalement de vous agenouiller ; essayez de lui résister !
– Je serais curieux, en effet... murmura le jeune homme en se raidissant de toutes ses forces.
« Si vous réussissez à me faire faire cela malgré moi, je n’aurai plus rien à dire.
Le capitaine lui lança, à travers son masque, un regard fulgurant.
Georges Darvel eut au creux de l’estomac la sensation cuisante d’une brûlure.
Il eut beau s’arc-bouter, la face congestionnée, le front emperlé de sueur, malgré lui, ses muscles se détendirent, il s’agenouilla.
– C’est effrayant, balbutia-t-il. Qui pourrait résister à une semblable puissance ?
– La science est souveraine, dit orgueilleusement le bon Ralph Pitcher.
– Vous comprenez parfaitement, ajouta le Polonais, que si notre ami vous ordonnait par exemple d’aller prendre ce couteau de dissection là-bas sur la planche, et de couper la tête à l’honnête Zarouk qui nous écoute de son coin avec ébahissement, vous ne pourriez pas vous dispenser de le faire.
« D’ailleurs, tenez, vous êtes déjà en train d’obéir à la silencieuse injonction du capitaine.
Pâle comme un mort, les dents serrées, le visage crispé, Georges Darvel se dirigeait en effet vers l’endroit où se trouvait le couteau, avec les gestes anguleux et raides, les gestes contraints d’une marionnette humaine.
En poussant un profond soupir, il prit l’arme, la serra convulsivement et marcha droit au Nègre qui se reculait, vaguement effrayé.
La lame était déjà brandie, lorsqu’un regard du capitaine arrêta net le meurtrier malgré lui, l’immobilisa dans la pose du sacrificateur antique.
Le visage de Georges exprimait une souffrance et une fatigue indicibles.
– Je vous en prie, murmura-t-il, arrêtez pour un instant ces terribles expériences... Ce que j’éprouve est atroce... Il me semble qu’un autre être s’est installé en moi et qu’on m’a volé ma personnalité.
« Je crois maintenant à tout ce que j’ai lu sur la possession et l’envoûtement...
– Avec cette différence, expliqua Bolenski, que ces phénomènes de domination d’un être par un autre qui ne se produisaient que rarement, dans des circonstances et avec des tempéraments d’une nervosité exceptionnelle, sont maintenant obtenus par nous en toute occasion, avec la plus grande facilité.
– Cependant, dit vivement Ralph Pitcher, il ne faut pas que ces expériences, assurément prodigieuses, vous soient aussi pénibles.