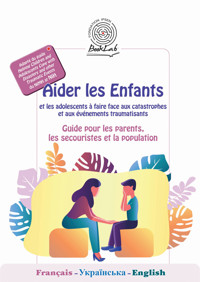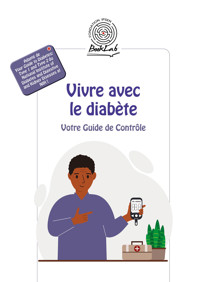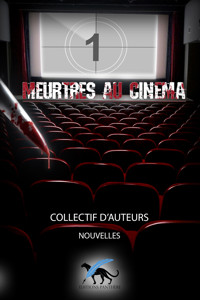Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Connaissances des Pères de l'Église
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
EditorialDans le cadre du Jubilé de l'an 2000, le numéro 69 de Connaissance des Pères de l'Église avait déjà été consacré à l'Esprit Saint, avec des articles de fond sur Tertullien, Basile de Césarée, Hilaire de Poitiers, Grégoire Palamas, et des synthèses sur la pneumatologie à l'époque patristique, dont celle de Basile Studer, publiée au début du numéro 70 de notre Revue.
En fait, e sujet est inépuisable. Les différents articles présentés, cette fois, complètent les précédents en envisageant: Irénée de Lyon, Grégoire de Nazianze, Jean Chysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et les Pères du Désert, sans oublier la procession de l'Esprit Saint. Ainsi se dessinent les grandes orientations de la pneumatologie en Orient et en Occident.
Marie-Anne VANNIER
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Quand le jour de la Pentecôte arrive, les onze disciples sont là, tous ensemble, en train de prier. Alors, comme les Actes des Apôtres nous le disent, soudain un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent. Un feu remplit toute la salle, et cela fait très peur aux amis de Jésus. Quand ils voient la maison qui s’agite comme une barque, ils crient : « Maître, arrête la tempête, et envoie l’Esprit très saint ».
Les disciples croient que l’étage tout entier va s’écrouler à cause de ce vent violent. Alors tous ont peur et ferment les yeux. Et voici qu’il arrive une chose plus effrayante encore. Une nouvelle peur s’ajoute à la première. Les faits étonnants se succèdent. Des langues de feu les touchent et vont se poser sur la tête des amis du Seigneur, elles ne brûlent pas leurs cheveux, mais elles éclairent leur esprit. Pour rendre purs les disciples et pour les laver, elles ont été envoyées avant la venue de l’Esprit très saint.
Pierre, en voyant tous ces événements, s’écrie : « Frères, soyons pleins de respect et d’émerveillement devant tout ce que nous voyons, mais ne nous posons pas de questions. Aucun de nous ne doit dire : Ce qu’on voit là, qu’est-ce que c’est ? » Ce qui s’accomplit est au-dessus de notre intelligence, et dépasse tous nos raisonnements. Le grand vent et le feu sont liés l’un à l’autre. Ce sont des faits étonnants qui réclament notre foi : le vent léger joue avec les flammes, et ce spectacle fait peur. Avec le vent, il y a des flammes ! Avec les gouttes d’eau, des étincelles ! Qui a vu, qui a entendu, qui peut dire ce qu’est l’Esprit très saint ? (…)
Maintenant, frères, chacun de nous doit rejeter sa peur et montrer son amour pour le Seigneur qui a été enlevé au ciel : il a tellement aimé ceux qu’il a appelés ! Tout ce qu’il avait annoncé, il l’a maintenant accompli, et il a tout fait, comme il l’avait dit.
ROMANOS LE MELODE, Hymne.
Sommaire
L’Esprit Saint source de vie
CPE n° 154
Éditorial — Marie-Anne VANNIER
Les Pères de l’Église et l’Esprit Saint — Marie-Anne VANNIER
La procession de l’Esprit Saint chez les Pères grecs — Mgr Job GETCHA
L’Esprit Saint, « metteur en scène » et interprète chez Irénée de Lyon — Agnès BASTIT et Sylvain DETOC
Qui locutus est per prophetas. L’inspiration prophétique chez Grégoire le Théologien — Philippe MOLAC
L’Esprit Saint, maître de vie et de prière d’après les Homélies sur les Psaumes Basile de Césarée — Michel VAN PARYS
L’Esprit Saint dans les Catéchèses baptismales de Jean Chrysostome — Patrick MULLER
Ambroise docteur, maître d’orthodoxie : du De fide au De spiritu sancto — Gérard NAUROY
La Pentecôte : fête de l’Esprit Saint selon Augustin prédicateur — Gérard REMY
Les fleurs de l’Esprit Saint dans le Jardin des moines — Ugo ZANETTI
Actualité des Pères de l’Église
Éditorial
Ce numéro se fait l’écho du colloque sur l’Esprit Saint, qui s’est déroulé à l’Université de Lorraine, à Metz, les 27 et 28 mars derniers.
Dans le cadre du Jubilé de l’an 2000, le numéro 69 de Connaissance des Pères de l’Église avait déjà été consacré à l’Esprit Saint, avec des articles de fond sur Tertullien, Basile de Césarée, Hilaire de Poitiers, Grégoire Palamas, et des synthèses sur la pneumatologie à l’époque patristique, dont celle de Basile Studer, publiée au début du numéro 70 de notre Revue.
En fait, le sujet est inépuisable. Les différents articles présentés, cette fois, complètent les précédents en envisageant : Irénée de Lyon, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d’Hippone et les Pères du désert, sans oublier la procession de l’Esprit Saint. Ainsi se dessinent les grandes orientations de la pneumatologie en Orient et en Occident.
Agnès Bastit et Sylvain Detoc mettent, tout d’abord, en évidence le rôle de révélateur qu’a l’Esprit Saint chez Irénée de Lyon. Grégoire de Nazianze reprend, à sa manière la question, en s’attachant au rôle des prophètes, comme le souligne Philippe Molac. Baile de Césarée, que présente Michel van Parys, et qui est connu pour son célèbre Traité du Saint-Esprit, adopte une perspective analogue, en mettant en évidence, cette fois, le caractère inspiré du Psautier. À partir des Catéchèses baptismales de Jean Chrysostome, Patrick Muller aborde un autre point : le rôle de l’Esprit Saint au baptême.
Comme le montre Gérard Nauroy, Ambroise de Milan, qui réalise la synthèse de la tradition antérieure, s’attache à faire comprendre le rôle de l’Esprit Saint à l’empereur Gratien, non seulement à partir de l’Écriture et des sacrements, mais aussi en raison de ses actions concrètes dans sa vie. Augustin prolonge ses intuitions dans le cadre de sa prédication pour la Pentecôte, comme l’explique Gérard Rémy. Quant aux Pères du désert que fait revivre Ugo Zanetti, c’est un chemin concret de vie dans l’Esprit qu’ils proposent.
Reste la difficile question de la procession de l’Esprit Saint, que Mgr Job Getcha présente de manière magistrale à partir des Pères grecs.
Pionniers, les Pères de l’Église l’ont été pour la pneumatologie, en raison de leur expérience de la vie dans l’Esprit et des réponses qu’ils ont dû donner aux hérésies naissantes.
Marie-Anne VANNIER
Les Pères de l’Église et l’Esprit Saint
L’un des apports essentiels de Vatican II et « la nouveauté majeure de l’après-concile, dans la théologie et la vie de l’Église, a un nom précis : l’Esprit Saint (…), le Pape Jean XXIII voulait faire du concile ‘une nouvelle Pentecôte pour l’Église’ »[1], et il l’a fait, permettant d’ouvrir plus largement le dialogue avec l’Église d’Orient, où la pneumatologie et la vie dans l’Esprit ont toujours été à l’œuvre. La redécouverte conciliaire du « grand oublié » qu’avait été l’Esprit Saint a amené, en même temps, un retour aux Pères de l’Église qui, non seulement, ont vécu dans la dynamique de l’Esprit Saint et ont établi les premières communautés chrétiennes, mais qui ont aussi développé toute une théologie de l’Esprit Saint que l’on appelle pneumatologie (à partir du nom grec pneûma : esprit).
À la suite des Apôtres, qui étaient « remplis de l’assurance que donne le Saint-Esprit (…), l’Église des origines s’est en effet comprise elle-même comme se trouvant sous l’action de l’Esprit Saint et remplie de ses dons »[2]. Les Actes des Apôtres en témoignent, tout comme les épîtres pauliniennes. Les Pères de l’Église, qui vivent dans leur dynamique, en sont à leur tour les témoins, et ils s’attachent à mettre en œuvre les charismes pour la construction des communautés chrétiennes. Ce sont nos frères dans la vie de l’Esprit. Nous retiendrons, en ouverture, cette remarque de Clément de Rome : « Comme la main se promène sur la cithare et les cordes parlent, ainsi parle en mes membres l’Esprit du Seigneur, et je parle par son amour »[3]. Il y a chez les Pères une dimension charismatique, prophétique.
Dans cet article d’ouverture, je ne reprendrai pas les nombreux textes de la Bible, où il est question de l’Esprit, depuis la ruah Yahvé jusqu’au Paraclet de l’Évangile de Jean, sans oublier les fruits de l’Esprit Saint, les charismes dont se font l’écho les épîtres de S. Paul. De plus, ces passages seront pris en compte dans les différents articles, car les Pères sont fondamentalement des commentateurs de l’Écriture. Il y a chez eux une remarquable convergence entre leur expérience de l’Esprit Saint et l’expérience qu’en a eue le peuple de Dieu et qui est consignée dans la Révélation, comme l’a montré Yves Congar dans son maître-ouvrage : Je crois en l’Esprit Saint. Il y précise que, par le terme d’expérience, il « entend la perception de la réalité de Dieu comme venant à nous, actif en nous et par nous, nous attirant à soi dans une communion, une amitié, c’est-à-dire un être l’un pour l’autre (…), une présence de Dieu en nous comme fin aimée de notre vie : présence qui se rend sensible à travers des signes et dans des effets de paix, joie, certitude, consolation, illumination et tout ce qui accompagne l’amour. L’expérience décrite par les grands mystiques est un degré singulier, voire exceptionnel, de cette perception d’une présence de Dieu donné, pour pouvoir en vivre comme objet vivant de connaissance et d’amour. En deçà de l’exceptionnel, il y a l’ordinaire. Dans la prière, dans la pratique des sacrements de la foi, de la vie en Église, de l’amour de Dieu et du prochain, nous recevons l’expérience d’une présence et d’une action de Dieu dans des appels et dans les signes que nous avons dits »[4]. Cette expérience, les Pères, qui ont été pour la plupart des mystiques, l’ont vécue et ils en rendent compte sans cloisonner les domaines, comme nous le faisons aujourd’hui. Ils ont employé des images, celles-là mêmes de l’Écriture : le vent, le souffle, la colombe, la lumière, le feu, la source, l’onction… pour évoquer la vie de l’Esprit. Ils sont partis de l’événement de la Pentecôte, et ils ont vécu, en quelque sorte, une nouvelle Pentecôte, voire une Pentecôte continuée. Jean Chrysostome, par exemple, disait que la Pentecôte, c’est chaque jour. Or, c’est là le creuset de la vie dans l’Esprit Saint.
Aussi avons-nous choisi une icône byzantine de la Pentecôte, élaborée au XIIe siècle, comme logo pour ce numéro de CPE. Elle manifeste le don qu’est l’Esprit Saint, l’expérience qui en est faite, avant d’en rendre compte par le témoignage et par l’approfondissement du mystère trinitaire à l’encontre des hérésies. Ainsi voyons-nous se dessiner une ligne de partage dans la pneumatologie patristique entre une période où il y avait une sorte d’immédiateté de la vie dans l’Esprit Saint dans l’Église, les sacrements et la prière et un tournant au IVe siècle, avec Eunome et les pneumatomaques, qui, en voulant réduire l’Esprit Saint au rang de créature, ont amené les Pères, en particulier les Cappadociens, à montrer la divinité de l’Esprit Saint et à développer non seulement la pneumatologie, mais aussi la théologie trinitaire, tout en soulignant le caractère indissociable de la pneumatologie et de la christologie.
Une pneumatologie aux multiples visages
Nous allons, tout d’abord, reprendre le premier point, en partant de l’écho poétique qu’Ephrem le Syrien a donné de la Pentecôte : « Ils étaient là, disait-il, comme des flambeaux disposés et qui attendent d’être allumés par l’Esprit Saint pour illuminer toute la création par leur enseignement (…). Ô cénacle, pétrin où fut jeté le levain qui fit lever l’univers tout entier. Cénacle, mère de toutes les Églises. Sein admirable qui mit au monde des temples pour la prière. Cénacle qui vit le miracle du Buisson ». Sans doute tous les Pères ne sont-ils pas appelés, comme Ephrem le Syrien, « la harpe du Saint-Esprit », il n’en demeure pas moins qu’il y avait, dans les premiers siècles, une certaine immédiateté de la vie dans l’Esprit, ce qui se manifeste par la mise en place de l’Église.
L’Esprit Saint constitue l’Église
À la suite des Pères, Jean Zizioulas disait récemment que « le Christ institue l’Église et l’Esprit la constitue », et il ajoutait : « La “constitution” est quelque chose qui nous engage dans son être même, quelque chose que nous acceptons librement, parce que nous avons part à son surgissement même ». Les Pères, qui ont eu un rôle de pionniers pour l’Église en étaient particulièrement conscients : Irénée de Lyon soulignait que « là où est l’Église, là est aussi l’Esprit de Dieu ». Augustin allait encore plus loin en comparant l’Esprit Saint à l’âme de l’Église. Tertullien, avant lui, expliquait que “l’Église, au sens propre et éminent du terme, c’est l’Esprit lui-même, dans lequel est la Trinité de l’unique divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est lui qui unit l’Église, celle qui, d’après le Seigneur, consiste en trois personnes”[5]. Cette fois Tertullien n’est pas sans anticiper Lumen gentium.
Sans vouloir actualiser immédiatement l’apport des Pères, force est de constater qu’ils ont compris l’Esprit Saint, non seulement comme celui qui divinise, mais aussi qui humanise et fraternise. Ainsi ont-ils mis en œuvre l’ecclésiologie de communion, comme en témoigne le célèbre cor unum augustinien, qui exhorte à être un seul cœur et une seule âme dans le Christ, comme l’était la première communauté de Jérusalem. Cette ecclésiologie de communion est reprise à Vatican II, autant dire que celui qui avait été le « grand oublié » depuis la fin du Moyen Âge : l’Esprit Saint reprend sa place de maître-œuvre de l’Église.
L’Esprit Saint, à l’œuvre dans les sacrements
De plus, il agit constamment dans les sacrements. Les Pères se sont particulièrement attachés aux sacrements de l’initiation : le baptême, la chrismation et l’eucharistie et ils ont expliqué qu’ils renvoient respectivement au symbolisme de l’eau qui purifie et renouvelle, de l’huile qui réjouit et guérit, du pain et du vin qui refont les forces quotidiennes et réjouissent le cœur.
Le baptême
Il y avait pour eux une sorte d’immédiateté de la vie dans l’Esprit dans les sacrements, ce qui les a amenés à expliquer, comme Ambroise de Milan que “l’eau ne guérit pas, si l’Esprit Saint n’est descendu et n’a consacré cette eau”[6], Cyrille de Jérusalem exhorte également à “ne pas considérer le bain baptismal comme s’il s’agissait d’une eau ordinaire, mais à considérer la grâce spirituelle donnée avec l’eau ; par l’invocation du Saint-Esprit, du Christ et du Père, elle acquiert une force sanctificatrice”[7] et Grégoire de Nysse explique que “ces bienfaits (de la rémission des péchés et de la régénération), ce n’est pas l’eau qui les procure, mais l’ordre de Dieu et la venue de l’Esprit, qui vient dans le mystère pour notre libération”[8]. Avant les autres Pères, Tertullien avait déjà rappelé que ce n’est pas “dans l’eau que nous recevons l’Esprit Saint. Mais purifiés dans l’eau par le ministère de l’ange, nous sommes préparés à recevoir l’Esprit Saint. Ici encore, la figure précéda la réalité : comme Jean fut le précurseur du Seigneur, en préparant ses voies, de même l’ange, qui est témoin du baptême, trace les voies pour la venue du Saint-Esprit, par l’effacement des péchés qu’obtient la foi scellée dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit”[9]. À elle seule, l’eau est inefficace, mais, renouvelée par l’Esprit, elle est le milieu où se réalise la création nouvelle.
La chrismation
Comme le souligne Cyrille de Jérusalem, ce qui est fondamental, c’est le sceau de l’Esprit Saint, qui manifeste le caractère indissociable du baptême et de la chrismation. Ainsi Cyrille de Jérusalem disait-il aux nouveaux baptisés : « Vous êtes devenus des christs, parce que vous avez reçu la marque du Saint-Esprit »[10]. Ambroise est plus explicite encore, lorsqu’il écrit dans son Traité du Saint-Esprit (I, 79): “Nous avons été marqués d’un sceau par l’Esprit de Dieu. Comme, en effet, nous mourons en Christ pour renaître, ainsi nous sommes aussi marqués d’un sceau par l’Esprit pour que nous puissions obtenir la splendeur, l’image et la grâce, qui est d’une manière évidente le sceau de l’Esprit. Car, même si apparemment nous sommes marqués dans notre corps, en réalité nous sommes marqués dans notre cœur, parce que l’Esprit Saint reproduit en nous les traits de l’image de l’homme céleste”. Il en va ici de la création nouvelle.
En une formule d’une étonnante concision, Irénée en précise la dynamique trinitaire : “ceux qui sont baptisés reçoivent l’Esprit de Dieu qui les donne au Verbe, c’est-à-dire au Fils, et le Fils les prend et les offre à son Père, et le Père leur communique l’incorruptibilité[11]”.
L’eucharistie
En fait, la distinction de ces trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie, confirmation a essentiellement une fonction pédagogique. Leur unité fondamentale se manifeste en ce qu’ils “sont célébrés grâce à une épiclèse qui, d’ailleurs, dans l’Église syrienne, a une structure analogue pour tous les trois. C’est que ces sacrements, dans lesquels s’exprime la foi du sujet, l’entraînent par une assomption progressive dans le corps du Christ glorifié, vers l’eschatologie. Le Saint-Esprit est le Don eschatologique, par et dans lequel nous revenons au Père”[12]. C’est justement l’Esprit Saint qui, par l’épiclèse, fait de l’eucharistie un mystère pascal et pentecostal.
Pour mieux le faire comprendre, les Pères ont mis en évidence la place centrale de l’épiclèse, de l’invocation de l’Esprit Saint dans la liturgie eucharistique. Basile de Césarée, qui est à l’origine de la liturgie qui porte son nom, soulignait le caractère mystérieux et unique des paroles de l’épiclèse. Ainsi s’interrogeait-il : “Les paroles de l’épiclèse, au moment de la consécration du pain eucharistique et de la coupe de bénédiction, quel saint nous les a laissés par écrit ? (…) Parmi les doctrines et définitions conservées dans l’Église, nous tenons les unes de l’enseignement écrit et nous avons recueilli les autres, transmises secrètement, de la tradition apostolique (…). Nos pères gardèrent cet enseignement tenu privé et secret dans un silence exempt d’inquiétude et de curiosité, sachant bien qu’en se taisant on sauvegarde le caractère caché des mystères, car ce qu’il n’est pas permis aux non-initiés de contempler, comment serait-il raisonnable d’en divulguer par écrit l’enseignement ?[13]”. Dans la Tradition Apostolique (IV), Hippolyte de Rome distingue la double épiclèse sur les dons et sur l’assemblée et rappelle qu’elle est formulée en ces termes : “Fais descendre ton Esprit Saint sur l’offrande de ton Église sainte et, après les avoir réunis, concède à tous les saints qui la reçoivent d'être remplis de l'Esprit Saint pour qu’ils soient fortifiés dans la foi et dans la vérité, afin que nous te louions et te glorifiions par ton Fils Jésus-Christ, par lequel à toi soient la gloire et l'honneur, Père et Fils avec l'Esprit Saint dans la sainte Église, maintenant et dans les siècles des siècles”. Il y aurait ici toute une étude à faire sur les différentes épiclèses, présentées par les Pères, ainsi que sur la place de l’Esprit Saint dans la liturgie.
L’Esprit Saint dans le Credo
Rapidement aussi, l’Esprit Saint a pris sa place dans le Credo, en passant des symboles binaires : christologiques aux symboles ternaires : trinitaires, avant d’en venir au Credo de Nicée-Constantinople, où est affirmée la divinité du Saint-Esprit.
De plus, dans le Credo, comme dans la foi des chrétiens des premiers siècles, l’Esprit Saint n’est jamais dissocié de l’Église qui est l’expression ou le sacrement de l’Esprit, même si l’action de l’Esprit Saint ne se limite pas aux frontières de l’Église. Cela apparaissait clairement au moment du baptême dans l’Église ancienne, lorsqu’il était demandé au catéchumène : “Crois-tu aussi à l’Esprit Saint dans l’Église pour la résurrection de la chair ?”, comme le rapporte la Tradition Apostolique.
Comme on l’a déjà vu, il y a, pour les Pères, une unité des différents domaines dans l’élaboration de la pneumatologie. Celle-ci connaît un tournant au IVe siècle, en réponse aux hérésies semi-ariennes et pneumatomaques
L’élaboration de la pneumatologie
C’est toute une élaboration théologique qui intervient alors, en particulier chez les Cappadociens, afin de mettre en évidence la divinité du Saint-Esprit et ce, non seulement avec le Traité du Saint Esprit de Basile de Césarée et le Discours 31 de Grégoire de Nazianze, mais aussi avec les Contre Eunome de Basile et de Grégoire de Nysse, avec les Lettres et les Commentaires des Psaumes…
Auparavant, toute une réflexion s’était déjà développée quant à la nature de l’Esprit Saint, à l’intérieur de la Trinité. Irénée de Lyon avait employé la métaphore bien connue des deux mains du Père que sont le Fils et l’Esprit pour l’évoquer. Il est le premier à proposer une pneumatologie. Ainsi écrit-il, au chapitre 20 du Livre IV de l’Adversus Haereses : “Vu autrefois par l’entremise de l’Esprit selon le mode prophétique, puis vu par l’entremise du Fils selon l’adoption, Dieu sera vu encore dans le Royaume des cieux selon la paternité, l’Esprit préparant d’avance l’homme pour le Fils de Dieu, le Fils le conduisant au Père, et le Père lui donnant l’incorruptibilité et la vie éternelle qui résultent de la vue de Dieu pour ceux qui le voient. Car, de même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur, de même ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or vivifiante est la splendeur de Dieu. Ils auront donc part à la vie ceux qui voient Dieu”[14]. Or, l’Esprit est celui qui donne cette lumière. Irénée le précise quelques lignes plus loin en ces termes : “L’Esprit prête son assistance, le Fils fournit son ministère, le Père notifie son bon plaisir et l’homme est rendu parfait en vue du salut”[15].
Origène apporte également une contribution substantielle à la pneumatologie, mais c’est surtout Athanase d’Alexandrie qui, dans ses Lettres à Sérapion, laisse entendre la divinité de l’Esprit Saint. À la suite du Concile de Nicée et en raison de résurgences d’arianisme, touchant, cette fois, la nature de l’Esprit Saint, Athanase s’attache à montrer qu’il est Dieu et qu’il est l’un de la Trinité.
Mais, c’est surtout avec les Cappadociens que la divinité est mise en évidence et reconnue au Concile de Constantinople. Basile et Grégoire de Nazianze ont déployé tous leurs efforts pour montrer que l’Esprit Saint n’est nullement inférieur au Père et au Fils, mais qu’il leur est pleinement égal, il ne leur est en rien subordonné, même s’il est souvent mentionné en troisième lieu. Il est une hypostase au plein sens du terme. Origène disait que le Fils est ‘l’exégète du Père’, la réciproque est également vraie et l’Esprit Saint est en quelque sorte ‘le dictionnaire’ qui nous permet de comprendre l’action de Dieu et qui nous met en relation avec lui.
En une remarquable formule, il distingue ce qu’on appelle aujourd’hui la Trinité économique de la Trinité immanente. Ainsi dit-il au chapitre XVIII du Traité du Saint-Esprit