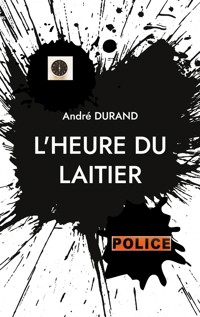
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Ce livre retrace ma carrière professionnelle au sein de la police nationale. Il relate un certain nombre d'enquêtes que j'ai initiées et qui m'ont marquées pour certaines d'entre elles. Ce manuscrit illustre ma vie de flic, de la police judiciaire en passant par la police urbaine de proximité, pour s'achever à l'inspection générale des services (IGS).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE
Le choix d’être flic
Cannes Ecluses
Premiers rendez-vous avec la mort
La P.J.
La femme agressée
La Ferrari volée
L’îlot Chalon
Les agressions sexuelles
Le groupe ramassage
Le groupe nuit
La mort au volant
La Peugeot 205 GTI
L’accident du pont de l’Alma
La moto
Accident de service
Les crimes crapuleux
Le crime du 17
ème
arrondissement
L’affaire Sergueï MAZAROV
Calmels ou le drame passionnel
La star du ballon rond
Les morts solitaires
Le vieux retraité
Le conseiller de l’Elysée
Le Crazy Horse
L‘overdose
La danseuse
Le saucissonnage
La séquestration
Les décès naturels
L’institut-médico-légal ou IML
Un peu d’histoire
Les missions
Drôle de bizutage
La police urbaine de proximité (PUP)
Cambriolage à la Trésorerie
Escroquerie de la nièce du préfet
Bye bye la PUP
L’IGS
Le contrôle routier
L’agression du rabbin
L‘anti sémitisme dans la voix
Les vols de portables
Le viol des prostituées
Les taxis rackettés
ADS et désespoir
La jalousie d’une femme de flic
L’affaire NEYRET
Les statistiques
La réforme
Retraite
Hommage à mes collègues policiers
Ma baraka
Attentat au pub Renault
Tragédie en sous sol
Attentat à l’Etoile
Agression dans le RER
De la sécurité
Le 7 janvier 2015
Conclusion
Remerciements…
Préface
« André Durand , Dédé pour les collègues, a été mon supérieur hiérarchique à l’IGS pendant six ans.
Nous avons travaillé dans le même bureau et nous nous sommes très bien entendus.
Nous étions complémentaires, chacun dans notre domaine.
Sérieux et méthodique dans son travail, il ne lâchait rien tant qu’il n’avait pas compris ou dénoué un problème. Ce qui ne l’empêchait pas d’être sociable avec tout le monde, de plaisanter et de prendre le temps de faire son jogging entre midi et deux.
J’ai hâte de lire son manuscrit sur les évènements qui ont marqué sa carrière de policier.
Je suis sûre qu’il est comme « Dédé », clair, précis et plein d’anecdotes intéressantes. »
Mathilde Ferrandiz
Le choix d’être flic
Pourquoi ai-je éprouvé l’envie, le besoin d’écrire ce livre?
Ajouter un ouvrage sur la police à tous ceux qui remplissent déjà les rayons des librairies ne présente en effet que peu d’intérêt!
En revanche, connaître d’une part, les raisons qui m’ont amené à épouser la carrière d’inspecteur de police puis d’officier de police, et d’autre part, dévoiler quelques affaires fort médiatisées que j’ai initiées et parfois également finalisées, me paraissent être une démarche originale, susceptible d’intéresser le lecteur.
Il ne s’agit pas là d’un roman, mais de faits réels que j’ai eu à connaître durant ma carrière.
Au terme de celle-ci, j’ai voulu partager avec mes proches comme avec les anonymes, la richesse de mon vécu professionnel, sans langue de bois.
Je suis fils de gendarme et l’aîné de trois enfants. J’ai donc été élevé dans la culture de l’ordre, du respect, de l’autorité et des valeurs. En tant qu’aîné, je devais en outre montrer l’exemple. Certains trouvent leur voie professionnelle depuis l’enfance, d’autres, dont je fais partie, choisissent un métier en fonction des aléas de la vie.
Depuis tout jeune, j’étais fasciné par les westerns et les films policiers, cette dichotomie entre le bien et le mal, les gentils et les méchants, à tel point que j’envisageais, enfant, de devenir policier.
Plus tard, je perdrai cette idée de vue à tel point qu’en fin de 3ème, je m’engageais, à l’égal de mon copain, dans la filière « comptabilité ». Finalement, mes difficultés avec les mathématiques m’obligeaient à m’orienter vers ce qui était alors le bac G3 (gestion et économie des entreprises).
Après l’obtention du diplôme, décidé à poursuivre des études, je devais choisir à nouveau une orientation. Le commerce ne m’attirait finalement pas plus que çà.
Etant particulièrement doué pour le « par cœur », je choisissais de m’inscrire en faculté de droit, à Paris I-Panthéon-Sorbonne. A l’époque, je me disais que la matière juridique pourrait m’ouvrir de nombreuses portes : avocat, service du contentieux dans une grande entreprise, sans compter la possibilité de me présenter à des concours.
J’effectuais mes deux premières années à la faculté de Tolbiac à PARIS 13ème.
Lorsque vous passez du secondaire à la faculté, vous quittez un univers pour en découvrir un autre, totalement différent. Dans le premier, vous êtes choyé, assisté, vous avez des devoirs à préparer, des leçons à apprendre. Le chemin est balisé en quelque sorte. Dans le second, vous êtes livré à vous-même. Il faut prendre des notes, le professeur ne dicte pas. En outre, vu la masse de connaissances à assimiler, il faut s’astreindre à apprendre régulièrement en vue des travaux dirigés et des examens de fin d’année, établir des fiches de synthèse. En un mot, il s’agit d’être discipliné, méthodique, appliqué. Pour l’avoir ignoré, bon nombre d’étudiants redoublent leur première année ou abandonnent.
L’éducation reçue de mes parents et ma volonté d’obtenir ma licence de droit, m’ont permis de franchir la première année sans difficultés, puis la deuxième et la troisième. Je devenais ainsi licencié en droit privé en juin 1980.
A ce moment-là, le sursis que j’avais obtenu pour effectuer mon service militaire prenait fin, il fallait donc que je parte. Il s’agissait encore à cette époque, d’un service de douze mois.
Ayant « baigné » depuis ma naissance dans l’univers de la gendarmerie, j’éprouvais le besoin de connaître la profession de l’intérieur et plus seulement par le biais des conversations familiales.
Je m’en ouvrais à mon père qui appuyait ma demande. En effet, si les métiers d’ordre comme la gendarmerie et la police, sont aujourd’hui boudés par les jeunes, au début des années 80, il valait mieux être « parrainé » pour y effectuer ses obligations militaires.
Etudiant de l’enseignement supérieur, j’étais incorporé début octobre 1980 (classe 10) et affecté à BERGERAC (DORDOGNE).
Mes camarades de conscription et moi vivions dans une caserne datant de la première guerre mondiale, à cinq par chambre. Un vieux poêle à mazout chauffait la pièce dépourvue d’isolation et de double vitrage. Dieu sait si l’hiver est rude dans cette région de FRANCE!
La vie est une école, dit-on. En quatre mois de classe, j’ai appris beaucoup sur la nature humaine et sur moi-même. J’avais le choix entre accepter les injustices et me soumettre ou faire face. J’optais pour la seconde solution.
Je dois ici effectuer un retour en arrière qui m’amène à mes dix ans. J’habitais alors à l’île de la REUNION dans l’océan indien où j’ai vécu trois ans avec ma famille. A cet âge, j’étais très timide. Un jour, j’entre au domicile en larmes : un copain de jeux m’avait mis une raclée pour le plaisir. Pour la petite histoire, il était plus petit que moi et avait le même âge. Loin de me consoler, mon père me menaça en ces termes : « s’il te met encore une correction, je t’en donnerai une autre à la maison ». C’est ainsi que, quelque temps après, alors que j’avais gagné beaucoup de billes à mon adversaire, ce dernier tenta de récupérer sa mise, en utilisant comme d’habitude la force. Il fut alors surpris de ma volteface et de sa promenade « les coups de pied aux fesses » dans toute la caserne où ma famille et moi résidions, au grand dam des mères de famille qui discutaient dehors.
A partir de ce jour, j’ai pris confiance en mes capacités à me défendre. Ce fut un électrochoc et je dois remercier mon père, même si l’on peut penser qu’il avait eu une attitude dure à mon égard.
Dans la continuité, je m’inscrivais à un cours de judo. Cette pratique sportive qui enseigne notamment des valeurs telles que le respect, m’a procuré des bases solides pour me défendre et par voie de conséquence, me donner confiance en moi. C’est ainsi que, quelques années plus tard, adolescent, je me trouvais sur un autre lieu d’affectation de mon père, à NOUMEA en NOUVELLE-CALEDONIE, quand un garçon du même âge que moi me provoqua, une fois de trop, sans doute pour montrer aux autres son ascendant sur moi. Décidé d’en finir avec son comportement, je le défiais devant tous les autres copains, sur la pelouse de la caserne. Un « sutemi waza» (technique de projection de l’adversaire au sol) suivi d’une prise d’étranglement eut rapidement raison de lui. Plus jamais il ne tenta de s’imposer à moi.
Le comportement de mon père envers moi, aussi loin que je m’en souvienne, a influé sur ma vie d’adulte.
En effet, mon père ne semblait jamais content de ma scolarité. Je me rappelle qu’à l’issue de la classe de CM2, j’avais obtenu le prix d’honneur, c’est-à-dire que je finissais l’année second. Le premier décrochait quant à lui, le prix d’excellence. Au lieu de me montrer sa satisfaction, mon père s’exclama « tu aurais pu être premier! »
Je dois confesser avoir souffert de cette sorte d’éternelle insatisfaction. C’était sa façon à lui de me pousser à toujours m’améliorer. Je peux certes le comprendre mais je pense qu’il aurait pu s’y prendre autrement en me disant par exemple : « je suis fier de toi, grâce à ton travail tu finis second, en continuant de la sorte, tu peux viser la place de 1er ». J’aurais été content d’entendre ce discours, à défaut, je me sentais frustré!
Ma sœur était naturellement douée pour les mathématiques, contrairement à moi.
Je passais pour le vilain petit canard à l’école. Aussi, décrocher le bac puis une licence de droit et enfin une maitrise, était devenu pour moi comme une revanche.
Pendant mes classes à BERGERAC, je dus affronter deux situations qui ont accentué ma motivation alors que l’on essayait de me brimer.
Les premiers jours, lors de la réception du paquetage, un major, mon chef de section, me demanda ce que je voulais faire plus tard. Je lui rétorquais et c’était la vérité, que je souhaitais entrer à l’école des officiers de gendarmerie de MELUN. Le service militaire devant mieux me faire connaître la gendarmerie.
Mon honnêteté et ma franchise déclenchèrent chez cet homme aigri, qui finissait sa carrière six mois plus tard comme simple sous-officier, une jalousie exacerbée. Il n’eut de cesse de me dénigrer dans mes notations, en alléguant faussement que je trainais les pieds dans les marches, etc.
Si bien qu’à l’issue des quatre mois de classe, je me trouvais en milieu de classement de la promotion, sans espoir de choisir mon lieu d’affectation pour les huit mois restants.
Or ma préoccupation était de me rapprocher de ma petite amie de l’époque et donc de venir en ILE-DE-FRANCE, et plus précisément à la gendarmerie de ROSNY-SOUS-BOIS (93), au centre de recherches judiciaires N° 1.
Avisé de mon souhait, mon père, après m’avoir assuré que tous mes compagnons bénéficiaient de « piston », facilitait mon transfert vers ROSNY-SOUS-BOIS. J’avais des scrupules à accepter sa proposition mais à partir du moment où il me confirmait que les autres n’étaient pas là par le fruit du hasard, il n’y avait aucune raison que je subisse cette situation injuste et que je devienne en quelque sorte, le dindon de la farce! En acceptant son aide, je me hissais au même niveau que les autres, ce qui annihilait la volonté de me nuire du major. Cette situation rétablissait les choses. Je n’avais donc aucun état d’âme à avoir!
Nous devions tous être réunis dans l’amphithéâtre un après-midi de janvier pour choisir notre affectation en fonction du classement qui nous avait été attribué. Peu avant midi, je croisais le capitaine MARTINI commandant la caserne, flanqué du major.
Cet officier inspirait le respect : tenue impeccablement repassée, rangers cirées, cigarillo au coin des lèvres. Il s’adressa à moi :
- DURAND, vous souhaitiez aller à ROSNY-SOUS-BOIS?
- Oui mon capitaine
- Votre vœu est exhaussé, inutile de vous rendre dans l’amphi cet après midi
Le major en resta bouche bée
Je découvrais ainsi, qu’il existait, même dans cette noble institution qu’est la gendarmerie
- une « note de gueule »
- le « piston »
La seconde situation à laquelle je dus faire face, était née de l’arrogance d’un compagnon de chambre, qui, désirant montrer aux autres ses qualités de chef, me choisit comme son souffre douleur, qu’il pensait, à tort, sans défense. Chaque semaine, l’un de nous devait effectuer le ménage dans la chambre. Lorsque vint mon tour, je choisis naturellement un moment où il n’y avait personne dans la chambre pour exécuter ma tâche, ce qui me semble frappé au coin du bon sens. Il voulut m’imposer de faire le ménage dans la chambre en sa présence, pensant que je ne nettoyais rien. Refus de ma part. Je n’avais pas à lui prouver que j’avais bien fait mon travail. Pour moi, la propreté de la pièce suffisait à prouver mon labeur.
Lors d’une corvée collective de nettoyage des sols du réfectoire, voyant qu’il discutait abondamment avec un autre militaire, ayant décidé que j’avais réalisé ma quote-part de travail, je laissais mon balai et quittais les lieux. Ce compagnon de chambre me menaça ouvertement de représailles si je ne reprenais pas le ménage. Devant ma détermination, plutôt que de renoncer, il alla, pour ne pas perdre la face, se plaindre au major. Ce dernier me convoqua, me demanda des explications. Là encore, je tins bon et le major dut abdiquer devant ma volonté à ne pas subir.
Comprenons-nous bien, je n’ai jamais été un meneur, quelqu’un prêchant la révolution ou le « grand soir ». Plus vulgairement, je n’ai jamais été non plus un emmerdeur, mais j’entends que l’on me respecte ainsi que les droits qui sont les miens, tout simplement.
Telle est ma philosophie de vie qui me tiendra lieu de fil d’Ariane tout au long de ma vie d’homme. Dorénavant, tout ce que je considèrerai comme une injustice à mon égard ne restera jamais sans réponse, c’est une question de principe.
Il n’empêche, cette expérience voulue dans la gendarmerie, m’a détourné d’une carrière dans cette arme. Il faut savoir en effet que la notation, fut-elle celle d’un bidasse, le suit tout au long de sa vie active. Je ne souhaitais pas commencer avec des handicaps.
J’avais compris qu’il me faudrait trouver une autre perspective.
Début février 1981, j’arrivais au CRRJ N° 1 de ROSNY-SOUS-BOIS, en compagnie d’une dizaine d’appelés comme moi, dont une partie venait de SAINT-ASTIER (DORDOGNE).
A notre descente du car, un maréchal des logis demanda si l’un d’entre nous était intéressé par un poste de chauffeur du colonel, couplé à un travail de secrétariat. Deux conditions étaient requises : être volontaire et connaître un peu PARIS et l’ ILE-DE-FRANCE.
Je remplissais ces deux conditions et, flairant une bonne opportunité, je demandais le poste. Les autres m’avaient surpris par leur silence et leur peur de s’engager. J’avais osé et c’était pari gagnant : Pendant huit mois, ma vie de militaire se partageait entre la conduite de l’officier commandant la caserne et le secrétariat. Etant pensionnaire, le soir, j’allais courir dans un parc voisin pour entretenir ma condition physique.
Mes supérieurs, faisant fi des appréciations désastreuses lors de mes classes, m‘encourageaient au contraire à faire carrière dans la gendarmerie. Mais comme je l’ai dit, j’avais été déçu et je ne voulais pas débuter une carrière avec cette « tâche » sur mon CV. Pour moi, cette mauvaise notation était comme de la fonte sur la selle d’un cheval de course : un handicap l’empêchant de gagner!
En outre, j’avoue avoir été déçu par le matériel qui nous était attribué. En effet, on nous avait refilé le vieux fusil « MAS 36 » alors même que le FAMAS » appelé aussi « clairon » dotait une partie de l’armée et avait même été exporté à l’étranger. Nous étions les délaissés de la Défense!
Ma religion était faite : la gendarmerie, ce n’était pas pour moi.
Dès lors, je cherchais du travail dans le secteur privé, avant même le terme de mon service. Je répondais ainsi à des annonces cherchant des « jeunes diplômés de l’enseignement supérieur pour devenir de futurs cadres ». Je posais également des candidatures spontanées dans les grandes entreprises. Beaucoup restaient sans réponse.
Je réussissais plusieurs tests et entretiens auxquels je ne donnais pas suite.
Par exemple, je me présentais à l’association pour l’emploi des cadres (APEC). Le but était de former de jeunes diplômés tour à tour dans une épicerie Casino à SAINT-ETIENNE. Pendant six mois, l’un devait s’occuper de la caisse, l’autre de la gestion des stocks et le troisième de la mise en rayons. Un turnover devait s’opérer. Nous devions être jugés sur la progression du chiffre d’affaires après six mois d’activité. Bien que retenu, je demeurais sceptique sur les chances réelles de succès d’une telle entreprise et j’abandonnais cette piste.
J’étais également retenu aux Assurances Générales de France (AGF). On m’expliquait que la société était structurée en une forme pyramidale et que chacun débutait à la base. Il s’agissait à PARIS, d’aller démarcher les particuliers à domicile et leur proposer des contrats d’assurances. Très au fait des questions juridiques et de l’actualité, je n’ignorai pas qu’une loi fraîchement votée venait d’interdire le démarchage dans les immeubles d’habitation. J’en concluais que le travail à PARIS se révèlerait difficile pour ne pas dire impossible et ne donnais pas suite.
J’effectuais des tests dits « psychotechniques » dans une caisse régionale du Crédit Agricole aux termes desquels j’étais également retenu. Je passais ensuite devant un psychologue qui, visiblement testait ma détermination à décrocher le poste offert : guichetier pendant deux ans, sans espoir de promotion pendant cette période pour un salaire net de 4200 francs de l’époque. Je tenais tête à ce psychologue sans faillir si bien que ma candidature était acceptée.
Pour moi, cela s’assimilait à un bras de fer, c’était lui ou moi, le poste était passé au second plan.
Finalement, jugeant que le salaire offert était dérisoire eu égard aux trois années de faculté effectuées, et sans perspectives de promotion à court terme, je ne donnais pas suite, aussitôt arrivé à mon domicile.
Ces tests me procuraient une grande satisfaction même s’ils ne débouchaient pas sur un emploi. En effet, je les réussissais et c’est moi qui décidais de ne pas donner suite. Cela me confortait dans mes capacités et, étant l’acteur de mon avenir, je décidais seul.
Un seul entretien fut négatif. Il s’agissait d’une rencontre avec un chasseur de têtes à la banque régionale d’escomptes et de dépôts (BRED) de PARIS. Au vu de mon CV, il rejetait ma candidature sur la base de la rubrique sport où j’avais indiqué : footing, natation et vélo de route -trio sportif que je pratique encore aujourd’hui. Le recruteur m’expliquait qu’il s’agissait de sports individuels et il en concluait que je devais être individualiste, alors que dans son entreprise, le collectif devait l’emporter.
Ce prétexte pour m’exclure m’avait désarçonné mais très vite, je m’étais repris en me disant que lorsque l’on ne veut pas de quelqu’un, tous les prétextes sont bons. J’avais trouvé celui-là particulièrement futile.
Mon service militaire s’achevait et nul emploi à l’horizon.
Je pensais donc reprendre les études, la licence n’étant que la moitié du deuxième cycle, je décidais de m’inscrire en maîtrise. J’avais été bien naïf de penser qu’après trois ans d’études supérieures, j’allais trouver facilement un poste de cadre bien rémunéré.
Je m’installais rue de Sèvres à PARIS, au 5ème étage d’un immeuble sans ascenseur, dans un appartement régi par la loi de 1948, sans isolation, qu’un oncle me prêtait.
Aux premiers frimas de l’hiver, je superposais les couches de pulls pour résister au froid malgré les radiateurs d’appoint. Pour me réchauffer, j’allais deux ou trois fois par semaine aux cinémas du quartier Montparnasse, proches. L’appartement n’était pas luxueux : pas de salle d’eau, juste une kitchenette avec un robinet d’eau froide, WC sur le palier.
Au niveau psychologique, le premier trimestre fut terrible. Il fallut remettre la «machine à apprendre» en route, après une jachère d’un an. Je m’accrochais en relisant chaque soir les cours de la journée.
Le weekend, je me précipitais à LUCE (28), dernière affectation de mon père. Là, je m’engouffrais dans la salle de bains où je goûtais longuement le plaisir de l’eau chaude.
En venant chez mes parents, j’empruntais à pied le chemin qui conduisait de la gare au domicile, passant devant la préfecture d’EURE-ET-LOIR. Un jour, mon attention fut attirée par l’annonce d’un concours d’Inspecteur de Police. Je me souvins alors que cette idée m’était venue, enfant. Je décidais de m’inscrire. A l’époque, il fallait le bac et je préparais ma quatrième année de droit, mais un concours reste un concours, le résultat est aléatoire.
Désormais, mon objectif sera double : en priorité le diplôme et, si possible, le concours.
François MITTERRAND avait été élu Président de la République. Pour lutter contre le chômage (deux millions de chômeurs, déjà!), et relancer la consommation, il avait décidé de recruter en masse des fonctionnaires et notamment des policiers.
Le droit constitutionnel, le droit pénal général et spécial étaient au programme du concours : autant de matières que je maîtrisais parfaitement. Mes professeurs s’appelaient : BADINTER, BREDIN, LYON-CAEN et d’autres.
Je franchissais l’étape des écrits facilement et me préparais pour l’oral. Certains sont effrayés à l’idée de l’oral. A l’inverse, je n’en ai jamais eu peur. Je me souviens qu’en faculté, lors des oraux de fin d’année, je me présentais systématiquement parmi les premiers. Je tenais le raisonnement suivant : plus nous attendons, plus nous avons peur et plus nous risquons d’oublier ou de tout mélanger. C’est un passage obligé, il ne sert donc à rien d’attendre, il faut y aller.





























