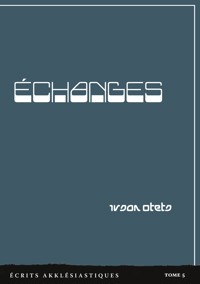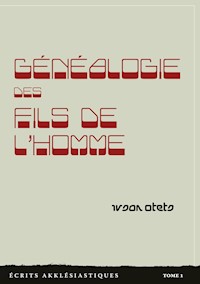Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ivsan Otets est le créateur du site akklesia.eu sur lequel il publie depuis plus de quinze ans des écrits de philosophie religieuse. Il travaille depuis plus de dix ans avec Dianitsa Otets.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
{ akklesia.eu · akklesia.fr · akklesia.com }
SOMMAIRE
A
VERTISSEMENT
P
ROLOGUE
Il faut s’arrêter
I -
ÉVIDENCES
: LOGIQUE, SÉCURITÉ, MESURE
À propos de l’infini
La puissance de Dieu
Les omniscients
Du silence de Dieu
Être transvasé
Jérémie d’Anatot
II -
D
ÉMESURE
&
LIBRE-ARBITRE DU
R
OI
Samson l’indomptable
La reine Vashti
L’erreur du Christ
Le jugement des miracles
Ésaïe le déséquilibré
De l’identité
ÉPILOGUE
Révélation
AVERTISSEMENT
Dans ce troisième tome des écrits akklésiastiques d’IVSANOTETS, comme dans les deux précédents, les textes ne suivent pas un ordre chronologique strict. C’est pourquoi certains d’entre eux apparaîtront peut-être d’un abord plus facile que d’autres publiés précédemment.
Toutefois, même les plus brefs de ces textes antérieurs énoncent des aspects significatifs du discours que nous portons, aspects qui ne sont parfois guère repris dans les textes postérieurs. Les écrits de ce tome 3 restent néanmoins inclus dans la période située globalement entre les années 2000-2015.
Nous remercions les lecteurs qui nous ont suivi jusqu’ici et dont la présence, même « virtuelle », nous encourage à poursuivre le travail de révision et de publication des textes d’Akklésia.
Ivsan & Dianitsa Otets
PROLOGUE
Il faut s’arrêter
À l’attention des sages
L’HOMMEQUI RÉUSSIT est celui qui s’arrête, tel est le slogan que nos pères et la société nous inculquent dès notre plus jeune âge. Ailleurs, nous trouvons cette même pensée lorsque la Bible affirme dans son LIVRE DESPROVERBES (chap. 9) : « La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes […] des hauteurs de la ville, elle proclame : Qui est simple? Qu’il passe par ici! À l’homme insensé elle dit : Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j’ai préparé! »
Réussir ses études, faire carrière, fonder une famille puis, s’arrêter. Dans une vie propre et bien organisée, où même le plaisir sera administré et encadré dans une sage planification de ses loisirs. Tel est le rêve secret de la majorité des hommes et des femmes. C’est pourquoi le couple trentenaire, jeunes parents dynamiques dévoués au travail, à la famille et à la société, s’en va, dans une logique implacable, bâtir son projet immobilier ! Le couple taillera les colonnes qui abriteront la sagesse de son but atteint : la maison. Le nid douillet est la juste rétribution à son obéissance scolaire, à son respect de la tradition familiale et à sa soumission aux lois du travail. On plantera la haie autour de sa propriété. Puis on fermera définitivement la porte à l’adolescent chez qui l’énigme de la vie résonnait en des rêves insensés.
Comme il est tentant de faire ainsi et même quasiment impossible de faire autrement. Fermer la porte derrière soi à l’énigme irrésolue du « pourquoi » de l’homme semble être le destin de tous. Et pour celui chez qui l’écho de cette énigme tinte encore dans l’âme, les hommes ont trouvé une solution idéale : la religion. Quelques activités religieuses et le culte dominical auront donc l’honneur d’être une des colonnes soutenant la maison des sages. Aussi fermera-t-on la porte en toute bonne conscience, certain que l’énigme de la vie est gravée sur cette sainte colonne, et qu’elle assure à la maison de n’être jamais détruite par le feu d’un jugement…
D’ailleurs, fermer la porte derrière soi est légitime. De grands noms ont eux-mêmes abdiqué devant cette recherche si harassante. Nous voyons GŒTHE dans son Faust affirmer : « J’ai étudié, hélas, la philosophie, le droit, la médecine et – je regrette de devoir l’avouer – également la théologie, j’y ai consacré loisirs et efforts – et me voici, pauvre imbécile, aussi sot qu’au départ. » Ailleurs le livre du ZOHAR, nous dit ANDRÉNEHER1, prévient aussi sur la difficulté de se lancer dans une telle recherche :
« Qui est au ciel ? Quoi sur terre ? Qui au-delà du ciel ? Quoi au-dedans de la terre ? Béréshit – au commencement – balancent ces deux questions, et l’homme est tendu entre les deux. […] Voici l’homme : il a l’audace de soulever la question, il scrute pour contempler, pour connaître. Dans la contemplation et la connaissance il avance progressivement, degré par degré, jusqu’au degré ultime. Et, soudain, arrivé en ce point ultime, il se heurte à la question : Quoi ? Quoi donc ? Que sais-tu maintenant ? Qu’as-tu contemplé maintenant ? Qu’as-tu scruté ? Tout est aussi fermé qu’au départ. » Et FLAUBERT, dans son Bouvard et Pécuchet, de résumer ainsi cette terrible angoisse : « Oh ! le doute ! le doute ! j’aimerais mieux le néant ! »
Ainsi, qui veut bâtir la maison de sa sagesse et s’arrêter sur un sol ferme se doit avant tout de s’attaquer au doute, ce maudit doute ! C’est-à-dire qu’il devra devenir « un certain ». La preuve le justifiera ; sa doctrine religieuse ou sa théorie de la connaissance, qu’importe… Tant que ses colonnes sont ainsi coulées au béton de la preuve, le sage n’imagine pas que la terre puisse trembler et que la vie ait l’audace de le viser, lui directement – en pleine gloire ! Qui serait d’ailleurs assez fou pour établir le doute en colonne dans l’architecture de sa maison ?
J’ai moi-même essayé. Et j’ai vu à maintes reprises ma maison s’écrouler. Autant de fois je la rebâtissais, autant de fois elle s’écroulait ! Tant que je m’obstinais à conserver la colonne du doute, tout s’écroulait toujours. Changer la structure des autres colonnes n’y fait rien. Il faut tuer le doute, il faut cesser d’interroger ! Il faut entrer dans la croyance, dans l’envoûtement de la conviction où l’on fait semblant d’adorer l’autre pour cesser de le connaître. Il faut s’arrêter de chercher. Ainsi fait celui qui a trouvé et mis à nu le mystère des siècles : il donne un nom à la vérité dernière, il fait entrer le dieu dans la boîte, l’imprévisible dans le prévisible, l’infini dans la limite. Je n’ai pu m’y contraindre. Dès le début il m’a semblé entendre qu’à l’affirmation : « Il faut s’arrêter car telle est la vérité », on me répondait : « Le diable paraît bien pâle auprès de celui qui dispose d’une vérité, de sa vérité. » (CIORAN)
Que celui qui s’arrête est heureux ! Comment ne pas désirer son statut ? Encore aujourd’hui, il m’est souvent terrible de vivre ainsi — sans lieu où reposer ma tête, tandis que « les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids ». D’autant que, le temps passant, les fous vivant ainsi, sous la tente, se font si rares. Les croyances sont légion, leurs vérités ne cessent de se reformuler en de belles bâtisses, faisant aujourd’hui de plus en plus cause commune. La symbiose « œcuménique », dénommée « paix », taille les colonnes d’un futur totalitaire. Tout nomade qui interroge est accusé de crime contre la sagesse et aussitôt relégué dans les déserts. Là, seul l’écho du désert lui offre l’espérance d’être entendu.
Où est donc l’avantage à devenir nomade me demanderez-vous ? Oserais-je vous répondre ? Car si je vous dis que tel est le statut de l’homme quand celui de la bête est de s’arrêter, je sais que vous me répondrez que je blasphème. N’est-ce pas ? Aussi me plaît-il de laisser résonner ici une autre voix, russe. Car voyez-vous, alors que DOSTOÏEVSKI écrivait cela dans la correspondance à son frère, laissez-moi penser que le mot « frère » s’entend précisément à propos de l’homme, non de l’animal et de son nid :
Je n’ai qu’une visée : être libre. J’y sacrifie tout. Mais souvent, souvent, je pense à ce que m’apportera la liberté… Que ferai-je, seul parmi la foule inconnue ? […] Je suis sûr de moi. L’homme est un mystère. Il faut l’élucider et si tu passes à cela ta vie entière, ne dis pas que tu as perdu ton temps ; je m’occupe de ce mystère car je veux être un homme.
1ANDRÉNEHER,Faust et le Maharal de Prague, PUF 1987, 2e partie, p. 27.
I - ÉVIDENCES : LOGIQUE, SÉCURITÉ, MESURE
À propos de l’infini
À l’attention des réalistes
EST-CE QUE L’INFINI EXISTE ? Question maladroite puisque dès l’instant où l’on pense l’infini, on l’invente. Mais existet-il réellement? insistera le quidam. Question tout aussi superficielle, car l’important n’est pas de savoir si l’infini est une réalité concrète ou s’il n’est qu’une utopie de l’esprit ; il s’agit plutôt de se demander lequel, d’entre le réel et l’irréel, a le plus de force !
L’Histoire nous répondra aisément : ne regorge-t-elle pas d’hommes ayant opposé à la vie réelle un irréel qu’ils concevaient ? Prenons par exemple le rêve de liberté. Combien d’hommes ont préféré sacrifier leur propre réalité au nom de cette liberté qu’ils imaginaient ? Certains se laissèrent démunir de tout, jusqu’à être diffamés publiquement ; d’autres furent emprisonnés ou torturés, tandis qu’un grand nombre laissèrent leur vie en sacrifice. Qu’a-t-on vraiment conservé de leur vécu si ce n’est justement ce qui n’a pas existé ? Cet irréel vers lequel ils tendaient. N’ont-ils pas laissé à la postérité le seul héritage de leurs rêves ? Ces rêves dont se sont emparés leurs fils, générations après générations, et avec lesquels ils n’ont cessé, à leur tour, de défier le réel en combat singulier. Et le réel, devant l’obstination de la liberté, dut céder du terrain. Il parut d’abord s’amenuiser, faisant des concessions, cherchant à se montrer plus discret pour anesthésier la rébellion en cours ; mais il abdiqua finalement face à la persévérance de l’imaginaire des hommes. Autrement dit, expliquera CHESTOV : « la matière se transforma peu à peu de maître autocrate en gouvernant disposé aux accords et aux compromis2 ». Et dans cette histoire, le meilleur ami de l’imagination, c’est LE TEMPS, qui la relaye ; ce TEMPS qui n’en finit pas de couler tandis que la réalité n’en peut stopper la marche. Il s’ensuit donc que les mains de l’irréel recèlent parfois d’une puissance cachée capable de faire reculer ou de briser le réel ; et devant une telle force, la matière même avec toutes ses lois semble impuissante.
Comment peut-on encore soutenir que tous les rêves ne sont que du vent sans consistance ni puissance ? Si tel était le cas, pourquoi nombre d’entre eux ont-ils réussi à remettre en question la vie concrète ? Et pourquoi ne craignent-ils pas de sacrifier la vie même de leurs messagers ? Le réel estil si lâche pour n’avoir que la mort à répondre aux rêves ? Maigre réponse cependant puisque le rêve parvient à survivre à la mort tandis que d’autres messagers se saisissent du relais tombé au sol. Il apparaît dès lors que la mort ellemême, en tant que son dernier ennemi, est directement mise en question par le rêve qui la dépasse ; tel est le murmure de la résurrection caché derrière la réalité ! Et qu’importe si nombre de rêves s’évaporent avec la fin de leurs porteurs. En effet, LE TEMPS ne se donne pas à tous, lui qui sait fort bien distinguer entre l’homme illuminé et l’homme de l’Esprit, car seuls les fils de l’Esprit seront introduits dans le triomphe de cette résurrection, amie du TEMPS, que tente de nous dissimuler la vie réelle. Telle est la différence entre la spéculation et la révélation, entre les fils du progrès et les fils de la résurrection, entre les pères d’un âge d’or ici-bas et le Père d’un rêve dépassant l’ici-bas : entre le royaume des cieux sur terre et le royaume des cieux seulement !
Face aux si nombreuses victoires de l’irréel que nous offre l’Histoire, n’est-ce pas la vie réelle qui se trouve être finalement inconsistante et fragile ? C’est pourquoi, aussi étrange que cela puisse paraître, ce n’est pas l’irréel, c’est le réel qui est enraciné dans l’inconsistance. Or, l’inconsistance n’a-t-elle pas ses racines dans le néant ? Le néant ne serait donc que la fragilité du réel parvenu à sa fin : la vanité dénudée de son apparat. Telle est la réalité. Derrière son feuillage bigarré, elle ne sert en vérité que de vêtement au néant. C’est pourquoi le réel – selon sa nature – veut retourner au néant : « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière » nous dit le texte biblique (GEN 319). Car le Monde fut dès l’origine rejeté de l’infini, de son irréel et des ses rêves : il fut rejeté de Dieu. Et il plonge depuis lors dans ce cauchemar qu’il se fabrique jour après jour : « Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » (GEN 217). Ainsi parlaient déjà les hommes de l’Antiquité ; eux qui savaient, contre toute science, que l’homme logique avait porte close sur l’infini avec son irréel et ses rêves, qu’il ne pouvait plus entendre ce mot de Dieu : « Rien ne vous sera impossible » (MT 1720) ; qu’il avait été mis hors de cette Vie divine où le moindre rêve sera un jour réalisable ; qu’il était tombé dans sa petite vie mortelle où l’on crucifie les rêveurs en les accusant d’être un danger pour la civilisation. Ces hommes de l’Antiquité, bien moins savants et spirituels que les religieux d’aujourd’hui, n’étaient-ils pas aussi plus proches de Dieu que tous ces fakirs chrétiens, eux qui leurrent la foule avec leur âge d’or messianique, avec leur prospérité, l’envoûtant avec l’illusion de lendemains heureux ? Ne sont-ce pas ces anciens qui diraient aujourd’hui, à l’instar de CHESTOV : « Dieu en général n’a pas de “savoir” et, en particulier, il n’a pas la science du bien et du mal3 ».
Ces hommes étaient de fait les premiers fils de l’irréel ; fous, prophètes et rêveurs. Ils s’étaient engagés sur les anciens sentiers, non pas ceux des promesses de la Torah dont parlait JÉRÉMIE (616), mais ceux de la puissance d’un Dieu « a-torahique ». Ils commençaient à sortir du néant, à échapper à ses deux rives, celle du bien et celle du mal ; et n’étant convaincus ni par le bien, ni par le mal, ni par l’entre-deux tiède, ils vivaient dans le murmure de l’infini insufflé selon leur folie et leur foi, espérant contre toute espérance au-delà du bien et du mal. Car il leur avait été révélé que la réalité n’est qu’un trompe-l’œil, aussi se languissaient-ils de cette Vie-à-venir ; cette Vie dont l’irréel est infiniment plus réaliste que le monde présent. Cette Vie d’où ils étaient venus, comme prédestinés dans le songe divin avant de naître simples mortels. Cette Vie dont ils savaient qu’elle précède le néant et qu’elle l’achèvera : qu’elle est l’alpha et l’oméga. Cette Vie contre laquelle le néant et son masque, la réalité, ne peuvent opposer aucune résistance ! — Dieu ne nous a pas créés dans la réalité ; il nous a rêvés