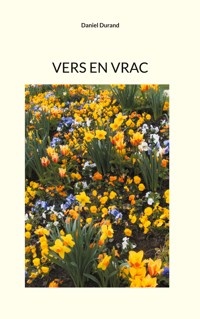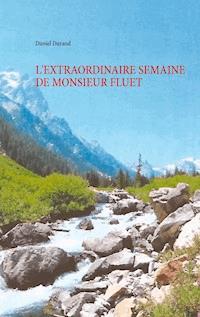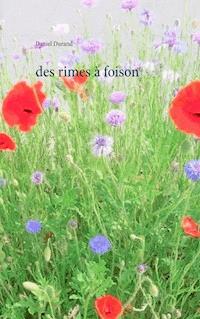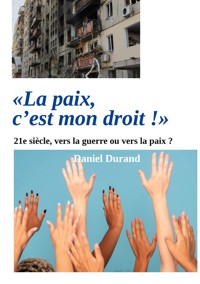
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Après avoir été un acteur actif du Mouvement de la paix à l'échelle nationale et internationale dans les années 2000, Daniel Durand a publié plusieurs ouvrages sur les institutions internationales ("Changer le monde, changer l'ONU" en 2006), les conflits ('Irak, qui a gagné ?" en 2003), le désarmement ("Désarmer ou périr" en 2008 et "Désarmement nucléaire, le rebond" en 2010). En 2018, il présente ses réflexions sur l'évolution de la notion de paix dans l'histoire ("1914-1918, cent ans après, LA PAIX !" ). Aujourd'hui, dans son dernier ouvrage, il trace un panorama complet des évolutions du monde et des incertitudes de ce siècle, face à la question de la guerre et de la paix. En affirmant "La paix, c'est mon droit !", il prend clairement parti pour une humanité débarrassée du fléau de la guerre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à tous ceux qui, au long des années, ont soutenu mes publications. Une reconnaissance particulière à Anne-Marie dont la relecture, les critiques et les corrections attentives ont permis à ce livre d’exister
Publications de l’auteur
1914-1918, cent ans après, LA PAIX !
éditeur Edilivre, Paris - 90 p - publication : 22/05/2018 - Prix : 10,50 €
Désarmement nucléaire : le rebond ?
ILV-éditions - 147 p - publication : août 2010 - Prix : 14 €
Désarmer ou périr ? pour une sécurité plus humaine, une diplomatie plus citoyenne
ILV-éditions - 147 p - mars 2008 - Prix : 14 €
Changer le monde... Changer l’ONU ?
éditions Je Publie - 110 p - septembre 2005 - Prix : 11 €
Irak : qui a gagné ?
éditions La dispute, Paris - 192 p - novembre 2003 - Prix : 13 €
La paix, c’est mon droit !
Introduction
Un monde en transition
Une situation internationale dangereuse
Mais une paix résiliente
Avoir des idées claires pour avancer
Le concours des fausses évidences guerrières
Le podium pour « ci vis pacem, para bellum »
Une médaille pour « ne baissons pas la garde »
Réflexions sur la notion de « menace »
Menaces ou défis : exemples
Une palme pour : « les armes nucléaires ont évité une 3e guerre mondiale »
Hors-concours : « l’ONU ne sert à rien pour éviter la guerre »
À propos de quelques « vraies » vérités !
La guerre est vraiment illégitime
La paix n’est pas (seulement) l’absence de guerre
La sécurité humaine est une notion-clé du 21
e
siècle
La sécurité humaine inclut la « responsabilité de protéger »
Certaines évolutions sécuritaires sont ambiguës
La paix est devenue « active »
Utilisons nos outils
Les changements du monde
De nouveaux acteurs
Des crises mondialisées : « biens communs », migrations, identitarismes, extrémismes
Les traités, bases du droit international, de la vérification et de la sanction donc de la confiance et de la sécurité
Les armes chimiques
Les armes biologiques
Les armes nucléaires
La démilitarisation de l’espace, les missiles, les zones dénucléarisées
La démilitarisation de l’espace
Les missiles balistiques
Zones dénucléarisées
Les armes classiques, le commerce des armes
Les mines anti-personnel
Les bombes à sous-munitions
Les questions inédites liées aux nouvelles technologies militaires
Les conférences, les conventions, les traités de renforcement de la confiance
Les accords d’Helsinki
Les conférences internationales et la nouvelle place des ONG
Les nouveaux moyens d’information
La paix comme stratégie politique – le rééquilibrage du monde
« Rien sans l’ONU »
Le système onusien, notre maison commune
La réforme des Nations unies
Le rééquilibrage du monde
Plus aux BRICS
Pour une France « p
uissance vertueuse
»
Tu causes… tu causes…
Les grands écarts de la politique étrangère macronienne
Un multilatéralisme rétréci
Les couacs en Europe
Russie – Ukraine, le parti de la guerre et non de la paix
L’inaction pour les biens communs
Quelles orientations alternatives pour la France ?
Être à l’initiative pour le désarmement
Promouvoir les biens communs
Ouvrir un débat national sur une autre politique de la France dans le monde
Faire de l’Europe une « puissance positive »
Une situation actuelle préoccupante
Extirper la guerre sur le continent européen
Le préalable du retour à la paix sur le continent européen
Pour un processus multilatéral d’architecture de sécurité collective
Resserrer le lien Union européenne et ONU
Quelles valeurs européennes ?
Les sociétés civiles, acteurs du monde
Revaloriser la place des peuples, des citoyens et citoyennes du monde
Développer l’éducation à la paix
La paix comme stratégie éthique et participative – L’humain au centre
La culture de paix, un concept révolutionnaire
Revaloriser l’engagement individuel
Le droit à l’information
Des réseaux sociaux au service de la paix
Les logiciels libres pour une information collaborative
Rénover l’engagement collectif pour la paix
Impliquer l’opinion publique
Pour un renouveau du mouvement de paix
Droit humain à la paix : changer de paradigme
Genèse d’un nouveau droit
« La paix, c’est mon droit » !
Créons « l’Affaire de la paix du monde »
Conclusion
INTRODUCTION
« Soyons clairs : le conflit local en Ukraine est en train de se transformer en Troisième Guerre mondiale1 ». Cette appréciation est apparue dans les débats aujourd’hui sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, le soutien de l’OTAN à celle-ci, les rhétoriques sur l’arme nucléaire qui reviennent d’actualité. Cette crainte était souvent présente dans les esprits dans les périodes les plus tendues de la Guerre froide (blocus de Berlin en 1948, crise des missiles à Cuba en 1962, débat sur les Euromissiles entre 1977 et 1987).
Pour comprendre cette période dangereuse que traverse le monde aujourd’hui, il est nécessaire de démonter les mécanismes porteurs de conflits aujourd’hui sur notre planète, réfléchir aux conditions pour construire une véritable stratégie politique de paix à mener à l’échelle nationale et internationale pour les décennies à venir.
Effectuons un premier retour en arrière sur le début de ce nouveau siècle. L’an 2000, « l’année du millénaire », a été celle d’une immense mobilisation et d’un formidable espoir pour tous les militants œuvrant pour un monde de paix et de justice. L’écroulement du Mur de Berlin, la fin de la Guerre froide avaient renforcé l’impression d’un monde plus ouvert, plus multilatéral.
Quatre objectifs se dégagèrent des débats sur la paix de cette époque : l’introduction du concept de culture de la paix, la volonté d’aller à l’élimination des armes nucléaires, l’impulsion à donner au développement dans les pays les moins avancés et la réforme des Nations unies pour plus d’efficacité dans la résolution des problèmes de la planète.
Globalement, trois des quatre grandes directions connurent une impulsion positive. L’année 2000 fut décrétée « Année internationale de la culture de paix » par les Nations unies. Lors de la conférence d’examen du traité de non-prolifération nucléaire, furent adoptées « 13 étapes pratiques » dans lesquelles la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie signèrent un engagement sans équivoque d’accomplir l’élimination totale de leurs arsenaux nucléaires. Des centaines d’ONG et de militants formulèrent des propositions fortes, lors du Forum du millénaire, pour réformer en profondeur le système des Nations unies et y donner plus de place à la voix des peuples. Enfin, le Sommet du millénaire, du 6 au 8 septembre 2000 à New York, constitua le plus grand rassemblement de chefs d’État et de gouvernement de tous les temps et se conclut avec l’adoption, par les 189 États membres, de la Déclaration du millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Las, l’attaque terroriste contre les Twin Towers à New-York en 2001, la réplique militaire contre l’Afghanistan, suivie par l’agression US contre l’Irak en 2003 minèrent ces espoirs. Les deux premières décennies du 21e siècle se traduisirent de fait par une détérioration du climat des relations internationales, le redémarrage des manœuvres géopolitiques de puissance à l’Est de l’Europe, tant du côté de l’OTAN que de celui de la Russie. Les crises régionales en Libye en 2011, puis en Syrie (2011-2013) mirent en place des affrontements « par procuration » dangereux. L’agression militaire russe contre l’Ukraine en 2014 avec l’occupation de la Crimée, puis en 2022 en Ukraine, dans le Donbass, porta les risques de conflits aggravés à une échelle nouvelle. Pour beaucoup d’observateurs, pour une large part de l’opinion publique, les incertitudes semblent revenues, la guerre mondiale possible.
Mais les réalités ne peuvent pas se réduire aux bruits de bottes qui occupent le premier de la scène médiatique. Vingt ans après, on constate ainsi que la notion et le concept de « culture de paix » qui, à l’époque, n’étaient évoqués que dans les milieux pacifistes, et encore avec beaucoup d’interrogations, sont devenus un patrimoine culturel commun dans la société, tant dans les organisations d’éducation populaire que syndicales ou politiques, et cela sur tous les continents.
Le deuxième objectif des années 2000 concernant l’élimination des arsenaux nucléaires est devenu une question politique et diplomatique concrète. En 2020, un traité international d’élimination des armes nucléaires a recueilli les ratifications nécessaires et est entré en vigueur.
Le troisième objectif lié au développement a été marqué en 2015, par le bilan plutôt positif des huit objectifs pour le développement (OMD). Dans les pays en développement, le taux d’extrême pauvreté est passé de 47 % à 14 %, le nombre d’enfants non scolarisés à l’âge de l’école primaire de 100 millions à 57 millions, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans est passé de 12,7 millions à 6 millions, deux fois plus de personnes ont eu accès à l’eau potable courante. Bref, cela montre que lorsqu’il y a une volonté politique forte, il y a des résultats positifs même si les conflits en Afrique centrale, au Moyen-Orient, en Europe centrale, les conséquences de la pandémie du Covid 19, ont affaibli ces bilans.
Par contre, concernant le quatrième objectif, la réforme des Nations unies, les positions n’ont guère évolué, même s’il faut relever que la plus grosse tentative de mettre de côté l’ONU sur le plan politique, c’est-à-dire la politique étrangère de Bush en 2002-2003, a globalement échoué. L’avancée politique qu’a constituée l’adoption en 2015 du concept de « responsabilité de protéger », proposé par Kofi Annan, a donné lieu à des tentatives d’instrumentalisation politique lors de la crise en Libye. Enfin, la guerre Russie-Ukraine montre une nouvelle volonté de contourner les Nations unies par l’utilisation d’organisations parallèles non-onusiennes comme le G7 ou le G20, la pression d’organisations régionales comme l’Union européenne ou l’OTAN. Pour ceux qui en douteraient, le combat pour donner aux Nations unies un rôle central dans la gouvernance du monde est permanent.
Il ne faut pas pourtant négliger un élément supplémentaire à prendre en compte.
Pendant ces vingt ans, les relations internationales ont été marquées par une implication grandissante des opinions, des ONG, implication renforcée par l’évolution des moyens de communication et l’essor des réseaux sociaux. Cette implication a eu le plus souvent un effet positif pour obtenir des accords et des progrès pour le désarmement et le développement.
C’est cette évolution souterraine et forte dans les relations internationales qui est, pour moi, un élément déterminant de ces deux décennies. Les phénomènes négatifs, et inquiétants, qui sont souvent surmédiatisés, sont des contre-réactions et non les moteurs de l’histoire. C’est cette analyse que je vais essayer de développer dans cet ouvrage.
1 Vladimir Federovski – Le Figaro, 1er mars 2023
UN MONDE EN TRANSITION
Nous sommes entrés dans une période de transition depuis 1989, fin de l’affrontement bi-polaire Est-Ouest qui marquait un monde figé entre ces deux blocs dans lequel d’autres forces (pays « non-alignés », opinions publiques) avaient du mal à se faire entendre. Trente ans après, le monde n’a pas atteint un équilibre stable et c’est cette instabilité qui est source d’incertitudes et d’interrogations.
Une situation internationale dangereuse
Dire que le monde est dangereux, que la paix est fragile, semble une évidence, à condition d’être précis dans cette affirmation. Le principal danger pour la paix du monde vient de l’existence d’un stock considérable d’armes nucléaires. 12 500 ogives nucléaires existent dans le monde selon le SIPRI dont 9 000 sont prêtes à l’emploi en janvier 2023 et 85 % de celles-ci sont aux mains des États-Unis et de la Russie2.
Que la guerre entre Russie et Ukraine compte d’un côté une puissance nucléaire, la Russie, comme belligérant direct et de l’autre, des puissances nucléaires de plus en plus engagées en soutien à l’Ukraine au sein de l’OTAN, laisse craindre à tout moment un incident, une provocation, pouvant déboucher sur un cataclysme.
Le deuxième élément qui rend dangereux le monde d’aujourd’hui est le niveau atteint par les armements accumulés dans le monde et des dépenses militaires annuelles record : 2240 milliards de $ en 20223. Les trois quarts de ces dépenses militaires sont dues à dix pays. Les États-Unis arrivent toujours au premier rang avec un budget de 877 milliards de dollars en 2022, soit 39 % des dépenses mondiales. La Chine est seconde (292 milliards de dollars, soit 13 % du total). La Russie, l’Inde et l’Arabie saoudite comptent des dépenses militaires respectives de 86, 81 et 75 milliards de dollars. Viennent ensuite Royaume-Uni, Allemagne et France avec 68, 56, 54 milliards de dollars. Pour comprendre l’énormité, voire l’indécence de ce chiffre, il faut savoir qu’au pire moment de la Guerre froide, juste avant la chute du Mur de Berlin, les dépenses militaires atteignaient 1000 milliards de $ par an !
Parler de « monde dangereux » en s’appuyant sur ces deux critères est un discours objectif, différent de celui qui s’appuie uniquement sur la notion controversée de « menaces » sur laquelle je m’étendrai dans un autre chapitre.
Pour nuancer le dossier sur le monde dangereux, il faut considérer l’étude historique faite régulièrement par le site Hérodote.net4 qui montre que sur 2001-2021, on a vécu les deux décennies les moins violentes de notre histoire.
Les chiffres reposent sur le nombre de tués imputables à la violence d’État (civils, militaires, francs-tireurs, mercenaires). Cet indicateur est le seul qui soit à peu près objectif et fiable. Cette violence d’État a causé moins d’un million de tués en 2001-2010 ainsi qu’en 2011-2020 ; soit beaucoup moins que dans les décennies antérieures, de 1840 à 2000 (à l’exception de la décennie 1900-1910).
Le tiers de siècle 1914-1947 apparaît comme la période la plus meurtrière de toute l’histoire de l’humanité avec 100 à 200 millions de morts violentes sur une planète alors peuplée d’environ 2 milliards d’êtres vivants. Si l’on rapporte le nombre de décès pour cause de guerre à l’ensemble des décès de cette même période, on obtient un taux exceptionnel de 5 à 10 %. C’est cinq à dix fois plus que les grandes périodes de guerre les plus connues (époque napoléonienne, guerres du XVIIIe siècle…).
La deuxième décennie de ce siècle marque une reprise de la mortalité dans les conflits. L’invasion de l’Ukraine, le 24 février 2022, a frappé les esprits en Europe de l’Ouest : après un an et demi de guerre, le chiffre des décès de personnes civiles oscille selon les sources entre 10 000 à 40 000 tués, celui des militaires entre 30 000 à 100 000 tués 5. Mais ils ne doivent pas faire oublier les chiffres encore plus horribles de guerres moins médiatisées dans les sociétés occidentales : les évaluations minimales évoquent depuis 2011 au moins 500 000 morts dans la guerre civile syrienne, 400 000 dans les affrontements au Sud-Soudan, 370 000 tués dans la guerre au Yémen, 400 000 dans la guerre en Éthiopie et Érythrée6. Au vu de ces chiffres, on comprend mieux les positions très réservées d’un grand nombre de pays du Sud devant la focalisation des pays occidentaux uniquement sur la question de la guerre Russie-Ukraine.
Cependant, même s’il n’est pas, jusqu’à présent, le plus meurtrier, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, depuis février 2022 a déjà entraîné des changements fondamentaux dans les postures et les politiques de défense, les chaînes d’approvisionnement et la sécurité alimentaire. L’inflation a augmenté dans le monde entier, atteignant 8 % par an aux États-Unis et 7 % en Europe au début de 2022. De nombreux pays de l’OTAN se sont engagés à porter leur budget de défense à un niveau proche ou supérieur au seuil de deux pour cent du PIB recommandé par l’OTAN.
Mais une paix résiliente
Dans ce monde qui reste donc dangereux, marqué par les affrontements des deux blocs pendant la Guerre froide, malgré la création et l’accumulation d’armes toujours plus sophistiquées, nous constatons qu’aucune conflagration mondiale ne s’est produite. Il s’est construit une forme de « résilience de la paix ». Quelles explications peut-on apporter à ce phénomène ?
Cette « résilience de la paix » est inséparable du développement du système multilatéral depuis la fin de la seconde Guerre mondiale : « pas d’ONU, pas de paix ». De cinquante pays formant l’Assemblée générale de l’ONU en 1945, nous sommes passés à 194 États aujourd’hui, notamment grâce à la décolonisation, auxquels il faut ajouter deux États ayant le statut d’observateur : le Saint-Siège et la République de Palestine. Tous ces pays réussissent l’exploit de vivre ensemble sous un même toit, les Nations unies, avec des droits théoriquement égaux (un pays, une voix). Il s’agit d’un fait unique dans l’histoire humaine.
Cette innovation est inséparable de la constitution progressive sur notre planète, n’en déplaise à Hubert Védrine qui conteste cette réalité7, d’une communauté humaine, de plus en plus consciente, dans toute sa diversité : ONG, tissu associatif, mouvements sociaux. Cet ensemble, certes en voie de formation et encore balbutiant, s’est constitué largement grâce à l’existence du système multilatéral onusien, ce « filet de sécurité » que nous avons tissé et tissons obstinément depuis 75 ans. Il s’agit de la multitude de traités et d’accords internationaux, de l’action des dizaines d’institutions et d’agences de l’ONU, de l’organisation de forums, de lieux de rencontres autour de « l’arbre à palabres » onusien qui ont commencé de “civiliser” les relations internationales.
C’est inséparable de la production, du développement d’un droit international englobant progressivement tous les secteurs de l’activité humaine. Alors qu’avant 1945, n’existaient que quelques accords humanitaires (Croix-rouge) et un début d’accord sur le travail (OIT), aujourd’hui, des dizaines d’organismes, des centaines d’accords, de conventions, de traités mondiaux, régionaux, bilatéraux, essaient de gérer les problèmes entre les États, ou entre les humains (FAO, UNICEF, UNRWA pour les réfugiés, PNUD, OMS, etc.). Le droit international, assis sur la Charte des Nations unies, produit par ces traités divers, progresse régulièrement et s’étend à tous les domaines de la vie. Depuis les années 1990, la notion de « droits humains » (pour les enfants, les femmes, le développement) est un élément incontournable des débats du monde.
C’est inséparable du passage en cours, à une échelle temporelle historique, de l’ordre exclusif des États à un réseau de forces mondial complexe, où on trouve à côté de ces États, des entités non–étatiques : les forces économiques et financières mais aussi les organisations de la société civile, dans leur action concrète, reconnue de plus en plus à côté de celle des gouvernements et des lobbies économiques. Le jeu des interactions, des rapports de force est devenu plus complexe mais joue un rôle de « filet amortisseur » aux comportements égoïstes des États.
Alors, cette « résilience de la paix » signifie-t-elle pour autant que la guerre est écartée, que la situation du monde n’est pas dangereuse ? Évidemment non. Ma démonstration vise simplement à signaler que pour apprécier une situation donnée, il faut aussi être capable de prendre un peu de recul, de « décoller le nez de la vitre », pour comprendre les grandes évolutions de l’histoire.
2https://fr.statista.com/infographie/23984/arsenal-puissances-nucleaires-nombre-de-bombes-par-pays/
3https://fr.staitsta.com/infographie/29870/reparititon-depenses-militaires-mondialespays-avec-les-plus-gros-budgets-defense/
4https://www.herodote.net/Un_monde_moins_violent_que_jamais-aritcle-1193.php
5https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_guerre_russo-ukrainienne – vu le 21 juin 2023
6https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines#cite_ref-37
7https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/04/07/31002-20160407ARTFIG00264-hubertvedrine-la-communaute-internationale-n-existe-plus.php
AVOIR DES IDÉES CLAIRES POUR AVANCER
Mais pour prendre du recul, il faut commencer par énoncer (et dénoncer) certaines idées qui paraissent de « bon sens » et sont, en fait, complètement fausses.
Le concours des fausses évidences guerrières
Le podium pour « ci vis pacem, para bellum »
« Si vis pacem para bellum » est une expression latine qui se traduit généralement par « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cette maxime trouve ses racines dans l’Antiquité romaine et a été utilisée longtemps dans un contexte jusqu’au XXIe siècle où n’existait aucune réglementation interétatique, ni organisations internationales, traités et mécanismes de résolution des conflits.
De manière générale, ce raisonnement a toujours institué un cercle vicieux de violence, créant une atmosphère de méfiance et d’hostilité et augmentant les risques d’un conflit armé. Cette escalade guerrière a toujours eu un coût économique et humain important, en gaspillant dans les guerres des ressources considérables, tant financières qu’humaines.
De plus, chaque fois qu’on a préparé la guerre, on a eu… la guerre et pas la paix !
Pensons à la 1re Guerre mondiale de 1914-1918. Elle fut précédée dans les années avant 1914 d’une série d’incidents diplomatiques commerciaux, politiques, de la construction d’un système d’alliances concurrentes, d’un renforcement des armements dans les différents pays européens. Il aura suffi alors d’un coup de pistolet sur un pont de Sarajevo pour déclencher des mécanismes d’alliances, finissant par déclencher un conflit mondial, effroyablement meurtrier.
La « guerre froide », entre 1948 et 1989, a vu, elle aussi, se dérouler une course folle aux armements, construisant un « équilibre de la terreur », marqué par la présence de plus de 15 000 ogives nucléaires du côté russe et du côté américain. Les études historiques d’aujourd’hui montrent que la guerre mondiale n’a été évitée à plusieurs reprises que grâce à des concours de circonstances chanceux pour l’humanité, tant dans le cadre de la crise des missiles de Cuba en 19628, que lors d’alertes accidentelles qui manquèrent de très peu de faire déclencher un conflit mondial, comme lors de la fausse alerte nucléaire de 1983 9.
De la même manière, la politique suivie par les pays de l’OTAN d’une extension continue vers l’Est de l’Europe et celle de Vladimir Poutine de construire un « glacis » de territoires soumis, aux frontières de la Russie (guerre de Tchétchénie, annexion de la Crimée), ont construit une situation explosive dont l’agression russe contre l’Ukraine est le dernier épisode sanglant dans cette marche vers une guerre plus étendue.
Le dernier corollaire de cette maxime de « ci vis pacem para bellum » est d’induire l’idée que seules les solutions militaires sont des solutions réalistes et fiables. Pourtant, les deux dernières décennies sont marquées justement par l’échec de toutes les solutions de force, de nature militaire essentiellement, qui ont été appliquées dans les diverses crises ou conflits.
Irak ? L’invasion par les États-Unis d’un État souverain, basée sur un mensonge à propos de la soi-disant présence d’armes de destruction massive dans ce pays10, au mépris de la Charte des Nations-Unies, ressemble comme une sœur à l’agression des troupes russes en Ukraine. Le résultat est un pays, l’Irak, dévasté, à la vie économique et sociale ruinée. La conséquence collatérale en a été de conforter l’Iran voisin dans l’intention de se doter un jour, si possible, de l’arme nucléaire pour ne pas être à la merci des aléas de la politique états-unienne.
L’exemple de la Libye est tout aussi éclairant : l’intervention militaire illégale des franco-britanniques, basée sur un dévoiement du sens de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 17 mars 201111 a transformé une crise interne grave qui pouvait se régler avec des efforts et pressions diplomatiques soutenus sur Khadafi, en un désastre, avec là aussi, un pays aux fragiles structures sociales et tribales détruites, devenu un refuge et une plateforme d’action pour les groupes terroristes fuyant la Syrie.
On peut ajouter à ces deux exemples, l’Afghanistan, où la guerre, puis l’occupation militaire US, puis otanienne, ont fait le lit des mollahs et réduit encore plus les femmes à la servitude ; la Syrie devenue un champ d’affrontements « par procuration » entre puissances régionales.
Pourtant les moyens militaires engagés dans ces pays n’ont pas manqué, l’OTAN est même sortie de son périmètre légal d’intervention, les diplomates de l’ONU ont été écartés !
Alors, est-ce la violence et les conflits qui ont provoqué le chaos dans ces régions, ou les solutions militaires imposées par les grandes puissances, au service le plus souvent d’intérêts économiques et stratégiques qui ne sont pas difficiles à pointer dans chaque conflit ?
Une médaille pour « ne baissons pas la garde »
La réflexion qui accompagne dans la même veine le faux « ci vis pacem para bellum » est cette affirmation apparemment pleine de bon sens et de prudente sagesse : les menaces se multiplient, « ce n’est pas le moment de baisser la garde ». La conséquence de ce postulat est bien sûr : « ce n’est pas le moment de baisser les dépenses militaires, au contraire ». Ce raisonnement est tellement répandu qu’il mérite que nous prenions un peu de temps pour le démonter en l’illustrant par rapport à la situation actuelle.
La justification du « ce n’est pas le moment » est l’affirmation de l’existence de « menace(s) » qui sont obligatoirement « importantes » ou « grandissantes » ou « nouvelles ». Prenons l’exemple des déclarations de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, lors son déplacement à Lorient le lundi 7 novembre 2022. Que dit-il ?
« Les menaces qui pèsent sur la France et sur la sécurité des Français évoluent très vite. […] des nouvelles menaces conventionnelles […], des menaces hybrides […], alors que les menaces s’additionnent et prennent des formes différentes, […], être en mesure de répondre à ces nouvelles menaces […] »
Cinq fois le mot « menaces » en dix lignes d’interview à Ouest-France12.
Ce discours était le même dix ans auparavant dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 : « les risques et les menaces auxquels la Nation doit faire face se sont multipliés en se diversifiant, […] ». Dans ce texte de 100 pages, on trouve le mot « menaces » pas moins de 144 fois. Ce texte était dans la lignée du « concept stratégique » défini par l’OTAN en 2012, dans lequel les « problèmes » du monde qui relèvent, soit d’une politique de prévention des conflits, soit de politique de développement, soit d’actions de justice internationale, sont transformés systématiquement en « menaces » sécuritaires ? Peut-on mélanger pêle-mêle :
« La mondialisation, les défis de sécurité émergents, comme les cyber-menaces, les contraintes majeures en termes d’environnement et de ressources, y compris le risque de perturbation des approvisionnements en énergie, ainsi que l’apparition de nouvelles technologies […] la piraterie et le terrorisme » ?
Cette construction thématique a été reprise par Emmanuel Macron dans son discours du 9 novembre 2022 à Toulon. Le Président de la République a été très disert sur les « défis du futur » qu’il présente, lui aussi, implicitement, comme autant de nouvelles menaces. Il a évoqué pêle-mêle le « risque de guerre de haute intensité entre États », les « tensions croissantes en Asie », « l’usage généralisé des drones », « la banalisation des missiles », le développement du « cyber », les « technologies de rupture », le « quantique », « l’intelligence artificielle », « l’hypervélocité » ainsi que « les risques sanitaires comme les risques climatiques ».
Réflexions sur la notion de « menace »
L’utilisation sans retenue de la notion de « menaces » pour justifier les politiques de militarisations, comme nous venons de le lire, appelle un examen critique et soulève, pour tout esprit rationnel, de nombreuses questions sur cette notion :
— cette menace est-elle réelle ou s’agit d’un « défi » ? Quelle est sa nature, comment la caractériser ?
— la réponse à cette menace ou à ce défi est-elle forcément d’ordre militaire, ou diplomatique, ou économique, ou judiciaire ou policière ?
— existe-t-il une réponse sans escalade à cette menace et peut-on mettre en œuvre des mesures pour éviter qu’elle ne se manifeste à nouveau à l’avenir ? Existe-t-il des voies pour que la justice internationale puisse se saisir de faits relatifs à cette menace ?
— peut-on combattre les déformations autour de la présentation (et déformation) de ces défis ou menaces pour empêcher qu’ils ne deviennent de l’information de guerre ou de la propagande de guerre (informations erronées, construction de l’image de l’ennemi) à l’époque de l’explosion des réseaux sociaux ?
Menaces ou défis : exemples
Deux exemples pour montrer la confusion entre ces deux termes. J’ai cité le « concept stratégique » élaboré en 2018 par l’OTAN qui est un véritable inventaire à la Prévert. Cette confusion entre sécurité et défense sur le plan militaire, présentait plusieurs avantages pour les dirigeants de l’Alliance. Le premier était d’atténuer, à l’époque, les éventuels renâclements de certains partenaires devant les coûts financiers de la « cotisation » OTAN, en démontrant que les dangers n’avaient pas disparu, au contraire, donc une