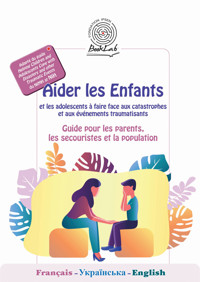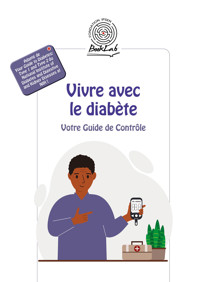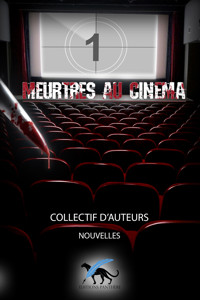Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nouvelle Cité
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Connaissances des Pères de l'Église
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Pour annoncer la nouveauté du christianisme dans le monde gréco-romain, les Pères de l'Église ontr mis en évidence la réalité de La Résurrection. Ils en ont cherché les modalités et précisé le sens et ce, dès Justin, Irénée... dans leurs traités et dans leur prédication pour Pâques. Ils ont expliqué comment La Résurrection du Christ et la pierre d'angle de notre résurrection, ce qui les a amenés à développer une théologie du marture... Nous reprendrons dans ce numéro, leur apport, en étudiant non seulement Justin, Irénée mais aussi les Cappadociens, Augustin...
la revue CONNAISSANCE DES PERES DE L'EGLISE : plus de 160 numéros CLIQUEZ ICI et TROUVEZ LE VÔTRE
SOMMAIRE
Éditorial
Marie-Anne VANNIERLa Résurrection et l'Exaltation du Christ dans la littérature de l'ère patristique
Raymond WINLINGLa célébration de La Résurrection à Pâques
Marie-Anne VANNIERLes martyrs et La Résurrection
Martin ROCHLe Peri Anastaseôs de Justin de Rome
Daniel VIGNENote sur La Résurrection chez Irénée de Lyon
Artur SWIDECKIHomélie de Narsai sur La Résurrection
Colette PASQUETActualité des Pères de l’Église
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Voici qu’est arrivée pour nous la fête désirable et salvatrice, le jour de la Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ, le fondement de la paix, le point de départ de la réconciliation, la destruction des guerres, l’anéantissement de la mort, la défaite du diable, la joie des humains. Aujourd’hui, en effet, les êtres humains se sont mêlés aux anges. Aujourd’hui, l’aiguillon de la mort a été détruit, aujourd’hui les liens de l’Hadès ont été rompus. C’est aujourd’hui le moment favorable pour prononcer cette parole ; « Mort, où est ta victoire ? Hadès, où est ton aiguillon ? »
Aujourd’hui, les femmes ont reçu la bonne nouvelle. Car il est toujours vivant le Verbe de Dieu.
Alors, célébrons cette fête lors de laquelle est ressuscité le Seigneur. Car il est ressuscité et, avec lui, il a ressuscité l’univers et a brisé les liens de la mort. As-tu vu l’amour que le Maître porte aux humains ? As-tu vu la grandeur de sa sollicitude ?
Que tout homme et ami de Dieu se réjouisse de cette belle et lumineuse fête,
qu’il entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur.
Celui qui a travaillé depuis la première heure,
qu’il reçoive aujourd’hui le juste salaire.
Celui qui est venu à la troisième heure,
qu’il célèbre la fête dans l’action de grâce.
Celui qui est arrivé à la sixième heure,
qu’il n’ait aucun doute, il ne sera pas lésé.
Si quelqu’un a tardé jusqu’à la neuvième heure,
qu’il appelle sans hésiter.
S’il a traîné jusqu’à la onzième heure,
qu’il n’ait pas honte de sa lenteur, car le Maître est généreux.
Il reçoit le dernier comme le premier ;
il accorde le repos à l’ouvrier de la onzième heure
comme à celui de la première.
Il fait miséricorde à celui-là, et comble celui-ci.
Il donne à l’un, il fait grâce à l’autre.
Premiers et derniers, recevez le salaire ;
réjouissez-vous aujourd’hui.
La table est prête, mangez-en tous.
Le Christ est ressuscité et voici que règne la vie.
Le Christ est ressuscité des morts, prémices
de ceux qui se sont endormis. »
Jean CHRYSOSTOME,
Homélie sur la Résurrection
Sommaire
La Résurrection
CPE n° 160
Éditorial — Marie-Anne VANNIER
La Résurrection et l’Exaltation du Christ dans la littérature de l’ère patristique — Raymond WINLING
La célébration de la Résurrection à Pâques — Marie-Anne VANNIER
Les martyrs et la Résurrection — Martin ROCH
Le Peri Anastaseôs de Justin de Rome — Daniel VIGNE
Note sur la Résurrection chez Irénée de Lyon — Artur SWIDECKI
Homélie de Narsai sur la Résurrection — Colette PASQUET
Actualité
Éditorial
S’il est une réalité centrale pour les premiers chrétiens, c’est bien la Résurrection, exprimée dans le kérygme qui, dès les Actes des Apôtres (Ac 13, 27-31 ; 14, 23-24), définit l’identité chrétienne à partir de l’annonce de la mort et de la Résurrection du Christ. Pour en rendre compte, Paul parle même dans la Première Épître aux Corinthiens (1-8) de « l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze »… Ce passage de la Première Épître aux Corinthiens, comme celui de la Première Épître aux Thessaloniciens (4, 13-18), a été largement commenté par les Pères de l’Église[1], qui ont montré que la Résurrection du Christ est l’ouverture du salut, la condition de notre propre résurrection.
Nous avons déjà abordé la question dans les numéros 93 et 153 de notre revue. Nous la reprenons désormais, à nouveaux frais, avec Raymond Winling, qui a largement étudié la Résurrection dans les premiers siècles[2]. Il nous fait tout d’abord partager les fruits de ses recherches, en une ample étude de la Résurrection chez les Pères. Nous envisageons ensuite la célébration de la Résurrection à Pâques, que les Pères ont rapidement défini comme le centre de l’année liturgique. Puis Martin Roch nous présente une théologie en actes de la Résurrection, à travers une solide recherche sur les récits de martyres, qui montrent à quel point le martyr revit la Passion du Christ en vue d’être associé à sa Résurrection. Daniel Vigne envisage « le plus ancien traité connu sur la Résurrection, attribué à saint Justin, philosophe et martyr » (p. 42). Après avoir situé l’authenticité de l’ouvrage, Daniel Vigne en rappelle la structure et en dégage l’enjeu qui est l’affirmation de la réalité de la résurrection de la chair, comme le fera ensuite Irénée au livre V de l’Adversus Haereses, que présente Artur Swidecki. Finalement, Colette Pasquet propose la traduction originale d’une homélie de Narsaï sur la Descente aux enfers et la victoire du Christ dans sa Résurrection.
Marie-Anne VANNIER
[1]. Voir La Résurrection chez les Pères, Cahiers de Biblia Patristica, 7, Turnhout Brepols, 2003 ; R. Baro, A. Viciano, D. Vigne (dir.), Mort et résurrection dans l’Antiquité chrétienne, Paris, Parole et Silence, 2017 ; D. Vigne (dir.), Résurrection du Christ et Transfiguration, Paris, Parole et Silence, 2017.
[2].R. Winling, La Résurrection et l’Exaltation du Christ dans la littérature de l’ère patristique, Paris, Cerf, 2000 ; Le Salut en Jésus Christ dans la littérature de l’ère patristqiue, 2 t., Paris, Cerf, 2016.
La Résurrection et l’Exaltation du Christ dans la littérature de l’ère patristique
À partir des années 1930 est intervenu un renouveau de la question de la Résurrection du Christ. Les contestations de la théologie libérale, les objections des milieux modernistes avaient provoqué une prise de conscience de la nécessité d’un retour aux sources chez les catholiques et même chez les protestants. Les tenants du mouvement liturgique notamment s’inspiraient des thèses d’Odon Casel, d’après lesquelles la liturgie chrétienne est un sacrifice spirituel d’action de grâces, au cours duquel, sous le voile des signes et de la parole, est rendue présente et toujours agissante l’œuvre de salut accomplie par le Christ par sa mort, sa Résurrection et son Exaltation. Des théologiens de l’époque, spécialisés dans l’histoire de la théologie, s’engagèrent dans les discussions pour signaler, de leur côté, des points précis qui demandaient des mises au point. Dans les deux cas, on pratique le retour à la liturgie et à la théologie des premiers siècles de l’Église. Le présent article essaie de rendre compte de la richesse des données théologiques qui concernent la question de la Résurrection et de l’Exaltation chez les Pères de l’Église et qui ont permis des renouvellements significatifs dans le domaine de la liturgie et même dans certaines questions de théologie pastorale.
État de la question : le malaise grandissant avant le concile Vatican II
Domaine de la liturgie
Dans le motu proprio du 14 février 1969, qui présente les normes universelles du nouvel Ordo missae, Paul VI reconnaît que des dérives se sont produites au cours du temps dans la pratique liturgique. Le pape rappelle les efforts de certains de ses prédécesseurs pour rendre au dimanche sa dignité de jour primordial, en tant que jour de la Résurrection, ainsi que pour restaurer la veillée solennelle au cours de la nuit du Samedi saint[1]. Pie XII était déjà intervenu pour mettre fin aux controverses entre partisans et adversaires qui se déchiraient au sujet des thèses d’Odon Casel. Dans son encyclique Mediator Dei (1947), il déclara : « L’année liturgique, qu’alimente et qu’accompagne la piété de l’Église, n’est pas une représentation froide et sans vie d’événements appartenant à des temps écoulés ; elle n’est pas un simple et pur rappel de choses d’une époque révolue. Ces mystères, ce n’est pas de la manière incertaine et assez obscure dont parlent certains écrivains récents, qu’ils restent constamment présents et qu’ils opèrent[2]. »
Les promoteurs du mouvement liturgique avaient dénoncé les déviations suivantes :
– à force de multiplier les fêtes des saints et de les solenniser au point qu’elles avaient la priorité sur les messes du dimanche, on avait occulté le sens premier du dimanche, « jour du Seigneur » ;
– la piété pascale avait connu un lourd infléchissement. Certes, la fête de Pâques continuait d’être célébrée comme solennité de première classe, mais en fait, la grande fête de la chrétienté était le Vendredi saint, comme l’a dit Karl Rahner[3] ;
– les promoteurs du mouvement liturgique s’adonnèrent aussi à des recherches sur l’histoire de la liturgie, pour mieux comprendre l’esprit dans lequel la liturgie s’est constituée et pour mieux saisir les raisons des déviations qu’elle a connues.
Domaine de la théologie systématique
La prise de conscience qui s’est produite dans le domaine de la liturgie est à l’origine d’un questionnement sur la place qui revient de droit à la Résurrection et à l’Exaltation du Christ dans la théologie systématique. On se rendit compte qu’au fond, un changement assez important est intervenu à la suite de la théorie de la satisfaction proposée par Anselme de Cantorbéry dans le Cur Deus Homo (1098). Cet ouvrage mettait l’accent sur la satisfaction offerte à Dieu par le Christ acceptant de mourir pour les péchés des hommes. L’importance croissante, à partir de là, de la mort du Christ pour le rachat des péchés et la focalisation grandissante sur le Vendredi saint s’expliquent en partie par là. Quant à la théologie de l’eucharistie, elle était dominée par la notion de sacrifice. Le concile de Trente a encore durci cette tendance par réaction contre certaines thèses protestantes sur le salut.
Requêtes de théologiens catholiques enseignant la systématique ou la théologie biblique
Force est de se limiter à quelques indications :
– l’étude de François Xavier Durrwell La Résurrection de Jésus, mystère de salut (1950) est une étude de théologie biblique. Elle s’attache à mener une réflexion sur la portée salvifique de la Résurrection du Christ ;
– Karl Rahner aussi a publié des articles sur la dimension salvifique de la Résurrection du Christ. Il explique notamment qu’il est nécessaire de maintenir un lien étroit entre la mort et la Résurrection du Christ. Cependant cet auteur estime que la Résurrection de Jésus n’a pas uniquement une valeur de « cause exemplaire », mais qu’elle représente un événement qui influe sur la transformation progressive du monde et l’avènement définitif du Royaume ;
– Walter Kasper souligne les aspects suivants :
• Résurrection et Exaltation ne doivent pas être dissociées de façon indue : elles ne se rapportent ni uniquement au passé, ni uniquement à l’avenir ; la seigneurie du Christ s’exerce dès à présent,
• la Résurrection a une portée sotériologique. Elle comporte des aspects salvifiques dès cette vie sur terre.
Pour un retour aux sources
Compte tenu de ce qui a été dit, il est légitime de pratiquer un retour aux sources en étudiant de plus près la période des Pères de l’Église. On pourra peut-être objecter qu’il conviendrait de commencer par la place occupée par la Résurrection et l’Exaltation du Christ dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne sera pas oublié. Bien au contraire. En effet, les Pères ont pratiqué une lecture attentive des écrits du Nouveau Testament et ils avaient à cœur de respecter ces données et de défendre les textes du Nouveau Testament contre les adversaires qui cherchaient à réfuter les affirmations doctrinales des chrétiens. Par ailleurs, les Pères se sont livrés à un impressionnant travail d’herméneutique pour justifier la place centrale du mystère de la Résurrection et de l’Exaltation.
La Résurrection du Christ comme élément de structuration du temps liturgique
Diverses données attestent que dès les origines, l’Église a accordé une place primordiale à la Résurrection du Christ. Ainsi, la semaine chrétienne s’organise autour du jour du Seigneur et l’année liturgique trouve son épicentre dans la fête de Pâques. Dans les deux cas, la Résurrection est principe de structuration.
La Résurrection du Christ comme principe d’organisation de la semaine chrétienne
Très tôt s’affirme un lien étroit entre la Résurrection du Christ et le premier jour de la semaine.
Le premier jour
D’après les Évangiles (Mt 28, 1 ; Mc 16, 9 ; Lc 24, 1 ; Jn 20, 1), c’est le premier jour de la semaine que commencent à se produire les apparitions de Jésus ressuscité. Les Actes mentionnent une réunion pour rompre le pain le premier jour de la semaine (Ac 20, 7). L’expression est couramment employée dans les Églises pauliniennes. Justin explique le sens de cette expression pour désigner le dimanche : C’est le jour du soleil que nous nous réunissons tous ensemble, parce que ce jour est le premier, celui où Dieu, en transformant la ténèbre et la matière, fit le monde, et celui où Jésus Christ notre Sauveur est ressuscité des morts[4].
Le huitième jour
Basile compte parmi ceux qui ont cherché à expliquer le sens de l’expression huitième jour utilisée pour désigner le dimanche. D’après lui, le jour du Seigneur est appelé huitième jour parce qu’il figure le siècle à venir, qui n’est plus soumis aux successions de l’hebdomade. De cette façon, il dépasse la conception cyclique du temps et fait comprendre que le temps placé sous le signe du septénaire est lui-même tendu vers le monde futur[5].
Le jour de la Résurrection
Au début du IIIe siècle est attestée une autre dénomination : anastasimos hèmera, qui correspond à l’expression dies dominicae resurectionis employée par Tertullien[6].
Le jour du Seigneur
Dès la fin du Ier siècle est attestée la dénomination « Jour du Seigneur » (Ap 1, 10). La Didachè 14, 1 offre la précision suivante : Le jour dominical du Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain. C’est donc le jour de la réunion de l’assemblée cultuelle. Le syntagme Jour du Seigneur / Hèmera Kyriou a été utilisé par les Septante pour désigner l’intervention eschatologique de Dieu pour le Jugement. Les chrétiens ont innové en ayant recours à l’expression pour désigner plus spécialement la Parousie. Pour éviter la confusion entre le jour de la Parousie et le jour marqué par les premières apparitions du Ressuscité, ils ont fait appel à l’adjectif kyriakos, qui a le même sens que le génitif kyriou (« du Seigneur »). Les chrétiens ont donc procédé à une innovation par transfert de sens, le mot kyrios désignant pour eux le Seigneur ressuscité.
Le jour du soleil
À partir du Iersiècle, le monde hellénistique adopte la coutume de désigner les sept jours de la semaine d’après l’astre sous le signe duquel chacun d’eux est censé être placé. Justin mentionne le jour du soleil dans le passage suivant : C’est le jour du soleil que nous nous assemblons tous ensemble, parce que c’est le premier jour où Dieu, transformant la ténèbre et la matière, fit le monde. […] Le jour du soleil, il [le Christ] apparut à ses apôtres et à ses disciples[7].
Sabbat et dimanche
À partir du IIe siècle, des auteurs chrétiens insistent sur la nouveauté du dimanche par rapport au sabbat. C’est le cas d’Ignace d’Antioche : Si donc ceux qui vivaient dans l’ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n’observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, jour où notre vie s’est levée par lui et par sa mort […], comment pourrions-nous vivre sans lui[8]? Effectivement, la semaine juive et la semaine chrétienne se présentent de façon différente : la première culminant dans le sabbat, la deuxième trouvant son acmé dans le dimanche au début de la semaine. De plus, le dimanche rappelle de semaine en semaine la Résurrection du Christ.
La Résurrection et l’Exaltation du Christ comme éléments de structuration de l’année liturgique
Si déjà ils avaient choisi le dimanche comme jour de célébration hebdomadaire de la Résurrection du Christ, les chrétiens ne pouvaient manquer de relire la Pâque juive à la lumière de leur foi en Jésus Christ mort et ressuscité à l’occasion de cette Pâque.
Certes, historiquement, les rites de célébration de la fête de Pâques ont connu un déploiement dans le temps qu’il serait trop long de décrire en détail. Pour le propos qui est le nôtre, il suffira de rappeler les origines de la célébration de la fête de Pâques chrétienne et ensuite de donner une vue d’ensemble du cycle pascal de l’Église, tel qu’il s’est constitué au cours des premiers siècles.
Le noyau primitif de la célébration de la fête de Pâques chrétienne
Aux chrétiens de Corinthe, Paul écrit : « Le Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain : la perversité et le vice ; mais avec du pain non fermenté : la droiture et la vérité » (1 Co 5, 7-8). Dans les documents les plus anciens sur l’ordonnance de la célébration, celle-ci consiste dans un jeûne de deux ou plusieurs jours, se terminant par une veillée nocturne au cours de laquelle s’effectue le passage du jeûne à la fête, celle-ci étant inaugurée par l’eucharistie destinée à commémorer la Résurrection du Christ.
Progressivement, ce noyau primitif connut une extension en raison de la célébration du baptême des catéchumènes : une période de jeûne de quarante jours précédant la nuit de Pâques servait notamment à préparer les catéchumènes adultes au baptême grâce à une initiation plus poussée : il s’agit du temps du Carême.
Par ailleurs, la fête de Pâques connut un prolongement de cinquante jours, nommé « cinquantaine pascale », au cours de laquelle l’Église célébrait dans la joie la Résurrection, l’Ascension et le jour de la Pentecôte. Jusqu’au IIIe siècle, la fête de Pâques fut la seule grande fête de l’Église. À partir du IVe siècle s’y ajouta le cycle de Noël, destiné à célébrer l’Incarnation du Christ.
Un aperçu sur le contenu mystérique de la veillée pascale
Quelques observations sur la veillée pascale d’après le rituel ancien et en partie actuel
Le rituel actuel remonte aux premiers siècles de l’ère chrétienne. Pour simplifier la présentation, il sera fait appel avant tout au rituel auquel se réfèrent les Pères de l’Église pour leurs fidèles et pour les catéchumènes baptisés au cours de la veillée pascale. Présentée de façon schématique, celle-ci comporte les données suivantes.