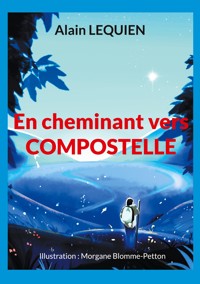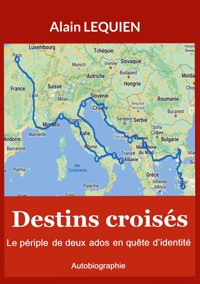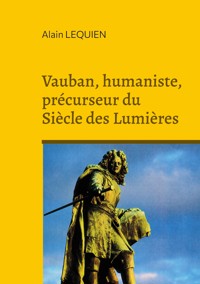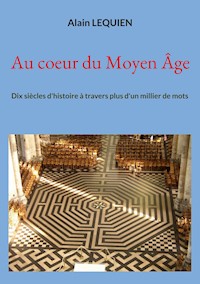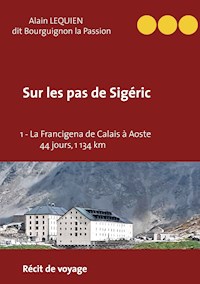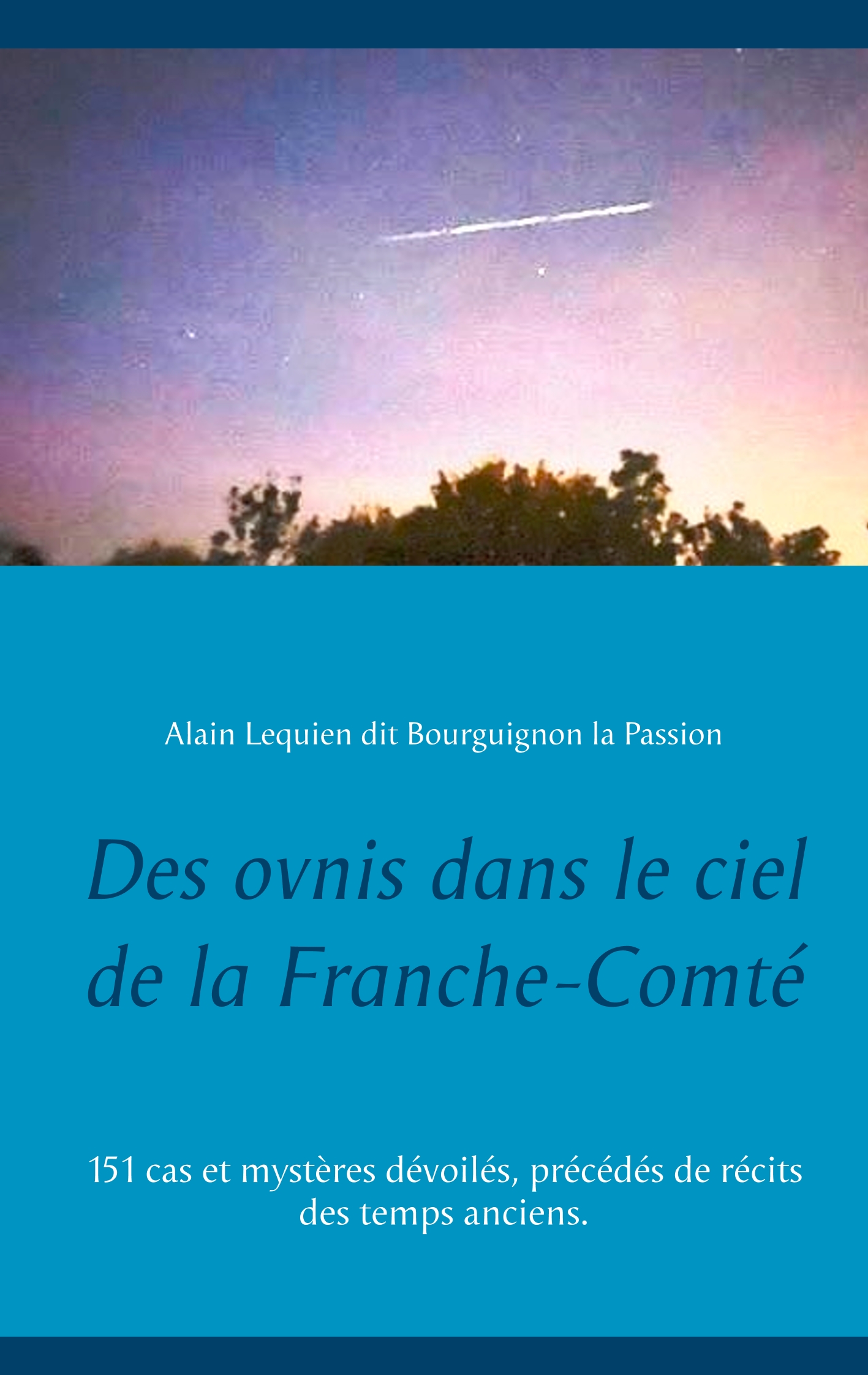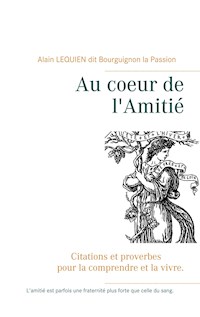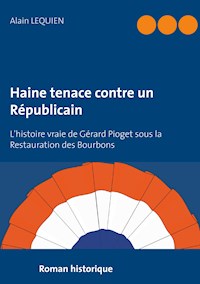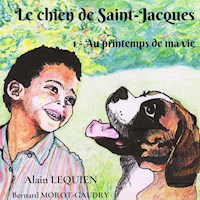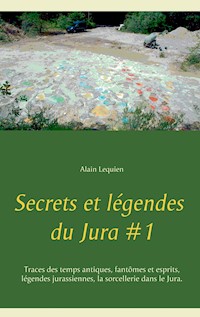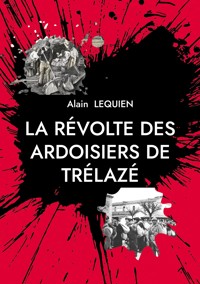
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans la nuit du 26 au 27 août 1855, plusieurs centaines d'ardoisiers issus principalement de Trélazé marchent sur Angers. La majorité d'entre eux sont affiliés à une société secrète, La Marianne, en lutte contre le pouvoir impérial au profit d'une république démocratique et sociale. Attendus par l'armée et la gendarmerie, ils sont rapidement dispersés. Plus d'une centaine d'entre eux sont arrêtés sans affrontement. Jugés à la hâte, avec une grande sévérité, certains sont condamnés à la déportation en Guyane, une douzaine perdirent la vie. Cet événement est un moment fort de l'histoire angevine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.alain-lequien.fr/
www.bourguignon-la-passion.fr/
Courriel : [email protected]
Table des matières
Préambule
Le contexte historique et local
L’Anjou noir, le pays de l’ardoise
L’exploitation des ardoisières
La Marianne, une société secrète
La société française face aux sociétés secrètes
Les sociétés secrètes en Pays de Loire
La Marianne ou le Grand Bâtiment en Anjou
La révolte des 26/27 août 1855
Le contexte social angevin
Déroulement de la révolte
Les procès en Cour d’Assises
La mise en accusation
Le premier procès du 8 au 16 octobre 1855
Le second procès du 17 au 22 octobre 1855
Au tribunal correctionnel
Les recours en grâce et l’amnistie
Commentaires sur la révolte
L’activité de La Marianne après la révolte
À Angers-Trélazé
Dans le reste du département
Bibliographie
Mes derniers ouvrages
Préambule
Dans la nuit du 26 au 27 août 1855, 600 à 800 ouvriers, la plupart des perreyeux1 trélazéens, de Saint-Barthélemy et des Ponts-de-Cé, marchent sur Angers, chef-lieu du Maine-et-Loire. La majorité d’entre eux sont affiliés à la société secrète républicaine La Marianne, en lutte pour renverser le pouvoir impérial. Ils veulent le remplacer au profit d’une république démocratique et sociale, en profitant des revendications populaires pour la baisse du prix du pain qui flambe.
Attendus par la troupe au niveau de la rue Bressigny d’Angers, les révoltés sont rapidement dispersés. Plus d’une centaine d’entre eux sont arrêtés sans affrontement. De là à penser qu’ils furent dénoncés ou manipulés par la police ou les autorités en leur faisant croire que la révolution se déroulait dans la France entière, le pas est facile à franchir. Durant les semaines suivantes, de nombreuses arrestations eurent lieu dans tout le département, et même au-delà. Jugés à la hâte, avec une grande sévérité, certains sont condamnés à la déportation en Guyane. Une douzaine y perdirent la vie. Cette révolte est à replacer dans son contexte historique et local.
C’est l’époque du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le conduisant à devenir Napoléon III. Un temps où il prit des mesures impopulaires tels la loi sur la presse, le renforcement du contrôle de l’Église catholique dans l’éducation (loi Falloux), la restriction du suffrage universel de près de trois millions de votants (ceux ayant peu de revenus)… C’est l’époque des sociétés secrètes, le seul moyen des républicains de revendiquer une société différente, plus égalitaire. En Anjou, les ardoisières emploient de nombreux ouvriers dans des conditions d’extraction difficiles. Un environnement favorable où La Marianne s’est bien implantée.
La date de sa création en Anjou est sujette à questionnement, mais dès 1852-1853, les enquêtes de police font le lien avec d’autres sociétés secrètes présentes dans la vallée de la Loire, notamment dans le Cher, la Nièvre et l’Allier. À la demande du député manceau Alexandre Ledru-Rollin, ancien candidat à l’élection présidentielle exilé à Londres, ces sociétés secrètes auraient fusionné avec La Jeune Montagne parisienne. De nombreux procès à Paris, Lyon, Tours, Bourges, Angers… témoignent de la volonté impériale de les démanteler.
En 1855, dans le contexte difficile de la guerre de Crimée, des rumeurs laissent entendre que l’Empereur serait mort et que le retour à la IIe République serait imminent. Jean-Marie Secrétain, le chef politique de La Marianne locale, se rendit du 18 au 25 août à Paris. Selon les accusations de son procès, il serait allé chercher le mot d’ordre d’insurrection.
C’est alors que débute la révolte pour conquérir la capitale angevine.
Bonne lecture.
1 Le perreyeux ou parreyeux désigne en patois angevin, l’ouvrier des carrières (perrières) du schiste ardoisier, le tailleur d’ardoises.
Le contexte historique et local
Pour comprendre cette révolte, commençons par évoquer le beau pays d’Anjou, le contexte particulier de l’industrie ardoisière et cette époque comprise entre les deux empires napoléoniens, riches de la présence de sociétés politiques secrètes.
L’Anjou noir, le pays de l’ardoise
En évoquant la « bonne et belle ville d’Angers », le visiteur garde le souvenir de son château-forteresse, de la tapisserie de l’Apocalypse (cent mètres de longueur, la plus importante conservée du Moyen-Âge), le lac de Maine, ses nombreux jardins et espaces naturels. Il ignore souvent que la belle cité fut au centre d’une industrie remarquable, l’exploitation ardoisière.
L’Anjou noir, du fait de la couleur de l’ardoise sur les terres et les toits, regroupe des paysages de schiste ardoisier issus des derniers contreforts du Massif armoricain, avec le Segréen et un peu plus loin, la Mayenne. L’ardoise est l’un des symboles majeurs de l’Anjou.
À l’aube de l’histoire, la région était constituée en grande partie de la vaste forêt des Verrières, recouvrant l’ensemble des terres du Loir à l’Authion, jusqu’à la grande Loire. Elle formait le territoire des Andécaves ou des Andes, un peuple celte.
Sa capitale, Juliomagus (nom antique d’Angers signifiant le marché de Jules) est citée dans les Commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César. Lors du Haut-Empire, cette cité ouverte était délimitée à l’ouest par la Maine, à l’est par un grand amphithéâtre, abritant trois mille habitants. Au Bas-Empire (IIIe siècle), l’insécurité règne. Les habitants se replient dans le castrum protégé par une enceinte.
Nous sommes à l’émergence du christianisme. En l’an 2000, un cercueil de plomb livra le squelette d’une jeune fille portant ses parures et un dépôt d’objets.
Vers le IVe/Ve siècle, la cité devient la civitas Andecavorum, ou Andecavis, origine de son nom actuel. Autre grande découverte, en 2010, la présence d’un mithraeum, un temple dédié au dieu indo-perse Mithra, une religion postchrétienne très prisée parmi les soldats romains issus du Moyen-Orient.
Au fil des siècles, les grands défrichements médiévaux augmentent les surfaces cultivées (ager) aux dépens des terres incultes, souvent inhospitalières, constituées de landes et de marais. Ce recul généralisé de la forêt atteignit son apogée aux XIIIe/XIVe siècles. Cependant, sur les plateaux ardoisés faiblement vallonnés du territoire du Trélazé actuel, de nombreuses zones restent couvertes d’une pauvre lande constituée de mousses et de lichens, contrairement aux zones arborées. Les bandes de schiste affleurent le terrain.
À l’époque carolingienne (VIIIe au Xe siècle), Angers est une grande paroisse urbaine englobant les zones des alentours. Les paroisses autonomes n’apparaissent qu’aux XIe/XIIe siècles sur les terres cultivables, donnant naissance à celles de Trélazé, Andard, Saint-Barthélemy… Les Comtes d’Anjou favorisent la fondation de nouvelles abbayes comme Fontevraud, Savigny, Saint-Laud, Saint-Maurice, Toussaint… possédant de nombreuses terres. La grande forêt recule, se morcelant au fil de l’avancée des défricheurs. Le monde rural prend toute son importance.
Pour compléter leur revenu, les paysans extraient des pierres de schiste durant la morte-saison des travaux agricoles. Cette exploitation artisanale consistait à bêcher le sol pour découvrir la roche à peu de profondeur pour ressortir ce qu’il pouvait. Une pratique, plus ou moins légendaire, suggérée au VIe siècle par Licinius qui aurait eu cette idée pour améliorer le sort de ses ouailles.
Celui-ci, élevé à la cour des Mérovingiens, devint le connétable du roi Clotaire, puis le gouverneur des provinces armoricaines. Il se retira comme moine à l’abbaye de Chalonnes. Devenu évêque d’Angers (592-608), il est inscrit au martyrologe romain sous le nom de saint Lézin, patron des ardoisiers.
Une ancienne commune du département perpétue sa mémoire, intégrée de nos jours à la commune de Chemillé-en-Anjou.
Il ne s’agissait pas de l’ardoise comme nous la connaissons de nos jours, mais de blocs bruts, non taillés, utilisés comme matériaux de construction. Leurs traces ont été retrouvées dans des maçonneries gallo-romaines. Vers le IXe siècle, ils apparaissent comme pierres tombales.
L’exploitation des ardoisières
Elle devint l’une des principales activités des paroisses avoisinantes d’Angers, comme Avrillé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy, Trélazé ou l’ancienne commune de La Pouëze. Une célèbre gravure du XVIe siècle représente le panorama de la capitale angevine avec, au premier plan, le travail des ouvriers. Les perreyeux s’y consacrent aux différentes phases de la fabrication des ardoises.
Au XIe siècle, la première fosse à ciel ouvert (la foncée dans le langage des ardoisiers) apparaît sur le site de l’Adézière d’Avrillé. Peu profonds, les blocs de schiste sont extraits pour la construction. Ce lieu est attesté par des documents datés de 1312.
En fait, la production d’ardoises de couverture y débuta vers 1815. Très vite, des difficultés apparaissent, les exploitants se succèdent : La Désirée en 1823, Les Bois en 1842. Elle cesse son activité à la suite d’un éboulement en 1847.
En 1894, la production est relancée sous le nom de La Renaissance. Son exploitation réalisée d’abord à ciel ouvert se poursuit en souterrain sur l’emplacement actuel du stade Delaune.
En 1904, cinq puits fonctionnent, employant plus de trois cents ouvriers à la production. La moitié sont des ouvriers du fond (ceux d’à-bas), les autres sont des fendeurs (ceux d’à-haut) auxquels il faut ajouter une trentaine de manœuvres. Elle rencontre de sérieuses difficultés techniques.
Le 25 janvier 1905, la rupture d’un câble supportant une benne de remontée provoque une chute de cent quarante mètres provoquant la mort de quinze ouvriers. Leurs collègues refusant de reprendre le travail, des incidents éclatent, des dommages sont causés aux installations malgré la présence de gendarmes. Deux mois plus tard, le conflit prend fin.
La Première Guerre mondiale entraîne l’arrêt de l’activité, les ouvriers partent au front. À l’issue de celui-ci, les tentatives de relance ne permettent pas de continuer durablement l’exploitation. Le site ferme définitivement en 1927. C’est la fin des ardoisières d’Avrillé.
De nos jours, ce vieux fond (site creusé d’une carrière) est connu sous le nom de Lac bleu. Il contiendrait plus de 2 700 tonnes de munitions immergées par l’usine d’armement voisine de Montreuil-Juigné, lors des deux Guerres mondiales.
Le deuxième site historique est situé à Juigné-sur-Loire, à neuf kilomètres d’Angers. Au XIIe siècle, peut-être auparavant, le schiste bleu de l’ardoise était extrait pour réaliser des pieux et des piquets de vigne, et pour couvrir le toit des maisons locales. À partir de 1348, la production de la carrière à ciel ouvert augmente pour approvisionner la couverture du château de Beaufort-en-Vallée (Beaufort-en-Anjou), aujourd’hui en ruines. Ses ardoises servirent aussi à la reconstruction de Londres après le violent incendie de 1666.
Souvenons-nous de cette tragédie. Le 2 septembre, Thomas Faynor, le boulanger du roi Charles II, s’endormit en oubliant d’éteindre ses fours à pain. À deux heures du matin, à cause des étincelles, l’incendie débute. Il dura quatre jours, détruisant 13 200 maisons, 87 églises… et fait huit victimes.
La qualité de ces schistes ne permettait que la fabrication d’ardoises grossières, épaisses et fragiles. Son exploitation cessa vers la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, en partie à cause des débordements de la Loire. Le Parc intercommunal des Garennes, recolonisé par la végétation, conserve de nos jours son empreinte.
Le troisième site historique se situe aux Ponts-de-Cé, à six kilomètres d’Angers. À la même époque que celle de Juigné, les ardoisières de la Belle-Poule et de La Glardière alimentent également la toiture du château de Beaufort-en-Vallée, mais surtout les réparations de celles du château d’Angers entre 1367 et 1376. Cette activité perdura, puisqu’elle apparaît dans les Extraits de comptes et mémoriaux du Roi René de 1456. La Belle Poule étant noyée, il faut rechercher d’autres terrains à exploiter.
À Angers, la roche affleurante en plusieurs endroits est exploitée de manière archaïque, notamment à La Pierre-Lise près du Faubourg Saint-Michel, et au Pigeon. Vers 1376, la couverture des édifices publics provenait de celle de Saint Cierge (Saint-Serge). À partir du XVe siècle, l’essor de la cité les fait disparaître au profit des paroisses rurales.
Proches de la Loire, de l’Authion et de nombreuses petites rivières, les crues sont dangereuses, inondant des milliers d’hectares de terres basses. Elles causent aussi une grande insécurité pour les habitations. Pour pallier ce manque de monticules naturels, les habitants construisent des tertres artificiels, puis des digues dénommées localement des levées. Au fil du temps, leur nombre augmenta, celles existantes furent surélevées.
Trélazé, la cité ardoisière
De nos jours, à cinq kilomètres d’Angers, la forteresse ardoisière de Trélazé dresse ses murailles de longues buttes de schistes gris-bleu, au cœur même du village. Plusieurs pistes pédestres bien identifiées permettent de se promener au milieu des traces de ce passé, sans oublier la visite du musée de l’Ardoise2. Ancienne capitale française de l’ardoise, le village est devenu une banlieue d’Angers en conservant son statut d’ancienne cité ouvrière.
Les ardoisières des Ponts-de-Cé devenant inutilisables, la recherche de sites s’étend vers Trélazé. La perrière de Tire-Poche s’ouvre en 1406, sur un terrain boisé appartenant à l’Hôtel-Dieu d’Angers. Elle fut la première perrière à ciel ouvert de la commune, suivie de celles du Bouc Cornu (1454), de Villechien (1484) et de La Chanterie (1491). Peu profondes, de vingt à trente mètres, elles se situent dans des zones non inondables. Au fil du creusement, la production donne accès à une meilleure qualité de roches et, en conséquence, à la fabrication d’ardoises plus fines.
Durant les XIVe/XVe siècles, les carriers extrayaient les blocs de schiste, transportés à dos d’homme. Les porteurs franchissaient les différents niveaux par des échelles jusqu’au lieu de taille. À partir du XVIe siècle, le travail est bien identifié entre les ouvriers d’à-bas (ceux extrayant la roche dans la carrière) et ceux d’à-haut, (les fendeurs transformant les blocs en ardoises). Ces derniers sont des artisans indépendants, propriétaires de leurs outils, de leur tue-vents qu’ils déplacent à chaque changement de carrière.
À partir de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, le besoin d’ardoises est si important que de nouvelles carrières ouvrent à Saint-Barthélemy et à Trélazé.
La plupart des terrains appartiennent aux abbayes de Saint-Serge, de Saint-Aubin, ainsi qu’à l’Hôtel-Dieu. Les premiers contrats d’exploitation entre le propriétaire d’un terrain et les exploitants apparaissent.
Profitant du développement de la navigation fluviale sur la Loire, les ardoisières connaissent un essor exceptionnel. L’extraction occupe plusieurs centaines d’ouvriers. Elles alimentent les besoins de couvertures des châteaux de la Loire, dont celui de Chambord en 1539. S’ouvrent d’autres sites : ceux du Lapin (1517), de Terre rouge (1547), des Fresnais (1553), du Petit Noyer (1576), du Grand Bouc (1598). La profondeur des carrières à ciel ouvert est limitée à cinquante mètres. À la fin du siècle, plusieurs points d’extractions sont abandonnés, remplis d’eau du fait des intempéries.
À partir du XVIIe siècle, le manège animé par un cheval aveugle est utilisé. Il actionnait un treuil sur lequel étaient enroulés deux câbles fonctionnant dans un sens différent. L’un remonte pendant que l’autre descend. Les premiers manèges servaient d’abord surtout à l’évacuation de l’eau. À la fin du siècle, au début du XVIIIe, ils sont utilisés pour remonter la pierre placée dans des bassicots, sortes de caisses en bois contenant quatre hottées.
L’activité se déplace sur le coteau. À Trélazé, c’est l’émergence des perrières de La Noue (1602), de la Masse (1612) de Champrobert (1614), de La Fosse aux Loups (1640), de la Gonardière (1655). À Saint-Barthélemy, c’est l’émergence de La Paperie (1607) (abritant de nos jours La Carrière, une école des arts du cirque3).
Le 9 novembre 1619, les ardoisiers reçoivent la visite de la reine mère Catherine de Médicis. Louis XIII lui a confié la gouvernance de l’Anjou.
Pour observer le travail des ardoisiers, elle monta, à la frayeur de tous selon les dires de l’époque, sur un pont de fortune traversant la carrière. En partant, elle gratifia un don financier important au profit des ouvriers. L’année suivante, son fils vint à Angers pour mettre à la raison sa turbulente mère. Il découvrit sûrement à cette occasion les couleurs bleutées de l’ardoise qui couvrit son relais de chasse de Versailles. Lorsque Louis XIV voulut en faire son extension pour devenir le château réputé, il imposa le recours exclusif à l’ardoise de Trélazé pour leur couverture.
Les ardoisières de Trélazé jouissent d’une belle réputation d’or bleu exporté à Londres. En 1678, elles attirent le philosophe anglais John Locke qui prend du temps pour les visiter. Dans son carnet de voyage, il en fait une description précise, estimant à plus de cent le nombre d’ouvriers payés dix sols pour les ouvriers d’à haut, treize sols pour les meilleurs. Dans son sillage, plusieurs philosophes écossais du siècle des Lumières comme Adam Smith, David Hume… constatèrent le dur labeur des perrayeurs et l’organisation du travail des ardoisières. Ils en tireront des conséquences dans leur perception du travail ouvrier.
Au XVIIIe siècle, la demande augmente. Toutefois, de grandes difficultés d’exploitation demeurent : précarité des installations, fonds des carrières noyés par les inondations, glissement de parois, chutes de blocs…
Les carrières des Petits-Carreaux et des Grands-Carreaux sont ouvertes en 1717, comme celles de La Brimandière et de l’Aubinière. Celle de La Noue prend de l’importance. Les puits se dirigent de plus en plus vers l’est, vers l’Authion.
En 1766, à Trélazé, les carrières employaient plus de 800 ouvriers : Villechien (180), l’Aubinière (200), la Noue (100), les Carreaux (140)… sans oublier le personnel affecté aux charrois (transport), et… 170 chevaux.
Dès 1772, six exploitants tentent de se regrouper pour réglementer et organiser la commercialisation. En vain !
À la veille de la Révolution, l’industrie ardoisière est en pleine expansion. De douze millions d’ardoises en 1728, la production est passée à vingt-six millions en 1772 et à cinquante-six millions en 1789. Il existait autant de sociétés d’exploitants que de carrières. Elles payaient un droit de forestage au propriétaire du sol sous forme de redevance en nature de l’ordre de 1/15e à 1/8e du volume d’ardoises fabriquées. Chacun revendant sa production, cette pratique créa une concurrence ardue au profit des acheteurs.
En 1740 et 1786, plusieurs édits royaux tentèrent d’abolir ce droit. En vain ! Ce n’était pas du goût des grands propriétaires, surtout les ecclésiastiques profitant de cette manne. En supprimant les servitudes seigneuriales, les lois révolutionnaires et du Premier Empire précipitent ce fonctionnement.