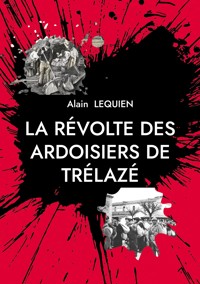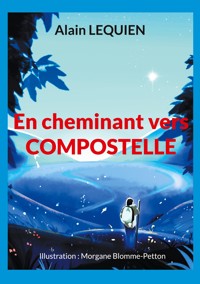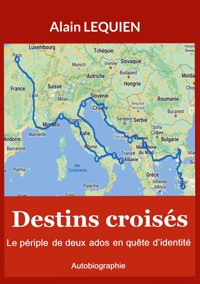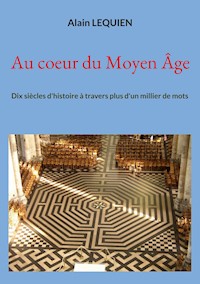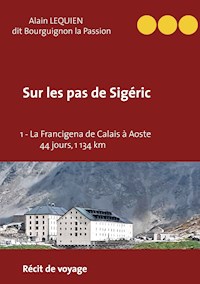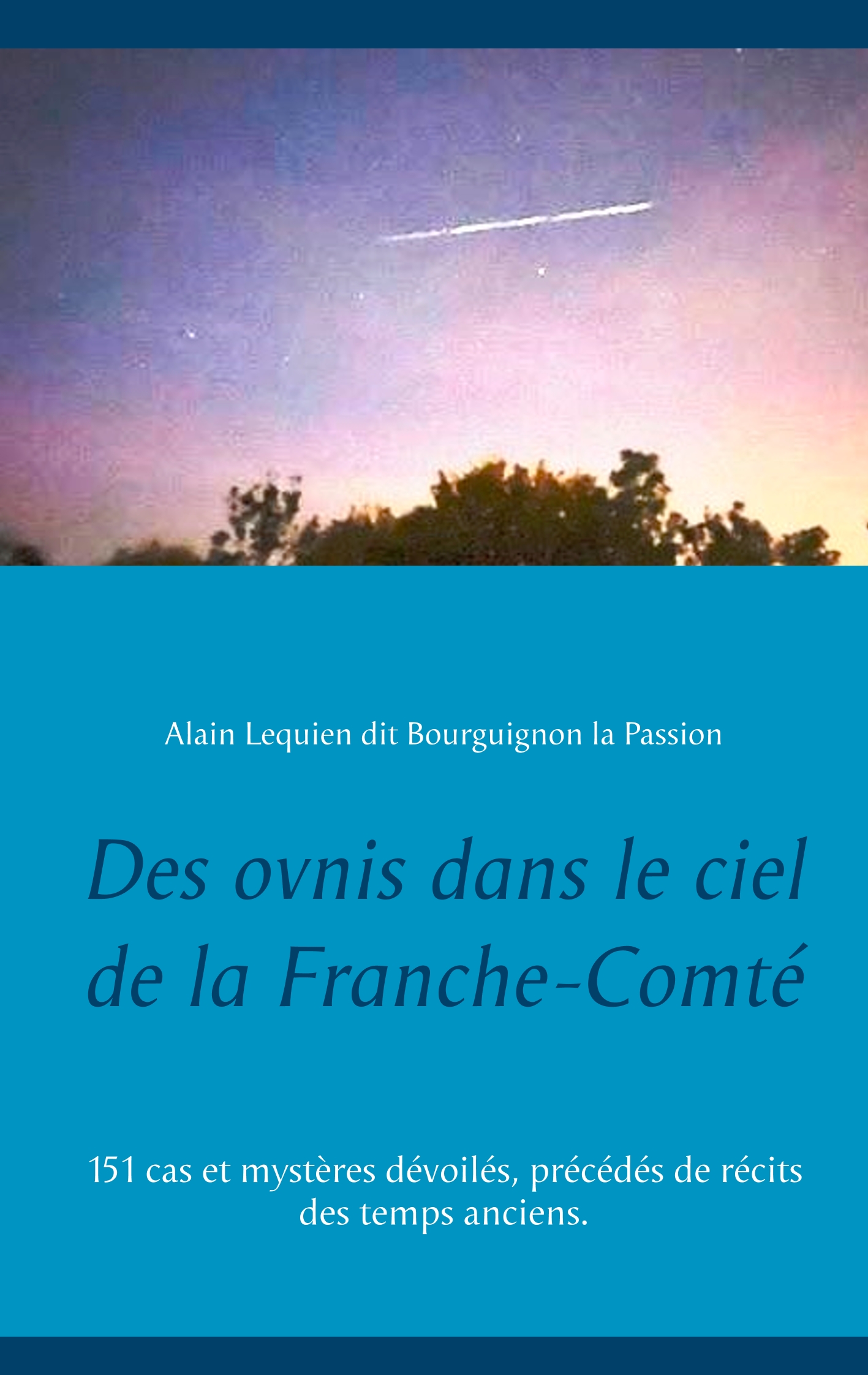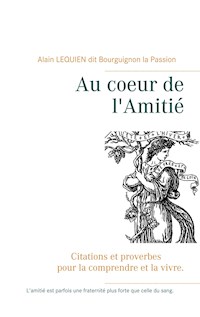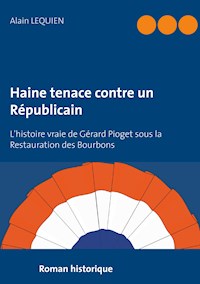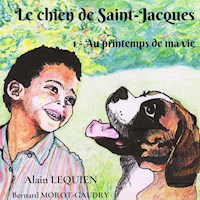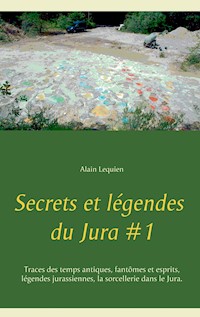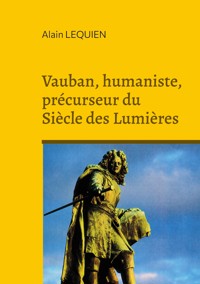
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Descendant d'une famille de petite noblesse ruinée, Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban fut un soldat courageux, un ingénieur de génie, un visionnaire hardi, un infatigable travailleur, un fidèle serviteur du roi Louis XIV qui eut une haute estime de lui en l'élevant à la dignité de Maréchal de France, et en lui prodiguant le titre de marquis. Il fut tout cela à la fois, pour la grandeur de la France. Cet homme au grand coeur n'oublia pas pour autant ses origines modestes, dans le rude Morvan bourguignon. Humaniste dans l'âme, il mit son franc-parler, sa générosité, sa probité, sa haute conscience et sa gloire au service des paysans écrasés d'impôts et des protestants persécutés. C'est assurément l'une des plus nobles figures de l'Histoire de France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Préambule
La vie de Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban
La France au temps de Vauban
1 - Son enfance morvandelle
2 – Son apprentissage militaire (1651-1667)
3 – Entre sièges et reconstructions (1667-1703)
4 - Commissaire général des fortifications (1677-1703)
5 – Vauban et Louvois, une relation de confiance
6 – Vauban, rénovateur de l’armée
7 - Une vie d’ingénieur militaire
8 - Vauban dans sa vie privée
9 - Trois funérailles pour Vauban
Vauban et le protestantisme
10 - Histoire du protestantisme en France
11 – La pacification avec l’édit de Nantes (1598)
12 - La révocation de l’Édit de Nantes (1685)
13 - La voix de Vauban
Vauban, pour une évolution sociétale
14 - Son regard sur la société
15 : Ses Oisivetés, un regard d’homme d’État
16 - Projet d’une Dîme royale
Vauban l’humaniste, précurseur du Siècle des Lumières
17 - Qu’appelle-t-on le Siècle des Lumières ?
18 - Vauban, un humaniste précurseur
Annexes
A – Principales dates de la vie de Vauban
B - Sites Vauban au Patrimoine mondial
C – L’édit de Fontainebleau (1685)
D -Éloge à Vauban par Lazare Carnot (1784)
E - Sources bibliographiques
Préambule
Moi, Sébastien Le Prestre, maréchal de Vauban…
Quelle est la meilleure façon de faire connaître l’homme que je suis, sinon me confier à un porteur de plume de votre siècle, passionné des hommes de devoir ? Il a tenu à me raconter, au-delà du temps et de l’espace, pour me faire connaître et peut-être transmettre le message que je portais au fond de moi.
Oui, j’ai été un cherchant qui aurait pu, ayant réussi sa carrière militaire, vivre comme un courtisan. J’aurais pu me contenter des honneurs qui m’ont été donnés par le Roi très Catholique, le Roi Soleil. Mais, sans le vouloir vraiment, j’ai été pris dans le flot de l’Histoire, en cette période où se termine un certain classicisme pour aller vers des temps plus audacieux.
Je n’ai pas été révolutionnaire au sens brutal du terme, mais mes réflexions, ma démarche, mon chemin de vie m’ont mis en position d’exprimer ce que je pensais sans fioriture. Né en 1633, ma jeunesse de petit noble désargenté, formé à la dure dans mon beau Morvan, m’a poussé à dire, sans détour, ce que je pensais. Dans ce pays vrai, où le paraître ne peut survivre, où le diseux est moins apprécié que le faiseux, où l’on respecte celui qui « est », tout simplement.
Je pense qu’au crépuscule de mon existence, j’ai pu me regarder dans une glace en me disant : j’ai fait mon devoir, parce que c’était mon devoir d’agir. J’ai eu mon franc-parler. À la fin de ma vie, en 1707, on me le fera payer. Mais quelle importance puisque, finalement, l’Histoire me donnera raison ! Beaucoup de mes détracteurs ont eu leur véritable mort : l’oubli.
Comme tout homme d’action, j’ai des choses à me reprocher. J’ai commis naturellement des erreurs d’appréciation, des excès, je n’ai pas toujours su communiquer, j’ai parfois été utopiste. J’ai été, tout simplement, un homme.
Mon porteur de plume s’est transformé lui-même en cherchant volontaire, non d’une seule vérité, mais de compréhension, dans l’époque qui fut la mienne. Il a beaucoup lu, beaucoup étudié, s’étant enquis auprès des spécialistes, il a surtout voulu, très simplement, avec ses mots et le recul de l’histoire, vous faire comprendre comment dans une période d’absolutisme, un homme peut agir en conscience.
Je m’appelle Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, maréchal de France. Je suis surtout connu comme ingénieur militaire, pour mes faits d’armes, que cela soit dans la construction des défenses de notre beau pays ou dans la manière d’emporter un siège.
Mais je suis aussi, et surtout, un homme de mon temps, le temps du Roi Soleil, Louis le Quatorzième, auquel j’ai porté toute ma vie une grande déférence, même si j’ai durement ressenti sa trahison à la fin de ma vie. Mais c’est moins à ce grand roi que je ferai des reproches qu’aux courtisans l’entourant, ces hommes et ces femmes donneurs de conseils qui défendent, en réalité, leurs propres intérêts. Ils n’ont pas vu venir la Révolution de l’esprit qui montait de la bourgeoisie et du peuple. Leurs enfants paieront cette insouciance quelques décennies plus tard. Pourtant, l’exemple de monarchie constitutionnelle des Anglais aurait dû les faire réfléchir.
De mon vivant comme après ma mort, je ne suis pas resté indifférent aux yeux de mes contemporains. Vilipendé par les uns, porté aux nues par les autres, je suis toujours vivant parmi vous. Trois siècles après ma disparition, on m’étudie, on porte des jugements sur mon œuvre – souvent de façon très positive. L’UNESCO a même classé quatorze de mes réalisations au Patrimoine mondial.
Mon porteur de plume a pris soin, pour éviter toute ambiguïté, toute interprétation, d’indiquer en italiques dans le texte, mes paroles, mes écrits, mes réflexions, les textes officiels.
Oui, mes amis, j’ai beaucoup écrit. J’ai laissé à la postérité de nombreux textes que je vous engage à découvrir, par exemple mes Oisivetés ou ma Dîme royale, dont les propositions auraient permis de faire évoluer ce grand pays que j’aimais d’un amour ardent, la France.
Je n’ai pas toujours été écouté. J’ai défendu la liberté de conscience en étant bien seul à m’opposer à ce triste Édit de Fontainebleau qui a bouté hors de France de nombreux adeptes de la Religion réformée. Mon ultime action, celle de la défense de l’égalité de pour tous devant l’impôt, a même hâté, sans doute, mon départ pour l’Orient éternel.
Dans Pensées d’un homme qui n’avait pas grand-chose à faire, j’ai écrit :
« La véritable gloire ne vole pas comme le papillon ;
Elle ne s’acquiert que par des actions réelles et solides. »
Bonne lecture.
La vie de Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban
La France au temps de Vauban
Lorsque Sébastien Le Prestre voit le jour en 1633, la France est gouvernée par Richelieu, Premier ministre de Louis XIII. Partisan d’une autorité royale forte, le cardinal est décidé à réduire la puissance politique des protestants et à contrer l’agitation de la noblesse. Il réduit les droits des parlements et des gouverneurs dans les provinces où il nomme des intendants royaux, véritables représentants du pouvoir central. Sa politique étrangère ambitieuse positionne la France comme l’une des puissances majeures de l’Europe. Amateur de culture, protecteur des arts, il crée l’Académie française, agrandit la Sorbonne et fait bâtir le Palais Cardinal devenu le Palais Royal.
Quand Richelieu meurt en 1642, le jeune Sébastien a neuf ans.
Quelques mois plus tard, à la mort de Louis XIII, la régence échoit à Anne d’Autriche (le dauphin n’a que cinq ans) assistée de Mazarin1, son principal ministre, qui continue la politique ambitieuse de Richelieu et multiplie les victoires militaires : Rocroi, Fribourg, Nördlingen, Lens. Le traité de Westphalie (1648) met fin à la guerre de Trente Ans, donnant l’Alsace à la France. Mais la guerre contraint le roi à lever de nouvelles taxes, provoquant des révoltes et poussant les Grands du royaume à combattre le centralisme royal.
Mazarin est menacé par la Fronde dite parlementaire (1648) qui force la Cour à se réfugier à Saint-Germain, puis par la Fronde des Princes, qui débute en 1650 avec l’arrestation de Condé. Celui-ci s’enfuit et traite avec les Espagnols, provoquant la guerre civile.
Louis XIV, à sa majorité, confie le gouvernement à Mazarin, revenu d’exil, et signe le Traité des Pyrénées (1659) mettant fin à la guerre d’Espagne. Il épouse l’infante Marie-Thérèse d’Autriche.
À la mort de Mazarin, Louis le Grand décide de gouverner seul. Pour l’assister, il nomme Jean-Baptiste Colbert contrôleur général des Finances, pour régenter tout à l’exception des Affaires étrangères et de la Guerre.
À l’intérieur du pays, la stratégie du roi est claire : ayant subi à deux reprises la révolte des nobles, il se les attache par une politique d’appartenance à la Cour et de distribution des faveurs.
À l’extérieur, au-delà du renforcement des frontières du royaume, de la défense du catholicisme et de la lutte contre les ambitions espagnoles, il vise à imposer la prédominance française en Europe. De 1661 à 1715, la France ne connaît que vingt-trois années de paix, pour trente et une années de conflits.
Louis XIV s’appuie sur deux grands chefs de guerre : Turenne jusqu’en 1675, Condé jusqu’en 1686. Grâce à ses ministres de la guerre — d’abord Le Tellier, puis son fils Louvois —, les effectifs militaires passent de soixante-dix mille hommes en 1667 à deux cent mille hommes en 1680. Avec tout ce que cela comporte de constructions de magasins, d’hôpitaux, de forteresses. De l’attaque contre l’Espagne (1665) au traité d’Utrecht (1713), Louis XIV modernise l’armement, invente l’artillerie, crée une marine !
Sébastien Le Prestre de Vauban participe pleinement à toutes les campagnes guerrières du Roi-Soleil, d’abord comme ingénieur, puis comme commissaire général aux fortifications, enfin comme Maréchal de France. En quarante ans, il dirigea avec succès une cinquantaine de sièges, fortifia près de trois cents places, y compris des ports entiers comme Toulon et Dunkerque. On disait alors : « Ville assiégée par Vauban, ville prise. Ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. »
Cette longue période est aussi riche d’avancées culturelles et artistiques. C’est l’époque où le philosophe René Descartes, exilé en Hollande, publie le Discours de la Méthode » (1637), où Mazarin crée l’Académie royale des peintres et sculpteurs (1648), le collège des Quatre-Nations (futur Institut de France) et la bibliothèque qui portera son nom. Le même Mazarin fait brûler les Provinciales de Blaise Pascal (1660). Après lui, Colbert s’illustrera en créant la manufacture royale des Gobelins (1662), l’Académie des Sciences (1666), la Comédie française (1680).
Cette période est aussi celle des comédies de Molière, des contes de Perrault, des fables de La Fontaine, des ballets de Lully… Sans oublier les œuvres de Boileau, La Bruyère, Mme de La Fayette, Fénelon…
En 1682, la Cour s’installe définitivement à Versailles. La monarchie est devenue absolue, la civilisation florissante.
Mais, tout le monde ne profite pas de ces fastes. Il faut financer les guerres et renflouer le trésor royal par tous les moyens : ventes d’office, taxes, emprunts forcés. Dans les campagnes, surtout dans le nord, règne une profonde misère, conséquence de la Fronde, des guerres incessantes et de la crise agricole qui touche le pays. Devant les difficultés financières, à son tour, Colbert prend des mesures impopulaires. Des révoltes sont matées, comme en Bretagne (1675). Deux années de terrible famine déciment la France (1693-1695), faisant dire à Fénelon que « la France n’est plus qu’un grand hôpital désolé. » C’est l’époque où le roi invente la capitation, première tentative d’impôt direct levé pour chacun, tous ordres confondus. Supprimée en 1698, elle est rétablie en 1701.
Vauban est le témoin de ce siècle contrasté. Pendant près de quarante ans, il parcourt la France, constatant la misère du peuple, les excès du clergé, des nobles et des intendants. À la fin de sa vie, il proposa la création d’un impôt pour toutes les classes de la société en remplacement de celui supporté uniquement par le Tiers-État. Sa « dîme royale » sera finalement rejetée, entraînant sa disgrâce.
Il est aussi le témoin des crises religieuses ensanglantant le pays. Le roi possède une foi vive, se sentant responsable devant Dieu, du salut de ses sujets. Il s’engage à peser de plus en plus sur leurs consciences en s’opposant aux dérives catholiques (jansénistes, quiétistes, libertins…), mais surtout, en tentant de persuader les protestants du bien-fondé de la religion catholique, jusqu’à ressusciter le spectre des guerres de religion. Cela l’entraîne à révoquer l’édit de Nantes (1685).
À ce moment de son règne, Louis XIV est au faîte de sa puissance. Ses victoires en Europe ont fait de lui un souverain redouté et respecté. Les protestants sont vaincus : si les camisards se révoltent encore dans les Cévennes, beaucoup d’entre eux abjurent ou émigrent vers la Hollande, l’Angleterre, la Suisse, le Brandebourg.
Dans les rangs proches du pouvoir, Vauban sera l’un des rares catholiques à s’élever contre cette politique, et à crier sa réprobation sur les conditions d’intolérance faites aux protestants. Il proposa au roi un projet facilitant leur retour. Sans succès.
Enfin, ce siècle voit émerger la science moderne, symbolisée par deux institutions prestigieuses : la Royal Society en Angleterre (1660) et l’Académie royale des sciences en France (1666), dont les missions sont d’ordre scientifique, utilitaire et politique. Il est du devoir des académiciens de faire progresser la philosophie de la nature, de développer les mathématiques, d’appliquer les théories scientifiques à des réformes pratiques. Mais aussi, de concourir au bien-être du royaume et de faire prospérer les affaires de l’État.
Vauban et consorts vont contribuer à la gloire de leur monarque.
1 Giulio Mazarini, en français, Jules Mazarin (1602-1661). D’abord fonctionnaire au service du Saint-Siège, il sert comme capitaine dans les armées du pape Urbain VIII, puis diplomate. Envoyé en mission en France en 1630, il se fait apprécier de Richelieu qui se l’attache à partir de 1639 à la mort du père Joseph, comme éminence grise. Deux ans plus tard, il est fait cardinal sans avoir été ordonné prêtre.
1 - Son enfance morvandelle
D’une famille de petite noblesse
Sébastien Le Prestre est né le 1er mai 1633 à Saint-Léger-de-Fouche-ret2, un petit village du Morvan en Bourgogne. Il appartient à une famille de petite noblesse, faisant penser qu’il soit né au château de Ruères situé sur un petit mamelon à l’est du hameau éponyme. De nos jours, il est reconnu que cette naissance eut lieu dans une maison plus modeste située à la sortie du village.
Il est baptisé le 15 mai par le curé du village, le père Orillard, qui fit inscrire sur le registre de la paroisse :
« Le quinzième de may mil six cent trente-trois a esté baptisé Sébastien, fils de Albin Prestre, escuyer, et de damoiselle Edmée Carmignolle. Son parrain, Messire Sébastien Clairin, curé de Cordois. Sa marraine, Judith d’Ham, veuve de Messire Georges Bierry. »
Sa famille est originaire d’Auvergne. Jean, damoiseau de Brezons, son premier ancêtre connu, est qualifié de chevalier dans un écrit datant de 1357. Quatre générations plus tard, ruinée par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans, mais aussi par des luttes sanglantes avec ses voisins Murat et Cardaillac, la famille migre vers le Nivernais. Elle s’installe d’abord à Dun, puis à Bazoches pour y exercer avec succès une carrière d’experts forestiers, organisant le flottage du bois vers Paris par la Cure, l’Yonne et la Seine. Emery Le Prestre, l’arrièregrand-père paternel, acquiert en 1550 le château de Vauban, situé à une lieue de Bazoches. Désormais, la famille portera le nom Le Prestre de Vauban.
Les guerres de religion mettent à mal leur activité, leurs biens sont anéantis vers 1560. L’incendie de leur demeure prive les Le Prestre de Vauban des actes et documents prouvant leur filiation nobiliaire. Celle-ci fut reconstituée plus tard grâce à l’intervention personnelle de Louis XIV. Cette période est difficile dans le Morvan : en 1569, les calvinistes mettent le feu à la basilique Sainte Madeleine de Vézelay, à l’église de Bazoches et au château de Vauban !
Le fils d’Emery, Jacques, écuyer, seigneur de Champignolles (hameau de Vauban), est le maître d’hôtel de l’Amiral de Coligny. A-t-il souscrit, pendant quelque temps, à la religion réformée avant de revenir dans le giron de l’Église romaine ? Faut-il voir, pour le futur maréchal, plus tard, dans ce séjour et cette alliance de son grand-père dans la cité protestante, un germe de sa tolérance naturelle et de sa largeur d’esprit ? Marié avec Charlotte Arnault, fille d’un conseiller à la cour, il n’a pas de descendance. Veuf à cinquante-huit ans, il épouse la grand-mère de Sébastien, Françoise de la Perrière, fille reconnue et non moins légitime du comte de la Perrière, propriétaire de Bazoches. Le Comte de la Perrière étant mort intestat, laissant sa fille Françoise frustrée, du fait de sa naissance, d’une part d’héritage, poussant sa nouvelle famille dans un interminable et ruineux procès. La terre et le château de Bazoches sont finalement acquis par la famille du comte de Melun.
Jacques meurt à quatre-vingt-seize ans, en ayant partagé ses biens, dont quelques revenus de l’héritage de Bazoches, entre ses huit enfants, quatre fils et quatre filles. Paul d’où partit la branche aînée, Urbain ou Albin, le chef de la descendance directe de Sébastien, Gabriel, tué aux armées sous la bannière de Condé, Jacques, le chef de la branche latérale cadette, engagé en 1636 dans le régiment de cavalerie d’Enghien, fait prisonnier à la bataille de Sedan, Jeanne, morte sans postérité, Magdeleine, d’où partit le rameau latéral demeuré sur place, Nicole et Claude dont on perd toute trace.
Sébastien n’a pas connu ce grand-père prolifique, décédé peu après sa naissance, mais il a gardé un vif souvenir de son grand-oncle maternel, Edme, engagé en 1635 comme « gendarme de Monseigneur le Prince Henri II de Bourbon, gouverneur de la Bourgogne » dans une compagnie de cavalerie lourde.
Ses récits de batailles, la mort héroïque de ses deux oncles, marquent le jeune garçon. L’envie de servir, de porter les armes, d’être un héros lui apparaît peu à peu comme la voie évidente de son avenir.
Urbain à son tour, sert dans les troupes du prince de Condé. Il en rapporte quatorze blessures et la ruine de sa famille. Le 3 mars 1630, il épouse « au chastel de Rivières, paroisse de Saint-Léger-de-Foucherets, demoiselle Edmée Carmignolle, fille de Jehan Carmignolle, escuyer, et de Françoise Prévost. »
La pauvreté dans laquelle sa famille vivait l’oblige à vendre sa part d’héritage à son frère aîné Paul. La famille s’installe dans une maison à Rivières (aujourd’hui Ruères), paroisse de Saint-Léger, où les Car-mignolle possèdent des biens. C’est là que naquit le futur maréchal de France. Urbain est un homme discret, peu causant, sa seule passion étant la greffe des arbres fruitiers (une activité digne d’un écuyer depuis Sully). Il introduisit de nouvelles techniques de greffe, laissant à la postérité les fameuses pommes et poires Vauban.
Sébastien, observateur du monde qui l’entoure
Sébastien a longuement écouté ses oncles raconter la difficulté des temps. La guerre fait rage, déchirant l’Europe. Sur la frontière des deux Bourgognes, le duché français et le Comté espagnol, la bataille est rude. Même si le pays de la Montagne noire n’en supporte pas directement les conséquences, le duché est soumis au passage incessant des troupes royales ou des troupes ennemies n’hésitant pas à piller sur leurs passages. En 1636, plus de cent villages sont détruits dans la vallée de la Saône. Comme si la guerre ne suffisait pas, la peste envahit la province et gagne Dijon (1636) puis Avallon (1637).
La ville aura « portes fermées, guichets gardés, pour ne laisser entrer aucun estranger. On dépulsera hors la ville, dans les loges ceux dont la santé serait suspecte. »
Sébastien a cinq ans lorsque naît sa sœur Charlotte, surnommée Charlette. C’est une joie pour lui : même s’il reste le fils unique, il n’est plus le seul enfant de la famille. Il peut partager ses jeux et ses plaisirs.
Vers sept ans, ses parents veulent lui faire acquérir un minimum de connaissances pour tenir son petit rang de noblesse. Ses premiers rudiments de lecture, de latin, d’écriture à la plume d’oie, de calcul lui sont donnés par le curé de Saint-Léger ou de son parrain, le curé de Courdois. Le garçon montre un intérêt certain pour les études, essayant de les partager avec certains de ses compagnons de jeu. En vain !
Ces premières années d’enfance se passent dans l’insouciance, dans l’observation du monde qui l’entoure. Il partage ses jeux et les travaux des champs avec les enfants du village, la plupart fils de paysans. Il parcourt les chemins de ce pays rude et pauvre qu’il décrira dans la Description de l’élection de Vézelay, quelques années plus tard :
« C’est un terroir aréneux et pierreux, en partie couvert de bois, genêts, ronces, fougères et autres méchantes épines, où on ne laboure les terres que six à sept ans l’une ; encore ne rapportent-elles que du seigle, de l’avoine et du blé noir pour environ la moitié de l’année de leurs habitants qui, sans la nourriture du bétail, le flottage et la coupe des bois, auraient beaucoup de peine à subsister. »
« Le pays est partout bosillé, continue-t-il, fort entrecoupé de fontaines, ruisseaux et rivières, mais tous petits, comme étant près de leurs sources. Il y aurait assez de gibier et de venaison si les loups et les renards, dont le pays est plein, ne les diminuaient considérablement, aussi bien que les paysans, qui sont presque tous chasseurs. Les mêmes loups font encore un tort considérable aux bestiaux, dont ils blessent, tuent et mangent une grande quantité tous les ans, sans qu’il ne soit guère possible d’y remédier à cause de la grande étendue des bois dont le pays est presque à demi couvert.
« Le pays est en général mauvais, bien qu’il y ait de toutes choses un peu. L’air y est bon et sain, les eaux partout bonnes à boire. »
Il se montre très critique sur le comportement des paysans :
« Les hommes y viennent grands et assez bien faits, et assez bons hommes de guerre quand ils sont une fois dépaysés. Mais les terres y sont assez mal cultivées, les habitants lâches et paresseux jusqu’à ne pas se donner la peine d’ôter une pierre de leurs héritages, dans lesquels la plupart laissent gagner les ronces et méchants arbustes.
« Ils sont d’ailleurs sans industrie, art ni manufacture aucune, qui puissent remplir les vides de leur vie et gagner quelque chose pour les aider à subsister, ce qui provient apparemment de la mauvaise nourriture qu’ils prennent. Car tout ce qui s’appelle bas peuple ne vit que de pain d’orge et d’avoine mêlés, dont ils n’ôtent pas même le son, ce qui fait qu’il y a tel pain qu’on peut lever par les pailles d’avoine dont il est mêlé. Ils se nourrissent encore de mauvais fruits, la plupart sauvages, et de quelque peu d’herbes potagères de leurs jardins, cuites à l’eau avec un peu d’huile de noix ou de navette. Il n’y a que les plus aisés qui mangent du pain de seigle mélangé d’orge et de froment. »
« … Des bœufs, petits et si faibles qu’on est obligé de tirer les bêtes de labour d’ailleurs, dit-il du bétail, ceux du pays n’ayant pas assez de forces. Les vaches mêmes y sont petites (…) Très peu de chevaux, et ceux qu’on y trouve sont de mauvaise qualité et propres à peu de choses. La brébiale y profite peu parce qu’elle n’est point soignée ni gardée en troupeaux par des bergers intelligents, chacun ayant soin des siennes comme il l’entend (…) Il y a quantité de bourriques, mais pas un seul mulet… »
Le jeune garçon parcourt le pays de long en large, posant des collets, pêchant dans les ruisseaux, attrapant les écrevisses, dénichant les nids, gaulant les noix, observant la nature, écoutant les histoires fantastiques des anciens, observant le travail des « laboureurs, des manants, des artisans qui vivent de la forêt ».
« Contrairement à lui, vêtu sobrement, il les voit « mal vêtus, été comme hiver, de toile à demi pourrie et déchirée, chaussés de sabots dans lesquels ils ont les pieds nus toute l’année. » Il accompagne aussi son père dans ses travaux arboricoles.
Parmi ses compagnons de jeu se trouvent des enfants issus de familles protestantes et des cousins appartenant à la noblesse paysanne. Ces rencontres multiples forgent en lui une prise de conscience intuitive, un état d’esprit d’acceptation des différences, de tolérance qu’il pratiqua dans sa vie. D’un naturel curieux, l’esprit éveillé, il interroge, observe, enregistre. Dans ce milieu austère, il apprend ce qu’est la difficulté, la souffrance, le travail, la rusticité des choses.
Le partage, aussi, quand il y a peu à répartir ? Il en garda toujours une trace profonde qui va, dans un premier temps, décupler et forger son envie de réussir, puis, la réussite venue, va nourrir nombre de ses réflexions.
Le temps des études
Vers dix/onze ans, ses parents l’envoient parfaire son éducation dans une école plus adaptée à sa condition de petit noble. La plus proche de bonne réputation est le collège des Carmes situé à Semur (Semur-en-Auxois), distant de dix lieues.
Autrefois dirigé par des carmes, l’établissement est animé par des laïcs et des prêtres séculiers. Son protecteur est le gouverneur de la ville, Guillaume Le Bourgeois d’Origny, seigneur de Saint Léger, qui loue au roi de France le château et les terres de la seigneurie. Pierre de Fontaine, un cousin de la famille, ancien prieur de Montréal, prieur de Semur, est son chaperon. Avec de tels mentors, Sébastien est reconnu par la noblesse locale.
Il suit une formation normale, faisant comme on le dit à cette époque, « ses humanités. » Il apprend la grammaire, l’étude de la syntaxe, des auteurs antiques tels Cicéron et Virgile. Puis la maîtrise de la discussion académique appelée « dispute », la rhétorique pour développer l’art de la parole, la déclamation, la dissertation.
Il découvre l’art de la mathématique, l’étude de la géométrie et de l’algèbre, le dessin prélude à l’art de tracer des plans. Les livres lui permettent d’approfondir seul ses connaissances, sans l’assistance d’un maître. Il s’intéresse à l’hydraulique, la mécanique, l’art du plan, » arpentage, au toisé, à tout ce qui est pratique… C’est un monde vaste et multiple qui lui ouvre les bras, loin du village confiné de son enfance.
Sébastien apparaît comme un adolescent sérieux, mais comme tous les jeunes de son âge, il sait aussi s’amuser.
Lors de son premier séjour à Paris, accompagné de deux camarades avec lesquels il avait un peu abusé de la chopine, il avise le convoi funéraire d’un riche personnage : « Sautant à califourchon sur le cercueil, raconte-t-il, je me mis à crier : À mon logis, porteurs ! » Cette facétie, précise-t-il, fit rire les suivants du convoi et le curé qui n’y attachèrent aucune importance.
Il participe aux fêtes locales, notamment à la course de la « bague » créée quelques années plus tôt (1639) à Semur. Celle-ci existe toujours de nos jours (fin mai), restant la plus ancienne fête de Bourgogne.
2 Un décret impérial transforma son nom en Saint-Léger-Vauban (Yonne) en 1867.
2 – Son apprentissage militaire (1651-1667)
En 1651, Sébastien a dix-huit ans. De taille moyenne, c’est un garçon robuste, bien charpenté, le visage tanné de ceux ayant l’habitude de l’exercice physique, courant la campagne dans de longues courses à cheval. Son regard clair et perçant illumine un visage souriant. Son avenir est tout tracé. Il sait, depuis qu’il a pris conscience de son appartenance à la petite noblesse, après avoir écouté les histoires de ses oncles et suivi ses études à Semur qu’il fera des armes, son métier.
Nous sommes à l’époque de la Fronde des Princes menée par le prince Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, gouverneur de la Bourgogne. A vingt-et-un ans, alors qu’il n’était encore que duc d’Enghien, il avait remporté à la tête de l’armée de Picardie, l’éclatante victoire de Rocroi (1643) face aux Espagnols bien supérieurs en nombre. Héros de Fribourg, de Nördlingen, il s’était couvert de gloire, lors des succès de Dunkerque et de Lens. Lors de la première guerre de la Fronde opposant la royauté au Parlement de Paris (1640), il avait eu une attitude ambiguë en donnant son soutien d’abord à la Cour, puis en se retournant contre Mazarin. Refusant de prendre la tête des frondeurs, il partit servir la régente Anne d’Autriche et le futur Louis XIV. Hostile à Mazarin, porté à la tête de la révolte de la noblesse s’appuyant sur la province, il est arrêté avec son frère, le prince de Conti et son beau-frère, le duc de Longueville. Condé resta treize mois en captivité à Vincennes. En 1652, il se rallia aux Espagnols avant d’être pardonné par Louis XIV, sept ans plus tard, devenant le commandant des armées françaises.
Durant son emprisonnement, Condé, prince gouverneur de la Bourgogne depuis la mort de son père en 1646, a été remplacé provisoirement par César de Bourbon, duc de Vendôme. Malgré cela, il est venu chercher aide et assistance auprès de la noblesse bourguignonne qui a toujours eu une grande considération pour sa famille.
Au service du Prince de Condé
C’est donc un combattant de la haute noblesse, auréolé de gloire, que Vauban rencontre au château de Vézigneux, chez François-Louis Antoine de Bourbon-Busset. Sébastien veut faire partie de l’armée de Condé, comme l’avaient été ses oncles et son père. Âgé d’une trentaine d’années, le prince le dévisage de cet œil perçant de l’homme cherchant à sonder les intentions de son interlocuteur, ayant l’habitude d’être écouté et entendu. Sébastien est impressionné. Condé lui posa quelques questions, exigeant de lui des réponses rapides. Le garçon bafouille, expliquant « qu’il a une assez bonne teinture des mathématiques et des fortifications et qu’il ne dessine pas mal. » Satisfait, Condé le confie à Charles-Antoine de Coningham, écuyer, seigneur d’Arcenay (un fief voisin de Saint-Léger) pour y faire ses classes comme cadet dans un régiment de cavalerie en formation.
La nouvelle recrue a envie de se battre. Pourtant, ses chefs ne l’envoient pas au combat, le considérant plus utile dans la préparation de la bataille pour établir un siège ou assurer la défense d’une place. C’est donc comme ingénieur volontaire, flanqué d’un maître d’apprentissage qu’il apprend son nouveau métier.
Faisons le point des connaissances de cette époque. Dès le milieu du XVIe siècle, les ingénieurs italiens conçoivent l’idée de protéger les places fortes contre les boulets métalliques très destructifs en les ceinturant de murailles basses comprenant des talus, des fossés et des bastides d’angle. L’un des plus anciens témoignages se trouve à Navarrenx, en Béarn. Ces techniques firent l’objet de travaux théoriques de l’ingénieur Blaise Pagan3 (1604-1665). Dès l’âge de vingt ans, il conçoit des plans de siège.
Devenu maréchal de camp en 1642, il devient aveugle au cours d’un combat. Quittant la carrière militaire, il rédigea plusieurs ouvrages dont Les fortifications du comte de Pagan (1645). Mais, sa science resta théorique, n’ayant pu la mettre en œuvre. C’est alors que Vauban, comme d’autres ingénieurs militaires de son temps, s’en inspire en améliorant les techniques de défense et de siège proposés, appelées poliorcétique.
Revenons à Vauban. Apprécié pour ses capacités d’adaptation, de compréhension et de mise en œuvre, il est affecté, durant l’hiver 16511652, à la place de Clermont-en-Argonne, en Lorraine. Sa principale tâche est d’effectuer des travaux dans cette forteresse ayant subi de nombreux sièges. Dans le Traité de l’attaque des places qu’il rédigera pour le duc de Bourgogne, il écrit : « C’était une grande demi-lune bâtie sur le penchant de la montagne qui couvrait l’unique porte de cette place dont le revêtement était beau et très épais, mais sans contrefort. C’est pourquoi les faces n’étaient point terrassées, mais seulement les flancs d’une épaule à l’autre soutenue par un second reculement formé en portion de cercle. »
Apprenant le décès de son père sur le champ de bataille (1652), il ne semble pas éprouver une grande souffrance, son père n’ayant jamais été très expansif. Le voici désormais à dix-neuf ans, chef de famille, devant assurer l’avenir de sa mère et de sa sœur, aidé par la famille et les nobles locaux qui suppléeront toujours son absence. Il en sera toujours comptable.
En novembre 1652, il prend une part active au siège de Sainte-Menehould4. C’est sa première bataille. Il s’y distingue par une action d’éclat en passant l’Aisne à la nage sous le feu de l’ennemi. L’année suivante, après avoir brillamment servi et reçu sa première blessure, il tombe dans une embuscade de l’armée royale avec trois camarades. Il est fait prisonnier.
Camille Rousset5 rend compte de cet incident, qui démontre l’exceptionnelle énergie du jeune homme :