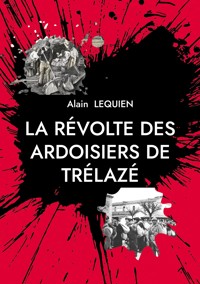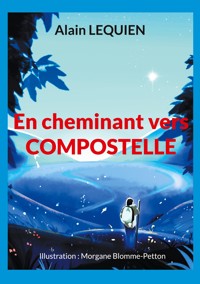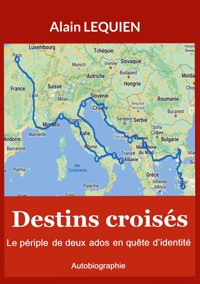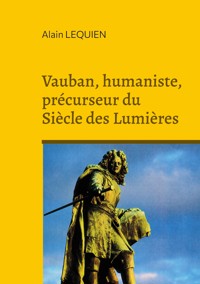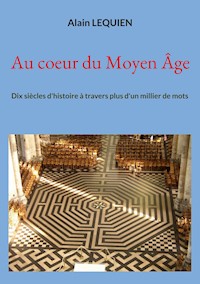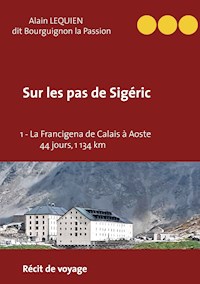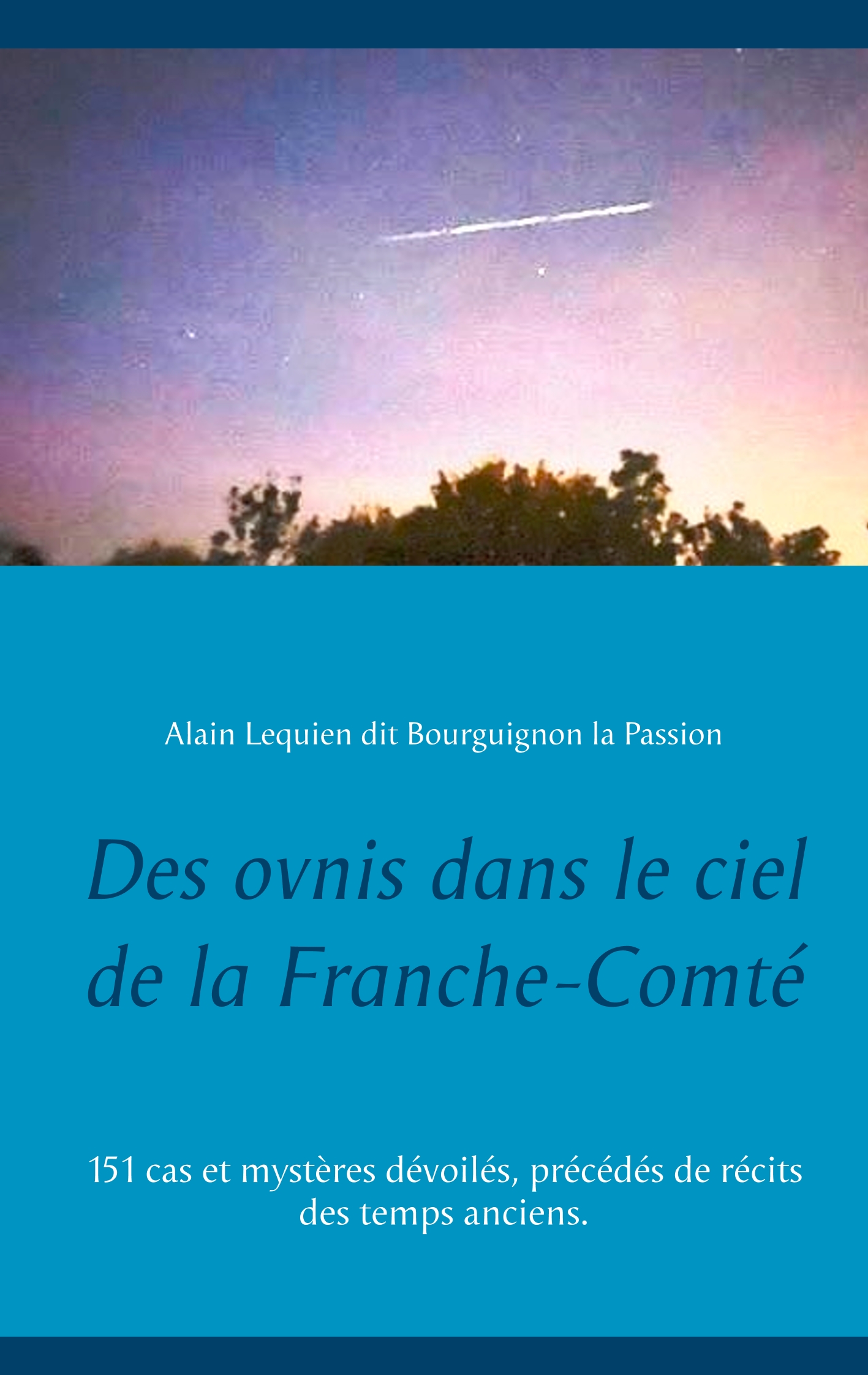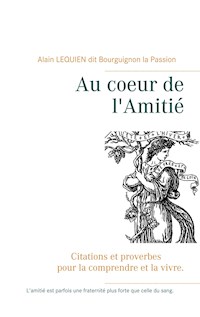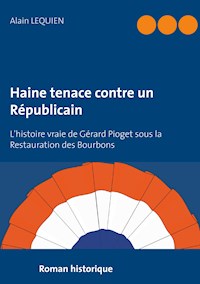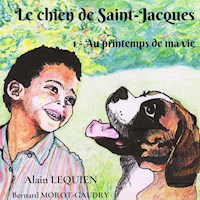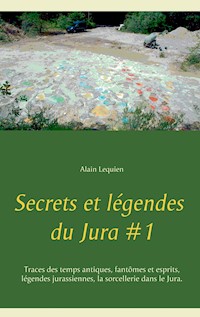Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Grande cuisinière, Da ti Clé, notre aïeule, nous a confié au fil du temps ses principales recettes traditionnelles. Après les avoir dégustées, pendant de nombreuses années, nous les avons collectées pour les transmettre à notre famille élargie. Ce sont des recettes simples, issues de la cuisine familiale basées sur les ingrédients disponibles. A vous de les adapter dans cet état d'esprit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
L’HISTOIRE DE LA MARTINIQUE
QUELQUES MENUS TYPIQUES
LES BOISSONS
Le rhum et ses préparations
Punch blanc
Punch vieux
Punch au lait
Cocktail à la noix de coco
Cocktail de la Reine
Shrob
Liqueur de coco
Anis coq
Absinthe amère
Quelques boissons rafraîchissantes
Orangeade ou citronnade
Planteur
Jus de corossol
Jus de goyave
Cidre martiniquais
Le mabi
Le madou
LES ENTRÉES
Les Acras (ou Acrats)
Acras de morue (ou de lieu ou de colin)
Acras de cribiches (crevettes d’eau douce)
Acras de titiris (alevins)
Acras de carottes
Acras de chou des Caraïbes
Acras d’aubergine
Les soupes
Soupe z’habitants
Soupe de fruit à pain au lard
Soupe de giraumon (potiron)
Soupe grasse
Soupe maigre
Soupe de poireaux à l’igname
Soupe de pied de porc ou de bœuf
Soupe calalou (version végétarienne)
Soupe de poisson
Soupe à la chair de cribiches
Pâté en pot
LES LÉGUMES
Aubergine en beignet
Aubergine à la tomate
Le féroce d’avocat
Bananes plantains frites à la poêle
Bananes plantains bouillies
Christophines ou chayottes au gratin
Massissis ou concombres en daube
Massissis ou concombres en salade
Les croquettes de fruit à pain
Fruit à pain au four
Fruit à pain à la béchamel pour la morue
Fruit à pain aux lardons
Gombos à la vinaigrette
Gombos sautés à l’antillaise.
Gratin de patate douce
Patates douces à l’eau
Riz à la créole
Riz au hareng saur
Gratin de giraumon (giromon)
Les haricots rouges
LES VIANDES
Pâté chaud à la viande de porc
Beefsteak ou côtelette de porc à la créole
Boudin à la créole
Poulet au Kary
Porc au Kary ou Chèlou
Fricassée de poulet
LES PRODUITS DE LA MER
Poisson au court-bouillon
Blaff de poissons
Poisson au bleu
Poisson en friture
Poisson en daube
Poisson mariné
Poisson grillé
Poisson farci
Dessalage de la morue
Morue frite
Morue grillée
Morue en court-bouillon
Morue au gratin
Morue en macadam
Morue en salade
Ragoût de chatrous (poulpe)
Ragoût de lambi (conque)
Lambi grillé
Oursins (chadrons) en blaff
Matoutou de crabes
Fricassée de crabes
Colombo de crabes
Crabe farci
Crabe à la sauce piquante
Omelette au crabe
Œufs farcis au crabe
LES DESSERTS
Confiture de coco
Tablettes et boules de coco
Pâté de coco
Lotchios Capresses
Blanc-manger au coco (recette traditionnelle)
Gâteau de maïs
Gâteau de patate douce
Pain d’épice créole
Pudding de fruit de pain
Les fruits et leurs préparations
Abricot
Ananas
Banane
Barbadine
Corossol
Goyave
Mangue, mangot, mangotine
Orange
Papaye
Pomme d’acajou ou pomme cajou
Pomme cannelle
Prune de Cythère
Sapotille
Tamarin
Graines bois
Beignets de banane
Daube de banane
Sorbet au coco
Sorbet au chocolat
Glace à la goyave
Glace au corossol
Omelette martiniquaise
Ouvrages disponibles Alain LEQUIEN
L’HISTOIRE DE LA MARTINIQUE
La période indienne (Arawaks, Caraïbes)
Entre Amérique du Nord et celle du Sud, en pleine zone tropicale, se situe la Madinina, l’île aux fleurs. Partie centrale de l’archipel des Antilles, une chaine montagneuse récente sujette aux phénomènes sismiques et volcaniques, sa superficie est de 1 100 km2. Sa plaine se situe en son centre.
Les premières traces humaines connues datent de deux millénaires avant J.-C. Ces visiteurs étaient des nomades.
Le premier peuplement fut celui des Arawaks, une tribu venue du bassin de l'Orénoque, l'actuel Venezuela, un siècle avant notre ère. Chassés de leur pays, ils trouvèrent refuge dans l’île quasiment vierge. Peuple pacifique d’agriculteurs, les Arawaks réussirent à sauvegarder leur terre durant dix siècles face aux tentatives d’invasion.
Entre le 8e et le 10e siècle, les Caraïbes d’origine amazonienne conquirent les terres de l'archipel, s’installant plus tard dans la future Martinique. Ils anéantirent les Arawaks en mangeant les hommes et en conservant les femmes pour leur plaisir et leur service. Installés sur les zones côtières, ils vivaient des produits de la mer (poissons, crustacés, tortues et lamantins), d'agriculture et de chasse.
La période espagnole
Le danger imprévisible vint de l’au-delà des mers, des Européens.
Au cours de son quatrième voyage, Christophe Colomb accosta dans l’île le 15 juin 1502. Il débarqua sur une plage de l’actuelle commune du Carbet, comme le rappelle une plaque commémorative sur les lieux. Il aurait alors déclaré :
« C'est la meilleure, la plus fertile, la plus douce, la plus égale, la plus charmante contrée qu'il y ait au monde. C'est la plus belle chose que j'ai vue, aussi ne puis-je fatiguer mes yeux à contempler une telle verdure ».
Un bien bel hommage à notre île paradisiaque d’alors. Il la baptisa et rembarqua sans laisser d’hommes sur place.
Cependant, sa visite n’eut pas de suite. Les Espagnols jugèrent que les petites îles des Antilles n’étaient pas suffisamment riches, si bien qu’ils la délaissèrent pendant un siècle.
La fin de la culture caraïbe
Vers 1618, des Français, équipiers du capitaine Fleury, font naufrage près de la Martinique. Ils trouvent refuge sur l'île et y vivent pendant près d'un an, parmi les Caraïbes. À leur retour, ils en parlent avec enthousiasme, suscitant l'intérêt.
En bon visionnaire et stratège, le cardinal de Richelieu, au nom de Louis XIII, créa la Compagnie des Isles d’Amérique (1635-1650) pour coloniser ces îles laissées à l’abandon.
La conquête débuta le 1er septembre 1635 avec l'arrivée du flibustier Pierre Belain d’Esnambuc, un aventurier normand. Avec une centaine de compagnons, il fit construire à la hâte le Fort Saint-Pierre au nord de l’île, aujourd’hui Saint-Pierre. Il en fit la capitale d’une terre française administrée et exploitée par une compagnie à vocation commerciale. Pierre Belain mourut l’année suivante. Il fut remplacé par son neveu et héritier, Jacques du Parquet comme Lieutenant général de la Martinique.
Durant cette période, si les Français avaient été bien accueillis avec un certain amusement par la population locale (c’étaient des va-nu-pieds parfois contraints de manger leurs bottes tout en étant dévorés par les moustiques), les Caraïbes comprirent que les nouveaux venus avaient l’intention de les déposséder voire de les exterminer.
Ils opposèrent une forte résistance, mais, que peuvent faire des flèches empoisonnées face aux bâtons de feu ?
Ce fut un génocide de part et d’autre. Les Indiens survivants durent s’enfuirent vers d’autres îles, d’autres se plièrent aux vainqueurs et devinrent esclaves de fait. La civilisation caraïbe en tant que telle prit fin à la Martinique.
Durant toute sa vie, jusqu’à son lit de mort en 1643, Louis XIII, roi très croyant, se montra opposé à l’esclavage malgré la pression de ses confesseurs. Il ne consentit jamais à légaliser la traite négrière.
Le début de l’esclavage aux Antilles
Avec l’arrivée au pouvoir de Louis XIV, la situation évolue.
En 1650, après la faillite de la compagnie des Isles d’Amérique, Du Parquet racheta pour 41 500 livres la Martinique, Sainte Lucie, la Grenade et les Grenadines.
En 1654, sous la pression des Jésuites, le nouvel homme fort refusa d’accueillir 1 200 juifs hollandais chassés du Brésil qui trouvèrent asile en Guadeloupe. Apprenant leur expertise dans l’industrie sucrière, il se ravisa et accueillit 300 d’entre eux. Ils furent à l’émergence de la production de la canne à sucre et du rhum en Martinique.
Attirés par la possibilité d’enrichissement, les colons affluèrent de France et d’ailleurs. On y trouvait aussi bien des nobles fuyant une lettre de cachet que des aventuriers recrutés dans les cabarets contre promesse d’un lopin de terre. L’engagement était de trente-six mois, mais la plupart d’entre eux prirent souche dans l’île.
Voyant la richesse que l’on pouvait en tirer, et voulant maitriser le territoire, Louis XIV racheta les droits de propriété des descendants de Du Parquet. Il plaça les îles sous la tutelle de la Compagnie des Indes occidentales, puis préféra les rattacher au Domaine royal en 1674.
Les productions initiales de coton et de tabac étant en déclin, dès 1671, il poussa celle de la canne à sucre qui va prendre un grand essor malgré le départ des Hollandais après la révocation de l’Édit de Nantes (1685). Cela nécessite une main-d’œuvre nombreuse. Le peu d’Indiens caraïbes restant dans l’île n’y suffit pas.
L’Église catholique ayant déclaré « que les nègres n’avaient pas d’âme », c’est donc vers l’Afrique que, sans se poser de problème de conscience, les négriers allèrent les chercher.
Ce commerce existait déjà depuis 1650. Il va s’intensifier à partir de Nantes, Bordeaux, La Rochelle… À Nantes1, la traite négrière fut le principal commerce de la cité. Les négociants partant des quais de Loire transportèrent à la Martinique et à Saint-Domingue près de dix mille esclaves sur une quarantaine de bâtiments officiels.
Ce commerce prit la forme d’un commerce triangulaire dénommé circuiteux.
Pour acheter des esclaves sur les côtes africaines, les négriers emportaient des fusils venant de Flandre, des tapis, des moquettes, des coraux, des couteaux et étoffes grossières… Ils échangeaient ces marchandises contre des esclaves.